La Société des Amis de Panckoucke a entrepris d'élaborer, progressivement, un dictionnaire des femmes et des hommes de presse des Hauts-de-France, de 1746 à la fin du XXe siècle, un dictionnaire de celles et ceux qui, en leur temps, ont fait la presse régionale qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire…, politique, culturelle, sportive… Seules conditions pour y figurer : être né ou mort dans l'un des départements de la région, y avoir, à un moment ou à un autre, fait une partie de sa carrière.
Ce projet ambitieux demande la mobilisation de nombreux participants, il se veut donc collaboratif. Point n'est besoin d'être adhérent à la Société des Amis de Panckoucke pour y participer. Historien, lecteur de journaux ou simple curieux, vous avez déjà rencontré, lors de vos recherches ou de vos lectures, des publicistes, des journalistes, des imprimeurs, ou, pourquoi pas, des crieuses et crieurs de journaux dont vous pensez qu'ils mériteraient de figurer dans un tel dictionnaire. Pour que ces renseignements ne se perdent pas, constituent une base de données utiles à d'autres recherches, la Société des Amis de Panckoucke vous convie donc à participer à ce travail de longue haleine.
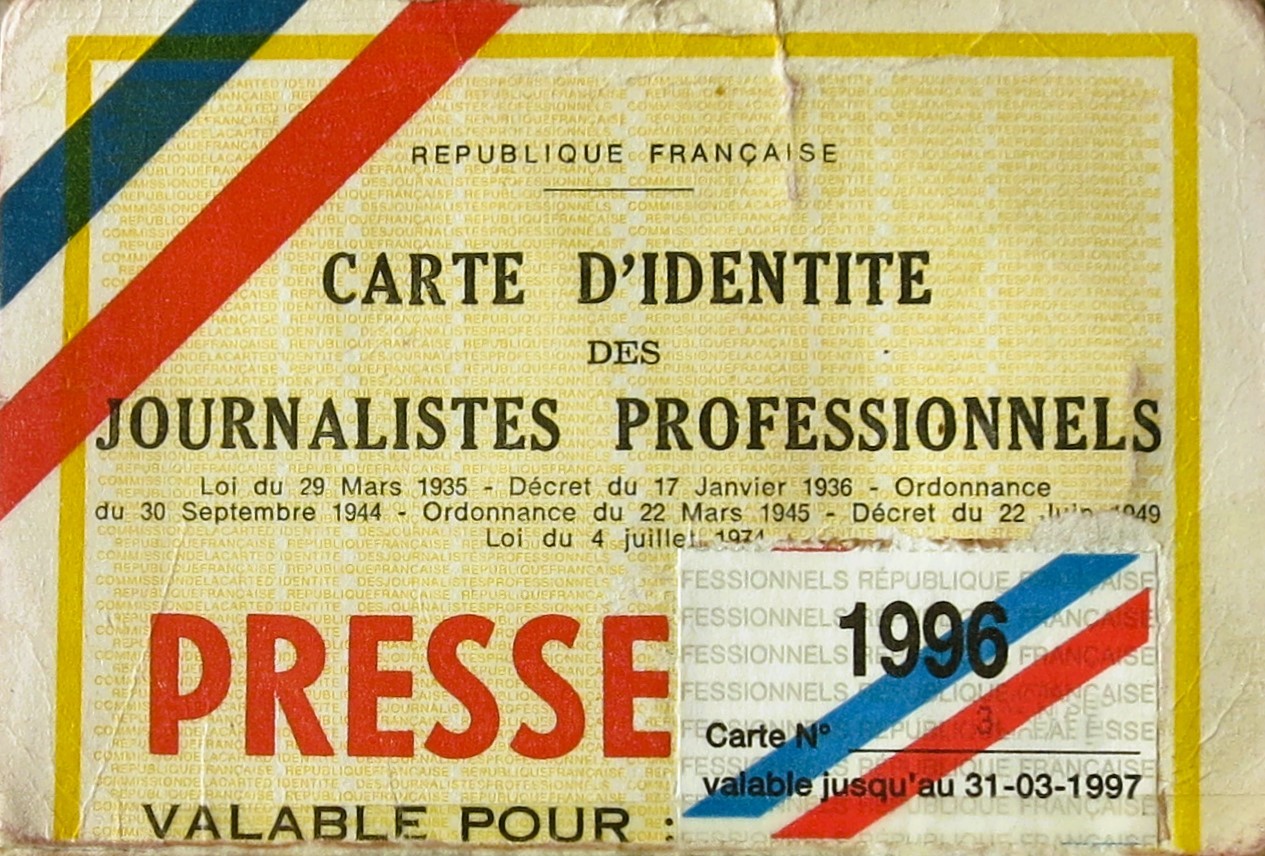
Les contributeurs
Ont collaboré au dictionnaire des journalistes et hommes de presse du Nord-Pas-de-Calais :
Dominique Adam (†), Marie-Christine Allart, Jérôme Delavenne, Pierre-Jean Desreumaux(†), Marc Dubois, Bernard Grelle, Émile Henry, Maurice Leclercq, Jean-Pascal Vanhove, Marie Oudart (†), Evelyne Visse, Jean-Paul Visse, Philippe Waret.
A
-
ADAM (veuve)
Mme veuve Adam prend, en 1859, la succession de son mari à la tête de l’imprimerie Adam. En 1860, une société en commandite entre elle et ses deux fils, Paul et Jules, est créée pour l’exploitation de L’Indépendant dont la moitié lui appartient. En 1862, elle lance un journal d’annonces, les Petites Affiches du Nord et du Pas-de-Calais dont son fils Paul devient propriétaire en 1864.
Source(s) :AD Nord.
-
ADAM Charles
Charles Adam est rédacteur en chef et gérant duPetit Calaisien en 1888.
Source(s) :Le Petit Calaisien, 1888.
-
ADAM D’AUBERS
Fils d’un cultivateur-propriétaire d’Aubers Pierre Joseph Adam, Louis Vincent Auguste Adam prend à l’âge de 28 ans la succession de son beau-frère Bernard Alexis Aimé Joseph Wagrez, dit Wagrez l’aîné. Il est nommé imprimeur le 9 juillet 1836 et prend le nom d’Adam d’Aubers, pour éviter la confusion avec un autre imprimeur. De ses presses sort Le Mémorial de la Scarpe dont il est cofondateur et copropriétaire avec Duthilloeul. Ce journal change de titre le 15 mars 1848 et devient L’Indépendant . En 1838 Adam d’Aubers publie L’ouvrier dirigé par l’inspecteur d’Académie Hannequin.
Il meurt en septembre 1859, laissant une veuve Marie Anne Elise, qui prend sa succession, et deux enfants, Paul et Jules.
Source(s) :AN F/18/2018; AD Nord, 5 Mi 020 R 053; J.-P. Visse, La Presse douaisienne, Ibid.
-
ADAM Dominique
« Un sourire en coin, des yeux pétillants de malice, puis un grand rire qui emporte tout », écrit La Voix du Nord au lendemain de la mort de Dominique Adam. Tous ceux qui l’ont côtoyé gardent en effet le souvenir de « son indomptable joie de vivre », lui que les ennuis de santé n’avaient pas épargné. Né à Châlons-en-Champagne, Dominique Adam avait commencé sa carrière de journaliste en 1966 à La Dépêche de l’Aisne. Entré à La Voix du Nord trois ans plus tard, il y inaugure le bureau d’Hirson dans l’Aisne. En 1977, il est nommé chef adjoint de la rédaction de Maubeuge, puis en devient chef. En 1990, changement de cap, il arrive au siège du journal où il a été promu délégué de la direction chargé de la zone sud du Nord (Avesnois, Hainaut et Cambrésis). Il devient ensuite chargé de mission auprès du rédacteur en chef et quitte le journal en 2000. Dominique Adam qui a formé de nombreux jeunes journalistes qui, par la suite, accédèrent à des postes de responsabilité au sein de La Voix du Nord, a été également président de l’Association de défense de la qualité de la vie dans sa ville et membre de la chorale.
Source(s) :La Voix du Nord, 9 janvier 2016, édition de Lille.
-
ADAM Jules
Fils de Vincent Louis Adam, imprimeur, Jules Adam est, en 1859, à la mort de son père, propriétaire d’un quart des parts de la société en nom collectif et en commandite, créée pour l’exploitation du journal L’Indépendant édité à Douai. Lors de son mariage en 1860 avec Marie Langlois, âgée de 15 ans, il se déclare rentier. Il meurt à Paris le 22 décembre 1916.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 020 R 055, Arch. Paris, 16 D 10; J.-P. Visse, La Presse douaisienne, 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017.
-
ADAM Paul
Fils aîné de Vincent Louis Adam, dit Adam d’Aubers, Paul Vincent Adam est né le 2 octobre 1837 à Douai. Il est déclaré en présence de son grand-père Joseph Adam et de son oncle Hippolyte Romain Joseph Duthillœul, juge de paix. Bachelier ès lettres, il devient rédacteur au journal L’Indépendant en 1856. Après la mort de son père le 16 septembre 1859, il possède un quart de la Société en commandite créée pour l’exploitation du journal qu’il dirige ainsi que l’imprimerie. En 1864, à la suite de la retraite de sa mère, il obtient son brevet de libraire, lithographe, imprimeur. A cette occasion, sa mère écrit au ministre de l’Intérieur le 14 mai 1864 : « L’attachement de mon fils à la patrie et au souverain sont garantis par les précédents qu’ont su lui établir sa rédaction depuis 1856 et sa gérance depuis 1859 au journal L’Indépendant. » De son côté, le préfet du Nord note le 3 juin de la même année : « Le sieur Adam est le gérant d’un journal L’Indépendant qui porte à l’administration en toute circonstance un concours utile et dévoué. C’est un homme honorable jouissant de la considération publique et présentant à tous points de vue, les garanties désirables. » Malgré cet avis favorable du préfet, Paul Adam se voit refuser un brevet d’imprimeur en lettres pour Carvin en septembre 1864. En avril 1866, il revend sa société à Alphonse Casimir Laigle et Oscar Duthillœul. Il semble quitter le monde de l’imprimerie et Douai pour Paris où, rentier, il se marie le 18 octobre 1891 avec Catherine Pauline Bourgoin, elle-même rentière. Quelques mois après le décès de sa femme, il se remarie le 25 septembre 1899 à Courbevoie avec Caroline Amélie Vaudez, elle-même veuve.
Source(s) :AN F/18/2018, AD Nord, 5 Mi 020 R 053; J.-P. Visse, La Presse douaisienne, Ibid.
-
ADAM Vincent
-
ADRIENSENCE Elise
Cf. Bayot Elise
-
ADRIENSENCE Floribert
Né à Lecelles, Floribert Adriensence s’installe comme imprimeur-libraire, rue de Mons à Maubeuge. En 1871, il fonde la Feuille d’annonces du canton de Maubeuge qui devient successivement La Feuille d’annonces de Maubeuge , puis La Frontière. Il meurt le 17 janvier 1878 à l’âge de 39 ans. Sa femme, née Elise Bayot, prend sa succession.
Source(s) :AD Nord 1 Mi EC 392 R005.
-
ADRIENSENCE Gaston
Fils de Floribert Adriensence, Gaston Régnier Auguste Adriensence n’a pas encore 10 ans lorsqu’il perd son père. A 18 ans, après ses études au collège de Maubeuge puis au lycée de Valenciennes, il est engagé conditionnel. Il est incorporé au 128e RI à Sedan où il passe successivement caporal en mai 1887 et sergent en novembre de la même année au moment de « passer dans la disponibilité de l’année active ». A 20 ans, il est promu sous-lieutenant de réserve. Revenu à la vie civile, il se forme, pendant deux ans, au métier d’imprimeur chez Robbe à Lille, puis il rejoint l’entreprise familiale gérée depuis 1882 par son beau-père Ernest De Cagny. Quelques années plus tard, il lui succède comme directeur et rédacteur en chef de La Frontière, « principal et l’on pourrait dire unique rédacteur » selon le sous-préfet qui lui reconnaît « un certain talent » .Très actif, Gaston Adriensence n’hésite pas à engager des polémiques avec ses confrères pour défendre ses idées.
Attentif aux autres, il fait partie des fondateurs de l’Association professionnelle des journalistes du Nord. En 1914, dès les premiers mois de la guerre, il crée l’office des prisonniers de Maubeuge. En novembre 1919, il se présente aux élections législatives comme candidat de la Fédération républicaine du Nord (tête de liste Louis Loucheur)
Terrassé par la maladie, il meurt le 9 avril 1920. Sa femme Eugénie Augustine Foulon prend sa succession à la tête de La Frontière.
Source(s) :AD Nord, 1 R 2178, 3 E 10174, 1T 222/24, La Frontière, 10 avril 1920.
-
AFCHAIN Paul
Ouvrier tisseur, Paul Afchain est licencié en raison de ses activités politiques et syndicales et devient employé à la mairie de Caudry. Membre du parti socialiste dès 1905, il fonde avec Auguste Beauvillain, conseiller municipal de Caudry à partir de 1908, l’hebdomadaire L’Action du Cambrésis et de l’Arrondissement de d’Avesnes dont il est gérant et rédacteur. Paul Afchain est secrétaire du syndicat des employés et ouvriers municipaux et responsable de l’Union locale CGT de Caudry. Durant l’entre-deux-guerres , il est secrétaire de la section locale de la SFIO et membre de la Commission administrative fédérale.
Source(s) :ADN M 149/142.
-
ALBERTIER
Albertier est rédacteur au Réformiste de Douai. En 1852, il est condamné, solidairement avec Pierre Lacquement, gérant, à 50 F d’amende pour diffamation envers le maire et le garde champêtre de Waziers.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/7.
-
ALLE Pierre
Pierre Allé est rédacteur au Grand Echo du Nord en 1928 et 1929. Il quitte la presse régionale pour la presse parisienne où il est successivement journaliste au quotidien de François Coty, L’Ami du peuple , puis au Figaro.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
ALLECJournaliste
Allec est rédacteur à L’Echo du Nord en 1845.
Source(s) :BM de Lille, fonds Humbert.
-
ALLEGRE Robert
La guerre a probablement changé le destin de Robert Edmond Maurice Allègre, fils de Louis Léonce Allègre, notaire, et de Marie Jeanne Louise Longhaye. Né à Lille le 8 avril 1884, il entre à l’école militaire de Saint-Cyr le 29 octobre 1903 et en sort en 1905 comme sous-lieutenant affecté dans l’infanterie coloniale. Nommé lieutenant en 1907, il séjourne au Tonkin jusqu’en mai 1910. Par la suite, il est affecté au Tchad jusqu’en avril 1913. Il se trouve au Gabon lors de la déclaration de guerre. En septembre 1914, il participe à la conquête du Cameroun et est promu capitaine en 1915. L’année suivante, il est grièvement blessé et doit être amputé. Durant cette période, il est cité deux fois à l’ordre de l’Armée et deux fois à l’ordre du régiment. Sa conduite lui vaut d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur, et par la suite de recevoir la croix du combattant et la médaille coloniale.
Cependant Robert Allègre doit quitter l’armée. Le 17 mai 1917, à Paris, il épouse Anne-Marie Langlais, veuve du vicomte Jean Carrelet, mort le 24 octobre 1914 à Dixmude, et fille d’Henri Langlais, directeur du quotidien lillois La Dépêche . Après l’armistice, il se tourne vers le journalisme. Il prend la direction de la rédaction du Nouvelliste , édition du soir de La Dépêche . Parallèlement, il crée et rédige dans ce dernier quotidien une page coloniale hebdomadaire qui obtient en 1929 la grande médaille de vermeil de la propagande coloniale. En septembre 1932, il est promu officier de la Légion d’honneur. Par la suite, Robert Allègre est nommé codirecteur avec son beau-père à qui il succède à la tête de La Dépêche lors de sa mort en juin 1938. La Dépêche disparaît en mai 1940. Installé à Paris durant l’Occupation, il devient chef de service à la répartition du papier. A partir de 1945, il dirige une imprimerie. Le 12 mai 1947, il est élevé au grade de commandeur de la Légion d’honneur.
Président de l’Association professionnelle des journalistes du Nord à partir de 1938, Allègre était président du Groupement des amputés de guerre du Nord et du Pas-de-Calais.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 350 R039, M 127/7, dossier Allègre du 9 septembre 1932, M 149/142, dernier trimestre 1937; Site Léonore, dossier de légionnaire; Journal des Débats, 27 mai 1917.
-
AMIGUES Jules
Né en 1829 à Perpignan, Jules Amigues commence sa carrière dans la presse comme correspondant du Temps en Italie, puis il entre en 1864 au Moniteur universel pour lequel il est en poste à Florence, il collabore également à d’autres quotidiens. Fidèle à la cause bonapartiste, il est, en 1871, l’une des figures de proue de l’Union du Commerce et de l’Industrie qui tenta d’arriver à un compromis entre Versailles et Paris afin d’arrêter la guerre civile pendant la Commune. En janvier 1873, il participe aux obsèques de Napoléon III à Chislehurst en Angleterre. Il fait également partie de la délégation chargée de reconnaître à l’académie royale de Woolwich en Angleterre le corps du prince impérial, Louis-Napoléon, tué le 1er juin 1879 par les zoulous en Afrique du sud. Poursuivant sa carrière de journaliste, Amigues est notamment chroniqueur au Moniteur universel, directeur de L’Espérance nationale, rédacteur en chef de L’Ordre. Il collabore au Figaro et au Petit Caporal. En septembre 1877, il fonde, à Cambrai, L’Aigle du Nord. Journal de la démocratie impériale, en vue des élections législatives du 14 octobre où il est élu député de la 2e circonscription, battant le député sortant Bertrand-Milcent. Invalidé l’année suivante, il ne réussit pas à se faire réélire face à son ancien adversaire. Il est à nouveau battu en 1879, à la mort de Bertrand-Milcent, et lors des élections générales de 1881 remportées par Cirier.
Auteur de nombreux romans et contes, Jules Amigues meurt à Paris le 29 avril 1883.Source(s) :Base de données des députés français depuis la Révolution.
-
ANDRE Arthur
Fils d’Etienne Bertrand André, fileur de coton, et d’Emilie Langnelin, Arthur André est d’abord compositeur typographe de La Gazette de Douai. Il est ensuite reporter au journal L’Echo douaisien et correspondant du quotidien conservateur lillois La Dépêche du Nord.
La police le présente comme « très roublard », mais aussi « un collaborateur précieux et dévoué pour les journaux qui l’occupent ». Elle ajoute : « Il se conduit bien et n’a pour vivre que le produit de son travail. »
Marié, père d’un garçon, il meurt à l’âge de 48 ans le 30 janvier 1903.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 020 R 059 et 1T 222/8.
-
ANGLEBERT (d’) Clément
Docteur en droit, Clément d’Anglebert est propriétaire du Messager du Nord, journal monarchiste et catholique, édité à Dunkerque à partir de février 1868. Celui-ci prend la périodicité quotidienne à partir de 1872, puis, en décembre 1873, son propriétaire lui donne le nom de Journal de Dunkerque et du Nord de la France, politique, commercial et d’annonces. Selon Emile Bouchet, « ses connaissances variées, la solidité de ses articles, la courtoisie de sa polémique lui acquirent une influence personnelle qui lui valut, un instant, une place au conseil municipal ; mais on peut dire qu’il ne tira pas de sa situation tout le parti qu’il eut pu en obtenir, dans l’intérêt même du journal. Fatigué et malade, il ne prêta pas toujours aux questions purement locales, toute l’attention qu’elles méritaient, surtout dans un port, dont l’importance commerciale et maritime commençaient à prendre un grand développement. Les questions générales et d’économie politique le séduisaient davantage, il les possédait bien, il les trouvait plus faciles à traiter, et le pouvait faire aisément du fauteuil où la souffrance l’immobilisa longtemps. » Le Journal de Dunkerque et du Nord de la France, paraît jusqu’au 31 décembre 1881.
Source(s) :Emile Bouchet, «La Presse dunkerquoise», Bulletin de l’Union faulconnier, 1899., J.-P. V.
-
ANNEQUIN Paul
Né en Isère en 1855, Paul Joseph Annequin accomplit une grande partie de sa carrière professionnelle à Lille. En 1885, il est nommé rédacteur en chef du nouveau quotidien républicain, Le Réveil de l’Ain édité à Bourg-en-Bresse. En 1906, il arrive dans le Nord où il est secrétaire de rédaction au Réveil du Nord . Il quitte le quotidien socialiste lillois pour la presse parisienne. Après la Première Guerre, il revient au Réveil du Nord où il est secrétaire de rédaction aux informations générales. A partir de décembre 1921, il tient dans Le Réveil illustré la “Chronique gastronomique” qui devient en 1924 “La cuisine familiale” plus adaptée au lectorat ouvrier du quotidien. Hospitalisé à l’hôpital Saint-Sauveur à Lille pour y subir une opération, il meurt le 6 février 1928 à l’âge de 73 ans.
Source(s) :AD Nord, 3 E 15456; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, 7 février 1928.
-
ANSART Gustave
Né dans une famille ouvrière du quartier du Pile à Roubaix, Gustave Ansart est d’abord métallurgiste. Réfractaire au S.T.O., il entre au P.C.F. en 1944 et il est élu au conseil municipal de Roubaix en 1947. Il est nommé secrétaire de l’Union syndicale des métallurgistes du Nord, et, parallèlement, il monte dans l’appareil du parti : secrétaire de la Fédération du Nord en 1955, du Comité central en 1956. De 1956 à 1958, il est député de Roubaix. En 1973 il est élu député de Denain où il sera réélu sans interruption jusqu’à sa mort.
Grâce aux stages syndicaux, aux écoles du parti, l’ancien métallo se cultive. Il prend la direction du quotidien régional communiste Liberté en 1958, qu’il garde jusqu’en 1982. Il défend âprement son journal, refusant qu’on « mise tout sur L’Humanité ». Veillant aussi bien au contenu qu’à la vente du journal, il est à l’origine des comités de diffusion de Liberté, qui « ont permis au journal de survivre dix ans de plus » selon René Gabrelle, ancien journaliste au quotidien communiste.
Source(s) :«Hommage : Il y a 20 ans, Gustave Ansart», Lille, Liberté hebdo, Arras, Liberté 62, 2010, 12 p.
-
ANSELIN Rémy
Pseudonyme de Joseph Dessaint.
-
ANTHYME Lucien
Né dans une famille d’agriculteurs du Pas-de-Calais, Lucien Anthyme conserva des attaches avec le monde de la terre durant toute sa carrière. Il sort de l’Ecole nationale de Grigon, en 1942, avec le titre d’ingénieur, et poursuit ses études à l’Institut national d’agronomie.
Réfractaire au STO pendant la guerre, il entre à la direction des services agricoles du Pas-de-Calais à la Libération avant de rejoindre le service économique de La Voix du Nord le 15 mai 1946. Ses compétences en matière agronomique y font merveille et en mars 1963, le ministre de l’Agriculture, Edgard Pisani le fait chevalier du mérite agricole. En 1976, il est promu officier. Chef du service économique, Lucien Anthyme, grand journaliste et homme de cœur, a formé de nombreux jeunes confrères qui s’exprimeront tant à La Voix du Nord que dans d’autres médias. Il prend sa retraite en 1984.
Source(s) :La Voix du Nord juin 1986.
-
ARDOUIN Victor-Eugène, dit Ardouin-Dumazet
Fils de Pierre Ardouin, ouvrier imprimeur sur indiennes, et d’Adelle Hammer, Victor-Eugène Ardouin, né le 12 janvier 1852, n’a qu’une instruction primaire qu’il complète par des cours du soir alors qu’il est employé de bureau dans une fabrique d’extrait de châtaignier à Lyon. Lors de la guerre de 1870, il s’engage comme volontaire. De retour à la vie civile, il s’engage une nouvelle fois et se retrouve en Algérie pour cinq ans. A Tlemcen, il participe à la formation d’une société de géographie et donne un cours régulier.
A son retour en France, il est clerc de notaire à Saint-Symphorien-d’Ozon tout en donnant un article hebdomadaire au Courrier de Tlemcen et des chroniques sur l’Algérie au Courrier de Lyon dont il devient rédacteur politique de 1876 à 1879. Directeur du Petit Oranais, il est embauché à La Petite Gironde de Bordeaux, puis arrive à L’Echo du Nord où pendant quatre ans, il est secrétaire de rédaction. En 1885, il est nommé directeur politique du journal La Charente , puis rédacteur en chef de L’Avenir de la Sarthe. A cette époque, il publie un premier roman sous forme de feuilleton Brigands de Braconne , mais aussi des études militaires et notamment Le 12e Corps d’Armée et les manœuvres de 1886. Ardouin-Dumazet est devenu un spécialiste des affaires militaires lorsqu’il collabore au quotidien Le Temps. Pour ce journal, mais aussi pour Le Figaro et L’illustration, il parcourt divers pays d’Europe. Il donne des chroniques militaires dans de nombreux périodiques de province, c’est ainsi que les lecteurs du Grand Echo retrouvent sa signature jusqu’à la veille de la Première Guerre. A partir de 1893, il commence à publier l’ouvrage qui fera sa renommée et sera couronné par plusieurs prix Voyage en France. Ce travail dans lequel il décrit toutes les activités agricoles, industrielles, artistiques des territoires qu’il traverse comprendra soixante-dix volumes qui seront actualisés et réédités. C’est en 1899 qu’il fait paraître les tomes 18 et 20 consacrés à la région du Nord : Flandre et littoral du Nord, et Artois, Cambrésis, Hainaut.
Déjà titulaire de la médaille de 1870-1871, Ardouin-Dumazet est nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1896, puis il est promu officier en 1927.
Devenu entreposeur spécial de tabacs, il meurt à Arsonval dans l’Aube à l’âge de 88 ans, le 16 mai 1940.
Source(s) :C.-E. Curinier (dir.), Dictionnaire national des contemporains, Paris, Office général d’édition, tome 3, p. 204-205, consultable sur Gallica; site Leonore, dossier de Légion d’honneur.
-
ARMAND Eugène
Lorsqu’il se marie le 10 octobre 1902 à La Madeleine-sous-Montreuil avec Marie Florine Hélène Segret, née à La Calotterie, Eugène Charles Armand est typographe à Montreuil-sur-Mer. Lors du recensement de 1911, domicilié dans cette même ville, il est publiciste chez Delambre, imprimeur, éditeur et propriétaire de l’hebdomadaire L’Echo de la Canche. Après la mort de son patron, il devient rédacteur détaché à Montreuil-sur-Mer du quotidien Le Télégramme du Pas-de-Calais édité à Boulogne-sur-Mer. Il est membre de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 3 E 535/5 et 5 MIR 588/11; Le Mémorial artésien 1er avril 1913.
-
ARNOLD Auguste Charles, Joseph
Editeur-gérant de La Gazette de Flandres et d’Artois de 1833 à 1854, Auguste Arnold a ensuite dirigé Le Journal du peuple (1864-1865), avant que ce dernier ne soit absorbé par Le Courrier populaire du Nord de la France, journal auquel il collabore sous le pseudonyme d’Adventif. Lors du lancement de La Vraie France en 1871, il fait partie de la rédaction jusqu’à sa mort survenue après une courte maladie.
Source(s) :Hippolyte Verly, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869…, Lille, Leleux, 1869.
-
ARNOULT Paul
Après des études au collège Stanislas, Paul Hector Jules Arnoult enseigne le français dans un collège de Londres. A son retour, il entre comme secrétaire de rédaction au quotidien Le Courrier du Pas-de-Calais. Il occupe également les mêmes fonctions à l’hebdomadaire Le Pas-de-Calais édité par la même société. Lors de la création du Courrier sportif, page rose qui paraît deux fois par semaine dans le quotidien, il devient rédacteur sportif. Paul Arnoult est tué le 19 mai 1940 lors du bombardement d’Arras alors qu’il sortait du cimetière.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 160/29; Le Courrier du Pas-de-Calais, 5 juillet 1940.
-
ASSOIGNON Paul
Né à Lille, dans le quartier populaire de Saint-Sauveur, où son père était serrurier et sa mère couturière, Paul Joseph Assoignon commence sa carrière de journaliste en 1881 comme reporter au Progrès du Nord à Lille.
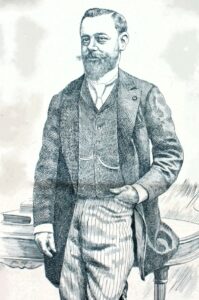 Il passe successivement rédacteur, puis secrétaire de rédaction, secrétaire général et rédacteur en chef. Parallèlement, il assure la correspondance des journaux Le Temps, Le Petit Parisien, Le Journal, Le Petit Bleu de Bruxelles. Membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord en 1902, il en est le premier trésorier. Durant la Première Guerre, resté à Lille occupée par les Allemands, Paul Assoignon devient secrétaire général de la mairie de Lille, aux côtés de Charles Delesalle. Après la Délivrance, il reprend son métier de journaliste, comme correspondant régional de plusieurs titres parisiens. En décembre 1923, appelé à témoigner dans une affaire de bagarres entre des camelots du roi et des policiers à l’occasion de la venue à Lille de l’ancien ministre de l’Intérieur Malvy, condamné à cinq années de bannissement en 1918, il refuse de témoigner, invoquant le secret professionnel. Menacé d’une amende par le juge d’instruction, Paul Assoignon est vivement défendu par Henri Langlais, président de l’Association professionnel des journalistes du Nord. Ardent défenseur de l’école publique, il fut délégué cantonal, membre de la Caisse des écoles de Lille, il fut également l’un des fondateurs du Denier des écoles laïques. A ce titre, il est nommé officier d’Académie en 1887 et officier de l’Instruction publique en 1893. Il était aussi un grand amateur des choses militaires et un homme altruiste, toujours prêt à organiser, fêtes, concerts ou autres afin de recueillir de l’argent pour des associations charitables. Fondateur de la société de gymnastique « La Patriote », il crée l’œuvre de L’Arbre de Noël qui, tous les ans, distribue des jouets et des vêtements aux enfants pauvres de Lille, aux malades des hôpitaux et aux orphelins des hospices.
Il passe successivement rédacteur, puis secrétaire de rédaction, secrétaire général et rédacteur en chef. Parallèlement, il assure la correspondance des journaux Le Temps, Le Petit Parisien, Le Journal, Le Petit Bleu de Bruxelles. Membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord en 1902, il en est le premier trésorier. Durant la Première Guerre, resté à Lille occupée par les Allemands, Paul Assoignon devient secrétaire général de la mairie de Lille, aux côtés de Charles Delesalle. Après la Délivrance, il reprend son métier de journaliste, comme correspondant régional de plusieurs titres parisiens. En décembre 1923, appelé à témoigner dans une affaire de bagarres entre des camelots du roi et des policiers à l’occasion de la venue à Lille de l’ancien ministre de l’Intérieur Malvy, condamné à cinq années de bannissement en 1918, il refuse de témoigner, invoquant le secret professionnel. Menacé d’une amende par le juge d’instruction, Paul Assoignon est vivement défendu par Henri Langlais, président de l’Association professionnel des journalistes du Nord. Ardent défenseur de l’école publique, il fut délégué cantonal, membre de la Caisse des écoles de Lille, il fut également l’un des fondateurs du Denier des écoles laïques. A ce titre, il est nommé officier d’Académie en 1887 et officier de l’Instruction publique en 1893. Il était aussi un grand amateur des choses militaires et un homme altruiste, toujours prêt à organiser, fêtes, concerts ou autres afin de recueillir de l’argent pour des associations charitables. Fondateur de la société de gymnastique « La Patriote », il crée l’œuvre de L’Arbre de Noël qui, tous les ans, distribue des jouets et des vêtements aux enfants pauvres de Lille, aux malades des hôpitaux et aux orphelins des hospices.Franc-maçon, il a été initié à la loge « L’Etoile du Nord » en avril 1866. Il est l’auteur d’un ouvrage sur le siège de Lille et de plusieurs revues jouées aux Bouffes lilloises. Son activité lui valut plusieurs décorations, il était notamment chevalier de la Légion d’honneur, de l’Ordre de la couronne de Belgique et du mérite agricole.
Il meurt à l’âge de 71 ans le 19 mai 1931 après une très longue maladie.
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord de la France; Le Grand Écho du Nord, 20 mai 1931 {Assoignon, Paul}; «Les journalistes peints par eux-mêmes : Paul Assoignon du Progrès du Nord» (+ dessin), La Vie flamande illustrée, n° 17, 16 mai 1903; site Léonore, dossier de légionnaire; Le Grand Echo du Nord 18 et 22 décembre 1923.
-
AUBERT Maurice
Pseudonyme de Louis Robichez, rédacteur au Journal de Roubaix.
-
AUBRY Gilbert
Son père, Albert Aubry, fut l’un des fondateurs du Nord Littoral avec Jean Baratte. C’est donc tout naturellement que le jeune Gilbert rejoint le journal en 1957, à tout juste 20 ans. Il ne le quittera qu’en 2007, après 50 ans d’activité, pour prendre une retraite active, consacrée en partie à la photographie, son hobby.
Source(s) :Nord littoral, 24 mars 2021.
-
AUDEBERT Paul
Fils d’un tailleur parisien, Paul Audebert est né le 18 septembre 1875. Etudiant à la Sorbonne, il y obtient une licence ès lettres. Il exerce alors comme professeur de musique. Après son service militaire, en 1899, il se tourne vers le journalisme. Il travaille d’abord à L’Avenir de l’Orne et de la Mayenne, édité à Alençon, où il signe ses éditoriaux du pseudonyme de René Mailly. En 1902, il est nommé directeur et rédacteur en chef de l’hebdomadaire L’Avenir du Jura paraissant à Dôle. Membre du Parti radical et radical-socialiste dont il est le délégué pour le Jura, il fait partie, en 1908, des fondateurs de L’Action jurassienne qui prend la suite de L’Avenir du Jura. Il en assume la rédaction en chef jusqu’en 1921. C’est à cette date qu’il arrive dans le département du Nord. Il est d’abord secrétaire général de la rédaction du quotidien Le Progrès du Nord qu’il quitte trois ans plus tard pour entrer au Grand Echo du Nord de la France. Chef du bureau de Douai, il suit notamment tous les procès d’assises. Parallèlement, Paul Audebert collabore à plusieurs revues littéraires et il est l’auteur de plusieurs pièces musicales.
Officier d’académie en 1908, médaille d’argent de la mutualité en 1931, proposé onze fois pour la Légion d’honneur de 1927 à 1939, il n’obtient pas la croix de chevalier.
Pendant l’Occupation, toujours en poste au Grand Echo du Nord, il est également le gérant du Journal de Douai, un bulletin d’information qui paraît sous le contrôle des Allemands jusqu’en octobre 1942.
Membre de l’Association des journalistes républicains depuis 1920, Paul Audebert est, avec Paul Béghin, cofondateur, le 26 mai 1924 à Lille, de la première section régionale du Syndicat national des journalistes.
Source(s) :Archives Paris, V 4 E 2521; AD Nord, M 127/8.
-
AVINEE Pascal
Fils d’un gendarme, Pascal Avinée était attaché au département photo du magasin Le Printemps, à Lille, quand il fut engagé le 1er février 1968 par La Voix du Nord pour son édition de Cambrai. Sa bonne connaissance du Cambrésis où il avait passé une partie de son enfance et son adolescence, son père appartenant à la compagnie de gendarmerie de l’arrondissement, rendait de grands services à l’équipe rédactionnelle d’autant plus qu’elle se doublait d’une facile adaptation à tous les milieux et d’une grande disponibilité. Un problème de santé l’a trahi à l’âge de 42 ans.
-
AYASSE Alphonse
Né à Montluel, dans le Lyonnais, Alphonse Michel Louis Ayasse est élève au lycée de Bourg-en-Bresse où il fait de brillantes études. Arrivé dans le département du Nord, où il se marie avec Alida Zoé Michel en 1875, il est administrateur, rédacteur en chef et copropriétaire avec Lepez du journal valenciennois L’Impartial du Nord. Il est également directeur régional d’une compagnie d’assurances. Le Grand Echo du Nord le décrit comme « un lettré, un amateur d’art et polémiste de talent ».
Membre de la Société d’agriculture, sciences et arts de l’arrondissement de Valenciennes, il meurt le 11 novembre 1906.
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord de la France; Le Grand Echo du Nord, 14 novembre 1906.
-
AYRAUD-DEGEORGE Horace
Petit-fils de Frédéric Degeorge et fils de Pierre Ayraud-Degeorge, Horace Ayraud-Degeorge naquit le 7 juillet 1850 à Arras où son père est journaliste au Progrès du Pas-de-Calais.
Il a à peine 17 ans quand son père se suicide en mai 1867 à Croissy. Pour subsister, il devient correcteur d’imprimerie. Il collabore ensuite à divers journaux : en 1869, il entre au quotidien Le National puis passe au Mot d’ordre où il fait la rencontre du journaliste Olivier Pain. Par l’intermédiaire de ce dernier, il fait la connaissance d’Henri Rochefort et entre au quotidien L’Intransigeant en 1880. Pendant vingt-quatre ans, il en est le secrétaire de rédaction, signant également des articles sous divers pseudonymes : Villiers, Frédéric Didier, Adrien Cayrol. Il est le témoin de Rochefort lors de la plupart des duels dans lesquels le directeur de L’Intransigeant est engagé. Pendant les années d’exil de Rochefort, il assume même la direction du journal.
En arrêt de travail le 5 octobre 1904 pour subir une opération d’un phlegmon, son nom disparaît quelques jours plus tard de la manchette d’un journal en déclin depuis plusieurs années. Rochefort le remplace brutalement, ne lui laissant plus la possibilité que « d’apporter des articles qui passeront suivant que les nécessités budgétaires du journal le permettront ». Ayraud-Degeorge poursuit en justice la société de L’Intransigeant et réclame alors 25 000 F de dommages et intérêts, il en obtient 5 000 à titre d’indemnités en juin 1905.
Ayraud-Degeorge devient critique d’art au Rappel puis au XIXe Siècle. Parallèlement, il est trésorier de l’Association des journalistes parisiens de 1909 à 1918. Il est l’auteur, avec Ernest Vauquelin, de l’ouvrage Aimée du roi, paru en 1883.
Il meurt à Paris le 2 février 1922.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5MIR 041/38; Le Figaro, 5 août 1869; Le Matin, 1er et 21 juin 1905; La Petite République, 1er juin 1905; Le Rappel, 11 mai 1906; Le XIXe Siècle, 21 mars 1910.
-
AYRAUD-DEGEORGE Pierre
Originaire de Charente-inférieure – Rochefort ou Aigrefeuille, selon les actes d’état civil –, Pierre Alexandre Ayraud, fils de Pierre Jacques Ayraud, cultivateur, et de Magdeleine Courtin, est avocat à Amiens quand il commence à collaborer au Progrès du Pas-de-Calais, journal républicain édité à Arras . En juin 1846, il épouse la fille du rédacteur en chef, Frédéric Degeorge, Jeanne, âgée de 21 ans. Il prend désormais le nom de Ayraud-Degeorge. Rédacteur dans ce journal arrageois, il en devient rédacteur en chef en 1848. Nommé sous-préfet de Boulogne en avril 1848, il ne reste qu’une dizaine de jours dans ce port de la Manche, il est ensuite préfet du Var de juillet 1848 à janvier 1849. Remplacé par Georges Eugène Haussman, il reprend ses fonctions au Progrès du Pas-de-Calais. Lors du coup d’Etat de décembre 1851, le journal est suspendu. Proscrit, Ayraud-Degeorge doit s’enfuir. Arrêté, il est condamné par la commission mixte du Pas-de-Calais à être interné pendant quelques mois à Angoulême. Finalement, il choisit de s’exiler à Bruxelles, Charles Hugo lui consacre d’ailleurs une belle page dans ses Hommes de l’exil. Autorisé à rentrer par décret du président de la République, Ayraud-Degeorge regagne Arras le 8 août 1852 et reprend une nouvelle fois ses fonctions au sein du journal arrageois. Après l’internement de son beau-père pour raisons de santé en mars 1854, il assume seul la gérance du journal et la rédaction en chef jusqu’à sa suspension en août 1857 après plusieurs avertissements. Le lendemain, Ayraud-Degeorge lance une feuille non politique Le Pas-de-Calais dont la parution est éphémère, à peine une quinzaine de jours. Il la remplace immédiatement par L’Echo du Pas-de-Calais qui disparaît après quatorze mois d’existence. En juin 1859, il lance Le Propagateur du Pas-de-Calais . L’affaire tourne court, le journal cesse de paraître le 30 octobre de la même année. Ayraud-Degeorge est cependant autorisé à le continuer le 1 er juin 1860 à Lille sous le titre Le Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais. Le 5 octobre, il doit, à nouveau, renoncer, cédant son journal à un groupe de légitimistes lillois.
Pierre Ayraud-Degeorge gagne alors Paris où il habite 17, rue des Moines. Dans une situation très précaire, ne subsistant que grâce à l’aide de deux amis, il se suicide le 31 mai 1867, l’âge de 51 ans, en se jetant dans la Seine à Croissy.
Auteur des ouvrages André Bernard ou le siège de Valenciennes, avec Eugène Fillon, et La Dentellière d’Arras , il était le père d’Horace Ayraud-Degeorge, qui sera secrétaire de rédaction à L’Intransigeant.
Source(s) :AD Charente-maritime, 3 E 311/190; AD Pas-de-Calais, 5MIR 041/46; AD Yvelines, 4 E 729; Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2009; La Gazette du Midi, 3 avril 1852; Journal des débats politiques et littéraires, 9 avril 1852; Journal du Cher, 14 septembre 1852; Le Figaro, 2 juin 1867.
B
-
BAILLEUL Augustin
Rédacteur au Bloc des rouges édité à Noeux-les-Mines en 1925-1926.
-
BAILLEUL Charles
 Ancien répétiteur au collège d’Avesnes, Jules Charles Bailleul quitte l’enseignement pour le journalisme. Fils de Charles Constant Bailleul et d’Isaline Josèphe Millot, né au Cateau-Cambrésis, il entre au Réveil du Nord à Lille où, sous le pseudonyme de Floridon, il s’occupe principalement des questions locales. Bien qu’« acquis au socialisme » selon la police, Bailleul ne trouve pas Le Réveil du Nord « assez solide » et il entre à L’Echo du Nord en août 1895. Il quitte Lille pour Dunkerque où il est secrétaire de rédaction du Phare du Nord, quotidien radical. En janvier 1903, il est nommé rédacteur en chef. Quelques mois plus tard, il se marie à Saint-Pol-sur-Mer avec Maria Elise Angèle Roche, âgée de 20 ans. En 1909, il choisit une autre orientation professionnelle, il est nommé directeur de l’octroi de Dunkerque en remplacement d’Alfred Roche, son beau-père, qui vient de prendre sa retraite. En 1927, Charles Bailleul divorce et se remarie avec Eva Deckmyn.
Ancien répétiteur au collège d’Avesnes, Jules Charles Bailleul quitte l’enseignement pour le journalisme. Fils de Charles Constant Bailleul et d’Isaline Josèphe Millot, né au Cateau-Cambrésis, il entre au Réveil du Nord à Lille où, sous le pseudonyme de Floridon, il s’occupe principalement des questions locales. Bien qu’« acquis au socialisme » selon la police, Bailleul ne trouve pas Le Réveil du Nord « assez solide » et il entre à L’Echo du Nord en août 1895. Il quitte Lille pour Dunkerque où il est secrétaire de rédaction du Phare du Nord, quotidien radical. En janvier 1903, il est nommé rédacteur en chef. Quelques mois plus tard, il se marie à Saint-Pol-sur-Mer avec Maria Elise Angèle Roche, âgée de 20 ans. En 1909, il choisit une autre orientation professionnelle, il est nommé directeur de l’octroi de Dunkerque en remplacement d’Alfred Roche, son beau-père, qui vient de prendre sa retraite. En 1927, Charles Bailleul divorce et se remarie avec Eva Deckmyn.Officier de l’Instruction publique, Charles Bailleul avait été syndic de l’Association professionnelle des journalistes du Nord.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 136 R 010 et 3 E 12681; Le Grand Echo du Nord, 10 janvier 1905 et 23 mars 1909.
-
BAISE Michel
Journaliste à Nord-Matin, Michel Baise est le premier journaliste licencié par le nouveau propriétaire du quotidien lillois, Robert Hersant, en 1967. Embauché à La Voix du Nord, il exerce les fonctions de secrétaire de rédaction jusqu’à sa retraite.
-
BAJU Léonard, Louis, Adolphe
Fils d’un officier français, Léonard Baju adopta la carrière militaire. En 1836 ou 1837, il l’abandonna pour entrer à la rédaction de La France septentrionale que Sproit venait de fonder à Lille, pour soutenir les intérêts de l’opposition modérée. Devenu directeur politique du journal, Baju encourut une condamnation pour avoir rendu compte sans autorisation des débats du procès de Louis-Napoléon Bonaparte après la tentative d’insurrection de Boulogne-sur-Mer en 1840. Baju fut enfermé à la tour Saint-Pierre, et céda peu après la direction de La France septentrionale à Seiter, avant de quitter Lille.
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869…, Lille, Leleu, 1869
-
BAJUX
Dans le chassé croisé de rédacteurs en chef qui passent au Courrier du Pas-de-Calais, Bajux prend la succession de Lherminier en juin 1839. Il y travailla, semble-t-il, jusqu’en 1843.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30 168, 1er et 2 janvier 1928.
-
BALLET-LEBRUN
Imprimeur-libraire à Bruay-en-Artois, Ballet-Lebrun édite à partir de 1905 Le Petit Bruaysien dans lequel il signe quelques articles sous le pseudonyme de Tellab.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notice, Le Petit Bruaysien.
-
BARATTE Jean
Fils d’un employé de commerce et d’une brodeuse, Jean Ernest Charles Baratte est orphelin dès l’âge d’un an. Son père, Henri Alfred, alors caporal au 1er RI, est tué à l’ennemi à Bétheny dans la Marne le 15septembre 1914. Jean est reconnu pupille de la Nation en 1919 par le tribunal civil de Boulogne-sur-Mer. Il devient instituteur public successivement dans cette ville, puis à Calais et aux Attaques. En 1936, il adhère à la SFIO qu’il quitte en 1938.
Le 16 avril 1938, il épouse Marie Charles, employée. Dès septembre 1939, il est mobilisé. Fait prisonnier en juin 1940, il est libéré grâce à de faux papiers et reprend son métier d’instituteur en février 1941. Un peu plus tard, il est même nommé directeur de l’école Condé à Calais.
Parallèlement, Jean Baratte rejoint la Résistance. Il est membre du réseau Pat O’Leary et du mouvement Libé-Nord. A la Libération, il est ainsi nommé président du comité de Libération de Calais.
Le 23 décembre 1944, avec l’appui de Jacques Vendroux, dont il est le deuxième adjoint dans la municipalité provisoire, il obtient l’autorisation de faire paraître, sur les presses du Phare de Calais interdit, un nouveau quotidien Nord Littoral. En 1945, il devient le principal actionnaire de la Société des impressions et éditions du littoral (SIEL) qui édite le journal.
Sous sa direction, Nord Littoral atteint en mars 1948 un tirage de 18 500 exemplaires et il emménage en août 1952 dans de nouveaux locaux 39, boulevard Jacquart.
Jean Baratte meurt accidentellement en septembre 1956 dans les Alpes-Maritimes. Sa femme lui succède à la tête de la SIEL.
Source(s) :AD Nord, 3 E 14883; AD Pas-de Calais, 3 E 193/423; site Mémoire des hommes; J.-P. Visse, Ces Voix des Hauts-de-France…, ibid.
-
BARBEZ Désiré Armand Constant
Fils d’un libraire de Bergues, Désiré Armand Constant Barbez épouse le métier de son père auquel il adjoint celui d’imprimeur. Par la suite, il rachète Le Journal de Bergues fondé en 1852 par Aimé Focqueur.
Il meurt à l’âge de 49 ans, laissant la succession à son fils Gaston âgé de vingt ans.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 025 R 028 et 5 Mi 060 R 006.
-
BARBEZ Gaston
Fils de Désiré Constant Barbez, imprimeur et directeur du Journal de Bergues, Gaston Armand Benoît Barbez est licencié en droit. A la mort de son père en juillet 1898, il prend sa succession à la tête de l’imprimerie familiale et du journal. Dès novembre 1898, il est cependant appelé sous les drapeaux et sert au 110e RI jusqu’en septembre 1900. En juin 1905, il se marie avec Marguerite Léonie Honorine Denys.
Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, Gaston Barbez ne retrouve la vie civile que le 4 février 1919. Interrompue le 4 mai 1915, la publication du Journal de Bergues reprend quelques jours après son retour, le 25 février 1919. En mars 1932, le titre du périodique devient Le Journal des Flandres.
Avant la Première Guerre, Gaston Barbez est élu conseiller municipal. Il devient 1er adjoint au maire durant l’entre-deux-guerres. Outre ses obligations politiques, il exerce par ailleurs de nombreuses fonctions : vice-président de l’Union des familles nombreuses de Bergues, de la Société mutualiste « La Fraternelle » de Bergues, administrateur de la Banque des Flandres,… Lors de la création de l’agence Inter-France en novembre 1938, il en devient administrateur à titre personnel.
Gaston Barbez interrompt la publication de son journal en mai. Il meurt pendant l’Occupation et c’est son fils qui obtient l’autorisation de faire reparaître Le Journal des Flandres en décembre 1944.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 025 R 036 et 1 R 2559; Le Nord maritime, 1er novembre 1922, Le Grand Echo du Nord, 8 mai 1935; Journal officiel, 25 janvier 1936; La Journée industrielle, 16 novembre 1938.
-
BARBEZ Jacques
Fils de Gaston Barbez, imprimeur et directeur du Journal de Bergues, Jacques Barbez lui succède à sa mort en 1943. Il fonde, en octobre 1960, quelques mois après la disparition du Nouveau Nord, un hebdomadaire du soir qui disparaît en mars 1963. Dix ans plus tard, en novembre 1972, il rachète L’Armentiérois qu’il arrête en décembre 1973.
-
BARBRY François-Régis
Ancien élève de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, François-Régis Barbry fut rédacteur à La Voix du Nord, à La Croix et au Monde puis il fut nommé chef des informations religieuses à La Vie. Il quitte l’hebdomadaire catholique en 1987 où il entre au groupe Reader’s Digest.
Spécialiste de la chanson, il était, depuis 1985, producteur sur France-Culture de l’émission « La mémoire en chantant ».
-
BARIL DE LA HURE
Rédacteur au Courrier douaisien où, en 1863, il remplace Taton. Il redonne à ce journal une tonalité légitimiste.
Source(s) :AN F/18/297, rapport 53 du 9 octobre 1863.
-
BARJAVEL Henry
Né en Provence, Paul Henry Bernard Barjavel suit des études de droit. Il devient artésien après son mariage. Nommé Administrateur de La Croix d’Arras en 1895, il allait vite en devenir le rédacteur en chef. Il occupe ce poste pendant dix ans. Lors de sa mort en octobre 1907, La Chronique artésienne de La Croix écrit : « Il était un écrivain de race. Si les circonstances et son caractère l’avaient mieux servi, il eût pu se créer un nom dans la grande presse parisienne. Quel brillant chroniqueur il eût fait ! »
Source(s) :La Chronique artésienne de La Croix, 20 et 21 octobre 1907.
-
BARNI Jules Romain
Élève de l’École normale supérieure, professeur de philosophie à Reims et à Paris, Barni fut secrétaire de Victor Cousin (1841-1842). Docteur ès lettres, il refusa de prêter serment après le coup d’Etat du prince-président. Il collabora à La Liberté de penser (1847-1851), écrivit ensuite à La Revue de Paris (1854-1857), puis donna des articles à L’Avenir . En 1860, il obtint une chaire à Genève, et participa au Congrès pour la paix (Berne, 1867 et 1868) dont il fut élu vice-président en 1868. Le gouvernement de la Défense nationale le nomma inspecteur général. Il fut élu député de la Somme en 1872, il soutint Thiers en 1873, s’opposa à de Broglie, vota la constitution de 1875. On lui doit de nombreux ouvrages philosophiques, et des traductions de Kant, dont il s’attacha à populariser la pensée en France, ainsi qu’un Manuel républicain (1872).
Source(s) :Roton, Ad., Histoire du département du Nord, avec la biographie des personnages remarquables qui en sont originaires, Paris, G. Guérin, 1890, 71 p.; Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, Ibid.
-
BARRE Emile
Emile Barre gère L’Echo de la Lys de 1855 à 1857. A la mort de Jean-Baptiste Poulain, la veuve de ce dernier, née Florentine Tartar, continua de diriger le journal avec son aide.
M. O.
Source(s) :Pierre Kerlévéo, «Une ville et son journal, Nouvelles chroniques locales», Revue historique et culturelle d’Aire sur la Lys et de sa région n° 4, 1990, p. 22 .
-
BARRE Louis
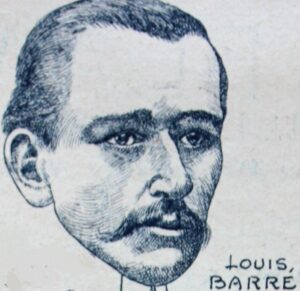 Enfant du département de la Marne, où il est né le 22 février 1874, Louis Félix Barré, après des études de droit, s’orienta vers le journalisme. Il commença sa carrière à L’Eclaireur de l’Est dirigé par Alexandre Israël, il passe ensuite à L’Indépendant rémois alors sous la direction de Fernand Réal. Louis Barré quitte l’Est pour le Nord de la France où, en 1906, il entre, comme localier, à L’Echo du Nord. Après la Première Guerre, en septembre 1919, il passe au Télégramme du Nord qui vient d’être créé. Après la disparition de ce quotidien, il est correspondant régional d’un journal parisien.
Enfant du département de la Marne, où il est né le 22 février 1874, Louis Félix Barré, après des études de droit, s’orienta vers le journalisme. Il commença sa carrière à L’Eclaireur de l’Est dirigé par Alexandre Israël, il passe ensuite à L’Indépendant rémois alors sous la direction de Fernand Réal. Louis Barré quitte l’Est pour le Nord de la France où, en 1906, il entre, comme localier, à L’Echo du Nord. Après la Première Guerre, en septembre 1919, il passe au Télégramme du Nord qui vient d’être créé. Après la disparition de ce quotidien, il est correspondant régional d’un journal parisien.Louis Barré meurt à l’âge de 51 ans à Lille des suites d’une longue maladie. Il était officier d’Académie.
Source(s) :La Vie flamande illustrée, 1910; Journal des réfugiés du Nord, 25 juillet 1917; Télégramme du Nord, 21 septembre 1919;Le Grand Echo du Nord, 1er juin 1925.
-
BARTHELEMY Georges
Instituteur, Georges Barthélémy fait ses débuts dans le journalisme à La Bataille socialiste de mars 1912 à octobre 1913.
-
BASCOU Olivier
En 1889, Olivier Bacou est rédacteur en chef de L’Impartial de Saint-Pierre.
-
BASIN Célestin
Ancien inspecteur des ventes du quotidien le Télégramme de Boulogne , Célestin Basin rachète en 1921 l’imprimerie d’Henri David établie à Béthune et le journal qu’il éditait L’Avenir de l’Artois, successeur en 1919 du Patriote de l’Artois. A partir de cet hebdomadaire, il crée un véritable groupe de presse hebdomadaire avec Le Journal de Bruay, Le Guetteur de Lillers, L’Avenir d’Auchel , L’Hebdomadaire d’Hénin-Carvin et L’Avenir de Lens, autant de titres qui correspondent aux différentes concessions minières du Pas-de-Calais. En 1932, il participe au premier congrès de la presse hebdomadaire et devient membre du Conseil d’administration du groupement. Durant l’Occupation, ses journaux suspendent leur parution. A la Libération, ils la reprennent et Célestin Basin poursuit l’expansion de son groupe de presse : en 1950, il rachète Le Journal de Lillers. En juillet 1951, Célestin Basin cède la place à la tête de son groupe de presse à un jeune journaliste Béthunois, Léonce Desprez. Il meurt en 1965.
Source(s) :Damien Ricaut, ESJ formation PHR; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notices des journaux cités.
-
BASQUIN DE L’EPINE Albert
Licencié en Droit, Albert Basquin a d’abord été avoué à Saint-Omer. Il collabore à plusieurs journaux royalistes avant d’entrer à La Croix du Nord en 1893 comme reporter. Le travail ne lui convenant guère et ayant d’autres ambitions, il quitte la quotidien catholique. La police rapporte une anecdote sur ses convictions politiques : « Dans une conversation où il discutait de son entrée possible dans un journal républicain, M. Basquin, en portant la main à l’épingle à fleurs de lys de sa cravate, s’écria : « Au fait, il suffirait d’enlever cela ». »
Source(s) :AD Nord, 1 T 222/22.
-
BASSEE Achille
Collaborateur d’Oscar Duthilloeul pendant une trentaine d’années, Achille Bassée prend sa succession à la tête de L’Indépendant de Douai en mars 1903 lorsque, malade, il abandonne le journal fondé en mars 1848 par son père et Vincent Adam d’Aubers. Devenu directeur propriétaire, Bassée le transforme en Courrier républicain pour tenir compte de l’évolution de la société. Dans son journal, Jules Limbour, professeur agrégé d’allemand et rédacteur au Démocrate, journal d’Union républicaine édité à Douai entre 1900 et 1902, se montre particulièrement sévère, voire vindicatif à l’égard de Bassée : « Ce Bassée était, écrit-il, le plus vil des journalistes douaisiens. Il n’est pas de saloperies de journal dont il ne fut capable pour de l’argent. »
Achille Bassée meurt à Douai en janvier 1911 des suites d’une congestion cérébrale.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne, 1790-1940 Société des amis de Panckoucke, 2017; Roland Allender, Jules Limbour, un Douaisien très occupé (1914-1918), Mémoires de la Société nationale d’agriculture, sciences et arts, 5esérie, tome VII, 2013-2014.
-
BASSEE Léon
Fils de l’imprimeur douaisien Achille Bassée, Léon Bassée fait ses études au lycée Henri IV à Paris où il a pour condisciple Georges Bonnet. Inscrit au barreau de Douai, il opte pour le journalisme et entre à l’agence Havas où il va faire toute sa carrière.
En 1938, il est chef du service politique de l’agence, c’est d’ailleurs lui qui, avant le président du Conseil Daladier, annonce, en avril, à Bonnet sa nomination comme ministre des Affaires étrangères. En juillet 1938, Léon Bassée est nommé administrateur d’Havas. Il deviendra également Pdg de la Société européenne de publicité.
Léon Bassée est impliqué dans de nombreuses associations professionnelles. Il est membre du conseil d’administration de « L’Accueil français » fondé en 1936 pour les journalistes étrangers de passage en France, de l’association de « La Maison des journalistes ». Il est président de l’Association internationale des journalistes accrédités auprès de la Société des nations.
Léon Bassée était commandeur de la Légion d’honneur.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940 Ibid; «Les décideurs français et la puissance française 1938-1939», in René Girault et Robert Frank (éd.), La puissance en Europe, 1938-1940, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p.23-43 (actes du colloque de Sèvres, avril 1982, sur «La perception de la puissance en Europe, 1938-1940»); Le Figaro, 11 novembre 1937; Le Grand Echo du Nord 30 mars et 2 avril 1942.
-
BATAILLE Guy
Originaire du Boulonnais, Guy Bataille commence sa carrière de journaliste en 1951 au Journal du Pas-de-Calais et de la Somme , édité à Boulogne-sur-Mer. Le 18 février 1953, il entre à la rédaction boulonnaise de La Voix du Nord dont il devient le chef d’édition en 1968. Il occupe ce poste jusqu’à sa retraite en mars 1990. Historien, il publie de nombreux articles et ouvrages sur l’histoire de Boulogne pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment Boulogne dans la tourmente, 1940-1944.
Ses nombreuses activités lui ont valu d’être nommé chevalier dans l’ordre national du Mérite, des Palmes académiques, des Arts et Lettres. Membre du Rotary de Boulogne, il en fut également le président.
-
BAUCHAT Lucien
Fils d’un maréchal des Logis de gendarmerie, c’est probablement dans l’Armée que Lucien Bauchat comptait faire carrière. Après avoir obtenu son brevet supérieur, il s’engage à 19 ans au 67e RI à Soissons. Nommé sous-officier, il prépare les examens d’entrée à l’Ecole militaire de Saint-Maixent. Reçu, il quitte pourtant l’Armée avec le grade de sergent-fourrier et se tourne vers la presse. Rédacteur à l’Indépendant rémois de mai 1900 à mars 1901, Lucien Bauchat est ensuite secrétaire de rédaction au journal Les Ardennes qui ferme quelques mois plus tard. A son arrivée dans le département du Nord en avril 1902, il devient rédacteur au Progrès du Nord qu’il abandonne en février 1903 pour L’Echo du Nord. Pendant seize ans, il y publie de nombreuses études sur les grandes industries du Nord. En 1914, il est mobilisé comme lieutenant d’administration de santé. Après la guerre, en janvier 1919, il retrouve L’Echo du Nord qu’il quitte quelques mois plus tard. Le 11 octobre 1919, avec un autre journaliste avec lequel il a travaillé à la rédaction du quotidien lillois, Paul Frémaux, et Decroix, il fonde le Nord Industriel. Bauchat et Frémaux font de ce périodique la plus importante revue économique régionale de France : « En créant le Nord industriel, note la police en 1930, [Bauchat] a permis aux industriels de mieux s’adapter à l’œuvre de reconstruction industrielle d’après-guerre. Aide tous les jours les industriels et les groupements à s’adapter aux nouvelles circonstances économiques du temps présent. Entreprend des campagnes profitables aux industries du Nord. » Toujours avec Frémaux, Bauchat crée ensuite en 1923, le Nord Charbonnier, puis en février 1924: le Nord commercial , organe de défense des commerçants du Nord et du Pas-de-Calais, journal officiel de plusieurs groupements et de la fédération des chambres syndicales des gérants de débits de tabacs de la région du Nord. Tandis que Paul Frémaux est une nouvelle fois mobilisé en août 1939, Lucien Bauchat continue la publication du Nord industriel jusqu’au 17 mai 1940 puis se replie à Boulogne-sur-Mer. Il rentre à Lille après la prise de la cité portuaire par les Allemands et reprend la publication de son hebdomadaire en novembre 1940. Deux ans plus tard, Paul Frémaux cède ses parts dans la société à son chef de publicité, Louis Gauche. La société devient alors « Bauchat, Gauche et Cie ». Le périodique cesse sa publication le 26 août 1944. Etant toujours resté sur le terrain économique, ses dirigeants ne font l’objet d’aucune poursuite. Membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord et de l’Association des secrétaires de rédaction des journaux et revues de France, Lucien Bauchat était membre du syndicat de la Presse républicaine départementale de France et de la Société des ingénieurs civils de France. Il avait été fait chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :AD 59 M127/10; AD 59 9W 1078.
-
BAUDIN Pierre
Louis Désiré Bodin pour l’état civil, Pierre Baudin comme nom de plume. Fils d’un jardinier de Wasquehal, Bodin quitte le Nord avec son frère dès l’invasion allemande en 1914 et gagne la France non occupée. Tentant de s’engager, il est d’abord ajourné pour faiblesse en 1914, puis il est appelé avec la classe 1915. En septembre, il est ainsi incorporé au 63e RI à Limoges. Très rapidement, il se retrouve au front où sa bravoure lui permet de gagner du galon. Plusieurs fois blessé, il se voit décerner d’élogieuses citations. Il est démobilisé en novembre 1919 avec le grade de sous-lieutenant d’aviation. En 1932, il est fait chevalier de la Légion d’honneur pour sa conduite pendant la guerre. Démobilisé, Bodin entre comme rédacteur au Journal de Roubaix où pour ses lecteurs il est devenu Pierre Baudin. Domicilié d’abord en Belgique à Dottignies dans l’arrondissement de Tournai/Mouscron, puis à Roubaix, c’est dans cette ville qu’en août 1923, il se marie avec Suzanne Masurelle. Quelques années plus tard, il rejoint Le Grand Echo du Nord où il est secrétaire de rédaction. Passionné par l’aviation, il rend compte de toutes les manifestations aériennes organisées dans la région du Nord durant ces années d’après-guerre et qui suscitent un large engouement, il suit son développement commercial notamment à partir de Lille. En juin 1933, il crée d’ailleurs un bimensuel Les Ailes du Nord, organe des aéro-clubs des départements septentrionaux dont il assume la direction. Il multiplie les conférences publiques et les causeries à Radio PTT Nord autour de l’aviation. En octobre 1935, il est inculpé d’extorsion de fonds sous menaces de mort à l’égard du commanditaire du journal, cependant « en raison de la fragilité des accusations », le juge d’instruction lui accorde un non-lieu en février 1936. Le périodique poursuit sa parution au moins jusqu’en avril 1937, date du dernier numéro conservé à la BnF, mais Pierre Baudin quitte la région. Il est domicilié à Marseille, puis à partir de 1936 à Bordeaux où il est journaliste à La France de Bordeaux et du Sud-Ouest.
Le 26 août 1939, alors que la guerre menace à nouveau, il est rappelé et rejoint le centre de mobilisation de Dreux. En 1945, on le retrouve à Hanoï avec le grade de capitaine. Rentré en France, il meurt le 4 août 1968 à Cannes.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 646 R 002, 3 E 15983, 1R 3257, M 149/142; Site Léonore, dossier de Légion d’honneur; Le Grand Echo du Nord, 12 août 1923, 5 et 13 janvier 1932, 16 juin 1933, 25 mai 1935; La Croix du Nord 13 octobre 1935 et 7 février 1936.
-
BAYLE
Bayle est rédacteur à L’Annotateur boulonnais (1823-1830) , imprimé à Boulogne-sur-Mer par P. Hesse.
-
BEAUCAMP Fernand
D’abord professeur d’art et d’archéologie à l’Institut technique roubaisien et à l’École de journalisme de Lille, Fernand Beaucamp avait rejoint Le Grand Écho du Nord en 1924. Il y assurait la critique d’art (artistes et expositions) et celle des ouvrages d’histoire sur la région. En 1918, et à nouveau en 1938, il avait sans aucun titre officiel, aider à mettre à l’abri les chefs-d’œuvre du musée de Lille, établissement dont il briguait la direction, au moment de sa mort.
Il avait accompli avec succès une mission en Italie pour régler les problèmes de la Fondation Wicar, et devait soutenir prochainement devant l’Université de Lille une thèse de doctorat sur ce peintre.
Il était membre de la Commission historique du Nord, du Comité flamand de France, de la Commission des musées, du Nord et de la Commission des monuments historiques du Nord. Il avait notamment publié en 1923 La Flandre et l’Artois, époque médiévale, xvie et xviie et en 1925 La Découverte archéologique de Warneton (Belgique). Il était titulaire de la Croix de guerre et était officier de l’Instruction publique.
Source(s) :AD Nord, M 149/142
-
BEAUJEAN Henri
Henri Beaujean est rédacteur à l’édition d’Arras de La Voix du Nord en 1946.
Source(s) :Libre Artois, 10 novembre 1946.
-
BECQUET Désiré Joseph
Etre vendeur d’un hebdomadaire anarcho-syndicaliste n’est pas de tout repos, mais peut néanmoins induire en tentation. Désiré Becquet criait le journal à Liévin quand la police lui dressa procès-verbal. Le juge de Paix de Béthune le condamna à 10 F d’amende, fixant la contrainte par corps éventuelle à cinq jours, ce que bien sûr L’Action syndicale trouva disproportionné, accusant le juge de se venger, le journal ayant révélé quelques-uns de ses petits secrets. Le rédacteur de l’article faisait remarquer que d’appel en grâce pour le 14 juillet, Becquet n’était pas prêt de se retrouver en prison, puisqu’il était en fuite (L’Action syndicale , 28 février 1908). La police était sans doute bien informée puisqu’elle retrouve Becquet fin mars. Selon L’Action syndicale (3 mars 1904), Becquet dînait chez trois mineurs habitant une chambre en garni. À l’un des mineurs sorti de la chambre, les agents demandent si Becquet va dormir avec eux. Mais on ne nous dit pas le fin mot de l’histoire, le rédacteur de l’article préférant ironiser sur les agapes permises à Basly et pas à Becquet. L’Action syndicale menait une intense propagande néo-malthusienne. Pour un article intitulé « Possibilité d’aimer sans enfanter », signé « Adultérin », et pour recommander et faire diffuser par ses vendeurs deux brochures Plus d’avortement et Moyens d’éviter les grandes familles , Broutchoux, secrétaire du journal, Colbaert, administrateur, l’imprimeur Méresse, un typographe et le vendeur Becquet sont convoqués chez le juge d’instruction pour « outrages aux bonnes mœurs ». Le 24 mars, Méresse et Becquet sont condamnés chacun à 50 F d’amende, et Broutchoux à vingt jours de prison. (L’Action syndicale 27 mars 1904). Les trois font appel. Ils seront acquittés par la cour de Douai qui les « renvoie des frais de la poursuite sans dépens ». Entre temps, Désiré Becquet a cessé d’être, si l’on ose dire, « en odeur de sainteté » dans les bureaux de L’Action syndicale. La livraison du 29 juin 1904 apprend à ses lecteurs que Becquet « est parti furtivement en emportant la somme de 165,20 F ». Fuite qui, cette fois, ne fait pas rire le journal. L’hebdomadaire conseille donc de se méfier de cet « estampeur », qui a déjà commis la même indélicatesse à l’égard de plusieurs organes de défense ouvrière. Il demande aussi « à la presse révolutionnaire de signaler en le flétrissant l’acte dégoûtant qu’à commis le faux-frère ». Bien entendu, pas question d’utiliser les lois bourgeoises pour poursuivre le voleur. Un « boycottage ouvrier » suffira. Le 5 juin 1906, la Commission du journal décide d’agir avec autant d’énergie envers les vendeurs en retard qu’elle en a mis à l’égard de Becquet : « Les vendeurs en retard sont donc avertis d’avoir à s’arranger avec la commission le plus tôt possible, sinon ils seront dénoncés par la voix du journal. » Tant il est vrai que le problème de la remontée du produit des ventes est endémique dans les journaux militants. Et que Becquet y est aussi pour quelque chose, témoin la « Petite Correspondance » du 12 juin 1904 : « Wavrin. À D. Ton dernier versement s’élève à 1 franc et a été fait le 31 janvier. Les 2 francs que tu as remis à Becquet ne m’ont point été remis. » Néanmoins le 28 août, le journal est en déficit. Les 165,30 F emportés par Becquet font défaut, les ventes ne paient pas l’impression, et les vendeurs en retard doivent 254,50 F au journal. D’où la menace : « la Commission espère que tous les vendeurs en retard feront leur devoir, et qu’elle ne sera pas dans la pénible obligation de les clouer au pilori comme elle l’a fait pour le sieur Désiré Becquet. » C’est la dernière fois que L’Action syndicale imprimera le nom du faux-frère.
Source(s) :Les numéros de L’Action syndicale cités.
-
BÉCU Chrysostome
Bécu assura pendant longtemps la critique musicale de L’Écho du Nord qu’il signait Y. Sous le pseudonyme de Bernon, il composa un grand nombre de romances, de stances de cantates, etc.
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, op. cit.
-
BEGHIN Hippolyte
Pharmacien de son état, mari de la première libraire de Roubaix, Hippolyte Édouard Joseph Béghin, né d’un père bijoutier, obtient la trentaine passée, le 14 février 1829, un brevet d’imprimeur en lettres qu’il complète sept ans plus tard, le 13 novembre 1836, par un brevet d’imprimeur lithographe. En 1829, il installe dans la Grand-Rue une presse à imprimer à bras en bois, construite par les frères François, Joseph et Louis Lemesre. L’idée lui vient vite de créer un périodique pour rentabiliser ses investissements et il lance La Feuille de Roubaix, recueil un peu décousu de diverses rubriques, comportant très peu d’informations roubaisiennes. Il abandonne ce premier titre au bout de six mois et lance alors Le Narrateur roubaisien qui ne dure pas plus longtemps (tirage des deux périodiques: environ 100 exemplaires). Puis Beghin est associé à la publication du Chemin de fer français, œuvre collective dont il semble avoir été l’imprimeur. L’hebdomadaire a des bureaux à Lille chez Jouan, à Roubaix chez Béghin et à Tourcoing chez Mathon. En 1843 (?), Béghin participe à la création d’un autre périodique, La Tribune du département du Nord, imprimé pour la partie générale à Lille chez Bronner-Bauwens et pour la partie locale chez Béghin. Dans son numéro 149 du 25 juin 1843, Le Moulin-à-vent de Lille prend à partie le nouveau journal, accusé d’être financé par le gouvernement belge. Ces deux derniers périodiques sont absents des collections de la BnF.
C’en sera terminé des incursions dans le domaine de la presse périodique pour Hippolyte Béghin, le premier Roubaisien à s’y être frotté.
Source(s) :B. Grelle, Commerce des imprimés à Roubaix et Catalogue presse roubaisienne.
-
BEGHIN Paul
Paul Béghin est, avec Paul Audebert, le fondateur de la première section régionale du Syndicat national des journalistes le 26 mai 1924 à Lille. Alors âgé de 32 ans, il est secrétaire de rédaction au quotidien Le Grand Echo du Nord où il est entré en 1920. Né à Roubaix le 12 juillet 1892, Paul Béghin commence sa carrière de journaliste en 1911 au Journal de Roubaix où il travaille jusqu’à son départ pour l’armée en 1913. Il est encore sous les drapeaux lors de la déclaration de guerre, en août 1914. Affecté au 8e régiment d’artillerie de campagne à Nancy, il y effectue toute la guerre d’abord en qualité de téléphoniste-observateur, puis comme brigadier. Blessé en service commandé, il est cité à l’ordre du régiment le 14 octobre 1918. Pendant cette période, il fonde un journal de tranchée, La Magnéto Gazette, pour entretenir le moral de ses camarades. Titulaire de la croix de Guerre, il est démobilisé en août 1919. Au Grand Echo du Nord, Paul Béghin devient premier secrétaire de rédaction, attaché au service des informations générales, puis, en 1940, secrétaire général de la rédaction. Il s’intéresse aux questions sociales et publie notamment deux études sur la loi sur les habitations à bon marché et sur les Assurances maladies. Ces enquêtes donnent lieu à deux brochures Comment devenir propriétaire avec la Loi Loucheur et Guide populaire des Assurances sociales tirées respectivement à 92.000 et 100.000 exemplaires. Parallèlement, Paul Béghin est correspondant régional du Petit Parisien.
Défenseur des intérêts de sa corporation, il est d’abord trésorier, puis secrétaire de la section Nord-Pas-de-Calais du SNJ qui s’enorgueillit d’accueillir « presque tous les journalistes de la région ». Il siège également au conseil d’administration du syndicat. A ce titre, il participe aux congrès de la Fédération internationale des journalistes à Dijon en 1928, à Londres en 1932, à Bruxelles en 1934 et à Helsinki en 1935. Désigné en 1937 par le syndicat pour prendre part aux travaux de la commission chargée d’établir la convention nationale professionnelle, il est l’un des quatre journalistes – et le seul de la presse de province – signataires de cette charte.
Dans sa région, il fonde une section de la caisse de chômage des journalistes, participe activement à la mise en place du statut de journaliste institué par la loi du 29 mars 1935. Il est également membre de plusieurs groupements de presse : Association professionnelle des journalistes du Nord, Association syndicale des journalistes républicains français, Association des secrétaires de rédaction des journaux et revues, etc. Ses nombreuses activités lui valent d’être nommé, en août 1939, chevalier de la Légion d’honneur.
Ayant repris ses fonctions après l’occupation allemande, il est emprisonné une dizaine de jours pour avoir annoncé en octobre 1940 la mise en place de cartes de rationnement. Après la Libération, il entre à La Voix du Nord, et quelques mois plus tard, il reconstitue la section Nord-Pas-de-Calais du SNJ qu’il préside jusqu’à sa mort le 25 mai 1948.
Source(s) :AD Nord, M 127/10; Journal de Roubaix, 10 août 1939; Léonore, dossier de la Légion d’honneur.
-
BEGUE Pierre
Fils du secrétaire général de la mairie de Douai, Pierre Bègue fit tout sa carrière de journaliste à l’agence de Cambrai de Nord-Matin, dont il fut le chef . Pierre Bègue fut également conseiller municipal de Cambrai, maire de la commune libre du quartier de Cantimpré.
-
BEHAGHEL Aimé
Ancien rédacteur du Mémorial de Lille, il devient rédacteur en chef du journal La Vraie France le 15 décembre 1881. Il n’y fait qu’un bref passage, en conflit avec Reboux, il quitte le journal royaliste en février 1882.
Source(s) :Choquet (René), La Vraie France, journal royaliste, légitimiste, catholique lillois à la fin du XIXe, siècle, Université de Lille, mémoire de maîtrise, 1994
-
BEHAL Pierre
Avant d’être journaliste, Pierre Béhal fut mineur. De ses origines, il avait d’ailleurs gardé un profond attachement à la classe ouvrière.
C’est à Nord-Matin , quotidien socialiste, qu’il commence après la Libération sa carrière de journaliste. Pendant plusieurs années, il est représentant de la rédaction au conseil d’administration du journal. Il quitte Nord-Matin peu après la vente du journal à Robert Hersant. Il entre à La Voix du Nord le 1er mars 1968, où il est affecté au service économique. Il y reste jusqu’à la retraite en 1982. Pierre Béhal est notamment l’auteur de l’ouvrage Des journalistes en Nord publié en 1986 et écrit en collaboration avec Robert Décout, Marie-Georges Delmasure, Jacques Estager et Georges Sueur.
-
BELE Maurice
Maurice Bèle fit ses débuts dans le journaliste au sortir de la Première Guerre comme intérimaire au Nord-maritime . Il exerça successivement au Télégramme du Pas-de-Calais, au Phare du Nord et à Nord-Eclair avant de revenir, en 1925, au Nord-Maritime où il était particulièrement chargé des faits divers. Témoin de nombreux faits amusants, il ouvrit une chronique, le « Coin du Dunkerquois » qu’il signait du pseudonyme de Jepht’je. Après la Seconde Guerre, il poursuivit cette chronique rebaptisée «Bonnes histoire de Baptiste» dans Le Nouveau Nord, puis à partir de 1960 dans l’édition dunkerquoise de La Voix du Nord.
Membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, officier de l’Instruction publique, Maurice Bèle est mort à l’âge de 80 ans.
Source(s) :«Ceux qui nous quittent : Maurice Bèle», La Voix du Nord, édition de Dunkerque, 1er, octobre 1975.
-
BELLENGE André
André Bellengé entre à l’hebdomadaire Nord-France lors de sa création le 23 décembre 1944. Lorsque ce périodique reprend le contenu de Semaine du monde, il entre à La Voix du Nord le 1 er mai 1954 où il est nommé grand reporter avant de prendre en charge la rubrique « Détente loisirs » jusqu’à son départ en retraite en 1980.
-
BELLENGER Henri
Rédacteur en chef du Républicain de l’Allier , Henri Bellenger prend dans les années 1880 la succession de Léon Marc à la tête du Libéral de Cambrai , fondé en 1869 par Théophile Depreux. « Homme de lettres » qui « s’est occupé de travaux historiques et littéraires », note la police lors de son arrivée dans le Nord, il a collaboré à divers journaux républicains de la capitale dont La République française de Gambetta. Ignore-t-elle ou feint-elle d’ignorer le passé de Bellenger ? Sous la Commune de Paris, il a été l’un des principaux rédacteurs du Cri du Peuple de Jules Vallès, il a également collaboré au Vengeur de Félix Pyat et au Journal officiel de la Commune. Après la semaine sanglante, il s’est réfugié en Suisse, puis à Londres. Durant son séjour en Angleterre, il écrit, en 1876, Londres pittoresque et la vie anglaise. En 1878, il publie une traduction de l’ouvrage La Russie, le pays, les institutions, les mœurs, de l’anglais Mackensie-Wallace qui lui vaut le prix Langlois de l’Académie française.
Source(s) :AD Nord, 1T 217/8, document non daté [1885?]; La Presse, 21 juillet 1871; JO de la République française, 17 juillet 1875.
-
BELLONI A.-Pierre
Belloni est directeur de L’indépendant d’Hénin de 1925 à 1927 et du Journal de Lens. Parallèlement, il est président de l’union commerciale d’Hénin-Liétard.
-
BENOSLAWSKA M.
Collabore à la Gazeta dla Kobiet.
-
BERCHAUD Victor Léopold
Arrivé à Lille dès sa plus tendre enfance, Victor Berchaud fit son apprentissage de menuisier à Loos, puis à Paris. C’est là qu’il participe à la rédaction du périodique L’Atelier écrit par des ouvriers. Revenu à Lille lors de la révolution de 1848, il écrit dans L’Echo du Nord sous le pseudonyme de Jérôme Pajot. Peu à l’aise dans ce quotidien, il entre dans le périodique nouvellement créé La Liberté. Il y défend la cause légitimiste. Il collabore également à L’Echo de Lille , sous le pseudonyme de Ludovic Millen. A la disparition de La Liberté, Victor Berchaud, qui vient de perdre sa femme et son enfant, quitte Lille pour Toulouse. Ce malheur porte, semble-t-il, un coup fatal à sa raison. Il entre alors à la rédaction de L’Aigle. Contraint de quitter la ville, il gagne Paris où il est enfermé dans une maison d’aliénés, il est transféré à Auxerre où il meurt.
Source(s) :BM Lille, Fonds Humbert.
-
BERGES Théodore
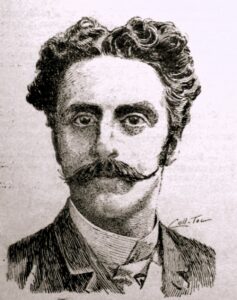
Ex-secrétaire général du gouvernement de la Guadeloupe, Théodore Bergès devient rédacteur en chef du Progrès du Nord. Il quitte le quotidien lillois en février 1891 où il est nommé directeur de l’Intérieur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il assure les fonctions de gouverneur intérim du 1er avril au 6 août 1891 et du 25 octobre 1895 au 29 avril 1896
-
BERJO François
François Berjo est l’imprimeur de L’Echo républicain d’Orchies qui parut de 1899 à 1931.
-
BERNARD César
Fils de Jules Eugène Bernard et de Désirée Euphrasie Deboffle, César Bernard est, après sa sortie de l’école normale d’Arras, nommé instituteur à Lens, puis à Calonne-Ricouart. Il fonde le premier journal syndical de l’enseignement du Pas-de-Calais, Syndiquons-nous. Militant socialiste, il est élu député SFIO en 1919, réélu en 1924, mais est battu en 1928. Quelques semaines avant les élections législatives, il avait fondé Le Travailleur de l’Artois qu’il dirige, rédige partiellement et finance. Pendant quatre ans, ce périodique se veut le défenseur de la classe ouvrière et paysanne, « la voix socialiste et républicaine ». Cependant, il survit difficilement, et, en juin 1932, alors que César Bernard n’a pas réussi à reprendre son siège de député, paraît le dernier numéro. En 1936, à l’occasion des législatives, il reparaît pour l’ultime combat national de son directeur. L’échec de César Bernard signifie la disparition définitive de l’hebdomadaire. Parallèlement, César Bernard est administrateur de L’Eclaireur du Pas-de-Calais , l’organe de la fédération socialiste SFIO, créé après la scission du parti et qui sortira chaque semaine jusqu’en 1938.
Conseiller municipal de Frévent depuis 1925, il est élu maire en 1945, et réélu en 1947. Sa conduite pendant l’Occupation lui vaut d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. Il meurt à l’âge de 74 ans en 1950. César Bernard était également l’auteur de contes et pièces de théâtre pour enfants.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, notice, Le Travailleur de l’Artois; La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, Société des Amis de Panckoucke, notice, L’Eclaireur du Pas-de-Calais; AN, dossier de Légion d’honneur, LH/194/48
-
BERNARD Charles
Originaire du Cambrésis, Charles Bernard exerce divers métiers, homme de peine, directeur de fabrique de chicorée, voyageur de commerce, avant de devenir journaliste puis directeur de banque. En avril 1902, il lance un journal Le Patriote de l’Artois, journal républicain nationaliste de l’arrondissement de Béthune, pour soutenir sa candidature lors des élections législatives d’avril-mai 1902 dans la 4 e circonscription de Béthune. Candidat nationaliste et antiministériel, avec quelque 2100 voix sur 17486 votants, il ne parvient pas à accéder au second tour et peut empêcher la victoire du maire de Noeux-les-Mines Beharelle. En 1905, Charles Bernard quitte Le Patriote de l’Artois dont Georges Maerten devient directeur-gérant et Louis du Moulin, rédacteur en chef.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du Bassin minier du Pas-de-Calais, Ibid.
-
BERNARD Jules
Fils de Henri Joseph Bernard, menuisier, et de Céline Catherine Séverin, couturière, Jules Henri Bernard est présenté, par la police vers 1896 (?), comme «simple reporter de locale» de L’Emancipateur de Cambrai , sans autre commentaire.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 012 R049, 1T 222/3.
-
BERT André
Esprit facétieux et vif, André Bert était aussi un homme de grande culture. Etudiant en droit et en anglais à la Catho de Lille, il choisit de s’orienter vers le journaliste, poursuivant ses études à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille. Trois fois vainqueur du cross de la catho, champion universitaire du 1500m UGSEL, champion de boxe universitaire ASSU, sélectionné universitaire de natation, c’est tout naturellement qu’il entra le 21 octobre 1944 au service des sports de La Voix du Nord . Affecté ensuite à la rédaction locale de Lille, il traite des faits divers. Secrétaire de rédaction chargé des éditions du littoral, puis des pages régionales, il devient ensuite adjoint au chef du service technique de la rédaction. André Bert prend sa retraite en 1983.
Source(s) :La Voix du Nord, 18 octobre 1988.
-
BERTHOUD, Samuel-Henri
 Fils d’un imprimeur-libraire de Cambrai, Samuel Henri Berthoud fit ses études à Douai. Après avoir collaboré au journal de son père, il fonda en 1828 La Gazette de Cambrai. Il inséra des feuilletons qui attirèrent l’attention de périodiques parisiens, La Mode et La Revue des Deux Mondes, qui acceptèrent ses écrits. En même temps, il instituait à Cambrai des cours gratuits d’hygiène, d’anatomie, de droit commercial, il se chargeait lui-même d’enseigner la littérature. En 1832, il se fixa à Paris, collaborant à divers journaux. Il fut l’un des rédacteurs du Mercure de France, avant d’en devenir le directeur. Puis il dirigea avec succès Le Musée des familles, dont les bénéfices servirent à fonder La Presse. Il collabora à ce dernier journal jusqu’en 1848, puis écrivit des articles scientifiques dans la Patrie sous le pseudonyme de Sam. Berthoud fut un écrivain prolifique. Toutes ses œuvres partent d’une donnée morale, et son style ne manque pas de verve. On lui doit des Chroniques et traditions surnaturelles de la Flandre, commencées à Cambrai et complétées à Paris ; des Contes misanthropiques (1831) ; des romans : La Sœur de lait du vicaire (1832), le Cheveu du diable (1833), une Mater dolorosa (1834), L ’Honnête homme (1837), Pierre-Paul Rubens (1840), publié d’abord dans Le Musée des familles, La Bague antique (1842), Berthe Frémicourt (1843), L’Enfant sans mère (1843), Le Fils du rabbin (1844), Daniel (1845), récit de famille, La Palette d’or (1845), La Mare du diable (1847), El-Hioudi (1848), études de mœurs algériennes, ainsi que le Zéphyr d’El-Arouch (1850), qui a paru d’abord dans le journal Le Pays , etc. Il a aussi écrit pour la jeunesse, et fait éditer La France historique, industrielle et pittoresque (1835-1837), des Fantaisies scientifiques et plusieurs volumes de la collection des Petits livres de M. le curé (1844-1850). Il a aussi commis un vaudeville, Une Bonne qu’on renvoie, joué en 1851 au Théâtre des Variétés et, paraît-il, fort gai. Berthoud a été promu chevalier de la Légion d’honneur le 1er septembre 1844 et officier le 14 août 1867.Source(s) :
Fils d’un imprimeur-libraire de Cambrai, Samuel Henri Berthoud fit ses études à Douai. Après avoir collaboré au journal de son père, il fonda en 1828 La Gazette de Cambrai. Il inséra des feuilletons qui attirèrent l’attention de périodiques parisiens, La Mode et La Revue des Deux Mondes, qui acceptèrent ses écrits. En même temps, il instituait à Cambrai des cours gratuits d’hygiène, d’anatomie, de droit commercial, il se chargeait lui-même d’enseigner la littérature. En 1832, il se fixa à Paris, collaborant à divers journaux. Il fut l’un des rédacteurs du Mercure de France, avant d’en devenir le directeur. Puis il dirigea avec succès Le Musée des familles, dont les bénéfices servirent à fonder La Presse. Il collabora à ce dernier journal jusqu’en 1848, puis écrivit des articles scientifiques dans la Patrie sous le pseudonyme de Sam. Berthoud fut un écrivain prolifique. Toutes ses œuvres partent d’une donnée morale, et son style ne manque pas de verve. On lui doit des Chroniques et traditions surnaturelles de la Flandre, commencées à Cambrai et complétées à Paris ; des Contes misanthropiques (1831) ; des romans : La Sœur de lait du vicaire (1832), le Cheveu du diable (1833), une Mater dolorosa (1834), L ’Honnête homme (1837), Pierre-Paul Rubens (1840), publié d’abord dans Le Musée des familles, La Bague antique (1842), Berthe Frémicourt (1843), L’Enfant sans mère (1843), Le Fils du rabbin (1844), Daniel (1845), récit de famille, La Palette d’or (1845), La Mare du diable (1847), El-Hioudi (1848), études de mœurs algériennes, ainsi que le Zéphyr d’El-Arouch (1850), qui a paru d’abord dans le journal Le Pays , etc. Il a aussi écrit pour la jeunesse, et fait éditer La France historique, industrielle et pittoresque (1835-1837), des Fantaisies scientifiques et plusieurs volumes de la collection des Petits livres de M. le curé (1844-1850). Il a aussi commis un vaudeville, Une Bonne qu’on renvoie, joué en 1851 au Théâtre des Variétés et, paraît-il, fort gai. Berthoud a été promu chevalier de la Légion d’honneur le 1er septembre 1844 et officier le 14 août 1867.Source(s) :Vapereau G. et al., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers Paris, Hachette, 4e éd., 1870.
-
BESIN André
Rédacteur à Liberté , André Besin a également été c onseiller municipal de Lille.
-
BESSERVE Albert Marius
Militant du syndicat autonome des marins de Dunkerque, Albert Besserve était le responsable de la rubrique « La Bataille du marin » publiée dans le journal libertaire hebdomadaire Germinal (Amiens) à partir du n° 426 daté du 22 octobre 1927. Puis la rubrique deviendra début 1928 l’organe autonome du syndicat autonome des marins de Dunkerque qui comptait alors 90 adhérents. Fin octobre 1927, Besserve était arrêté « pour entrave à la liberté du travail » à la suite à son intervention à bord du vapeur Lieutenant Saint-Loubert lors d’un mouvement de grève et où le commandant de bord avait porté plainte contre lui.
Source(s) :Repris du Dictionnaire international des militants anarchistes, sur Internet.
-
BESSIN Philippe
Journaliste à la rédaction douaisienne de Nord Eclair, Philippe Bessin a rejoint la rédaction de La Voix du Nord lors de la fusion des rédactions des deux quotidiens nordistes, en 2001. Il est alors affecté au bureau de Lens. Il meurt à l’âge de 49 ans des suites d’une longue maladie.
-
BETHLEEM Louis
L’abbé Bethléem est d’abord enseignant à l’Institution Saint-Jude à Armentières. Nommé vicaire de la paroisse Sainte-Catherine à Lille en 1898, il est vicaire de la cathédrale de Cambrai en 1903 où il publie la première édition de son ouvrage Romans à lire, roman à proscrire. Chapelain de la paroisse Saint-Joseph à Sin-le-Noble à partir de 1904, il lance en 1908 le mensuel Romans-revue. En 1911, il rejoint Lille où il a obtenu de se consacrer uniquement à ce guide des lectures pour les prêtres et les familles, lu bien au-delà du cercle catholique. En 1913, le mensuel qui aborde tous les genres d’ouvrages, mais aussi de périodiques prend le titre de Guide des lectures.
-
BEUGNIEZ Louis
Condisciple de Maurice Thorez à l’école primaire supérieure d’Hénin-Liétard, Louis Beugniez est employé aux Mines de Dourges de 1922 à 1935. En 1929, il milite dans les rangs de la Jeunesse ouvrière chrétienne et crée, le 1 er juin, à destination de ses camarades L’Ouvrier. Trait d’union mensuel des membres sympathisants jocistes de la section Saint-Benoît . Ce «canard prolétaire», comme il le qualifie lui-même, fait avec les moyens du bord, paraît irrégulièrement jusqu’en juin 1933.
Deux ans plus tard, Louis Beugniez devient secrétaire permanent de la CFTC des employés des Houillères et est élu maire de Noyelles-Godault. Mobilisé en 1939, il est démis de ses fonctions de maire par le régime après son retour dans sa ville. En 1943, il fonde avec Jules Catoire, un réseau de résistance d’inspiration chrétienne.
En novembre 1944, il devient secrétaire général de la fédération MRP du Pas-de-Calais. Il devient pendant quelques mois rédacteur au quotidien Nord Eclair. En octobre 1945, il est élu député du Pas-de-Calais à l’Assemblée constituante, réélu en juin 1946 dans la deuxième constituante. Il siège à l’Assemblée nationale jusqu’en juin 1951 où il n’est pas réélu. Il est maire de Noyelles-Godault de 1947 à 1971.
Source(s) :Base de données des députés français : www2.assemblee-nationale>Histoire>base de données; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, op. cit., notice, L’Ouvrier.
-
BEURTHERET Fernand
Membre de la Jeunesse catholique et président de la JOC de Lille-Saint-Sauveur, Fernand Charles Beurtheret, fils d’un sellier installé à Lille, commence sa carrière de journaliste à La Croix du Nord. Il rejoint ensuite Le Grand Echo du Nord où il est rédacteur détaché à Armentières, poste qu’il occupe jusqu’à la Libération. En 1944, il entre à Nord-Eclair où il est chroniqueur judiciaire.
-
BIANCHI Alphonse Alexandre
Alphonse Bianchi naquit fils unique d’un émigré italien et d’une mère française. Il passa sa jeunesse rue des Chats-bossus, à Lille, à deux pas du magasin de broderie du père des frères Testelin. Il fréquenta le collège communal et monta à Paris pour faire des études de droit. Il voulait devenir avocat, mais en fut empêché par une condamnation politique. Il revint à
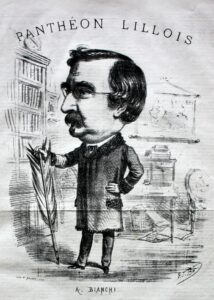
Portrait de Bianchi paru dans L’Abeille lilloise. Lille en 1837 pour exercer la profession de mouleur en plâtre comme son père et épousa Jenny Hortense Henripré, qui lui donna six enfants. Ayant fait la connaissance de Vincent Leleux, propriétaire de L’Écho du Nord, il publia anonymement nombre d’articles et de satires dans son journal. En 1841, il fonda la Société des Amis de Béranger avec Célestin Schneider et le compositeur d’imprimerie A. Jomain, également gérant d’un cahier de chansons mensuel les Publications lilloises , où l’on trouve des compositions de Alexandre Desrousseaux et de Decottignies, le poète roubaisien. Cette société chantante attirait tous les opposants au régime. En 1843, Bianchi fonde avec François Fémy Le Barbier de Lille (1843-1846), d’abord journal littéraire et satirique vite transformé en journal politique : « La pensée politique du Barbier de Lille est démocratique. Nous croyons que tous les citoyens devraient être égaux devant la loi comme ils le sont devant Dieu, Nous croyons qu’ils ont tous droit à la somme de liberté qui ne porte pas préjudice à la liberté d’autrui. » Le Barbier de Lille n’est pas socialiste : sans remettre en cause le principe de la propriété, Bianchi se lance dans la recherche des « moyens les plus propres à diminuer la misère qui pèse sur les travailleurs ». Partisan de la liberté de conscience, tolérant à l’égard de tous les cultes, Bianchi veut malgré tout que l’éducation soit dispensée à tous par l’Université. En mai 1846, Le Barbier de Lille devient Le Messager du Nord , organe de la «démocratie avancée», si radical qu’il fut interdit en décembre 1851. Bianchi a participé avec Testelin, Fémy et quelques autres à l’organisation de la campagne des banquets de 1847. L’année suivante, il est président du Club central républicain qui centralisait le travail de tous les clubs républicains du département. Bianchi est alors très populaire auprès des ouvriers de Lille et au-delà. Il passe pour le chef des républicains ; son esprit fougueux lui vaut quelques inimitiés qui l’amènent plusieurs fois sur le pré, par exemple contre Sauvé, rédacteur du journal littéraire de Wazemmes, Le Moulin-à-vent . En 1849, il est naturalisé français. Membre du conseil municipal et du conseil général, il doit se réfugier en Belgique après le coup d’Etat de 1851. Il en fut expulsé vers l’Angleterre ; de là, il passa à Jersey, où il participa comme rédacteur et correcteur au journal L’Homme . À Jersey, Bianchi, franc-maçon lillois de la loge La Fidélité, fréquente la loge La Césarée n° 860, d’abord en tant que visiteur à partir du 11 novembre 1853, puis très régulièrement en tant que membre jusqu’au 22 septembre 1856, en même temps que Pierre Leroux. De Jersey, il gagna Genève où il profita de l’amnistie de 1859 pour rentrer en France. En 1865, il prit la direction de L’Écho populaire de Lille , avec Fémy, P. Lepercq, Huidiez et Hippolyte Verly. L’année suivante, il fonda avec les mêmes Le Messager populaire de Lille , qui dura cinq mois. Bianchi, qui fut aussi poète, a également collaboré à La Revue du Nord , et à L’Atelier (Paris). Il est enterré à Lille. Sa tombe se trouve au cimetière de l’Est (C 10 face C 12). Elle porte un sceau maçonnique comme ornement.
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, op. cit.; Visse, Jean-Paul, La Presse du Nordet du Pas-de-Calais au temps de L’Écho du Nord, 1819-1944, op. cit.
-
BIDOUX Marcel
Marcel Bidoux adhère au parti socialiste en 1918, et devient secrétaire administratif de la Fédération socialiste SFIO du Pas-de-Calais au lendemain de la scission de Tours, en décembre 1920. Il conserve ce poste jusqu’au début des années 1930. Gérant de L’ Éclaireur , organe de la Fédération depuis 1921, il abandonne ce poste et monte à Paris au siège de la SFIO pour épauler Paul Faure. Il est secrétaire de rédaction du Populaire , avant de devenir chef du service politique et parlementaire de ce journal. Membre de la commission exécutive de la fédération de la Seine, puis de la Commission administrative permanente de 1929-1931, il tente de se faire élire, sans succès. Pendant la guerre, il rejoint d’abord Marseille pour travailler au Mot d’ordre que Louis-Oscar Frossard vient de lancer. Revenu à Paris, il propose et obtient de Daniel Mayer la création du journal socialiste clandestin Gavroche (10 numéros parus). À la Libération, Gavroche reparaît le 9 novembre 1944, avec le sous-titre hebdomadaire littéraire, artistique, politique et social, Marcel Bidoux y participe activement sous le pseudonyme de Jean Fresnoy, tout en continuant à écrire dans Le Populaire . Après la disparition de Gavroche le 26 mai 1948, Bidoux travaille comme rédacteur politique pour La France de Bordeaux, et termine sa carrière à La Nouvelle République du centre-ouest .
Source(s) :Demonsais, Bruno, Gavroche, hebdomadaire culturel socialiste, de la Résistance à la guerre froide, Paris, L’Harmattan, 2006.
-
BIEBUYCK André
 André Biebuyck a été journaliste pendant une vingtaine d’années à Hazebrouck, d’abord pour L’Echo du Nord (à partir de 1931) puis, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à sa mort, pour La Voix du Nord.
André Biebuyck a été journaliste pendant une vingtaine d’années à Hazebrouck, d’abord pour L’Echo du Nord (à partir de 1931) puis, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à sa mort, pour La Voix du Nord.Il est surtout connu à Hazebrouck pour avoir été le directeur artistique du cercle musical et théâtral de l’Orphéon dont il a écrit les Revues à partir de 1914. Il préparait le centenaire de l’Orphéon lorsqu’il est mort le 30 mars 1954. Les festivités prévues pour les 5 et 6 juin suivants furent maintenues, un hommage lui étant rendu à cette occasion par le baptême d’une rue portant son nom. Il s’agit de l’ancienne rue de l’Hôtel-de-Ville, dans laquelle le journaliste avait son bureau.
André Biebuyck avait également eu une courte carrière politique. De 1919 à 1925, il fut maire de Vieux-Berquin et conseiller d’arrondissement du canton de Bailleul sud-ouest sous l’étiquette de républicain de gauche.
Source(s) :Jean- Pascal Vanhove, Ce que racontent les rues d’Hazebrouck, Bailleul, 2007, p. 83-85.
-
BIGUET André
Pseudonyme d’Arsène Joseph.
-
BILLET Paul
Etudiant dans une école de commerce, Paul Billet opte pour le journalisme et commence sa carrière professionnelle au quotidien lillois La Dépêche du Nord . Mobilisé en 1940, il est fait prisonnier et envoyé en captivité en Allemagne. En juillet 1941, il est rapatrié en raison de son état de santé . Il travaille alors à l’Office des corps gras. A la Libération, il entre à La Voix du Nord où il devient chef du secrétariat de rédaction. Homme cultivé, il assume encore après sa retraite la critique des spectacles de danse. Engagé dans la vie associative, il était titulaire de la médaille du Mérite social.
Source(s) :La Voix du Nord, 21 janvier 1985.
-
BINAUT Louis
Louis Binaut fut pendant plusieurs années rédacteur en chef de La Gazette de Flandres et d’Artois , et l’un des principaux collaborateurs de La Revue du Nord (1834). Il se retira ensuite dans le Berry pour y mener une expérience agricole. Après avoir échoué, il se rendit à Paris, collaborant à plusieurs organes, principalement La Revue des deux Mondes . Il y a publié de nombreuses études littéraires (« Homère et la philosophie grecque », « Sophocle et la philosophie du drame chez les Grecs », « Ménandre et la comédie de mœurs » etc.) et des articles historiques (« Les origines de la République des Etats-Unis » , « Une cour féodale au XII e siècle », « La trêve de Dieu », « Lamennais et sa philosophie », etc.).
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, op. cit
-
BIS Hippolyte
Hippolyte Bis est plus connu comme auteur dramatique et librettiste que comme journaliste. Né à Lille, il collabora cependant à L’Echo du Nord, puis au Mémorial de la Scarpe .
-
BIZEMONT vicomte Adrien Marie Charles
Né dans le Berry, Adrien Marie Charles de Bizemont est le fils d’André Louis Maximilien comte de Bizemont et d’Antoinette Louise Félicité Marie de Monspey. Il se fixe dans le Pas-de-Calais à l’occasion de son mariage avec Mlle Berthe Marie Mathilde le Bailly d’Inghen.
Durant la guerre 1870, sous-lieutenant des cuirassiers, le vicomte de Bizemont participe en août à la charge de Reichshoffen. En 1893, il se présente à la députation dans la circonscription de Saint-Pol-sur-Ternoise contre le député sortant Georges Graux.
Elu maire de Neulette, il est suspendu à plusieurs reprises pour paroles outrageantes envers le gouvernement de la République.
Le vicomte de Bizemont est un collaborateur régulier deLa Croix du dimanche d’Arras, de l’Artois et des mines. Il meurt à Neulette à l’âge de 64 ans.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 3 E 605/8; Le Grand Echo du Nord, 9 août 1898.
-
BLANCHARD Ovide
Employé à la mairie de Lens, Anatole Ovide Joseph Blanchard fait ses débuts dans le journalisme lors du lancement du premier périodique édité dans ville le 4 janvier 1880, L’Echo de Lens dont il assume la rédaction en chef. En avril 1880, il participe à la fondation du périodique radical , Le Petit Béthunois dont il est le rédacteur en chef, puis, après la mort du docteur Eugène Haynaut en 1891, directeur politique. En désaccord sur son orientation avec le nouveau propriétaire du journal, Jules Logier, il le quitte après dix ans de collaboration. En juillet 1900, Ovide Blanchard fonde L’Avant-garde. Organe de la démocratie et des intérêts commerciaux et industriels de l’arrondissement de Béthune . Selon un rapport du commissaire de Béthune, « sur le terrain démocratique, les fondateurs de L’Avant-garde [combattent] énergiquement le parti dit « nationaliste » ». Son tirage serait alors de 4000 exemplaires, pourtant le journal disparaît en janvier 1901. Deux ans plus tard, le 18 octobre 1903, Ovide Blanchard fonde avec Ernest Tabuteau un nouvel hebdomadaire imprimé à Liévin par Loutte, La Feuille du peuple. Organe de la démocratie socialiste du bassin houiller du Pas-de-Calais . Le 11 février 1904, à l’occasion des élections municipales où les deux hommes soutiennent la candidature du socialiste Lamendin, un conflit intervient avec l’imprimeur et la parution du journal est interrompue jusqu’ au 24 avril. Ovide Blanchard quitte le journal peu de temps après. Il devient alors receveur buraliste à Burbure où il meurt dans sa 55e année.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 3 E 188/18; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, op. cit.
-
BLANCKAERT Michel
Michel Blanckaert succède à Alfred Dodanthun à la tête de L’Indicateur de la région flamande.
-
BLANCKAERT Serge
Fils de Maurice André Charles Blanckaert, résistant mort en déportation à Sonnenburg en Prusse orientale, Serge Blanckaert est entré comme journaliste au Nouveau Nord Maritime en 1953. Il intègre la rédaction dunkerquoise de La Voix du Nord en 1956. Il devient chef d’édition en 1985 et le reste jusqu’à sa retraite en 1991. Il fonde alors un hebdomadaire, Les Dunkerquois , dont l’existence est éphémère. Féru d’histoire, Serge Blanckaert avait également milité pour la création du musée des deux guerres à Dunkerque. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Dunkerque pendant la seconde guerre, alimentés notamment par le témoignage des acteurs de l’époque: L’Infernale Bataille de Dunkerque (1976), Le Siège le plus long (1977), Notes sur l’occupation (1978), Le 110 e RI, le régiment de Dunkerque (1993), Dunkerque 1944-1945. Du débarquement à la résurrection (1995) Dunkerquois sur tous les fronts (1996 ),… Serge Blanckaert meurt le 6 avril 2009.
Source(s) :La Voix du Nord, 7 avril 2009; Dictionnaire Biographique dunkerquois.
-
BLANQUART-EVRARD Louis
 D’abord préparateur pour les cours de chimie de Kuhlman, peintre de miniatures sur ivoire et porcelaine, domaine dans lesquels il obtint un succès certain, Blanquart-Evrard étudia la photographie alors naissante, et tout particulièrement la reproduction sur papier des clichés photographiques. Il s’employa à perfectionner le calotype breveté par William Henry Fox Talbot en 1840. Ce en quoi il a bien mérité de la presse. Il présenta ses travaux à l’Académie des sciences, il obtint des récompenses aux expositions universelles de New York, de Bruxelles, et Amsterdam, et il fonda à Loos une imprimerie photographique dirigée par son ami H. Fockedey en 1851. Cinquante ouvrières y travaillaient, produisant trois cents tirages par jour. Ils y ont « imprimé » les illustrations de livres ( Voyage en Egypte, Nubie, Palestine et Syrie ; Jérusalem ) et d’albums de photos (Les Pyrénées ; Les Bords du Rhin ; L’Art religieux ; L’œuvre de Poussin , etc.). Membre de la Société d’encouragement et de la Société libre des Beaux-Arts de Paris, Blanquart-Evrard fut membre de la Commission historique du Nord, de la Société des sciences de Lille, il a écrit deux livres : L’Intervention de l’art dans la photographie et le premier Traité de photographie (dans la collection Roret), ainsi que de nombreux articles sur le sujet dans Le Bulletin de la Société française de photographie, Le Moniteur de la photographie, et les revues Le Cosmos et La Lumière. En 1856, il avait fondé, en collaboration avec Thomas Sutton, le Photographic Notes, un magazine qui fut publié onze ans de rang. En savoir plus : Isabelle Jammes, Blanquart-Évrard et les origines de l’édition photographique française : catalogue raisonné des albums photographiques édités, 1851-1855, Histoire et civilisation du livre, Mémoire de l’École pratique des hautes études, IVe section, janvier 1980, 325 p. ; Jean-Claude Gautrand et Alain Buisine, Blanquart-Évrard, Centre régional de la photographie du Nord-Pas-de-Calais, Douchy-les-Mines, 1999, 177 p.Source(s) :
D’abord préparateur pour les cours de chimie de Kuhlman, peintre de miniatures sur ivoire et porcelaine, domaine dans lesquels il obtint un succès certain, Blanquart-Evrard étudia la photographie alors naissante, et tout particulièrement la reproduction sur papier des clichés photographiques. Il s’employa à perfectionner le calotype breveté par William Henry Fox Talbot en 1840. Ce en quoi il a bien mérité de la presse. Il présenta ses travaux à l’Académie des sciences, il obtint des récompenses aux expositions universelles de New York, de Bruxelles, et Amsterdam, et il fonda à Loos une imprimerie photographique dirigée par son ami H. Fockedey en 1851. Cinquante ouvrières y travaillaient, produisant trois cents tirages par jour. Ils y ont « imprimé » les illustrations de livres ( Voyage en Egypte, Nubie, Palestine et Syrie ; Jérusalem ) et d’albums de photos (Les Pyrénées ; Les Bords du Rhin ; L’Art religieux ; L’œuvre de Poussin , etc.). Membre de la Société d’encouragement et de la Société libre des Beaux-Arts de Paris, Blanquart-Evrard fut membre de la Commission historique du Nord, de la Société des sciences de Lille, il a écrit deux livres : L’Intervention de l’art dans la photographie et le premier Traité de photographie (dans la collection Roret), ainsi que de nombreux articles sur le sujet dans Le Bulletin de la Société française de photographie, Le Moniteur de la photographie, et les revues Le Cosmos et La Lumière. En 1856, il avait fondé, en collaboration avec Thomas Sutton, le Photographic Notes, un magazine qui fut publié onze ans de rang. En savoir plus : Isabelle Jammes, Blanquart-Évrard et les origines de l’édition photographique française : catalogue raisonné des albums photographiques édités, 1851-1855, Histoire et civilisation du livre, Mémoire de l’École pratique des hautes études, IVe section, janvier 1980, 325 p. ; Jean-Claude Gautrand et Alain Buisine, Blanquart-Évrard, Centre régional de la photographie du Nord-Pas-de-Calais, Douchy-les-Mines, 1999, 177 p.Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, op. cit.
-
BLONDEL Louis
Elève au collège d’Arras, Louis Blondel embrasse le métier de son père après la mort de celui-ci en 1866 et devient brasseur. Cofondateur du Comité républicain libéral, qui regroupe des catholiques ralliés à la République, il participe, en juillet 1893, à la création du journal La République libérale d’Arras et du Pas-de-Calais. Il est nommé président du Conseil d’administration de la société éditrice.
Hebdomadaire, le périodique devient quotidien le 15 octobre 1894 tout en conservant une édition du dimanche. Le quotidien cesse sa parution en janvier 1897, tandis que l’hebdomadaire continue jusqu’en 1899.
Ayant des problèmes de santé, Louis Blondel s’était retiré en septembre 1896, faisant de nombreux séjours à Cannes. Il avait été président du tribunal de commerce. Membre de l’Académie d’Arras à partir de juillet 1897, il avait succédé au fauteuil de l’avocat Paris, fondateur du journal Le Pas de Calais, ancien ministre et sénateur. Particulièrement attentifs aux questions sociales, il avait publié plusieurs ouvrages dont La Politique libérale et les libéraux, leur credo et leur programme politique, Principes d’économie industrielle appliqués, pour l’exemple, à l’administration d’une brasserie, La Théorie du bénéfice,…
Source(s) :La République libérale, juillet 1893-septembre 1896.
-
BLONDIAU André
Journaliste au service des sports de La Voix du Nord , André Blondiau entre au quotidien lillois le 1 er mai 1958. Spécialiste du football, il y fit toute sa carrière jusqu’à sa retraite.
-
BOCQUET Léon
Léon Bocquet est rédacteur en chef du Journal de Roubaix , directeur du Beffroi . De 1905 et pour quelques années Le Journal de Roubaix a pour rédacteur en chef Léon Bocquet, l’animateur de la revue littéraire Le Beffroi , qu’il amène alors à Roubaix.
Outre son œuvre littéraire personnelle, Bocquet a traduit J. O. Curwood, et R. L. Stevenson.
-
BODEREAU Georges
« L’affaire Bodereau », « Le cas Bodereau ». En octobre 1892, le journaliste Georges Bodereau fait la Une de nombreux quotidiens. A Calais, des affiches sont placardées sur les murs. Secrétaire de rédaction au Petit Calaisien fondé en 1887 par Naudin, il vient d’être révoqué de son grade d’officier d’administration adjoint de la réserve « en raison de ses attaches avérées avec le Parti socialiste ».
Né le 23 mars 1861 au Mans, Georges Louis Joseph Bodereau est le fils d’un inspecteur de la Société mutuelle mobilière. Selon son livret militaire, il commence sa vie professionnelle comme employé de banque. De novembre 1882 à septembre 1886, il effectue son service militaire qu’il termine avec le grade de sergent d’exploitation. Probablement entre-t-il dans la presse dans les mois qui suivent. Il rejoint d’abord le quotidien parisien L’Impartial où il a son premier duel contre l’un de ses collègues Touron. On y trouve sa signature jusqu’en novembre 1887, puis il semble faire un retour vers sa ville natale.
En juillet 1889, il arrive à Calais où il devient secrétaire de rédaction et gérant du Petit Calaisien. Il y signe des articles sous son nom ou sous le pseudonyme de Jacques Flesselles – du nom de jeune fille de sa mère. Il assume également la correspondance du Petit Journal et de l’agence Havas. L’homme a le sang chaud, il se reconnaît un caractère emporté et violent, n’hésitant pas à mettre « une gifle par an ». Lorsque « l’affaire » éclate en 1892, il s’est déjà battu en duel, il a déjà trois condamnations pour violences et voies de fait à son passif. La dernière lui a valu six jours de prison et 300 F d’amende. Membre de l’association des journalistes républicains, cette société hésite à le défendre. Heureusement pour lui, à la fin du mois de novembre, il est réintégré dans son grade d’officier d’administration adjoint par un décret présidentiel.
En février 1895, il fait partie des personnalités avec Naudin qui accueillent et prennent la parole lors du passage à Calais d’Henri Rochefort. Réfugié à Londres, le rédacteur en chef de L’Intransigeant, condamné par contumace en juillet 1889 à la déportation perpétuelle pour son soutien au général Boulanger, vient d’être amnistié. En mai, Georges Bodereau se marie avec Justine Marie Emelie Hache. Ses témoins sont Georges Robert, rédacteur en chef du Progrès du Nord et Emile Lemaître, rédacteur en chef de L’Indépendant de Boulogne-sur-Mer. Poète à ses heures, parrainé par Jules Claretie et Emile Zola, il est admis en mars 1896 à la Société des gens de Lettres. Parallèlement, il est secrétaire de l’Association amicale et professionnelle des journalistes républicains du Pas-de-Calais.
« Intelligent et actif », écrivant « avec facilité » selon un rapport du commissaire des chemins de fer adressé au préfet du Nord, « il ne manque jamais une occasion de montrer son hostilité contre l’armée et ses chefs auxquels il ne peut pardonner sa cassation d’officier. » En mars 1898, il est encore condamné à 300 F d’amende et 1 000 F de dommages et intérêts pour avoir annoncé la présence de l’ancien sénateur Cadart, président du conseil général du Pas-de-Calais, à une réunion électorale à laquelle il ne participait pas et avoir eu des paroles offensantes à son égard.
En janvier 1899, le bruit court à Armentières que Bodereau va racheter le périodique de Verbaere, le Journal d’Armentières. Le journaliste a beau affirmer qu’il n’est « pas socialiste de conviction […] que dans son journal, il défendra une politique simplement républicaine », le député de la circonscription et le maire de la ville sont, selon la police, à la manœuvre pour faire échouer la vente. Après cet échec, Bodereau quitte la région du Nord-Pas-de-Calais pour Paris.
En juin 1901 à Paris, en vue des élections législatives de 1902, est fondé le Parti radical et radical-socialiste. Lorsqu’il se structure, Bodereau, qui est membre de la maçonnerie, est élu secrétaire, puis vice-président. En vue du scrutin d’avril-mai, il gagne Pau pour diriger la rédaction du Progrès des Basses-Pyrénées qui sort à partir du 9 mars afin de soutenir le candidat radical-socialiste, l’avocat Georges Madaune, conseiller municipal et conseiller général. Très rapidement, la polémique s’engage et enfle avec le rédacteur en chef du Mémorial des Pyrénées. Celui-ci lui envoie ses témoins, mais Bodereau, assagi, lui refuse toute réparation par les armes et toute rétractation de ses propos. Georges Madaune ne dépasse pas le premier tour, le 16 mai 1902, Le Progrès de Basses-Pyrénées cesse sa parution et Georges Bodereau regagne Paris où sa femme, âgée de 28 ans, meurt en octobre. Le journaliste est également engagé dans des organismes professionnels : Syndicat de la presse socialiste, Association et syndicat de la presse républicaine départementale, Caisse des retraites des dames et d’assistance aux orphelins qu’il préside. En février 1903, il est nommé officier d’Académie.
En juillet de la même année, il fonde La Dépêche de Rouen et de Normandie dont il est le directeur politique. Deux ans plus tard, il répond à l’appel du directeur du Petit Comtois dont il devient rédacteur en chef à « l’essai ». N’ayant pas trouvé les appuis qu’il souhaite, il dit au revoir à ses lecteurs le 1er mai 1907. Georges Bodereau passe ensuite au Gâtinais, puis au Républicain d’Etampes, Corbeil et Rambouillet à l’existence éphémère. Lorsqu’il se remarie en août 1912 avec Rachel Habib, il est directeur de L’Indépendant de Semur-en-Auxois. Puis, on le retrouve à L’Indépendant du Morvan, journal républicain de l’arrondissement d’Autun.
A la faveur de la colonisation, de nombreux périodiques spécialisés ont été créés, Georges Bodereau est un acteur de la presse coloniale. Alors qu’il est encore dans le Nord, il fonde La Vie coloniale en 1897. Le titre n’a qu’une brève existence, ce qui n’empêche pas le journaliste de persévérer. Il participe à la création ou collabore à L’Action coloniale, La Presse coloniale, L’Autre France, Colonisation française… Membre du Syndicat de la presse coloniale à partir du 1er mars 1900, il est élu membre du comité en 1906 et, par la suite, secrétaire général. Le 23 février 1925, c’est à ce titre qu’il est nommé chevalier de la Légion d’honneur par le ministre des Colonies.
Lors de la guerre 1914-1918, il n’hésite pas à reprendre du service et gagne le grade de lieutenant. Cet engagement ne l’empêche pas de poursuivre son activité de journaliste. En 1916, il devient administrateur et rédacteur de l’hebdomadaire La Grimace, satirique, politique, coloniale, littéraire, théâtrale. Il y donne régulièrement un « croquis du front » et diverses chroniques. Après la guerre, il en devient directeur-administrateur et signe chaque semaine des articles sous son nom ou sous son pseudonyme de Jacques Flesselles. Durant l’après-guerre, Georges Bodereau reste un homme engagé au sein du Parti radical et radical-socialiste, mais aussi d’organismes professionnels, notamment le syndicat général de la presse. En 1924, il prend ainsi, dans la presse de sa région natale, la défense de Joseph Caillaux, ancien chef du gouvernement, condamné à trois ans de prison pour « correspondance avec l’ennemi ».
Retiré dans sa maison de Seine-et-Oise, il meurt en janvier 1941. Le quotidien L’œuvre, de sensibilité radical-socialiste passé à la collaboration sous la direction de Marcel Déat, est probablement le seul à annoncer sa mort. Georges Bodereau était l’auteur de romans : L’Aurore et la vie, Vers l’inceste, mais aussi de nouvelles et de poèmes.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/1; AD Pas-de-Calais, 5 Mir 193/52;AD Sarthe, 1 R 1248; Arch Paris, 9 M 278; site de Légion d’honneur; de nombreux quotidiens de 1887 à 1930, L’Œuvre, 12 janvier 1941.
-
BOLVIN Charles
Fils d’un employé des Chemins de fer du Nord, Charles Emile Bolvin embrasse d’abord la carrière des armes qu’il quitte après cinq ans de service avec le grade de sergent. «Son intelligence vive, son esprit, sa perception nette des choses, son entrain primesautier, écrit le 6 décembre 1923 dans Le Nord maritime Albert Salignon, lui facilitèrent ses débuts dans le journalisme.» Charles Bolvin entre en effet dans le quotidien dunkerquois tout juste créé par Chiroutre comme vendeur de journaux, puis reporter. En 1895, la police ne se montre guère tendre à son égard tant sur le plan personnel que professionnel : «Sans instruction, peu capable de rédiger lui-même un article sérieux, il est souvent le prête-nom des réactionnaires qui veulent calomnier sans se faire connaître.» Fait-diversier, le 18 mai, il vient d’être condamné à douze jours de prison, 2400 F d’amende et 3600 F de dommages et intérêts pour diffamation. Il l’a déjà été en juillet 1892 pour coups et blessures et outrages à un officier. Selon Henri Langlais, président de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, il est ensuite rédacteur à l’agences Havas. A la fin des années 1890, il rejoint Le Phare de Nord où il est successivement reporter, chef des informations puis codirecteur. La réputation de l’homme a probablement évolué, le 28 octobre 1908, il est en effet nommé officier d’Académie. Bien qu’âgé de plus de 47 ans, donc exempt de toute obligation militaire, Charles Bolvin s’engage dès le début de la guerre le 6 août 1914 au 110 e RI. Dès octobre, il est nommé adjudant et reçoit la médaille militaire. Soldat courageux et exemplaire, il est blessé par des éclats d’obus le 16 février 1915 à Mesnil-les-Hurlus dans la première bataille de Champagne. Elevé au grade de sous-lieutenant en mars, il est nommé, en juillet 1916, adjoint au commandant du camp de Caussade en Dordogne et reçoit, en octobre, la croix de Guerre avec palme. Il termine la guerre avec le grade de lieutenant. Lorsqu’il retrouve la vie civile, Charles Bolvin reprend son métier de journaliste au Nord maritime où il est chargé de la rubrique maritime et signe sous le pseudonyme de Jean des Darses une chronique, «ca et là» où «il apportait, dit son rédacteur en chef, toute l’originalité de son style, la variété inépuisable de ses souvenirs, sa parfaite connaissance du terroir, un humour malicieux et, parfois caché sous des mots qui faisaient surtout rire, une verve caustique habilement dosée». Il est également le rédacteur-correspondant du Grand Echo du Nord pour l’arrondissement de Dunkerque, mais aussi de journaux parisiens. Toujours très actif – il était membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, du groupement des journalistes professionnels de Dunkerque, du Comité d’initiative de Dunkerque-Malo-les-Bains – il meurt brusquement à l’âge de 56 ans. Lors de ses funérailles, plusieurs personnalités lui rendent hommage.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/10; site Léonore, dossier de Légion d’honneur; Le Nord maritime, 6 et 8 décembre 1923; Le Grand Echo du Nord, 29 juin 1919 et 9 décembre 1923.
-
BON Joseph
Ancien étudiant en droit de l’université catholique de Lille, Joseph Bon est docteur en droit. En 1894, il est rédacteur en chef de La Dépêche du Puy-de-Dôme . Il regagne le Nord où il rejoint le quotidien catholique et royaliste La Vraie France . Après la mort de Gabriel Boyaval, survenue en mars 1896, il est nommé rédacteur en chef. Le 30 juin 1897, La Vraie France cessant sa parution, il y publie son dernier éditorial. Durant son séjour lillois, il donne des cours à la section des sciences sociales et politiques de la faculté libre de droit de Lille. En mars 1898, il participe au congrès des Œuvres de la jeunesse catholique organisé à l’Université catholique de Lille où il donne un rapport sur la presse. Joseph Bon rejoint Paris où il rédacteur au quotidien catholique La Vérité. On retrouve également sa signature dans L’Echo de Paris , mais aussi dans quelques titres de province. Il collabore à la Revue française politique et littéraire et à La Revue pour tous. En 1925, lors du mariage de l’un de ses fils à Vaudricourt dans le Pas-de-Calais, La Croix du Nord le présente comme secrétaire du député nationaliste des Vosges, Maurice Flayelle.
Source(s) :Choquet (René), La Vraie France; Bulletin des facultés catholiques de Lille, décembre 1897, n° 219, tome XIX; La Vérité, 31 mars 1894; L’Univers, 13 mars 1898; La Croix du Nord, 23 octobre 1925.
-
BONAPARTE Charles Louis Napoléon
 Après l’échec lamentable de ses coups d’Etat, le prince entra en contact avec les républicains français. Ceux-ci désignèrent Frédéric Degeorge, directeur du Progrès du Pas-de-Calais comme émissaire auprès de lui. Les discussions, parfois orageuses, n’aboutirent pas, le prince refusant le régime républicain, lui préférant bien sûr l’empire. Mais les deux hommes avaient, dans une certaine mesure, sympathisé, et Degeorge, tout en restant fermement républicain, n’hésita pas à rendre service à Napoléon. Il lui rend visite au fort de Ham, et lui ouvre largement les colonnes de son journal, en particulier en 1843-1844. Le prince aborde dans ses articles les sujets les plus divers, des rapports entre l’Église et l’État au sucre de betterave, en passant par les comètes, les questions militaires ou la politique étrangère de Louis-Philippe. Il y publie en particulier une série d’articles qui seront repris en brochure sous le titre Extinction du paupérisme. Ces services rendus vaudront à Degeorge et son journal une certaine sollicitude de la part du Prince-Président, puis de L’Empereur, quand bien même il n’abandonnera jamais son combat pour la République.
Après l’échec lamentable de ses coups d’Etat, le prince entra en contact avec les républicains français. Ceux-ci désignèrent Frédéric Degeorge, directeur du Progrès du Pas-de-Calais comme émissaire auprès de lui. Les discussions, parfois orageuses, n’aboutirent pas, le prince refusant le régime républicain, lui préférant bien sûr l’empire. Mais les deux hommes avaient, dans une certaine mesure, sympathisé, et Degeorge, tout en restant fermement républicain, n’hésita pas à rendre service à Napoléon. Il lui rend visite au fort de Ham, et lui ouvre largement les colonnes de son journal, en particulier en 1843-1844. Le prince aborde dans ses articles les sujets les plus divers, des rapports entre l’Église et l’État au sucre de betterave, en passant par les comètes, les questions militaires ou la politique étrangère de Louis-Philippe. Il y publie en particulier une série d’articles qui seront repris en brochure sous le titre Extinction du paupérisme. Ces services rendus vaudront à Degeorge et son journal une certaine sollicitude de la part du Prince-Président, puis de L’Empereur, quand bien même il n’abandonnera jamais son combat pour la République.B. G.
Source(s) :Fortin, André, Frédéric Degeorge, Lille, Université de Lille, Faculté des lettres et sciences humaines, 1964, 227 p.
-
BONNARDEL
Secrétaire général du syndicat des verriers de bouteilles à Manières et membre du Parti ouvrier Emile Bonnardel est candidat du le Parti ouvrier français lors des élections législatives de 1893 et de 1898 dans la 1 re circonscription de Cambrai. En février 1900, il est rédacteur au journal L’Avant-garde , lancé à Cambrai par son parti à l’occasion des élections municipales où il mène la liste des «collectivistes» contre Paul Bersez.
Source(s) :AD Nord, 14 février 1900; Le Grand Echo du Nord, 7 août 1893, 10 octobre 1893, 16 avril 1898, 20 mai 1900.
-
BONTE Florimond
 Séminariste, Florimond Bonte est d’abord instituteur dans l’enseignement catholique. Puis il devient métreur en bâtiment et publiciste. Militant démocrate-chrétien, il adhère au Parti socialiste puis, après le congrès de Tours, au Parti communiste. Membre du comité central à partir de 1924 – et jusqu’en 1964 – il entre au bureau politique en 1934.
Séminariste, Florimond Bonte est d’abord instituteur dans l’enseignement catholique. Puis il devient métreur en bâtiment et publiciste. Militant démocrate-chrétien, il adhère au Parti socialiste puis, après le congrès de Tours, au Parti communiste. Membre du comité central à partir de 1924 – et jusqu’en 1964 – il entre au bureau politique en 1934.Florimond Bonte est rédacteur en chef de l’Enchaîné de 1923 à 1929 où il rejoint L’Humanité pour occuper les mêmes fonctions. En 1933-1934, il est correspondant du quotidien communiste à Moscou. A son retour, il devient directeur des Cahiers du bolchévisme . Après la guerre et jusqu’en 1956, il dirige France nouvelle. Elu député de la Seine en 1936, il est arrêté en novembre 1939 et condamné le 3 avril 1940 à cinq ans de prison par le tribunal militaire de Paris. Détenu dans divers établissements pénitentiaires, il se retrouve à la prison militaire d’Alger. En avril 1943, il est libéré et devient quelques mois plus tard délégué à l’Assemblée consultative à Alger. De retour en France métropolitaine à la Libération, il est député des deux assemblées constituantes élues le 21 octobre 1945 et le 2 juin 1946. De novembre 1946 à juin 1958, il est député de la Seine.
Florimond Bonte meurt à l’âge de 87 ans après plusieurs mois d’hospitalisation. Il est enterré dans son Nord natal à Wattrelos.
Source(s) :Base de données des députés français depuis 1789, site de l’Assemblée nationale.
-
BOTTIN Sébastien
Moine, Sébastien Bottin quitta son couvent sous la Révolution, et fut embauché comme employé au secrétariat général du Bas-Rhin lorsque Napoléon créa les préfectures. Il publia des annuaires statistiques de ce département pour les années VII, VIII et IX. C’était là les tous premiers du genre. En 1893, il fut appelé par Dieudonné, son ami, alors préfet du Nord, au secrétariat général de la préfecture. Il y restera jusqu’à la chute de l’Empire en 1814.
Le nouveau secrétaire général joue un rôle important dans le renouveau de la vie intellectuelle dans le Nord, donnant des articles à des publications de Lille et Douai, aidant en particulier au lancement des Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique , et favorisant la création de sociétés littéraires. L’Empereur avait demandé à tous les préfets de faire exécuter un ouvrage statistique sur leur département, selon un plan dressé par le ministre Chaptal. Cet ordre resta lettre morte dans nombre de départements. Pas dans le Nord, où, à la demande de Dieudonné, Bottin se chargea de collationner les données constituant la Statistique du département du Nord , trois gros volumes parus en 1804 à Douai chez Marlier. Cette Statistique a été continuée par un annuaire statistique annuel. Sous la Restauration, Bottin alla s’établir à Paris, où il fonda L’Almanach du commerce , qui connut le succès que l’on sait, devenant L’Almanach-Bottin . Sébastien Bottin fut président de la Société des sciences et arts de Lille, secrétaire de la Société des Antiquaires de France, et membre de nombreuses sociétés savantes du Nord et Bas-Rhin, ainsi que de la Société royale et centrale d’agriculture. Sébastien Bottin est également l’auteur de livres et brochures dont plusieurs concernent le Nord: Sur la culture de l’orme dans le département du Nord, s. d. ; Notice sur les eaux et boues thermales et minérales de Saint-Amand, Lille, Marlier, 1805 ; Sur quelques monuments celtiques découverts dans le département du Nord, Lille, V. Leleux, 1813 ; Tableau statistique de toutes les foires de la France, … accompagné d’un résumé statistique sommaire en tête de chaque département…, 1825 ; Mélanges d’archéologie: précédés d’une notice historique sur la société royale des antiquaires de France, et du cinquième rapport sur ses travaux, 1831 .
Source(s) :Dinaux, Arthur, «Sébastien Bottin», Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique, 3e série, tome 3, décembre 1852, pp. 417-419.
-
BOUCHE Émile Eusèbe
« Secrétaire de la section de Lens de l’Union anarchiste, en 1925, Émile Bouché était (selon le Maitron ) très proche du Parti communiste et se qualifiait lui-même d’anarcho-communiste. Il y a sans doute identité avec Eusèbe Bouché qui en 1927 était membre du Syndicat autonome fédéraliste et révolutionnaire intercorporatif de Canonne-Liévin qui comptait une trentaine de militants dont Frédéric Lafrère et la famille Larivière (Louis, François, Sylvie, Gabrielle et Raymond). Ce groupe avait participé activement à l’organisation en août 1927 d’un meeting de Nicolas Lazarévitch en faveur de Sacco et Vanzetti. En 1928, Eusèbe Bouché était responsable de l’édition régionale du Pas-de-Calais de l’organe libertaire Germinal qui publiait également à l’époque des éditions dans le Nord et dans l’Oise. E. Bouche était en 1928 le trésorier de la Fédération du Pas-de-Calais de l’Association des fédéralistes anarchistes (AFA) dont le secrétaire était F. Michel. »
Source(s) :Repris de, Dictionnaire international des militants anarchistes, sur l’Internet.
-
BOUCHER Auguste
Orphelin à l’âge de 8 ans, Auguste Boucher était destiné au commerce par sa famille. Après un séjour en Angleterre, il prépare l’Ecole normale supérieure au lycée Napoléon. A sa sortie de Normale, il est nommé professeur au lycée d’Orléans, il est notamment chargé du cours spécial pour les jeunes filles.
Après la guerre de 1870, il soutient la cause conservatrice et collabore au Journal du Loiret. En 1875, il entre comme rédacteur politique au quotidien Le Français et collabore à la revue Le Correspondant. Installé à Paris, il est l’un des secrétaires de Philippe, comte de Paris et, à ce titre, l’un des organisateurs de son bureau de presse. Après la mort du prétendant au trône, le comte de Chambord en 1883, il met un terme à cette collaboration. Il reprend ses activités au Journal du Loiret qu’il dirige jusqu’en 1907.
Auguste Boucher est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Glossaire du patois picard en 1861, Etudes de mythologie celtique en 1869, Récits de l’invasion : journal d’un bourgeois d’Orléans pendant l’occupation prussienne en 1871, Le prince de Joinville pendant la campagne de France en 1873. Il était membre de l’Association professionnelle de la presse monarchique et catholique départementale. Après la mort de sa première épouse en 1877, il avait épousé la fille de Léon Lavedan, ancien préfet et directeur du Correspondant. Cette dernière meurt en avril 1887
Source(s) :AN, 305 AP; notice BnF, FRBNF12591932; divers journaux.
-
BOUCHET Émile, dit Doudelet
Émile Bouchet, anarchiste semble-t-il, après un rapide passage au Parti ouvrier, se mit au service de l’Union sociale et patriotique. L’U.S.P., formation regroupant les républicains opportunistes et les républicains « ralliés » tel Reboux et son Journal de Roubaix , avait pour but de remplacer le maire Carrette et son équipe du Parti ouvrier français par Gaston Motte, industriel roubaisien. Émile Bouchet, dit aussi Doudelet, est donc rédacteur au Roubaisien , hebdomadaire satirique animé par Deschamps, où il utilise plusieurs pseudonymes. La Lutte , hebdomadaire radical-socialiste, écrit, dans son numéro du 1 er avril 1896 : « ce morceau est signé du caméléon imberbe, C. Lemaime, Émile Boucher dit Doudelet, rédacteur au Roubaisien ». L’historien Jean Piat, utilisant un article du Cri du 8 juin 1921, accuse un certain nombre d’anarchistes d’avoir pactisé, en 1896, avec l’Union sociale et patriotique de Motte, et d’avoir reçu de ce dernier des sommes rondelettes en échange de leurs services : dénonciations de leurs camarades, informations sur les mouvements sociaux, création d’une liste destinée à gêner les socialistes aux élections municipales de 1896. Le seul nom cité est celui d’Émile Bouchet, qui aurait fourni un article chaque semaine au Roubaisien . Jean Piat précise d’ailleurs ses accusations dans son Jean Lebas : « Après un bref passage au Parti ouvrier de 1889 à 1894, il [Émile Bouchet] s’était mis au service de l’Union sociale et patriotique d’Eugène Motte en 1896. Moyennant une rétribution hebdomadaire à partager avec quelques compagnons, et cinq francs pour lui-même, il donnait chaque semaine au journal Le Roubaisien , un article dans lequel il traînait dans la boue ses anciens camarades. Un peu plus tard, il était devenu reporter à La Libre Parole , organe férocement antisémite. »
Source(s) :Piat, Jean, Jean Lebas, Paris, l’auteur, 1994, 527 p.
-
BOUCHEZ, Gustave
Gustave Bouchez fit se premières armes à 20 ans dans La Revue du Nord en 1854, puis soutint une polémique en vers contre Casimir Faucompré dans L’Écho de Lille . Il livra de nombreux poèmes à différents journaux de la ville, tout en assurant pour L’Écho du Nord , sous différents pseudonymes la critique musicale et littéraires. Il a publié Espoir et vérité , chez Dentu, et écrit des livrets, des chœurs, des romances, etc. pour différents compositeurs lillois.
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869…, op. cit.
-
BOUDENOOT Louis Charles FrançoisAprès des études au lycée de Saint-Omer, Louis Boodenoot obtint une licence en droit, avant d’entrer à l’École polytechnique en 1876, puis à l’École des mines en 1878. Ingénieur civil des mines, il a été président des Mines de Carvin. Il est également membre fondateur de la Société anonyme de crédit immobilier du Pas-de-Calais, avec Ribot, Jonnart et quelques autres. Cette société avait pour but de consentir des prêts hypothécaires individuels en vue de la construction de maisons à bon marché.
 En 1885, il est élu conseiller général de Fruges, il le restera jusqu’en 1922. De 1891 à 1901, il est élu et réélu député. En 1901, il est élu sénateur, il sera réélu jusqu’à sa mort en 1922.
En 1885, il est élu conseiller général de Fruges, il le restera jusqu’en 1922. De 1891 à 1901, il est élu et réélu député. En 1901, il est élu sénateur, il sera réélu jusqu’à sa mort en 1922.Parlementaire, il signera de nombreux rapports à caractère technique sur les « chemins de fer agricoles », – entendre les chemins de fer d’intérêt local destinés à désenclaver les campagnes –, la poste, la télégraphie, etc.
Il se lance très tôt dans la presse. Alors potache au lycée de Saint-Omer, il fonde avec son condisciple Jonnart un journal pour protester contre la discipline trop rigoureuse du lycée, initiative qui sera sévèrement réprimée, nous dit ce dernier. Plus tard, il donne des articles à caractère scientifique au Mémorial artésien , et devient secrétaire de rédaction du Portefeuille économique des machines, et des Nouvelles annales de la construction.
La Bibliothèque nationale de France ne conserve pas moins d’une centaine de rapports, propositions de loi et discours signés par Louis Boudenoot.
.
Source(s) :Vavasseur-Desperriers, Jean, République et liberté : Charles Jonnart, une conscience républicaine, 1857-1927, Villeneuve d’Ascq, Presse universitaires du Septentrion, 1996, et plusieurs sites informatiques.
-
BOULANGER Jean Baptiste
Jean Baptiste Boulanger est entré au quotidien lillois La Dépêche comme employé. Il devient chef des ventes, puis passe à la rédaction. La police le décrit, en septembre 1895, comme « un reporter très dégourdi », mais aussi comme «l’homme de confiance» de Langlais, directeur du journal. « Toujours au courant de tout », Boulangé «a des accointances partout, la police de sûreté le sert non seulement à titre de réciprocité, mais aussi parce qu’il sait user de grand moyen (sic), l’argent. Il a l’ordre de ne pas hésiter dans une pièce de 20 F.»
En juillet 1896, il est piétiné lors de la manifestation contre la venue des députés socialistes allemands venus participer au congrès du Parti ouvrier à Lille.
Source(s) :AD Nord, 1er, septembre 1895; Le Grand Echo du Nord, 26 juillet 1896 et jours suivants; La République libérale, 26 juillet 1896.
-
BOULINGUEZ Odilon
Fils du directeur du pensionnat de La Bassée, Odilon Boulinguez est élève au collège Saint-Jean à Douai, puis étudiant en philosophie et en théologie à l’Université catholique de Lille. Enseignant en sciences physiques au séminaire d’Arras, il est, en juin 1881, ordonné prêtre. En 1887, il dirige le collège Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer.
En 1891, il est nommé vicaire de Notre-Dame de Boulogne, puis plus tard curé de Saint-Léonard. Il cumule ses fonctions pastorales avec celles de rédacteur-en-chef de La Croix de Boulogne et du Pas-de-Calais. En 1908, l’abbé Odilon Boulinguez est nommé rédacteur en chef La Croix du dimanche et de La Croix d’Arras et des mines du Pas-de-Calais, puis de La Croix du Pas-de-Calais où il signe sous le pseudonyme de Viator.
Il meurt accidentellement le 24 octobre 1915 alors qu’il se rendait à son journal.
Source(s) :AD Pas-de-Calais 10T 22, rapport du commissaire de Boulogne au sous-préfet 4 août 1895; Nelly Dupré-Lafaille, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, Arras-Artois-Côte d’opale, Editions Beauchesne, 2013 p. 96.
-
BOULOGNE Horace
Horace Paul Louis Boulogne est le fils de Jules Boulogne, ancien journaliste au Progrès du Nord où il sera également rédacteur après avoir dirigé un temps avec son père Lille Artiste . Auparavant, le 9 octobre 1906, Horace Boulogne, encore étudiant, s’engage pour trois ans. Affecté au 27 e RA, il passe au 4 e RA à Besançon qu’il quitte avec le grade de sous-lieutenant. Rappelé le 1 er août 1914, il rejoint le 41 e RA avec le grade de lieutenant, il est tué à l’ennemi le 26 septembre 1915, près de Berry-au-Bac dans l’Aisne. Chevalier de la Légion d’honneur et croix de Guerre avec palme, ses funérailles ont lieu le 25 mai 1921 à Lille où il est enterré au cimetière de l’Est.
Source(s) :AD Nord, 1 R 2905; Le Réveil du Nord, 27 mai 1921; Le Grand Echo du Nord, 4 avril 1908, 7 avril 1912 et 22 mai 1921.
-
BOULOGNE Jules
Fils d’un boulanger de Pérenchies, dans l’arrondissement de Lille, Jules César Boulogne participe comme engagé volontaire à la guerre franco-prussienne, il quitte l’armée décoré de la médaille de 1870. Lors de son mariage en 1886 avec Pauline Liénard, il est fabricant de chicorée à Marcq-en-Baroeul.
Jules Boulogne abandonne l’industrie pour la presse. Il est d’abord rédacteur-reporter au Petit Nord puis au Progrès du Nord. Selon la police, c’est «l’un des plus adroits reporters de la presse lilloise». Correspondant du quotidien parisien Le Petit Journal, il dirige ensuite l’hebdomadaire sportif et littéraire Les Saisons puis Lille artiste qu’il a lancé avec le photographe Delarue.
Durant la guerre 1914-1918, il perd son fils Horace. Profondément affecté, il meurt le 4 juillet 1921 quelques semaines après les funérailles officielles de ce fils. Officier de l’Instruction publique et titulaire de la médaille coloniale, Jules Boulogne était membre de l’Association de la presse républicaine départementale et de l’Association professionnelle des journalistes du Nord.
Source(s) :AD Nord, 1er, septembre 1895, Le Grand Echo du Nord, et, Le Réveil du Nord, 7 juillet 1921.
-
BOURDON Hercule
Bourdon a été rédacteur au Globe , périodique saint-simonien, et à la Revue du progrès social . Auteur de livres et d’articles à caractère juridique ( De l’Emploi respectif de l’emprisonnement et de l’amende édictés au Code pénal par exemple) , il a aussi publié De l’origine des noms (Lille, Vanhackère, 1856) et Jeanne de Flandres et la mort de l’ermite Glanson (Vanhackère, 1858). Il a participé aux travaux de la Société dunkerquoise pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. Après sa retraite il s’établit à Bailleul.
Il avait épousé Mathilde Lippens, dame Fromont, auteure prolifique de romans bien-pensants, publiés par Lefort à Lille.
-
BOURGEOT
Ancien répétiteur au lycée de Saint-Omer, Bourgeot a été rédacteur au Réveil du Nord à Lille qu’il quitte, selon la police, le 25 juin 1895 après une altercation avec le rédacteur en chef.L’homme semble avoir le sang vif. En juillet de la même année, il se bat en duel avec Constant Carlier, reporter au Réveil du Nord, qu’il aurait giflé pour un emprunt de 10 F non remboursé. Bourgeot serait devenu professeur.
Source(s) :AD Nord.
-
BOURGUER Jean
.
Militant anarchiste, antimilitariste, anticlérical, syndicaliste révolutionnaire, Jean Bourguer fut condamné pour «excitation de militaires à la désobéissance» et insoumission. Tisserand à Reims, il s’enfuit à Roubaix pour échapper à un mandat d’arrêt en 1898.
En 1897 il était l’un des rédacteurs de La Cravache (Roubaix, 11 numéros du 14 novembre 1897 à 22 janvier 1898) puis du titre qui le suivit Le Cravacheur , dont il devint gérant à partir du numéro 6 à la place de A. Sauvage (neuf numéros, 4 février à 16 avril 1898), tout en collaborant au Droit de vivre , un journal parisien. En 1905, il est le gérant-imprimeur du Combat , un journal anarchiste de Tourcoing. En 1907, rentré à Reims, il est l’un des principaux collaborateurs d’un nouveau Cravacheur . Risquant d’être condamné pour recel, il s’enfuit aux États-Unis. Amnistié, il rentre après la guerre, toujours anarchiste.
Source(s) :Dictionnaire des militants anarchistes, http://militants-anarchistes.info/spip.php?article497, Éphémérides anarchistes, http://www.ephemanar.net/janvier16.html
-
BOUSSEMAER Maurice
Né en 1865, Maurice Boussemaer devient propriétaire du Journal de Lillers le 23 novembre 1889. Il le cède ainsi que l’imprimerie, en décembre 1909, à Jules Poriche. S ource: Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940 , Société des amis de Panckoucke, 2010, notice Le Journal de Lillers.
-
BOUTTEAU Désire
En 1852, Désiré Boutteau est présenté par la police comme le seul rédacteur avec Henri Carion, de L’Emancipateur de Cambrai.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/3.
-
BOUVEUR Jacques
Entré comme journaliste à La Voix du Nord le 1 er juin 1954, il y effectue toute sa carrière. Il fut notamment chef de l’édition de Villeneuve d’Ascq. Il fut ainsi le témoin privilégié de la naissance et du développement de la ville nouvelle.
-
BOYAVAL P G
Gabriel Boyaval commence sa carrière de journaliste en 1871 à La Vraie France sous la direction de son beau-père, Frédéric Delbreil, rédacteur en chef. Il travaille ensuite pour Le journal de Rome, Le Moniteur du Canal . Il devient rédacteur en chef de La Flandre à Dunkerque. Ce journal refusant de se rallier, il revient en 1892 à La Vraie France où il est secrétaire de rédaction. Parallèlement, il tient la chronique politique du Nord hebdomadaire. Il meurt le 7 mars 1896.des suites d’une longue maladie. A cette occasion, Le Grand Echo du Nord salue sa bienveillance, sa grande courtoisie et la droiture de son caractère.
Source(s) :Choquet (René), La Vraie France, journal royaliste, légitimiste, catholique lillois à la fin du XIXe, siècle, op. cit.; Le Grand Echo du Nord, 9 mars 1896.
-
BREJSKI Jan
Jan Brejski est rédacteur au Kurjer Polski de Cravovie lorsqu’il rachète en 1894 Warius Polski installé à Bochum en Allemagne. Autour de ce quotidien, il crée avec son frère Anton un véritable empire de presse avec toute une série de journaux spécialisés. Après la guerre, il fonde le parti national ouvrier. Elu député de la nouvelle république de Pologne, il devient secrétaire d’Etat. Après avoir perdu son poste de voiévode de Poméranie, il gagne l’Allemagne où sont venus travailler des dizaines de milliers d’ouvriers polonais. Warius Polski reparaît à Lille à partir de juillet 1924. Il doit faire face à un concurrent venu comme lui d’Allemagne et installé à Lens. Brejski dirige le journal jusqu’à sa mort en décembre 1934 où son beau-fils Stanislas Nawrocki lui succède jusqu’à la Libération où le journal est interdit de parution.
-
BRICHE Georges
Ancien combattant de la guerre 1914-1918 et, à ce titre, titulaire de plusieurs distinctions, Georges Briche est rédacteur au Réveil du Nord durant l’entre-deux-guerres , il est nommé, par la suite, secrétaire général de la rédaction. Il reste le titre durant l’Occupation, mais semble déposséder de tout pouvoir. Il était syndic de l’Association professionnelle des journalistes du Nord. En 1939, il avait reçu la médaille d’or de Ligue républicaine du bien social et avait été fait officier de l’Instruction publique.
Source(s) :L’égalité de Roubaix-Tourcoing, 23 juin 1939, «Journée de la presse et de la publicité à l’Exposition du Progrès social; Le Grand Echo du Nord, 19 avril et 3 juillet 1939.
-
BRIDOUX Adolphe
« Militant libertaire de Lens (Pas-de-Calais), Adolphe Bridoux, qui travaillait comme mineur en 1923, fut délégué aux congrès de l’Union anarchiste de 1922, 1924 et 1928. Il était secrétaire du groupe anarchiste de Lens et diffuseur du journal Germinal (Amiens). Le 27 janvier 1924, il participait à Lens au congrès régional anarchiste du Nord et il était nommé à la rédaction du Combat avec O. Descamps et P. Thant. En juillet 1926, il participait à la création du Syndicat autonome fédéraliste et révolutionnaire intercorporatif de Hénin-Liétard. Le 20 novembre 1926, au nom de la «contrainte par corps», il était arrêté sur un chantier à Wasquehal et interné à la prison de Loos au régime de droit commun. L’affaire datait du 9 avril 1922 où suite à une distribution de tracts en faveur de Cottin, il avait été inculpé avec sa compagne et d’autres militants ; jugé en 1924 devant le tribunal de Béthune avec Henriette Engrand, Emilienne Corroyer et Jules Chazoff, il était condamné à quatre mois de prison avec sursis. En 1925, le tribunal de Douai le condamnait à quatre mois de prison. Tuteur de ses quatre frères et sœurs, sinistrés de guerre, se considérant comme prisonnier politique et refusant de travailler en prison ce qui lui avait valu d’être frappé par un gardien, il entamait une grève de la faim le 24 novembre et était finalement libéré le 10 décembre. En 1927 il était le secrétaire du Comité de défense sociale du Nord-Pas-de-Calais: le bureau était, à l’époque, formé de Even (secrétaire adjoint), Vannier (trésorier), Boute (commission de contrôle), Hoche Meurant, Duquelzar, Volke, Dryburg et Dufour. Lors du 7 e congrès anarchiste du Nord-Pas-de-Calais tenu à Croix le 16 octobre 1927, auquel étaient représentés les groupes de Lille, Tourcoing, Roubaix, Wasquehal, Croix, Wattrelos, Marcq-en-Barœul, Dunkerque pour le Nord ainsi que les groupes de Lens, Béthune, Sallaumines, Canonne-Liévin et Hénin-Liétard pour le Pas-de-Calais, Adolphe Bridoux, qui demeurait alors à Croix (1 rue d’Arcole) avait été nommé responsable de l’administration et de la rédaction de l’hebdomadaire Germinal . Le 12 août 1928 il avait été l’un des délégués du Nord au congrès de l’Union anarchiste communiste révolutionnaire (UACR).»
Source(s) :Repris du Dictionnaire international des militants anarchistes, sur internet.
-
BRIL Albert
Fils d’un douanier, Albert Bril choisit la presse où il fait ses premiers pas en 1889. Dès juillet 1890, il est rédacteur en chef de L’Eventail, journal littéraire, artistique et musical paraissant le dimanche, puis, de juillet 1891 à décembre 1892, également de l’hebdomadaire Dunkerque-Saison, l’écho de la station balnéaire, littéraire et artistique. En 1898, il est rédacteur en chef du Littoral du Nord, organe des plages françaises, bulletin maritime et commercial du port de Dunkerque, hebdomadaire édité à Malo-les-Bains jusqu’en 1911. Devenu rédacteur en chef de l’hebdomadaire dunkerquois La Flandre en 1909, il est provoqué en duel par Sucche, rédacteur au Phare de Dunkerque , mais refuse toute réparation par les armes. Par la suite, il est rédacteur en chef du Télégramme du Pas-de-Calais édité à Boulogne-sur-Mer, puis au Nord maritime de Dunkerque. Membre de la Société historique de Dunkerque, de l’Union Faulconnier, dont il sera le secrétaire, et de la Commission historique du Nord, il est l’auteur de plusieurs ouvrages: Une Saison aux bains de mer de Dunkerque-Rosendael (1891), La Cité hospitalière de Dunkerque (1933), La Place Jean Bart, histoire et souvenirs (1935). Il laisse également de nombreuses communications parues dans le Bulletin de l’Union Faulconnier.
Doyen de la presse dunkerquoise, il reçoit en 1930 la grande médaille d’or du travail.
Source(s) :Plusieurs numéros du Bulletin de l’Union Faulconnier; Le Grand Echo du Nord, 29 octobre 1890 et 29 octobre, 1935.
-
BROUSSIER Yves
Yves Broussier entre à La Voix du Nord le 25 mai 1959. Journaliste à l’édition de Calais, il en devient en 1966 le chef. En 1979, il est nommé rédacteur en chef adjoint, chargé des éditions locales, poste qu’il occupe jusqu’au 1 er novembre 1991.
-
BRUN Élie, François, Louis
Fils d’Elie Brun-Lavainne, Elie Brun, après avoir tâté de la vie militaire, fut employé des archives départementales, bibliothécaire à Roubaix (1855-1857), secrétaire de la mairie de Tourcoing (1856-1866). Il publia avec son père Les sept sièges de Lille.
-
BRUN Louis
Rédacteur à L’Echo du Nord des années 1890 à 1918.
-
BRUN-LAVAINNE Élie Benjamin Joseph
 Brun-Lavainne fut, selon Hippolype Verly, l’une des personnalités les plus remarquables de son époque. Et si sa renommée ne dépassa pas les limites de la Flandre, c’est uniquement dû à sa modestie exagérée et son antipathie pour l’ostentation et l’intrigue, car l’homme possédait bien des talents.
Brun-Lavainne fut, selon Hippolype Verly, l’une des personnalités les plus remarquables de son époque. Et si sa renommée ne dépassa pas les limites de la Flandre, c’est uniquement dû à sa modestie exagérée et son antipathie pour l’ostentation et l’intrigue, car l’homme possédait bien des talents.Né à Lille le 22 juillet 1791 dans une famille d’artistes, Brun-Lavainne fut, après une brève carrière dans l’Armée, professeur de musique, puis archiviste de Lille, et devint secrétaire de la mairie de Roubaix. Historien (Atlas topographique de Lille; Mes souvenirs… ), il écrivit également des comédies, des opéras. Il a publié sous le pseudonyme du « Rôdeur wallon » dans Le Journal du département du Nord, édité par Reboux . Après un passage rapide à Paris, pendant lequel il participa à la réorganisation de L’ Ère nouvelle , de La Rochejacquelin et La Guéronnière, il revint dans le Nord. Il donna de nombreux articles à La Boussole, La Gazette de Flandre, L’Écho de Roubaix, L’Écho théâtral de Roubaix, Le Libéral du Nord, La Feuille d’annonces de Roubaix, Le Journal de Roubaix, etc. Il polémiqua avec L’Écho du Nord, qu’il qualifiait d ’Égout du Nord, trop libéral et trop chartiste à son goût. Il fonda La Revue du Nord, lointaine ancêtre de l’actuelle revue du département d’histoire de Lille, qui porte le même titre. (cf. Trénard, Louis, « Note préliminaire [sur l’historique de La Revue du Nord ] », in : «Tables des années 1951-1960, Revue du Nord, Publication de la faculté des lettres et sciences humaines de Lille, n°1, Collection du Centre régional d’études historiques n° 4, p. 1-2)
Brun-Lavainne mourut à Roubaix fin janvier 1875.
-
BRUNEL Henri
Henri Brunel est rédacteur à Nord Eclair en 1946.
Source(s) :Libre Artois, 4 novembre 1946.
-
BRUYELLE Jules
Fils de Pierre Bruyelle, cabaretier, et d’Augustine Bouvelle, tisseuse, Jules Augustin Bruyelle est né le 22 juin 1836 à Neuvilly dans le Cambrésis. Lors de son mariage avec Calixtine Lansiaux, le 25 juin 1862 à Haussy, il est instituteur. Quelques années plus tard, il embrasse la profession de journaliste et devient rédacteur en chef de L’Emancipateur de Cambrai à partir de 1872. Succédant à Henri Lemaire, il prend, le 13 juin 1876, la direction de la rédaction de L’Echo de la frontière à Valenciennes. Catholique intransigeant, il est surnommé «le petit Veuillot sans talent» par les républicains. Il quitte Valenciennes le 16 avril 1884, laissant la place à Mabille. Jules Bruyelle est l’auteur d’une notice sur Crévecoeur et l’abbaye de Vaucelles, édité en 1878, et d’un drame ayant pour cadre le Cambrésis, Les gens de chez nous. Mar’Zeph la blonde et le brun Tacho, paru chez Plon en 1881 et qui eût un certain écho dans la presse.
Membre de la Société des gens de lettres, il en démissionne lors de l’élection de Zola à la présidence en 1894.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 015 R 008, 5 Mi 018 R 014 et 3 E 6782; Jean-Paul Visse, La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de l’Echo du Nord; Le Grand Echo du Nord, 31 janvier 1920.
-
BUELLET Claude Clément
, préfet, trésorier-payeur général C’est dans la fonction publique que Claude Clément Buellet a accompli l’essentiel de sa carrière professionnelle. Né le 16 mai 1861 dans l’Ain, ce fils d’un instituteur public est nommé sous-préfet de Montreuil-sur-Mer en mai 1894, à l’âge de 33 ans, puis il est secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais à partir de 1900. Il quitte ensuite le Pas-de-Calais pour Vienne où il a été nommé sous-préfet, puis il devient préfet de l’Aveyron et de la Corse. Nommé préfet honoraire en 1911, il change d’administration en devenant trésorier-payeur général à Vesoul en 1912 et à Angers en 1919. En 1894, Le Grand Echo du Nord se félicite de sa nomination à la sous-préfecture de Montreuil et au poste de secrétaire général de la préfecture d’Arras. Buellet débuta en effet sa vie professionnelle comme journaliste. Le journal lillois rappelle avec fierté, à chaque fois que l’occasion se présentera, que « ce républicain éprouvé, libéral et tolérant », « fit longtemps partie de la rédaction ». Entré en 1888 au Grand Echo du Nord , il y « traite, peut-on lire lors de son départ, les questions d’affaires et tout spécialement celles qui intéressaient l’industrie et l’agriculture ». Ses compétences l’amenèrent également à traiter de politique, il commente régulièrement l’actualité politique. Il quitte le quotidien lillois six ans plus tard, laissant, semble-t-il, un excellent souvenir. Le journal le présente comme un homme « d’une rare courtoisie et d’une distinction parfaite ». Clément Buellet qui, après son baccalauréat ès lettres, avait été admissible à l’Ecole normale supérieure, était aussi, toujours selon Le Grand Echo du Nord « un écrivainde talent ». Il a notamment publié en 1888 Lille et le Nord au Moyen Âge , et Wagner et son œuvre. Le vaisseau fantôme . Marié en 1895 à Gabrielle Jeanne Victoire Adèle Dubourg, fille du maire de Montreuil-sur-Mer, Victor Dubourg de 1892 à 1915, Clément eut un fils Gabriel Jean Victor, sergent aviateur, mort pour la France le 25 août 1916. Clément Buellet fut élevé au grade d’officier de l’Instruction publique en 1899 et nommé chevalier de la Légion d’honneur en janvier 1922.
Source(s) :Grand Echo du Nord, 3 août 1894, 19 janvier 1900, 2 novembre 1925; Qui êtes-vous? Annuaire des contemporains, Paris, maison Ehret. G. Ruffy, successeur, 1924, tome III, p. 133; AN F/1bI/598; AN 19800035/278/37313.
-
BURNOD Claude
Salarié à la ville de Dunkerque, Claude Burnod s’engage dans la résistance en 1942. Il est arrêté le 30 novembre 1942 et condamné aux travaux forcés à perpétuité le 19 mars 1943. Déporté en Allemagne quelques semaines plus tard, il n’est libéré de la prison de Landberg qu’en avril 1945.
En juin de la même année, il rejoint la rédaction du Nouveau Nord dirigé par son père Louis. En avril 1956, il devient chef de la rédaction dunkerquoise de La Voix du Nord qu’il quitte à l’âge de la retraire en 1985. Il est alors nommé vice-président du conseil de surveillance de La Voix du Nord SA.
Sa conduite pendant la guerre lui vaut la médaille de la Résistance, la Croix de guerre 39-45 avec palme et d’être nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. Homme discret, attentif aux plus humbles, il meurt à l’âge de 96 ans.
Source(s) :Michel Tomasek (dir.), Dictionnaire biographique dunkerquois, Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, 2013, 1184 p.; «Décès de Claude Burnod, figure de la Résistance et de la presse», La Voix du Nord, 2 février 2017.
-
BURNOD Louis
 Originaire de la région lyonnaise, Louis Burnod a commencé sa carrière de journaliste au Journal de l’Ain. Engagé volontaire lors de la Première Guerre, il est correspondant du Matin en Orient, directeur du quotidien français L’Egide édité à Salonique. Arrivé à Lille au moment de la Délivrance, en octobre 1918, il est embauché à L’Echo du Nord où il exerce les fonctions de secrétaire général de la rédaction. En 1921, il passe au Télégramme du Nord qu’il quitte après quelques mois pour le quotidien dunkerquois Le Nord Maritime dont il est directeur et rédacteur en chef. Sous son impulsion, le périodique atteint les 15000 exemplaires, laissant loin derrière ses concurrents locaux. Il le dirige jusqu’à l’invasion allemande en 1940 où il refuse de mettre sa plume au service de l’occupant. Le 10 février 1945, Louis Burnod reprend son métier, fondant à Cassel le Nouveau Nord maritime. Il doit attendre la libération de Dunkerque, le 9 mai, pour y installer son journal dans la cité portuaire. D’abord hebdomadaire, celui-ci devient bihebdomadaire le 4 juin 1946, puis quotidien le 3 juin 1947. Louis Burnod en assure la direction jusqu’à sa mort le 5 décembre 1955.
Originaire de la région lyonnaise, Louis Burnod a commencé sa carrière de journaliste au Journal de l’Ain. Engagé volontaire lors de la Première Guerre, il est correspondant du Matin en Orient, directeur du quotidien français L’Egide édité à Salonique. Arrivé à Lille au moment de la Délivrance, en octobre 1918, il est embauché à L’Echo du Nord où il exerce les fonctions de secrétaire général de la rédaction. En 1921, il passe au Télégramme du Nord qu’il quitte après quelques mois pour le quotidien dunkerquois Le Nord Maritime dont il est directeur et rédacteur en chef. Sous son impulsion, le périodique atteint les 15000 exemplaires, laissant loin derrière ses concurrents locaux. Il le dirige jusqu’à l’invasion allemande en 1940 où il refuse de mettre sa plume au service de l’occupant. Le 10 février 1945, Louis Burnod reprend son métier, fondant à Cassel le Nouveau Nord maritime. Il doit attendre la libération de Dunkerque, le 9 mai, pour y installer son journal dans la cité portuaire. D’abord hebdomadaire, celui-ci devient bihebdomadaire le 4 juin 1946, puis quotidien le 3 juin 1947. Louis Burnod en assure la direction jusqu’à sa mort le 5 décembre 1955.Chevalier de la Légion d’honneur depuis 1932, il était membre de nombreuses associations.
Source(s) :AD Nord, Le Nouveau Nord, 7 décembre 1955.
-
BURNOD Marc
Formé au journalisme par son père Louis, directeur du quotidien dunkerquois Le Nord Maritime , Marc Burnod y est chroniqueur sportif jusqu’en mai 1940. Envoyé en Autriche au titre du STO en 1943, il ne retrouve Dunkerque que deux ans plus tard. Il reprend alors son métier dans le nouveau quotidien de la ville portuaire Nouveau Nord . En 1956, Marc Burnod entre à la rédaction dunkerquoise de La Voix du Nord continuant à se faire le héraut de l’essor du complexe industrialo-portuaire et du développement des dessertes nécessaires. En 1961, il fonde ainsi avec Claude Provoyeur, futur maire de Dunkerque, l’association «Pour le Grand Dunkerque» qui aboutit à la fusion de Dunkerque avec Malo, Rosendaël puis Petite-Synthe. Chroniqueur sportif, il participe à l’organisation des «Jeux universitaires de la Flandre maritime» en 1959, du «Circuit du port», des «Quatre jours de Dunkerque», etc. Il est également correspondant local du quotidien L’Equipe.
A partir de 1970, il se consacre exclusivement au service maritime, économique et social de l’édition dunkerquoise, puis en 1972 pour l’ensemble des éditions du littoral. Il créé notamment une page hebdomadaire «Le Nord et la mer» alimentée par ses reportages en France et à l’étranger.
Marc Burnod meurt à l’âge de 59 ans.
Source(s) :La Voix du Nord; Michel Tomasek (dir.), Dictionnaire biographique dunkerquois, Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, 2013, 1184 p.,
A – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais C
-
CADOT Henri
Fils d’un débitant de boissons, Henri Cadot, né le 22 avril 1864 à Quesnoy-en-Artois, devient mineur. En 1889, il cofonde le Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais dont il est alors vice-président. A ce titre, il est directeur politique de La Tribune. Organe du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, du Nord et d’Anzin de 1899 à 1940. En 1917-18, il exerce cette fonction au Réveil, périodique qui regroupe La Tribune et plusieurs autres titres. Il est également directeur de Prawo Ludu, journal lancé par la CGT à destination des mineurs polonais installés dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Membre du Parti ouvrier français dès 1899, il subit trois échecs avant d’être élu député SFIO de la quatrième circonscription de la Béthune en 1914. Il est réélu jusqu’au 1931, date à laquelle il accède au Sénat. Battu en 1935, il est réélu député en 1936. Maire de Bruay-en-Artois dès 1919, il reste en poste jusqu’en 1944, mais n’est pas inquiété à la Libération.
Source(s) :https://www.senat.fr/senateur-3eme-republique/cadot henri0980r3.html; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin houiller du Pas-de-Calais, Société des amis de Panckoucke, notices des titres cités
-
CAFFIN
Journaliste
Ancien marchand de vin et candidat malheureux au poste de commissaire de police à Arras, Caffin est nommé rédacteur en chef du Courrier du Pas-de-Calais à partir du 13 avril 1835 .
Source(s) :Le Propagateur du Pas-de-Calais, 13 avril 1835.
-
CAILLERET E.
Gérant de La Gazette de Lillers.
-
CAILLIEZ E.
Fondateur de L’Informateur de Lens en 1903, gérant de L’Eclaireur de Lens, il imprime d’autres périodiques dont L’Etoile du batelier.
-
CAILLOT Georges
Fils de Frédéric Georges Victor, juge de paix, et de Mathilde Eléonore Marie Herzog, Georges Caillot est né dans le département d’Ille-et-Vilaine le 11 juin 1861. Il fait ses études au collège de Juilly dans l’arrondissement de Meaux où son père a été nommé sous-préfet. Après une période militaire au 27 e régiment d’artillerie de Douai, il exerce la profession d’employé de commerce à Roubaix, il entre ensuite, comme rédacteur-reporter, au quotidien Le Journal de Roubaix. En 1886, il gagne le quotidien lillois La Dépêche où, écrira Henri Langlais, directeur du journal, «il était apte à tous les emplois d’une profession qu’il connaissait admirablement», passant du reportage à l’étude historique. En septembre 1895, la police le décrit comme «fort intelligent, mais souvent malade». Georges Caillot est en effet de santé fragile, ce qui ne l’empêche pas, comme le dira Emile Ferré, directeur du Grand Echo, d’écrire tant que la plume ne lui est pas tombée des mains. Georges Caillot meurt le 21 novembre 1899 dans sa trente-neuvième année. J .-P. V.
Source(s) :AD Ille-et-Vilaine, 10 NUM 35363561; AD Nord, 1 Mi EC 350 R 195; AD Nord, 1 T, 1er, septembre 1895; La Dépêche, 22 novembre 1899; Le Grand Echo, 24 novembre 1899.
-
CALONNE Alphonse de Bernard, vicomte de
Après des études de droit à Paris (1840-1842), il publie des articles d’archéologie et d’art. Légitimiste, il collabore à des brochures de circonstances ( Les Trois Jours de février ; Le Gouvernement provisoire, histoire anecdotique et politique de ses membres ), et publie des articles dans Le Lampion , périodique suspendu par Cavaignac le 21 août 1848. Il projette de le remplacer par La Bouche de fer , en collaboration avec MM. de Montépin et de Villemessant, mais ce journal est saisi dès la sortie du premier numéro. Calonne devient rédacteur à L’Opinion publique , et de Nettement . Il fonde ensuite un hebdomadaire, Le Henri IV, journal de la réconciliation (premier numéro le 4 août 1850). Après le coup d’Etat du 2 décembre, il participe à La Revue contemporaine du marquis de Belval, organe dont il devient propriétaire en 1856, et dont il fait alors une revue «officielle».
Source(s) :Vapereau, G., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers…, 4e éd., Paris, Hachette, 1870.
-
CAMBRELENG André
Licencié en anglais, André Cambreleng commence sa vie professionnelle dans l’enseignement en qualité de maître auxiliaire. Il entre à La Voix du Nord en 1946 où il succède au bureau d’Avesnes-sur-Helpe à Robert Décout. « Archétype du localier » comme l’écrit La Voix Nord lors de sa mort survenue le 2 octobre 2016, André Cambreleng effectue toute sa carrière de journaliste dans cette édition locale dont il devient le chef. Il meurt dans sa 95e année dans sa ville natale.
Source(s) :AD Nord, 3 E 7572; La Voix du Nord, 3 octobre 2016.
-
CANQUELAIN, Pierre
Journaliste, mais aussi syndicaliste, Pierre Canquelain a, toute sa vie, mis ses convictions au service de ses confrères, mais aussi de ses concitoyens.
C’est à L’Echo du Nord qu’il a commencé sa carrière de journaliste en avril 1937 avant d’intégrer la 17 e promotion de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille en 1940. A la Libération, le 4 septembre 1944, il est embauché à La Voix du Nord comme rédacteur au siège. Un an plus tard, il devient rédacteur-sténographe de presse. A partir de 1962, il assure la direction du service des sténos et jusqu’à sa retraite en 1982. Parallèlement à sa carrière professionnelle, Pierre Canquelain mène une longue carrière syndicale au sein du Syndicat national des journalistes (autonome). Elu délégué du personnel en 1964, il devient, en février 1969, délégué syndical à La Voix du Nord . La même année, il est élu secrétaire régional et secrétaire national de l’organisation jusqu’en 1982.
Soucieux de la formation des journalistes, il est administrateur du Centre d’information permanente des journalistes dès 1967, puis secrétaire et enfin président. Au sein du SNJ, il anime d’ailleurs, à partir de 1971, la Commission nationale de la formation professionnelle.
Pierre Canquelain est également très impliqué dans la vie associative et notamment dans celle de son quartier à Lille.
-
CARBONNIER Henri
Rédacteur au Journal de Roubaix , Henri Carbonnier prit en 1910 la direction du bureau roubaisien de La Croix du Nord . Mobilisé au 167 e RI en 1914, il est fait prisonnier en mai 1915 et emmené en captivité. Il meurt de ses blessures le 13 novembre 1915.
Source(s) :Manuscrit inédit de Louis Cassette; Site mémoire des hommes.
-
CAREY Gérard
Après un séjour de trois ans en Espagne où il s’initie au commerce international, Gérard Carey entre, en 1922, comme rédacteur traducteur à l’hebdomadaire économique Le Nord industriel, fondé quelques années plus tôt par Paul Frémaux et Lucien Bauchat . Lorsque le journal cesse de paraître le 17 mai 1940, il gagne Bordeaux où il reste jusqu’en avril 1942. Après avoir travaillé quelques semaines au Comité d’organisation du bâtiment et des travaux publics, il reprend sa place au Nord industriel jusqu’au 26 août 1944. En janvier 1946, il entre au quotidien La Voix du Nord dont il devient chef du service économique à la suite de la nomination de Lucien Pluvinage à la tête de la rédaction parisienne. Gérard Carey quitte La Voix du Nord en 1965 et se retire dans les Pyrénées. Premier prix de violon, Gérard Carey était également un mélomane qui côtoya les plus grands de Ginette Neveu à Yehudi Menuhin .
Source(s) :AD Nord; La Voix du Nord, 11 mars 1983.
-
CARION Claude
Rédacteur au service des sports de La Voix du Nord.
-
CARION Henri
Fils de Henri Carion, marchand de drap puis commissaire de police, et de Séraphine Richebé, Henri Carion fait ses études au collège de Cambrai, puis monte à Paris avec ses frères Louis et Auguste. De retour à Cambrai, ils fondent en avril 1834 dont Henri Carion devient rédacteur gérant.
Légitimiste, Carion est poursuivi à plusieurs reprises sous la monarchie de Juillet, en 1835, 1836 et 1838, pour ses «épistoles» et ses articles, mais ne sera jamais condamné. Il est présenté comme un «homme d’esprit et homme de bien, [qui] a toujours exprimé avec autant de décence que de loyauté, les sentiments qui l’animent et l’opinion à laquelle il appartient. Ces sentiments sont ceux d’un grand nombre de Français des plus honorables à la tête desquels marchent Châteaubriant, Berryer, Fitz Jamer, Hennequin. Cette opinion est celle dont La Gazette de France est le principal organe.» Après le coup d’Etat du 2 décembre 1851, L’Emancipateur, légitimiste et clérical, est suspendu et Carion n’obtient l’autorisation de le faire reparaître qu’à la mi-février 1852. Sous le Second Empire, le journal est averti deux fois. Après le deuxième avertissement, le 1 er octobre 1854, Henry Carion préfère céder la gérance à son frère pour le sauver d’une disparition. Il rejoint alors la capitale où il fonde l’Imprimerie de la province à Paris, il s’occupe ensuite de la Société du crédit des paroisses, avant de mener une vie aventureuse qui le mènera jusqu’en Croatie. Sources : AD Nord 2U1606, Landrecies, Jacques, «Un pamphlétaire en picard sous Louis-Philippe, Henri Carion, auteur de l’Z’épistoles kaimberlotte», Bibliothèque de l’école des Chartes, 210, vol. 159, n° 1, p. 93-127.
-
CARION Louis
Journaliste Frère d’Henry Carion, Louis Jules Ernest Carion lui succède, en 1854, à la tête de L’Emancipateur de Cambrai . En avril 1859, le sous-préfet de Cambrai le présente comme «un homme qui professe des opinions légitimistes et ultramontaines», en juillet 1866, comme «toujours très malveillant pour la politique impériale». Pourtant son journal échappe, malgré les demandes du préfet du Nord au ministre de l’Intérieur. à tout nouvel avertissement officiel. Louis Carion meurt d’une rupture d’anévrisme à l’âge de 54 ans. Sa femme, née Marie Catherine Bricout, garde la direction de l’imprimerie, tandis qu’après une période d’intérim, Ernest Delloye lui succède à la direction du journal dans lequel il avait déjà fait paraître quelques articles.
Source(s) :AD Nord, 1Mi EC 122 R036 et 1T 222/3.
-
CARLIER Briatte
Instituteur au Cateau qui a été révoqué, Carlier, demeurant, route de Bapaume à Cambrai, est en juillet 1870 rédacteur en chef du périodique La Revue hebdomadaire agricole et communale à Cambrai, imprimé par Régnier-Farez. Par la suite, il est rédacteur au journal L’Avant-garde , lancé à Cambrai en février 1900 par le Parti ouvrier français à l’occasion des élections municipales.
Source(s) :AD Nord, 1T 222, 9 juillet 1870 et 14 février 1900
-
CARLIER Constant
Fils d’une institutrice, Constant Carlier a commencé sa carrière comme reporter au Progrès du Nord d’où il est remercié . Le 1 er mai 1895, il est embauché dans les mêmes fonctions au Réveil du Nord où il reste un an. Il est ensuite commis aux écritures dans une laiterie. Dans une affaire d’expulsion, il est poursuivi pour «usurpation de fonctions». Selon la police, Carlier professe alors des opinions socialistes et quelque peu révolutionnaires». Le 1 er mai 1895, il est gratifié d’une contravention pour avoir arboré un drapeau rouge à sa fenêtre. Lors de la réception des députés allemands à Lille, il est arrêté pour s’être «opposé à l’arrestation d’un collectiviste». Après avoir mené une vie de bohème, il travaille ensuite au Torpilleur de Dunkerque créé par Elisée Polvent pour «défendre la cause des ouvriers». A la disparition de ce périodique, en octobre 1898, il est nommé rédacteur du Réveil du Nord à Valenciennes.
Source(s) :AD Nord M 154/172.
-
CARLIER Eugène
Fils de Jean-Baptiste Carlier, cultivateur et maire d’Achiet-le-Petit, et de Félicité Déhée, Eugène Carlier entre au journal républicain L’Avenir d’Arras lors de sa création en 1871. Il en devient rédacteur en chef en 1873. Il le quitte en juin 1883 et devient inspecteur départemental de l’Assistance publique, fonction qu’il exerce jusqu’en août 1904.
Eugène Carlier entre au conseil municipal d’Arras en 1879. Ses nombreuses activités lui valent d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1882, officier d’Académie en 1897, officier de l’Instruction publique en 1902. Il avait également été élu à l’Académie d’Arras en 1889.
Lors de sa mort, en 1919, Le Lion d’Arras écrit: «M. Carlier était certainement un de nos concitoyens les plus universellement apprécié, tant par l’aménité de son caractère que pour la largeur de ses idées et son dévouement illimité à l’intérêt public.» .
Source(s) :Dossier de Légion d’honneur LH/428/87; Le Lion d’Arras, 9 octobre 1919.
-
CARLIER François
Né à Morbecque en 1873, François Carlier entre à la rédaction du Nord maritime à Dunkerque en 1894. Il en devient rédacteur en chef pendant la Première Guerre mondiale. Bras droit pendant vingt ans de Chiroutre, le fondateur du journal, Francis Carlier reprend le quotidien dunkerquois le 20 juillet 1921. Il abandonne le journalisme en 1922 pour reprendre une librairie à Dunkerque qui est détruite en mai 1940. Il se réfugie dans le Tarn où il meurt en 1952.
Source(s) :Michel Tomasek (dir.), Dictionnaire biographique dunkerquois, Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, 2013, 1184 p.
-
CARPENTIER Charles Joseph Adolphe
Breveté imprimeur en juillet 1842, Charles Joseph Adolphe Carpentier prend la succession de la veuve Hurez, installée Grande Place à Cambrai. Il prend l’engagement de ne publier aucun journal politique et L’Echo de Cambrai succède à La Feuille de Cambrai. Quelques années plus tard, passé entre les mains de Charles Pety, ce périodique est présenté par le procureur de la République comme «l’organe du parti socialiste». Il cesse de paraître le 2 décembre 1851.
Source(s) :AD Nord, dossier, Echo de Cambrai.
-
CARPENTIER Rosalie Antoinette
Fille de l’imprimeur Séraphin Carpentier, Antoinette Rosalie se marie le 5 juillet 1827 à Désiré Céret, maréchal des logis au 1 er régiment de carabiniers en garnison à Metz. A la mort de son frère Théophile, en 1840, elle habite Saint-Quentin, elle a l’usufruit de ses biens: l’imprimerie estimée à 3000 F, La Feuille de Douai , et ses propriétés dont sa fille, Constance, est l’héritière.
L’imprimerie prend alors le nom de Céret-Carpentier après l’obtention du brevet d’imprimeur par son mari en février 1820, cependant Rosalie Carpentier semble conserver la haute main sur l’affaire. A la mort de Désiré Céret, elle obtient à son tour son brevet d’imprimeur et poursuit, jusqu’en 1873, l’activité de l’imprimerie et du journal dans lequel sa fille Constance Céret, veuve Vandecasteele, est, un moment rédacteur en chef.
L’imprimerie et le journal sont cédés à Albert Duramou. Rosalie Carpentier meurt le 2 décembre 1877 à Carvin où elle s’était retirée.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017, 428, p.
-
CARPENTIER Séraphin
Fils de Pierre Joseph Carpentier et de Anne François Derois, Séraphin Carpentier travaille dans diverses imprimeries de Douai avant de faire fonctionner ses propres presses. Le 2 vendémiaire an X (24 février 1801), il lance La Feuille de Douai, un journal d’annonces, d’avis divers, de proclamations… Très vite, il s’engage dans le camp légitimiste et, à ce titre, est inquiété à plusieurs reprises sous l’Empire. Dès 1804, le commissaire de police le rappelle à l’ordre: « Afin que l’Autorité puisse continuer d’accorder à votre entreprise la protection qu’elle a méritée jusqu’à ce jour, il sera convenable que vous donniez à ceux qui concourt à la composition de votre feuille l’ordre de n’y insérer sans me l’avoir soumis aucun article qui sorte du cercle des avis, nouvelles et actes des fonctionnaires publics.» 1807, 1814 et 1815, Carpentier est encore l’objet de rappels à l’ordre. En août 1810, un seul journal est autorisé à paraître par département, La Feuille de Douai disparaît. Dès janvier 1811, Carpentier la remplace par le Journal de l’Académie de Douai , lui-même interdit par le sous-préfet de Douai . Après plusieurs démarches, La Feuille de Douai est autorisée à reparaître le 12 novembre 1811. Dès la Restauration, La Feuille de Douai peut afficher un beau cartouche couronné de trois fleurs de lys. Séraphin Carpentier meurt à Douai en janvier 1823.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, Ibid.
-
CARPENTIER Théophile
S uccédant à son père Séraphin Antoine Joseph Carpentier après sa mort en janvier 1823, Théophile Alexandre Joseph Carpentier obtient son brevet d’imprimeur le 23 avril de la même année. En février 1824, il est autorisé à transformer la Feuille de Douai en journal politique. «Le sieur Carpentier, écrit le sous-préfet de Douai au comte de Murat, mérite cette faveur par les principes et les sentiments politiques dont il a donné des preuves honorables et je puis vous garantir qu’entre ses mains la Feuille de Douai conservera toujours l’esprit de loyalisme qu’il lui a donné.»
Sous la monarchie de Juillet, le 9 août 1832, il est acquitté par les assises du Nord pour offense publique envers le rois, excitation à la haine et au mépris du gouvernement. En mai 1836, il est mis en cause pour avoir publié « la troisième lettre camberlotte » d’Henri Carion. Si le juge d’instruction classe l’affaire, le procureur fait opposition. Cependant en juillet 1836, Théophile Carpenter est acquitté par la cour d’assises.
En janvier 1839, il comparaît une nouvelle fois d evant la même juridiction pour un article paru le 29 novembre 1838, «Les gouvernements de révolution ne naissent plus viables», accusé « d’avoir fait acte d’adhésion à une autre forme de gouvernement que celui établi par la charte de 1830 en exprimant le vœu ou l’espoir de la destruction de l’ordre monarchique constitutionnel ou de la restauration de la monarchie déchue ». Il est déclaré « non coupable ». Célibataire, Théophile Carpentier meurt dans sa cinquante-neuvième année, il a fait de sa nièce Constance Céret sa légataire universelle avec usufruit à sa sœur Rosalie Céret-Carpentier.
Source(s) :ADN 1T 222/27 et 2U 1536; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Ibid.
-
CARRIERE (Chevalier Victor de)
Ce Gardois collabora pendant de longues années à La Gazette de Flandres et d’Artois de 1835 à 1865.
-
CARTON André
Grand reporter à La Voix du Nord , c’est à l’occasion d’un reportage, la veille de Noël, dans les hôpitaux pour enfants de Berck et de Zuydcoote qu’André Carton eut l’idée de s’adresser à ses lecteurs pour qu’ils viennent en aide à ses enfants dans la souffrance et dans la misère. Pendant plus de trente ans, ce journaliste qui sillonna le monde, côtoya les grands de son époque, allait porter à bout Le Noël des déshérités . Chaque année, dans les colonnes de son journal, il donnait pendant près de trois mois rendez-vous à ses lecteurs pour apporter un peu de joie et de réconfort à des milliers d’enfants. Cette générosité ne doit pas faire oublier qu’André Carton fut d’abord journaliste. Né dans une famille d’imprimeur, il fit ses débuts dans le journalisme en 1930. Il fut notamment rédacteur au quotidien lillois Le Grand Echo du Nord de la France . Son père, Maurice, fut arrêté alors qu’il fabriquait La Voix du Nord clandestine dans son imprimerie de Saint-Amand-les-Eaux, et mourut en déportation. Entré à La Voix du Nord dès septembre 1944, André Carton fut nommé chef du grand reportage. Il suivit ainsi tous les voyages des présidents des IV e et V e Républiques, et notamment du ceux du général de Gaulle. Il fut ainsi élu vice-président de l’Association de la presse présidentielle.
Passionné par l’aviation, il fut, durant cinq ans, président de l’Union aéronautique de Lille-Roubaix-Tourcoing et membre du comité de l’Association des journalistes aéronautiques. Il prit sa retraite en 1971, mais continua à assurer la direction du Noël des déshérités pendant douze ans. Surnommé affectueusement «le vieux lion», André Carton était officier de la Légion d’honneur, commandeur dans l’ordre national du mérite.
Source(s) :La Voix du Nord, août 1993.
-
CASSETTE André
Fils de Louis Cassette, André Cassette épousa la même carrière que son père en 1946. Requis pour le STO pendant la guerre, il fut d’abord attaché de presse lors de son retour dans le Nord. En 1946, il entra à La Croix du Nord où il prit en charge l’édition de Tourcoing. Lorsque le quotidien catholique cesse sa publication en 1965, il rejoignit Nord Eclair qu’il quitta en 1970. André Cassette abandonna alors le journalisme pour d’autres activités professionnelles. Parallèlement, il fut élu adjoint au maire de Tourcoing.
Source(s) :Entretien avec Christian Cassette le 18 janvier 2021.
-
CASSETTE Louis Joseph
Louis Cassette est le benjamin d’une famille de sept enfants dont le père, Jules Henri, est tisserand à Croix. Très jeune, il participe à la diffusion de la presse catholique. En 1896, lors du congrès de la Bonne Presse à Paris, il reçoit du RP Vincent de Paul Bailly le diplôme de chevalier de La Croix . De 1895 à 1914, alors qu’il est employé dans un cabinet de dessins pour tissus, il est correspondant bénévole pour le quotidien lillois La Croix du Nord, seul son service militaire au 33 e RI d’Arras interrompt, pendant trois ans, cette collaboration avec le quotidien catholique. Se heurtant à l’opposition de sa mère, il a d’ailleurs refusé un poste de rédacteur-téléphoniste au Journal de Roubaix.
Parallèlement, très engagé dans les mouvements catholiques, Louis Cassette est secrétaire du cercle d’études Albert de Mun, secrétaire de l’Union catholique de Croix, secrétaire du Comité républicain fondé par Eugène Duthoit. Cela ne l’empêche pas de fonder en 1908 avec un associé son propre cabinet de dessins pour tissus.
Mobilisé durant la Première Guerre, Louis Cassette est fait prisonnier à Maubeuge en 1914, interné au camp de Friedrichsfeld en Rhénanie . Quatre fois, il est emmené en camp de représailles, De mai à décembre 1916, il est interné en Lituanie. Après avoir refusé en 1910, la direction du bureau roubaisien de La Croix du Nord, le titulaire étant mort durant la Première Guerre, il accepte la proposition de Mgr Masquelier, directeur, rédacteur en chef du quotidien lillois. Très rapidement, Louis Cassette développe l’édition de Roubaix, notamment par ses campagnes de presse contre les taudis de Roubaix en 1923, 1925, 1928 et 1933.
Lors de la Seconde Guerre, Louis Cassette gagne le siège du journal réduit au silence où la librairie et l’imprimerie purent continuer leurs activités. Une nouvelle fois, il s’efforce d’atténuer les difficultés de ses concitoyens devenant secrétaire du Secours national, des Soupes populaires, du Comité d’aide aux prisonniers.
A la libération, il reprend ses fonctions au bureau roubaisien de La Croix du Nord. En 1948, il est nommé membre du conseil d’administration du quotidien catholique.
Louis Cassette meurt le 28 août 1967. Il était également membre de la Commission historique du Nord, de la Société d’émulation de Roubaix, de la commission des Pupilles de la nation. Son dévouement au service des autres, son militantisme avaient notamment été récompensés par la croix de chevalier du Mérite social, et celle de chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand.
So urces: Manuscrit inédit de Louis Cassette, transcris par P.-J. Desreumaux; Nord-Eclair, 27-28 août 1967.
-
CATEL Edouard
Fils d’Arthur Léon Catel et de Marguerite Elise Lévêque, Edouard Henri Catel est orphelin de père à dix ans et commence à travailler comme apprenti-ébéniste. Militant catholique, il est l’un des artisans des débuts de la JOC à Lille et dans sa banlieue, il crée avec Mgr Six et Georges Torgue le syndicat libre de Lille dont il devient secrétaire permanent. Il est par la suite secrétaire de l’Union régionale CFTC. Après son service militaire à Metz, il entre comme rédacteur à La Croix du Nord dont il sera également chef de la propagande. Mobilisé en 1939, il regagne le Nord après l’armistice. Durant l’Occupation, La Croix du Nord n’ayant pu reprendre sa parution, il est responsable du service des réfugiés de la préfecture du Nord. A la Libération, il reprend son poste de journaliste au quotidien catholique où, particulièrement sensible aux questions sociales, il sera successivement reporter, secrétaire de rédaction, rédacteur et chef du secrétariat. A la fin de l’année 1944, il publie une brochure Le Crime des SS nazis à Ascq le 1 er avril 1944, la vérité sur cette monstruosité qui reprend les articles qu’il a donnés dans son journal dès septembre. La Croix du Nord connaissant des difficultés et se séparant d’une partie de son personnel, il entre en novembre 1965 à La Voix du Nord où il est secrétaire de rédaction jusqu’à sa retraite. Parallèlement, il est très actif dans sa paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes à Hellemmes ainsi qu’au sein de l’Association familiale scolaire de Fives-Saint-Louis. Edouard Catel meurt à Lille après une courte maladie. Il était chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand.
Source(s) :AD Nord, 3 E 1 14902; La Croix du Nord, 4 octobre 1953; La Voix du Nord, 11 février 1982.
-
CATOIRE Charles François
Des policiers se reconvertissent parfois en journaliste, Charles François Catoire fit lui le chemin inverse. Fils d’un boulanger lillois, François Charles Catoire, «de bonne conduite et de bonne moralité», selon la police, fut pendant quelques années rédacteur-reporter au quotidien Le Progrès du Nord. Dès 1895, il cherche une autre voie et entre dans la police. Il se marie à Bordeaux le 29 septembre 1898 avec Léonie Suzanne Niot .
Source(s) :AD Nord, 1T 222/19.
-
CAUDRON Ernest
Employé de perception, Ernest Caudron est également correspondant de La Croix du Nord qui l’embauche à plein temps en 1932, après son service militaire en Algérie.
Membre du Parti démocrate populaire (démocrate chrétien), il préside la section de Marcq-en-Baroeul, puis devient délégué à la propagande de la fédération du Nord. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier et envoyé en Allemagne où il participe à des actes de sabotage et à l’évasion de prisonnier. Membre du comité de Libération de Marcq-en-Baroeul, il est élu conseiller municipal M.R.P. de 1947 à 1959.
Devenu éditorialiste à La Croix du Nord , il dirige également Le Dimanche du Nord , édition hebdomadaire du quotidien catholique. En 1952, il devient rédacteur en chef de Nord Eclair et le reste jusqu’en 1959.
Membre du comité fédéral du M.R.P., il est vice-président départemental du Centre démocratie et progrès fondé par Joseph Fontanet. Il est adjoint au maire de Marcq-en-Baroeul de 1971 à 1977.
Très impliqué dans le monde combattant, il sera président départemental adjoint de l’UNC, chargé du périodique La Voix du combattant.
Source(s) :AD Nord, 3 E 3956; André Caudron, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, 4. Lille-Flandre, Beau Chesne CHRENO université de Lille III, 1990.
-
CAUDRON François
Fils d’un maçon et d’une ménagère, François Fénelon Joseph Caudron naît le 15 décembre 1865 à Ribécourt-la-Tour dans le Cambrésis. Elève au Petit séminaire de Cambrai, il y «exalte, selon la police, Voltaire et Rousseau». En 1890, Caudron entre pourtant comme rédacteur-reporter à La Dépêche de Lille . La police lui fait une «réputation d’ivrogne». En 1896, toujours employé au quotidien conservateur lillois, il se marie à Poperinghe en Belgique avec Léontine Markey.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/2, dossier, La Dépêche; Le Grand Echo du Nord, 10 avril 1896.
-
CAUVIN Charles
Charles Cauvin fut rédacteur en chef du journal La Vraie France du 4 septembre 1874 au 15 janvier 1877.
Source(s) :René CHOQUET, La Vraie France. Journal royaliste, légitimiste et catholique lillois de la fin du XIXe siècle, Lille III, 1994, Bernard Ménager (dir.).
-
CAUWEL Marcel
Début 1905, l a rédaction roubaisienne de L’Égalité de Roubaix -Tourcoing L’Égalité de Roubaix Tourcoing estdirigée parMarcel Cauwel, qui signe « Marcels ».
-
CAVROIS DE SATERNAULT Louis Jules Elisée
Docteur en droit, Louis Cavrois est membre du Conseil d’Etat qu’il abandonne en 1870. A la même époque, il s’installe à Arras et participe au lancement du Courrier du Pas-de-Calais dont il devient administrateur . Louis Cavrois est un des promoteurs de l’Université catholique de Lille. Candidat aux élections législatives dans la 1 re circonscription d’Arras, en 1881, il est battu.
Membre de la Commission des monuments historiques du Pas-de-Calais, il est l’auteur de plusieurs ouvrages ou études historiques.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, 10 novembre 1909.
-
CAZES Claude, dit Claude

Né dans le Gers en 1850, Claude Cazes, avant d’arriver dans le département du Nord au début des années 1880, fut journaliste au Progrès de Lyon puis au Républicain de l’Isère à Grenoble. Dans le Nord, il est d’abord rédacteur en chef du Progrès du Nord , puis il fonde en 1889 avec Edouard Delesalle Le Réveil du Nord dont il est le premier rédacteur en chef . Il quitte le quotidien socialiste en janvier 1896 pour des « raisons de convenances personnelles ». Emile Ferré lui rend alors un hommage appuyé dans Le Grand Echo du Nord du 5 janvier 1896.
Devenu percepteur, il meurt à Ollioules en janvier 1901.
-
CERET Désiré
Né à Marseille, DieudonnéDésiré Céret est maréchal des logis au 1 er régiment de carabiniers de Metz, mais est domicilié à Douai, lorsqu’il se marie, le 5 juillet 1827, avec Antoinette Rosalie Carpentier, sœur de l’imprimeur et propriétaire de La Feuille de Douai , Théophile Carpentier. Devenu commis négociant à Saint-Quentin dans l’Aisne, il est le 21 février 1840, nommé imprimeur en remplacement de son beau-frère mort en janvier 1840. L’établissement prend alors la dénomination de Céret-Carpentier et Désiré Dieudonné Céret devient directeur de La Feuille de Douai, qui se transforme en Réformiste en décembre 1847. Imprimeur du périodique Le Programme créé en janvier 1847, il en devient propriétaire en janvier 1848. Il est également l’imprimeur du Manuel général de l’Instruction primaire et du Salon du Nord (1843-1844). Il meurt à Paris le 17 novembre 1850 à l’âge de 49 ans.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017, 428 p.
-
CERET-CARPENTIER Rosalie
Mariée en 1827 avec Désiré Céret, Rosalie Carpentier bénéficie, à la mort de son frère, Théophile Carpentier, en 1840, de l’usufruit du journal La Feuille de Douai et de celui de l’imprimerie, fondés par son père Séraphin Carpentier. Après la mort de son mari, survenue en 1850, elle obtient son brevet d’imprimeur lithographe le 20 mars 1851. Elle poursuit l’activité de presse, transformant Le Réformiste (ex- Feuille de Douai ), après sa fusion avec L’Indicateur en septembre 1854, en Courrier douaisien. Organe d’opposition sous le Second Empire, ce journal devient dès le début de la III e République un fervent soutien du comte de Chambord. En décembre 1857, associée au libraire Adolphe Obez, Mme Céret dote Le Courrier douaisien d’une édition dominicale, Gayant. Echo de Douai qui disparaît en 1858. Le Courrier douaisien passe entre les mains d’Albert Duramou le 1 er avril 1876.
Rosalie Carpentier meurt à Carvin le 2 décembre 1877.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, op. cit.
-
CHABROUILLAUD Félix
Né à Barbézieux en Charente le 13 novembre 1802, Félix Chabrouillaud est d’abord avocat. Radical-socialiste, il est élu adjoint au maire de Limoges. Il collabore à La Dépêche de Toulouse, à La Petite République , puis devient chroniqueur judiciaire au Temps. En 1894, il participe à la création du journal collectiviste de Limoges, Le Réveil du centre. En 1897, il est embauché comme secrétaire de mairie à Roubaix. Il devient administrateur du Réveil du Nord et de L’Egalité de Roubaix-Tourcoing. «Créature de Millerand», selon l’historien roubaisien Jean Piat, il entraîne ces journaux du côté des participationnistes en 1902, créant ainsi une scission dans le camp socialiste. Il entraîne avec lui Carrette, premier maire socialiste de Roubaix, qui crée le Parti socialiste ouvrier roubaisien. En septembre 1905, il prend la direction et la rédaction en chef du Réveil du Centre , «journal d’union républicaine-socialiste» à Limoges.
-
CHADE Léon
Après des études de lettres à la Sorbonne, Léon Chadé devient journaliste à l’agence Havas en 1928. Promu rédacteur en chef du service étranger de l’Office français d’information qui, sous le régime de Vichy, a pris la suite de l’agence Havas, il est révoqué en novembre 1942 après avoir diffusé le récit du sabordage de la flotte française à Toulon.
 Contacté en 1943 par Jean Dubar, directeur du Grand Echo du Nord de la France, qui souhaite lui confier la direction de son journal après la guerre, Léon Chadé rejoint le quotidien lillois où il a été séduit par son équipement technique. Durant cette période, il aurait ainsi participé à la rédaction du journal clandestin Le Nord libre réalisé à partir d’avril 1944 par le directeur du quotidien lillois placé sous contrôle allemand ainsi qu’au Véritable Grand Echo diffusé au lendemain de la Libération de Lille. Le 3 septembre 1944, présenté par Jean Dubar à Jules Houcke, chargé de sortir au grand jour le journal La Voix du Nord fondé en avril 1941 par Natalis Dumez et Jules Noutour, il est nommé directeur de la rédaction et devient le seul membre du conseil de gérance qui ne soit pas issu du mouvement de résistance Voix du Nord. L’homme a de grandes ambitions pour le quotidien lillois, mais il se heurte à plusieurs reprises au conseil de gérance. En mars 1948, il est licencié, à l’issue d’une grève de trois semaines suivie par l’ensemble du personnel qui soutient son directeur contre le conseil de gérance, il quitte alors Lille. En 1949, il est nommé directeur du quotidien de Nancy, L’Est républicain, puis Pdg à partir de 1966. Souhaitant faire de son journal le premier de France, il engage une guerre de dix ans contre Le Républicain lorrain. Il fait ainsi passer L’Est républicain de 150 000 à 280 000 exemplaires, il rachète ou conclut des accords avec d’autres quotidiens. Agé de 69 ans, il quitte L’Est républicain en 1974, à l’occasion d’un changement d’actionnaire.Source(s) :
Contacté en 1943 par Jean Dubar, directeur du Grand Echo du Nord de la France, qui souhaite lui confier la direction de son journal après la guerre, Léon Chadé rejoint le quotidien lillois où il a été séduit par son équipement technique. Durant cette période, il aurait ainsi participé à la rédaction du journal clandestin Le Nord libre réalisé à partir d’avril 1944 par le directeur du quotidien lillois placé sous contrôle allemand ainsi qu’au Véritable Grand Echo diffusé au lendemain de la Libération de Lille. Le 3 septembre 1944, présenté par Jean Dubar à Jules Houcke, chargé de sortir au grand jour le journal La Voix du Nord fondé en avril 1941 par Natalis Dumez et Jules Noutour, il est nommé directeur de la rédaction et devient le seul membre du conseil de gérance qui ne soit pas issu du mouvement de résistance Voix du Nord. L’homme a de grandes ambitions pour le quotidien lillois, mais il se heurte à plusieurs reprises au conseil de gérance. En mars 1948, il est licencié, à l’issue d’une grève de trois semaines suivie par l’ensemble du personnel qui soutient son directeur contre le conseil de gérance, il quitte alors Lille. En 1949, il est nommé directeur du quotidien de Nancy, L’Est républicain, puis Pdg à partir de 1966. Souhaitant faire de son journal le premier de France, il engage une guerre de dix ans contre Le Républicain lorrain. Il fait ainsi passer L’Est républicain de 150 000 à 280 000 exemplaires, il rachète ou conclut des accords avec d’autres quotidiens. Agé de 69 ans, il quitte L’Est républicain en 1974, à l’occasion d’un changement d’actionnaire.Source(s) :La Voix du Nord; Gayan (Louis), La presse régionale. Le premier média de France, Editions Milan-Midia, Ecomédia, 1990, p. 54; «M. Léon Chadé quitte la direction de L’Est républicain», Le Monde, 16 décembre 1974; Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France, les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des amis de Panckoucke, 2021.
-
CHALENTON G
Pseudonyme de Barjavel. Gérant de La Croix du dimanche en 1898.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 10T 22.
-
CHALINES Fernand
Rédacteur en chef de L’Echo de Béthune du 10 janvier 1892 au 30 mai 1897.
-
CHAMBON Jean Chrysostome Louis Alphonse
Fils de Jean Chambon, praticien, Jean Chrysostome Chambon est né le 6 août 1825 à Prayssas dans le département du Lot-et-Garonne.
Rédacteur en chef du quotidien arrageois L’Ordre le 12 décembre 1868, il prend la gérance en remplacement de Clarenc de juin au 31 juillet 1870 .
-
CHAMONIN Louis
Fondateur de L’Annonce. Journal des propriétaires et locataires du Nord de la France en février 1899
-
CHAMOY Albert
Albert Chamoy est rédacteur au Journal de Lens , gérant de Nord-Sports en 1936.
-
CHAMPION-RICHEBÉ, Émile-Auguste
Ardent promoteur des principes démocratiques, Champion-Richebé fut l’un des promoteurs des banquets réformistes. Il collabora en 1848 au Messager du Nord , avec Bianchi, Testelin, Fémy, etc.
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869…, Lille, Leleu, 1869.
-
CHANTREL Joseph
Journaliste à L’Univers , puis au Monde à Paris, Joseph Chantrel est rédacteur en chef du quotidien arrageois Le Pas-de-Calais du 1 er mai 1871 au 18 avril 1872. Il est en 1874 rédacteur en chef de l’hebdomadaire populaire catholique, ultramontain et monarchique, La France nouvelle. Il fonde ensuite les Annales catholiques qu’il dirige jusqu’à sa mort . Historien, Joseph Chantrel est l’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages.
Source(s) :AD Pas-de-Calais 18J Ms 47. P.-M. Laroche, Les journaux à Arras au XIXe siècle. Impression d’un passant, 1899.
-
CHANVIN Jean-Baptiste
Fils d’un imprimeur audomarois, Jean-Baptiste Chanvin succède à son père en 1828. Installé 21, rue de L’ œ il à Saint-Omer, il fonde le 12 octobre 1831 L’Annotateur artésien qui devient successivement L’Observateur artésien puis L’Audomaroise . Cet hebdomadaire cesse sa parution le 30 décembre 1848, Chanvin le remplace le 22 février 1849 par L’indépendant. Journal politique de l’arrondissement de Saint-Omer . En 1859, l’imprimerie Chanvin est mise en liquidation. L’Indépendant est repris par l’imprimeur Charles Guermonprez.
Source(s) :«L’Indépendant créé le 22 février 1849 a 125 ans», L’Indépendant, février 1974.
-
CHANVIN Jean-François
Breveté imprimeur le 15 juillet 1811, Jean-François Chanvin, dit Chanvin-Gougeon, imprime les Affiches, annonces et avis divers de la ville de Saint-Omer puis à partir de 1814 la Feuille de Saint-Omer dont il est également propriétaire. Il transmet son imprimerie à son fils Jean-Baptiste qui est breveté le 2 février 1830.
Source(s) :data.bnf.fr/fr/atelier/17871/jean-françois chanvin/.
-
CHARLET Augustin
Diplômé de l’Institut d’Education physique de la faculté de médecine de Lille, Augustin Charlet entre au Grand Echo du Nord en 1925 après son service militaire effectué au 106 e régiment d’artillerie. Affecté au service des sports, il en devient chef en 1940. Mobilisé d’août 1939 à juillet 1940 au service de santé de la 1 re section militaire d’Infanterie militaire, il reprend son poste au Grand Echo du Nord lors de la reparution de celui-ci en août 1940. A partir de février 1944, il appartient au mouvement de Résistance Libé-Nord. A la Libération, il est nommé chef des services sportifs de La Voix du Nord , fonctions qu’il cumule à partir de 1946 avec celles de rédacteur en chef de La Voix des sports , hebdomadaire lancé par La Voix du Nord. Augustin Charlet est également chroniqueur sportif à Radio Lille, correspondant régional de plusieurs journaux: France-Soir , Le Parisien libéré , Le Provençal , La Dépêche de Toulouse , Le Progrès de Lyon,l’Associated Press, etc.
Soucieux de l’intérêt des journalistes, il est secrétaire de la section Nord-Pas-de-Calais du SNJ, membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes sportifs dont il sera vice-président, il est également président de la section Nord-Pas-de-Calais-Somme et Aisne du Syndicat national des journalistes sportifs.
Impliqué dans de nombreuses associations sportives, il est secrétaire général du Sporting club fivois de 1921 à 1925, vice-président fondateur de l’Association sportive des Postes Télégraphe Téléphone de Lille de 1927 à 1947, membre du Comité des Flandres de cyclisme, du Comité régional de la Ligue des Flandres de hockey, du Comité directeur de l’Association nationale des médaillés de l’Education physique, etc.
Ses activités lui valent de nombreuses distinctions: médaille du ministère de la Guerre pour services rendus à la préparation militaire, médaille d’or de l’Education physique et des sports, médaille d’or du travail. Officier d’Académie, Augustin Charlet est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1955. La médaille de la Reconnaissance française, du Combattant volontaire de la Résistance et la croix du Combattant avaient récompensé sa conduite pendant la guerre.
Source(s) :Dossier de Légion d’honneur; La Voix du Nord, 1955.
-
CHARLET Jean
Fils d’Augustin Charlet, rédacteur en chef de La Voix des sports, Jean Charlet devient naturellement journaliste. Il entre à La Voix du Nord le 1 er septembre 1953 comme secrétaire de rédaction au service des informations régionales. Il en devient le chef et le reste jusqu’à sa retraite. Il meurt en 2013 à l’âge de 81 ans.
-
CHATELET Achille
Imprimeur de L’Echo de Béthune en 1880.
-
CHATELLE Albert
Après ses études, Albert Chatelle devient journaliste dans sa ville natale, Boulogne-sur-Mer. Il travaille d’abord à L’Impartial , puis à La France du Nord , plus tard il continuera à collaborer au Télégramme du Pas-de-Calais , puis, après la Seconde Guerre, au Journal du Pas-de-Calais et de la Somme.
Après la Première Guerre, il est nommé conservateur adjoint du musée de la Marine et publie une vingtaine d’ouvrages historiques. Volontaire lors de la déclaration de guerre en 1939, il est affecté à l’état-major de l’amiral Nord, à Dunkerque. Capturé par les Allemands en juin 1940, il est interné.
Albert Chatelle était membre de l’Académie de la Marine, membre du Comité de restauration de la colonne de la Grande Armée, officier de la Légion d’honneur.
Source(s) :Daniel Tintillier, La Presse boulonnaise. Catalogue de l’exposition organisée par L’Association des journalistes du Pas-de-Calais, BM de Boulogne-sur Mer, 2009; dossier de Légion d’honneur.
-
CHATILIEZ Guy
Ancien de la JOC, militant au MRP, Guy Chatiliez, qui a entrepris des études de journalisme après son retour du STO, entre à Nord Eclair le 3 juillet 1949. Après avoir occupé divers postes au sein de la rédaction du quotidien roubaisien, il devient grand reporter.
Lors des élections municipales de 1977 où il est candidat sur la liste socialiste, il est élu maire de Tourcoing. Il meurt deux ans plus tard le 28 juillet 1979.
-
CHAULEUR Henri
Henri Chauleur a dirigé la rédaction du Télégramme du Pas-de Calais qu’il quitte en avril 1911.
Source(s) :Daniel Tintillier, La Presse boulonnaise. Catalogue de l’exposition organisée par L’Association des journalistes du Pas-de-Calais, BM de Boulogne-sur Mer, 2009.
-
CHAUMET Pierre
Fils d’un cultivateur de la Haute-Loire, Pierre Chaumet projetait probablement d’entrer dans les ordres. Séminariste lors du conseil de révision, il choisit pourtant une autre voie, le journalisme. D’abord ajourné du service militaire, il est finalement déclaré exempté en 1897 en raison d’une maladie rare, l’endocardite.
Arrivé à Cambrai, où il se marie le 13 décembre 1901 avec Marie Pauline Crépin, il est rédacteur au journal légitimiste et catholique L’Emancipateur.
Sa maladie l’obligea-t-elle à renoncer au journalisme ? Après plusieurs années passées au sein du même journal, il devient en effet courtier de commerce. Il meurt le 10 juin 1920 à l’âge de 45 ans.
Source(s) :AD Haute-Loire, 6 E 24/9 et 1 R 891; AD Nord, 3 E 6550; Le Grand Echo du Nord, 14 juin 1920.
-
CHAUNY Paul
Cf. Mallet de Chauny
-
CHAUSSOIS Robert
, historien La vie professionnelle de Robert Chaussois fut d’abord marquée par la fidélité à sa ville natale où il effectua toute sa carrière de journaliste. Il la commença durant l’Occupation au Phare de Calais, puis après la Libération il entra au Nord littoral. Responsable des informations locales et régionales du quotidien L’Echo de Calais et du Pas-de-Calais de juillet 1950 à février 1951, il entra alors à la rédaction de Calais de La Voix du Nord . En 1979, il prenait la succession d’Yves Broussier comme chef de l’édition calaisienne, poste qu’il occupa jusqu’à sa retraite en mars 1990.
Erudit, historien local de grande qualité, Robert Chaussois est l’auteur de nombreux ouvrages notamment sur la Seconde Guerre mondiale dans le Calaisis. Il a également publié un livre sur Louis Blériot, l’homme de la Manche, et un autre sur les géants du Nord.
Source(s) :Presse Actualité, n° 105, juin-juillet-août 1975.
-
CHERADAME
Selon Hippolyte Verly, qui ne fournit pas plus de précisions, Chéradame aurait été rédacteur à La Gazette de Flandre et d’Artois.
Source(s) :Hippolyte Verly, Essai de biographie lilloise contemporaine.
-
CHEVALIER Claude
Claude Chevalier débute dans le journalisme en 1957 au Journal du Pas-de-Calais et de la Somme. Il entre ensuite à la rédaction de Boulogne de La Voix du Nord où il effectue le reste de sa carrière.
-
CHIROUTRE Amédée Léon Charles
Fils de Charles Chiroutre et d’Agnès Gauvry, Amédée Chiroutre, domicilié 27, rue du Jeu-de- paume à Dunkerque, lance le 19 avril 1922, avec ses frères Gaspard et Roger, un journal républicain, Nord Eclair, quotidien d’union des gauches. Ce périodique cesse sa parution le 15 juin 1924
Par la suite, il quitte le Nord et devient imprimeur à Paris où, en 1940, il épouse Gabrielle Juliette Leclercq.
Source(s) :AD Nord, M 149/148.
-
CHIROUTRE Charles Désiré Joseph
Fils de Jean-Baptiste Chiroutre, cordonnier, et de Hyacinthe Bibiane Robitaillie, Charles Chiroutre arrive à Dunkerque pour y terminer son service militaire après s’être battu, en 1870, dans l’armée du Nord commandée par le général Faidherbe. Il avait auparavant été apprenti typographe dans des imprimeries à Armentières, Valenciennes et Roubaix.
Resté à Dunkerque, il est d’abord prote auPhare de Dunkerque. En octobre 1881, il crée un journal Le Petit Dunkerquois dont la parution ne dure que trois mois. Le 30 avril 1882, il fonde un quotidien, Le Nord maritime dont il est l’imprimeur, propriétaire et gérant. Répondant aux attentes des Dunkerquois, notamment grâce à son information locale développée et sa rubrique «Le carillon dunkerquois», sorte de tribune où chacun peut «se plaindre de tout et de rien, mais aussi d’exprimer [ses] désirs», selon Jean-Marie Goris, ce journal rencontre rapidement le succès. A la suite d’une polémique entre Le Phare de Dunkerque et Le Nord maritime, en juillet 1891, Chiroutre croise le fer avec Charles Simon, directeur de la Société des journaux réunis du Nord et du Pas-de-Calais. En octobre 1902, lors d’émeutes, Le Nord maritime est attaqué et ses bureaux saccagés. Chiroutre rend la ville responsable ce que confirme la justice . En 1908, Le Nord maritime quitte son siège du 6 de la rue David-d’Angers pour un magnifique hôtel édifié place Jean-Bart.
Le 29 septembre 1875, Charles Chiroutre avait épousé Adeline Thérèse Nissen dont il est veuf en 1884. Deux ans plus tard, il se marie avec Agnès Gauvry. Son entreprise prend alors le nom de Chiroutre-Gauvry. Elle va éditer et publier de nombreux ouvrages.
Le 20 juillet 1921, Chiroutre cède son journal à Francis Carlier, qui en était directeur depuis vingt ans, pour un million de francs. Il se retire à Petite-Synthe où il meurt en quelques semaines plus tard.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/10; Jean-Marie Goris, «Le Nord maritime, journal de Dunkerque (1882-1944)», Revue de la Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, novembre 1995, n° 29; Le Grand Echo du Nord, 23 juillet 1891, 16 juin 1904 et 2 mai 1905.
-
CHIROUTRE Gaspard Augustin Jules
Fils de Charles Chiroutre et de sa première épouse Adeline Thérèse Nissen, Gaspard Chiroutre fonde à Dunkerque avec ses frères Amédée et Roger Nord Eclair dont la direction est confiée à Louis Burnod et Ernest Dupont. Il crée quelques années plus tard la revue maritime Le Port de Dunkerque. Il meurt à l’âge de 49 ans des suites d’une longue maladie.
Source(s) :AD Nord, 1T 222; Le Grand Echo du Nord, 6 août 1927.
-
CHOMBART Michel
Après avoir débuté sa vie professionnelle dans l’administration portuaire à Boulogne-sur-Mer puis à Calais, Michel Chombart opte pour le journalisme, entrant comme rédacteur à Nord littoral , puis à La Voix du Nord . Il passe ensuite au Journal du Pas-de-Calais et de la Somme dont il devient rédacteur en chef. A la fermeture du quotidien boulonnais, il entre au Républicain lorrain . En 1969, il devient chef d’agence à Nice matin. Il prend sa retraite en 1982.
Source(s) :Daniel Tintillier, La Presse boulonnaise. Catalogue de l’exposition organisée par L’Association des journalistes du Pas-de-Calais, BM de Boulogne-sur Mer, 2009.
-
CHOQUET
Antoine (?,? –?,?) Journaliste Antoine Choquet devient rédacteur responsable de la Feuille de Douai à la mort de Théophile Carpentier en janvier 1840.
-
CHOQUET Marc
Journaliste Marc Choquet est rédacteur-correspondant au Réveil du Nord pour la région du Quesnoy durant l’entre-deux-guerres. A la Libération, il est membre de la Commission régionale de presse chargée d’examiner l’attitude des journalistes durant l’Occupation en vue du renouvellement de leur carte professionnelle. Homme de lettres, il est animateur en 1925 de la revue Terroir, semi mensuel du cercle littéraire Amédée Prouvost de Roubaix. Il publie plusieurs recueils de poèmes et donne également des causeries sur Radio PTT. Après la guerre, il est élu président de la société «La Muse Nadaud» à laquelle il donne un nouveau souffle avec la publication de plaquettes de poèmes, l’adoption d’un nouveau drapeau. Marc Choquet quitte la société au début des années 1960.
-
CIEREN Georges
Fils de Théophile Auguste Louis Cieren, praticien, et Henriette Louise Bac, Georges Cieren est né à Dunkerque le 19 octobre 1868. Entré en 1890 comme secrétaire de rédaction à La Croix du Nord , devenue quotidienne, Georges Cieren fut l’un des premiers collaborateur du journal catholique où il exerce en parallèle les fonctions de gérant. Plus tard, il gagne L’Indépendant du Pas-de-Calais fondé à Saint-Omer en 1849 dont il devient en 1920, après la mort du directeur Paul Gabriel, le directeur-rédacteur en chef et directeur de l’imprimerie. Durant l’Occupation, refusant de faire reparaître le quotidien audomarois qui avait cessé sa parution le 23 mai, il publie, à la demande du maire, un bulletin d’informations locales, Le Bulletin audomarois. A la Libération, aucune charge n’étant retenue contre lui, il reprend son poste de rédacteur en chef à L’Indépendant de Saint-Omer . Parallèlement, Georges Cieren est très impliqué dans la vie associative et la défense de la profession. Lors de la création, en mai 1897, de la Jeune Garde, section départementale des Jeunesses catholiques dont le siège était situé dans les locaux de La Croix du Nord, il en devient le président. Il est également l’organisateur de la Fédération des sociétés de gymnastique. Georges Cieren est l’un des fondateurs de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, créée pour venir aide aux journalistes retraités ou en activité. Arrivé dans le Pas-de-Calais, en 1922, il relance l’Association professionnelle des journalistes du Pas-de-Calais dont il est le vice-président jusqu’en 1932. Il assure ensuite la présidence jusqu’en 1937. L’année précédente, il avait créé le Syndicat des directeurs de journaux du Pas-de-Calais qu’il préside. Dans sa ville d’adoption, Saint-Omer, il est membre de plusieurs associations locales.
Cet engagement est récompensé par la croix de chevalier de la Légion d’honneur.Il meurt à Saint-Omer à l’âge 84 ans.
Source(s) :Léonore, dossier de chevalier de la Légion d’honneur; AD Nord, 6 W 455; Jim Kennedy, «L’Association catholique de la Jeunesse française dans le diocèse de Lille», Revue du Nord, 1971, n° 208 et différents numéros de, La Croix du Nord.
-
CIEREN Paul
Frère cadet de Georges Cieren, Paul Cieren commence sa carrière de journaliste à La Croix du Nord où il est reporter pendant dix-sept ans. Il quitte le quotidien catholique pour Le Télégramme du Pas-de-Calais où il est rédacteur en poste à Dunkerque. Il meurt en avril 1938 à l’âge de 61 ans.
Source(s) :AD Nord, 3 E 17179; La Croix du Nord, 28 avril 1938.
-
CLARISSE abbé
L’abbé Clarisse fonde en 1866 La Semaine religieuse du diocèse de Cambrai dont il est à la fois directeur et propriétaire. Malade, il demande en 1874 à Mgr Régnier, archevêque de Cambrai, de nommer à sa place l’abbé Henri Delassus, qui collaborait déjà au périodique.
-
CLASSE Ernest
Le 29 avril 1882, Le Journal de Roubaix informe ses lecteurs du décès d’Ernest Classe, survenu «après de longs mois de maladie» à l’âge de 30 ans. Issu d’une famille modeste d’ouvriers – son père est tulliste à Saint-Pierre-les-Calais –, boursier au collège de Roubaix, Ernest Classe entre au Journal de Roubaix en 1869 en qualité d’élève-compositeur. Devenu rapidement correcteur, il s’élève jusqu’au poste de secrétaire de rédaction. A partir de 1877, il est également rédacteur en chef du Courrier du dimanche , autre publication du groupe Reboux. Par ailleurs, Classe était officier de réserve. Dans le numéro du 30 avril 1882 du Réveil du Nord, Jules Jenniaux, au nom de la rédaction, signe un article nécrologique à la mémoire d’Ernest Classe qu’il désigne comme «un de nos amis les plus et les dévoués».
Source(s) :Le Journal de Roubaix, 29 avril 1882.
-
CLAUS Camille
En octobre 1907, Camille Claus prend la direction du Mémorial artésien édité à Saint-Omer. Pour ce journaliste de bientôt cinquante ans, c’est un retour dans son département d’origine après plusieurs décennies de carrière à Paris et dans l’Est de la France.
Fils d’un notaire, Camille Louis Joseph Claus voit le jour à Sains-en-Gohelle dans l’arrondissement de Béthune. Ses parents installés à Carvin, il est élève à l’Institution Saint-Joseph à Arras. Ses obligations militaires accomplies comme infirmier, il gagne Paris où il travaille pour différents journaux : Le Siècle, Le Petit Parisien, L’Estafette… Parallèlement, il est le parolier de plusieurs chansons sous son nom ou sous le pseudonyme de C. Carvin.
En 1902, il se marie à Montmorency en Seine-et-Oise avec Juliette Augustine Doré et devient le premier rédacteur en chef du Libéral de l’Est édité à Nancy. En juin 1903, il fonde, dans la même ville, La Vie lorraine illustrée, revue mensuelle littéraire, artistique, commerciale qu’il laisse dans les mains de Paul Fouquet. En octobre 1904, il est nommé rédacteur en chef du semi-hebdomadaire belfortain, L’Alsace, créé quelques mois plus tôt. Trois ans plus tard, il regagne le Pas-de-Calais, il prend les rênes de la rédaction du Mémorial artésien où il terminera sa carrière professionnelle.
En 1913, il fait partie des fondateurs de l’Association professionnelle des journalistes. Elu vice-président, il en devient président en 1916. La guerre terminée, il relance l’association dont il assume la présidence au moins jusqu’en 1926. Camille Claus était officier d’Académie.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 737/2, 1 R 8018 et 3 E 737/22; AD Val-d’Oise, 3 E 118 120; L’Est républicain, 15 octobre 1904 et 27 octobre 1907; Le Courrier du Pas-de-Calais, 16 octobre 1921; Le Beffroi d’Arras, 21 septembre 1922 et 25 septembre 1925.
-
COINTRELLE Henri
Elève brillant, Henri Cointrelle obtient, après une dérogation, le baccalauréat à l’âge de 15 ans. A l’issue de ses études de droit à la faculté libre de Lille, il devient avocat à 20 ans. Pendant plusieurs années, il assure une chronique juridique dans le quotidien lillois La Dépêche sous le pseudonyme de M e Lesec. Il est également un conférencier «à la parole chaude et vibrante», selon le dictionnaire biographique du Nord. Membre de différents comités anti-collectivistes, Henri Cointrelle fut élu adjoint au maire de Lille, délégué aux fêtes et à l’hygiène. Il fut également conseiller d’arrondissement sous l’étiquette des républicains libéraux de 1895 à 1901. Il fut président de plusieurs associations, notamment musicales:: cercle mandoliniste, musique du Centre. Il avait été fait chevalier de la Société d’encouragement au dévouement en 1934.
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord, 1893, plusieurs numéros du Grand Echo du Nord.
-
COISNE Désiré
Mineur de fond à Lens, Désiré Coisne devient secrétaire adjoint des mineurs CGT du Pas-de-Calais. Dans le cadre de son activité syndicale, il collabore à La Tribune, organe des mineurs du Pas-de-Calais, du Nord et d’Anzin. En 1939, il fonde un syndicat autonome qui se dote, en juillet, d’une publication imprimée à Béthune, Le Pays noir, bimensuel d’information et de défense du syndicalisme indépendant dont il est le directeur.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du Bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010.
-
COLAS Alphonse
Petit-fils d’un député dont l’amendement fit la République en 1875, Henri Wallon, et d’un artiste peintre, prix de Rome, Alphonse Victor Colas, le journaliste Alphonse Emile Alphonse Colas revendique plus de quarante ans de journalisme. Cependant, ce Lillois ne limita pas ses activités à la presse, on le retrouve en effet dans l’administration, mais aussi dans de nombreuses associations.
Bachelier ès lettres, Alphonse Colas, dont la famille maternelle a donné plusieurs militaires à la France, s’engage dès novembre 1895 pour quatre ans au 4e régiment de cuirassiers. De retour à la vie civile, il s’oriente vers le journalisme. Il est successivement rédacteur au Réveil du Nord, puis à L’Echo du Nord mais aussi correspondant et photographe de plusieurs journaux illustrés : l’Illustration, Le Monde illustré. En 1902, il fait partie des membres fondateurs de l’Association professionnelle des journalistes de la région du Nord. Selon la police, il est également professeur de sténo et sténographe du conseil municipal de Cambrai, ville dont son père est, lors de sa naissance, secrétaire de la sous-préfecture. En mai 1914, il aurait fait du contre-espionnage pour la Sûreté générale.
Mobilisé lors de la déclaration de guerre le 2 août, il se marie quelque deux semaines plus tard. avec Eugénie Octavie Huet, couturière. Le 22 novembre, il est blessé au combat. Invalide à 50 %, il est rayé des contrôles de l’Armée en février 1916. Il s’investit alors comme secrétaire dans différentes associations dont l’objectif est de venir en aide aux soldats et aux réfugiés, de préparer la reconstruction. Chargé, en novembre 1918, de la direction des bureaux de placement pour les soldats démobilisés, il est alors rédacteur en chef du Bulletin de renseignements sur les emplois civils réservés aux militaires et marins réformés n° 1 ou retraités par suite d’infirmités. En 1919, Colas est, pendant quelques semaines, attaché au cabinet d’Albert Lebrun, ministre des Régions libérées. A cette occasion, il fonde et dirige le Bulletin des régions libérées. A sa demande, il regagne Lille où il est nommé agent administratif des dommages de guerre, puis agent technique principal de la reconstruction agricole du département du Nord.
Si Alphonse Colas passe une quinzaine d’années dans l’administration, c’est bien dans la presse qu’il accomplit l’essentiel de sa vie professionnelle. De 1921 à 1926, il est rédacteur économique au quotidien Le Télégramme. Il est jusqu’en 1939 directeur du Progrès industriel. Revue mensuelle de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, des expositions et des congrès. Elu secrétaire général de la Société d’horticulture du Nord, il prend également en charge la revue Le Nord horticole. A ce titre, il organise de nombreuses expositions d’horticulture et il est membre du jury de plusieurs d’entre elles. En 1928, le ministre de l’Agriculture le nomme ainsi chevalier de la Légion d’honneur. Cette nomination, sur intervention d’Albert Lebrun selon la rumeur, suscite de vives critiques dans la presse régionale, qui, rapporte la police, le juge « intriguant et ambitieux ».
Alphonse Colas déploie beaucoup d’énergie dans de multiple autres associations, il est ainsi délégué cantonal, secrétaire adjoint de l’Union départementale des sociétés de secours mutuels du Nord, vice-président de la Fédération des sociétés protectrices des animaux, membre de l’Office des pupilles de la Nation… Autant d’activités qui sont couronnées par sa nomination dans divers ordres : du mérite agricole français et belge, de l’Instruction publique, de Léopold (Belgique), du Nichan Iftikhar (Tunisie) et par l’attribution de décorations : médaille commémorative de la Grande Guerre, médaille interalliée de la Grande Guerre, médaille d’or des sociétés de secours mutuels, médaille d’argent de la Prévoyance… Membre du Comité exécutif du Parti radical et radical socialiste, il est même tenté par un mandat électif. En 1925, il se présente en vain aux élections municipales à Lille sur la liste de l’Union des gauches…
A la fin des années 1930, Colas ambitionne d’accéder au grade d’officier de la Légion d’honneur, mais il se heurte à l’opposition du préfet du Nord. Après la Seconde Guerre, il pense avoir de nouveaux titres à faire valoir pour parvenir à cette promotion. Dès la déclaration de guerre, il a en effet cessé toute activité de journaliste, mais s’est engagé en qualité d’infirmier-secouriste dans la défense passive. Durant l’Occupation, il diffuse autour de lui les nouvelles recueillies à la BBC et, dit-il, subventionne La Voix du Nord clandestine. Au milieu de l’année 1941, à la suite d’une dénonciation, son domicile est perquisitionné. En octobre, il l’est une seconde fois et, cette fois, l’occupant y découvre des armes, des drapeaux anglais et américains. Sa femme et lui sont ainsi mis au secret à la prison de Loos jusqu’en janvier 1942.
A la Libération, âgé de 68 ans, Alphonse Colas reprend du service comme inspecteur au contrôle militaire de l’information. Malgré, cette fois, l’avis favorable du préfet, qui salue un homme de « bonnes conduite et moralité et d’une parfaite honorabilité », il ne sera jamais nommé officier de la Légion d’honneur. Il meurt à Lille le 18 février 1950.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 350 R 011, 3 E 15261; site Léonore, dossier de légionnaire; Le Grand Echo du Nord, 10 avril 1923, 28 juillet 1928, 5 mai 1929, 10 avril 1931, 15 avril 1936; La Croix du Nord, 19 février 1950.
-
COLBAERT Jean-Baptiste
Compagnon de route de Broutchoux, Jean-Baptiste Colbaert fait partie de la commission de rédaction du Réveil syndical qui paraît d’avril à décembre 1903 et de L’Action syndicale qui prend la suite à partir de 1904. Passé au Vieux-Syndicat fondé par Emile Basly, Colbaert devient gérant de La Voix du mineur à partir du 25 octobre 1913. Après la Première Guerre mondiale, il est rédacteur au quotidien Le Réveil du Nord. Secrétaire de la section socialiste de Béthune, il collabore également à L’Eclaireur du Pas-de-Calais , l’hebdomadaire de la fédération socialiste, qui paraît de 1921 à 1938.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du Bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, op. cit.
-
COLPIN Jules
Jules Colpin e ntre à La Croix du Nord en 1890 lorsque le journal catholique dirigé par l’abbé Masquelier devient quotidien. Il le quitte pour s’installer libraire, rue Esquermoise. Il dirige cet établissement pendant 34 ans avant de le céder à Jonas Tirloy. Catholique convaincu, Jules Colpin était membre de plusieurs œuvres, il fut notamment président des écoles et patronages catholiques, président de l’Union paroissiale de Flers Bourg. Son dévouement fut récompensé par la décoration Pro Ecclesia et Pontifice. Il était père de onze enfants. Son fils aîné le sous-lieutenant Pierre Colpin fut tué en mars 1923 lors de l’occupation de la Ruhr par les troupes françaises. .
Source(s) :La Croix du Nord, 14 mars 1929, 20 février 1928, 23 octobre 1929, 4 mars 1938.
-
CONTESSE Serge
Fils d’un capitaine reconverti dans la photo, Serge Contesse est entré à La Voix du Nord le 1 er octobre 1946. Grand reporter, puis chef du service photo du quotidien lillois, cet homme aux yeux malicieux et à la grosse moustache à la gauloise, a parcouru aussi bien sa région d’adoption que les plus lointaines contrées, il a photographié les plus humbles, ceux qui fêtaient leurs noces d’or, luttaient pour l’amélioration de leurs conditions de vie… comme les grands de ce monde: le général de Gaulle en visite dans le Nord-Pas-de-Calais, Elisabeth II d’Angleterre lors de son couronnement, le pape…, il a rencontré les artistes de son temps: Picasso, Brassens, Reggiani, Piaf…
Formé aux Beaux-Arts, Serge Contesse était aussi un peintre reconnu, s’inspirant du quotidien, de ses semblables dont il traquait les attitudes, les travers. Ami d’Arthur Van Hecke, qu’il avait rencontré à l’Atelier de la Monnaie à Lille, il avait présenté sa première exposition en 1957 dans le Vieux-Lille. L’heure de la retraite venue, il avait pu se consacrer pleinement à sa «barbouille» comme il disait en parlant de sa peinture. Il est mort le 3 juin 2003.
Source(s) :La Voix du Nord, 3 juin 2003.
-
COPPENS Raymond
A la Libération, Raymond Coppens est secrétaire de rédaction au Libre Artois.
Source(s) :Libre Artois, 10 novembre, 1946.
-
COQUELLE Robert
Fils d’agriculteur, Robert Coquelle, passionné de cyclisme dès son plus jeune âge, devient lui-même coureur cycliste. Il collabore au magazine Le Vélo et à La Vie au grand air. Il devient ensuite journaliste à L’Auto et administrateur de L’Echo des sports. Avec Victor Breyer, il écrira deux ouvrages sur le cyclisme: Les Rois du cycle et Les Géants de la route. De 1902 à 1924, il dirige le vélodrome Buffalo à Paris.
-
CORBANIE Dominique
Entré le 1 er juin 1967 à La Voix du Nord, Dominique Corbanie y est secrétaire de rédaction. Il meurt à l’âge de 45 ans des suites d’une longue maladie.
-
CORDIER Séraphin
«Sincère dans ses convictions, respectueux des idées de chacun, cherchant à faire partager ses vues par la persuasion», tel est le portrait que Le Grand Echo du Nord dresse de Séraphin Cordier au lendemain de sa mort survenue des suites d’une maladie le 6 juillet 1913. Le quotidien souligne également combien Cordier «jouissait dans les milieux ouvriers d’une réelle autorité». Né à Carnin dans le Nord sous le Second Empire, l’homme avait passé sa vie à défendre les mineurs et les ouvriers en général. Entré dès son plus jeune âge aux mines de Carvin (Pas-de-Calais), il était devenu délégué mineur en 1890, puis membre de la fédération régionale des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais à partir de 1893. En 1906, Séraphin Cordier fut nommé membre de la Commission d’enquête sur la catastrophe de Courrières. Avec ses camarades délégués mineurs, il se désolidarisa des conclusions des autres membres de cette commission. Plus tard, il sera élu secrétaire du Vieux Syndicat et occupa brièvement le poste de trésorier de la fédération des mineurs. Gérant de L’Ouvrier mineur en mai 1905, il fut rédacteur à La Voix du mineur à partir de septembre 1907, puis gérant. Parallèlement, Séraphin Cordier mena une carrière politique. Elu conseiller municipal à partir de 1900, puis 1 er adjoint radical-socialiste de Carvin, il démissionne en 1911. L’année suivante, il est élu conseiller municipal de Lens sur la liste Socialiste.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 8 juillet 1913; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, 7 et 9 juillet 1913.
-
CORMONT Charles
Rédacteur en chef de La Revue de l’Escaut , journal des intérêts littéraires, artistiques, scientifiques, commerciaux du Nord de la France (16 août 1857-2 mars 1862), Cormont est, selon la police impériale, «d’humeur agressive et d’un caractère un peu entier, se posant comme un redresseur de d’abus». En septembre 1860, il sollicite l’autorisation de publier un quotidien politique, La Revue du Cambrésis, qui lui est refusée.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/4.
-
COSTA Pierre
Fils de Pierre François Costa, un corse, chef de gare à Marly dans le Valenciennois, et de Sophie Delattre, Pierre Costa naît le 20 décembre 1886 dans une famille nombreuse. Il devient rédacteur à l’agence valenciennoise du Réveil du Nord avant la Première Guerre. Parallèlement, c’est un homme engagé. En 1919, il est élu conseiller municipal socialiste de Valenciennes. En 1925, il devient même adjoint au maire. Quatre ans plus tard, il choisit de se présenter dans sa ville natale. C’est également un homme impliqué dans plusieurs associations sportives: à la fédération du jeu de balle au gant dont il est vice-président, à la fédération colombophile «L’Eclair» dont il est président… En 1925, il est nommé officier d’académie, en 1927, il reçoit la médaille de la mutualité et en 1944, la médaille du travail pour plus de 30 années d’activités professionnelles. A la Libération, il n’est pas repris par Nord-Matin qui prend la succession du Réveil du Nord . Il meurt en 1950.
Source(s) :AD Nord, 1Mi EC 383 R 001; «Notre collaborateur Pierre Costa, nommé officier d’académie», L’Egalité; 5 octobre 1925, Le Réveil du Nord, 1er, août 1944.
-
COUAILHAC Gabriel
Fils puîné de deux artistes dramatiques Guillaume Couailhac, né à Cahors, et Geneviève Joséphine Fradelle, née à Rouen, mariés à Lille en décembre 1810, Gabriel Léon Couailhac est probablement le moins connu des enfants du couple. Né à Lille en 1813, il y passa certainement toute sa vie.
Lors de son mariage, dans cette même ville le 19 mai 1839 avec Jeannette Boyer, fille d’un ingénieur mécanicien, alors que ses parents parcourent la France, il y exerce le métier de fabricant de papiers.
Selon Hippolyte Verly, il entre à L’Echo du Nord comme rédacteur-correcteur en 1841. Il remplace alors Matthieu qui fonde quelque temps plus tard Le Moulin à vent. Il ne reste que quelques années à la rédaction du quotidien lillois où il est remplacé par Léon Gramain.
Il abandonne probablement le journalisme. Lorsqu’il meurt à l’âge de 68 ans, il est rentier.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 044 R 135, 5 Mi 044 R 215 et 1 Mi EC 350 R 080; Hippolyte Verly, Essai de biographie lilloise contemporaine; Georges Lepreux, Nos journaux, Douai, 1896.
-
COUAILHAC Louis
Si, comme l’écrivent lors de sa mort en 1885 plusieurs quotidiens parisiens, le nom de Louis Couailhac est un peu oublié, l’homme, auteur prolifique, « eut son heure de gloire ».
Né à Lille en 1810 où ses parents sont artistes, Louis Jean Joseph Couailhac fait de bonnes études au lycée Henri IV qui le conduisent au professorat à Lyon. Dès 1833, il quitte l’enseignement pour tenter sa chance à Paris dans la littérature.
D’abord précepteur, il entre, en 1837, au quotidien La Patrie. Commence une longue carrière de journaliste où, selon les mots prononcés sur sa tombe, il va exceller dans la presse judiciaire et parlementaire. Louis Couailhac collabore ainsi au Messager, au Courrier français, au Temps, au Figaro, au Corsaire, au Charivari… auxquels il fournit faits-divers, articles politiques, feuilletons… En 1852, il est nommé rédacteur en chef du journal La Normandie édité à Rouen, puis du Nord édité à Lille, titres créés pour soutenir la politique impériale. Louis Couailhac est d’ailleurs tenté par une carrière politique. En 1852, Le Siècle l’annonce candidat au Corps législatif dans le département du Lot d’où était originaire son père. On le retrouve ensuite à La Presse où, selon Vapereau, il signe une correspondance à partir de matériaux envoyés de Madrid par son frère Victor.
Depuis plusieurs années déjà, il s’est également fait un nom dans le monde des lettres. En 1832, alors qu’il vient tout juste d’occuper une chaire de grammaire à Lyon paraît son premier ouvrage, un recueil de nouvelles Les Sept Contes noirs, bientôt suivi des romans Avant l’orgie (1836), Pitié pour elle (1837), Une Fleur au soleil (1838)… En 1837, il donne avec Eugène Sandrin Les Tribulations d’un employé. L’année suivante, Le Charivari salue la représentation de sa comédie-vaudeville Plock le Pêcheur. En quelque cinquante années, Louis Couailhac écrit, seul ou en collaboration, une soixantaine de pièces de théâtre : Duchesse et poissarde, L’Oiseau de paradis, Maurice et Madeleine, Le Roi des goguettes, La Chasse aux grisettes, Les Bonnes, La Cuisinière mariée, Les Sociétés secrètes, Arrêtons les frais… Il est également l’auteur d’une histoire et d’une description du Muséum d’histoire naturelle, Le Jardin des plantes, d’une peinture des mœurs du théâtre, etc.
Membre de la Société des gens de lettres et de la Société des auteurs dramatiques, il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1867. Il est alors secrétaire de rédaction au Sénat. En 1876, sous la IIIe République, il est chef adjoint du compte-rendu analytique de la Chambre haute.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 044 R 132; G. Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris, Hachette, 1858, p. 443; Le Siècle, 2 février 1852; Paris, 17 décembre 1885.
-
COUAILHAC Victor
Frère des journalistes Louis et Gabriel Couailhac, Victor Henri Pierre Couailhac est né en 1814 à Auxey en Côte-d’Or, au gré des pérégrinations artistiques de ses parents. Il suit d’ailleurs leurs traces devenant artiste dramatique sous le pseudonyme d’Eugène Fradelle. Dans son Dictionnaire des comédiens français, Henry Lyonnet le signale en 1834 à Douai dans le rôle de « troisième amoureux ». En 1835 à Lyon, il fait ses débuts comme ténor dans une comédie mêlée de chants, Une Heure de mariage. Durant les années suivantes, Le Charivari se montre d’ailleurs élogieux sur ses prestations. Le 1er août 1838, il écrit encore : « Le jeune Fradelle se distingue par une aisance et une bonne compagnie qui deviennent de plus en plus rares au théâtre. » Les années passées dans l’ombre de ses parents ou sur scène lui inspireront en 1863 un ouvrage La Vie de Théâtre. Plusieurs anecdotes ont d’ailleurs pour cadre Lille et son théâtre. Victor Couailhac rapporte combien, malgré, depuis l’abolition des privilèges, la levée des interdits pesant sur les comédiens, leurs droits leur sont loin d’être respectés. Ainsi, en 1810, faut-il l’intervention du préfet du Nord auprès du ministre de l’Intérieur pour que l’union de ses parents, déjà mariés civilement, soit consacrée par l’Eglise, l’archevêque de Cambrai ayant opposé un refus. Un peu plus loin, il dévoile les tarifs de « la claque » qui fait le succès de certaines pièces dans les théâtres parisiens.
C’est cependant à l’écriture romanesque et théâtrale que Victor Couailhac doit sa notoriété tant sous le Second Empire qu’au début de la IIIe République. Seul ou en collaboration, notamment avec son frère Louis, il est en effet l’auteur, sous son nom ou sous le pseudonyme de Fradelle, de nombreuses comédies-vaudevilles (Une Noce aux vendanges de Bourgogne, Mariette, Le Roi des goguettes, Arrêtons les frais !, La belle Cauchoise…), de plusieurs romans salués par la critique (Jeanne Maillotte, Les Drames de l’espionnage). Il est également librettiste (Ah ! le divorce !, Chandernagor).
Selon Charles Simon, directeur du quotidien Le Petit Nord qui lui rendit hommage lors de ses funérailles le 10 juin 1888, « La République n’a pas eu de soutien plus dévoué, plus ferme, plus constant. »
Selon cette même source, Victor Couailhac aurait, après la révolution de 1848, « administré le département du Gers ». Le Messager des théâtres et des arts l’annonce directeur du théâtre de Toulouse. Par la suite, il est chargé de la sténographie des séances de l’Assemblée nationale pour le quotidien parisien La République, dirigé par Eugène Bareste. On retrouve également sa signature dans Le Moniteur industriel où il traite de l’industrie du coton, des procédés de fabrication dans la métallurgie. Toujours selon Charles Simon, il est, au lendemain du 2 décembre 1851, contraint à un long exil. Rentré en France, il collabore, à la fin des années 1850, à La Gazette de Paris et à La Gazette nationale.
De 1878 à 1888, il collabore au quotidien lillois Le Petit Nord des frères Simon, livrant régulièrement contes et feuilletons, participant à l’almanach publié chaque année par le journal. Parallèlement, de 1880 à 1882, il dirige l’hebdomadaire Le Bonhomme flamand, journal illustré des Flandres et d’Artois littéraire, commercial, financier, de mode, d’hygiène et de renseignements régionaux.
En février 1886, avec son confrère Henri Velh de L’Echo du Nord, il présente au théâtre de Lille une revue en cinq tableaux Lille excentric qui « a obtenu, dit la presse parisienne, un vif succès ». Il meurt le 8 juin 1888 à Lille des suites d’une longue maladie. Victor Couailhac était membre de la Société des gens de Lettres.
Source(s) :AD Nord, 1Mi EC 350 R 101; Le Petit Nord, 10 juin 1888; divers journaux parisiens : Messager des théâtres et des arts, 19 mars 1849, La République, 2 août 1850, L’Intransigeant, 3 février 1886; Henry Lyonnet, Dictionnaire des comédiens français, Tome 2, Genève, Bibliothèque de la revue universelle illustrée, p. 76; Victor Couailhac, La Vie de théâtre. Esquisses et anecdotes, Paris, Jules Lecuir, 1863, p. 156-160.
-
COURCIER Jean
Après avoir été chroniqueur théâtral pour différents journaux parisiens, chef de la publicité dans un quotidien, Jean Coursier est, à partir des années 1885, administrateur du quotidien républicain Le Phare de Dunkerque. Il est officier d’académie.
Source(s) :Dictionnaire biographique illustré du Nord, 1893.
-
COURMACEUL (de) Victor
Journaliste, magistrat, historien, poète, Victor de Courmaceul semble avoir vécu plusieurs vies dont il est difficile de suivre la trace. Né à Saint-Omer en 1818, il est rédacteur au Progrès du Pas-de-Calais à partir de 1842. Il en aurait même été rédacteur en chef. Lorsque le journal arrageois disparaît en 1857, Courmaceul est installé à Valenciennes où il est juge de paix pour le canton de Saint-Amand avant de l’avoir été à Nantes en 1848. Consacrant ses loisirs à l’histoire, il est membre de la Commission historique du Nord et prépare une Histoire de la ville et de l’abbaye de Saint-Amand qui paraîtra en 1866. Président du Comice agricole de Saint-Amand, il est l’auteur de plusieurs rapports ou comptes rendus sur l’agriculture dans l’arrondissement de Valenciennes. Poète, il publie en 1851 Les Incas de Valenciennes. La poésie dans tous les temps, en 1855 La Pêche d’Islande, travail couronné par la Société dunkerquoise d’encouragement, des sciences des lettres et des arts. Victor de Courmaceul quitte le Nord pour l’Ouest. Installé en Loire-Inférieure au moins dès 1860, il est rédacteur en chef et gérant du Courrier de Nantes. Ce journal disparaît en octobre 1864 et Courmaceul prend la direction du sud-est. Le 1 er avril 1867 il devient directeur politique du quotidien Le Journal de Nice qu’il quitte en 1870 pour deux nouveaux titres L’Avenir de la province et La Situation de Nice et des Alpes-Maritimes, dont les parutions furent éphémères. En 1871, est publié sous sa direction Nice et la France, histoire de dix ans 1860-1870. Etudes sur les séparatistes et la question niçoise. Victor de Courmaceul meurt à Gênes en Italie à l’âge de 56 ans.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des amis de Panckoucke, 2009; Le Phare de la Loire, 5 février 1864 et 17 novembre 1884; Le Siècle, 20 janvier 1875; Catalogue de la BnF.
-
COURTOY Paul Silvio
Fils d’un instituteur public, Paul Courtoy naît à Haumont le 29 janvier 1886. Après un scolarité secondaire au lycée de Valenciennes, il entre à l’Ecole des hautes études commerciales de Paris.
En 1908, il fonde à la demande du groupe radical et radical-socialiste de l’arrondissement de Laon, La Démocratie de l’Aisne . Il devient directeur-gérant de la société en commandite Paul Courtoy et C ie pour l’exploitation du journal et son imprimerie. En 1920, La Démocratie de l’Aisne est remplacée par La Dépêche de l’Aisne. Pendant la Première Guerre, il est mobilisé comme officier d’administration de santé au 3 e Corps d’Armée. Sa conduite pendant les hostilités lui vaut de recevoir la médaille militaire et la croix de Guerre. En 1928, il est même nommé chevalier de la Légion d’honneur. Dans l’entre-deux-guerres, Paul Courtoy devient négociant à Rouen. Colonel de réserve d’administration du service de santé, puis lieutenant-colonel, il est promu officier la Légion d’honneur en 1940, puis commandeur en 1949. Paul Courtoy meurt le 1 er avril 1974 à Charleville dans les Ardennes.
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord, 1893; AD Nord, 1 MI EC291, R 002, Base, Léonore.
-
CREPEAUX Célestin
Fils de Charles Crépeaux et de Nathalie Boilly, Célestin Crépeaux est rédacteur au Propagateur du Pas-de-Calais de Frédéric Degeorges dès la fin des années 1820. Il meurt, à Arras, le 16 avril 1842 à l’âge de quarante ans.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 041/38; Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise, ibid.
-
CREPEAUX Louis Joseph
Fils de Louis Charles Crépeaux, cultivateur, et de Françoise D’Haisne, Louis Crépeaux est breveté imprimeur en 1831. Entré dans le capital du trihebdomadaire orléaniste Le Mémorial de la Scarpe crée en 1826 par Hippolyte Duthill œ ul et Bernard Wagrez, il est mentionné comme propriétaire-gérant de ce journal. En 1835, il paie un tiers du cautionnement contre deux tiers pour Duthill œ ul. Installé rue des Ecoles à Douai, il abandonne Le Mémorial de la Scarpe pour imprimer le périodique républicain Le Libéral du Nord qui reparaît en 1839 après une interdiction de plusieurs mois. Interdit à nouveau après le coup d’Etat du 2 décembre 1851, Le Libéral du Nord disparaît. En 1852, Crépeaux devient rédacteur-gérant de L’indicateur du Nord pour lequel il dépose un cautionnement de 1800 F. Le journal est averti deux fois, le 13 octobre 1852, puis le 4 juin 1853, et cesse sa publication en septembre 1854. Parallèlement, Crépeaux imprime La Jurisprudence de la Cour royale de Douai , mensuel lancé en janvier 1843, par l’avocat Alphonse Delbecque, La Petite Bibliothèque populaire mais aussi l’ Echo du commerce (1849-1851) et L’Observateur du Nord (1851). En 1849, alors qu’aucun imprimeur valenciennois ne veut se risquer à sortir Le Républicain du Nord. Journal démocratique de Jules Desort, Alphonse Clavelly et Ernest Antoine, Crépeaux accepte de l’imprimer sur ses presses à Douai. Lorsque ce trihebdomadaire, plusieurs fois condamné, cesse sa publication et est remplacé par Le Démocrate du Nord , c’est toujours Crépeaux qui fabrique le journal valenciennois. Louis Crépeaux meurt le 21 septembre 1853 à l’âge de cinquante-six ans.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017, 428 p.
-
CREPIN Arthur
Fils de Lucien Crépin, Lucien Henri Arthur naît à Douai le 4 avril 1869. Il est à partir de 1895 rédacteur en chef du Journal de Douai auquel collabore son frère Henri Gaston Il gère également avec lui une librairie «bien achalandée, selon la police, et [les deux hommes] font rarement des articles politiques dans leur journal qui, comme L’Indépendant , est presque entièrement aussi rédigé à coups de ciseaux».
Toujours selon la même source, «le commerce de ces messieurs les gêne pour se lancer dans la politique et ils n’osent faire paraître des articles de crainte d’éloigner de leur librairie leurs principaux clients». Cependant, reconnaît la police, «MM. Crépin frères se conduisent bien et vivent de leurs commerces. Ils sont républicains.» Arthur Crépin meurt célibataire le 6 mars 1918.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/8; «Généalogie des familles d’imprimeurs», Douai-Généalogie, 2012, n° 84, p. 17-18
-
CREPIN Eugène
Troisième enfant de Lucien Crépin, Eugène est un moment journaliste. Il meurt en janvier 1890.
-
CREPIN Gaston
Frère des précédents, Gaston Henri est rédacteur à L’Ami du peuple . En 1923, ils’associe avec André Lunven, ingénieur des arts et manufactures. Il se marie en 1923 à Châlons-sur-Marne où il meurt le 12 juillet 1933.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/8; «Généalogie des familles d’imprimeurs», Douai-Généalogie, 2012, n° 84, p. 17-18.
-
CREPIN Lucien Louis
Libraire, puis imprimeur, fondateur de plusieurs titres, Lucien Crépin a marqué l’histoire de la presse douaisienne du Second Empire aux premières décennies de la III e République. L’homme n’est pourtant pas natif de Douai. Lucien Louis Crépin naît à Lille le 1 er décembre 1831, il n’est légitimé par son père, François Joseph, serrurier domicilié à Haubourdin, que le 28 octobre 1840 lors de son mariage avec sa mère Camille Catherine Duhem, rentière. D’abord installé libraire, 32, rue de Procureurs à Douai, Lucien Crépin obtient son brevet d’imprimeur le 8 juillet 1861 alors qu’il a déjà lancé plusieurs périodiques à la parution plus ou moins régulière et imprimés chez Horemans à Wazemmes (Lille), Le Kiosque en 1854, L’Industrie du Nord-Pas-de-Calais en 1857 qu’il transforme en journal politique en 1868, L’Echo de l’industrie du Nord et du Pas-de-Calais en 1859, le Bibliophile du Nord de la France en 1860 où il présente surtout les ouvrages en vente dans sa librairie… Titulaire du brevet d’imprimeur, il fonde Le Journal d’Orchies et de l’arrondissement de Douai, Les Annales du bibliophile… Le 15 mai 1864, à l’exemple du Petit Journal de Moïse Millaud et du Journal populaire de Lille de Géry Legrand dont le succès est incontestable, il crée «pour la classe ouvrière» un journal à cinq centimes le Journal de Douai … qui ne paraît, hélas, que «de loin en loin» selon l’expression de Georges Lepreux. Moins de six mois plus tard, la police annonce la disparition de ce Journal de Douai. Parallèlement, Crépin continue d’imprimer d’autres titres pour d’autres comme Souvenirs de la Flandre wallonne ou Le Courrier artésien … C’est surtout à partir de la guerre de 1870 qu’il donne sa pleine mesure. Le 26 août 1870, il lance le premier quotidien douaisien Le Petit Gaulois. Sommé par les propriétaires du quotidien parisien Le Gaulois d’abandonner ce titre, Crépin le baptise, dès le 4 septembre Le Journal de Douai . Une quinzaine de jours plus tard, le périodique qui entend défendre la République annonce que sa direction va être confiée à un comité de rédaction composé de démocrates connus. En fait, Le Journal de Douai s’efface le 25 septembre devant Le Libéral du Nord interdit après le coup d’Etat du 2 décembre 1851 dont Crépin est l’administrateur et imprimeur. L’entente entre le rédacteur en chef et l’imprimeur est-elle difficile? le 30 mars 1871, Emile Dupont transfère le journal à Roubaix où il est fabriqué par un imprimeur du cru, Lesguillon. Crépin reprend brièvement la parution de L’Industrie du Nord et du Pas-de-Calais avant de lancer le 21 mars L’Evènement dont il est, aujourd’hui, impossible de dire la durée de vie. Malgré deux condamnations pour délit de presse le 31 janvier et 27 avril 1872, Crépin persiste, le 22 mai 1872, il lance le Bulletin de l’Armée. Journal des administrations civils et des officiers ministériels qui ne semble pas non plus avoir connu un grand avenir. Par contre, quelques jours plus tard, il propose un trihebdomadaire qui, malgré bien des vicissitudes, connaît une existence plus longue, L’Ami du peuple. Son objectif annoncé: soutenir le gouvernement d’Adolphe Thiers. Dès le 28 janvier 1874, le journal est interdit de parution par le général commandant le 1 er corps d’Armée. L’Ami du peuple «condamné au silence» jusqu’au 2 février 1876, Crépin ne désarme pas, le 10 février 1875, il fait part aux autorités de son intention de faire paraître une feuille d’annonces, L’indicateur du chemin de fer du Nord. L’autorisation lui est refusée «en raison du mauvais esprit dont il est animé et des condamnations en matière de presse qui ont été prononcées contre lui». Un premier numéro paraît pourtant le 21 février, ce qui constitue, aux yeux de la loi, un nouveau délit en matière de presse. Le 4 janvier 1876, il obtient enfin l’autorisation de faire paraître Les Petites Affiches et annonces du Nord de la France de façon irrégulière, puis, à partir de mars 1882, chaque dimanche avec le sous-titre Journal de Douai qui, quelques mois plus tard, devient le titre principal. Le Journal de Douai paraît ainsi jusqu’au 28 juin 1935. Lors du retour de L’Ami du peuple, le journal est devenu la propriété «d’une société d’actionnaires» et Crépin a cédé la gérance. Le journal disparaît en 1886 à la suite d’un désaccord entre les actionnaires. Crépin qui reste propriétaire du titre le fait reparaître, en janvier 1888, comme supplément hebdomadaire du Journal de Douai qui l’absorbe le 30 juin 1890 . Durant toute cette période, Lucien Crépin imprime bien d’autres périodiques: La Revue des études, La Revue indépendante, Le Voyageur, le bulletin de L’Union des femmes françaises, les Procès-verbaux du Comice agricole de Douai… Il meurt le 10 janvier 1890, laisse cinq enfants dont deux fils qui lui succèdent Lucien Henri Arthur et Henri Gaston.
Source(s) :AD Nord, M 59/188
-
CRINON Jean
Fils d’un commerçant, Jean Crinon naît le 6 janvier 1927 à Walincourt dans le Cambrésis. Après ses études, il devient maître d’éducation physique à Chauny, Bohain,… En septembre 1945, il est recruté comme reporter sportif à Radio-Lille, tout en continuant à enseigner.
Ce n’est qu’en 1970 qu’il abandonne l’enseignement et entre à la télévision régionale à Lille où il dirige le service des sports avec André Wartel.
La retraite venue, il se présente en vain aux élections législatives de juin 1988. Jean Crinon meurt le 28 octobre 1994 à son domicile de Bruay-La Buissière.
-
CUVELIER Charles Alexandre
Fils de Nicolas Cuvelier, cultivateur, et d’Angélique Willerval, Charles Alexandre Cuvelier est né à Baralle, dans le Pas-de-Calais, le 16 décembre 1842.
Gérant du Libéral de Cambrai , Charles Alexandre Cuvelier, dont la police dit qu’il est «un commerçant plutôt qu’un journaliste», crée en mai 1882 Le Petit Cambrésien , dont il est le rédacteur . Cette création lui vaut d’être remercié par les administrateurs du Libéral.
La police le décrit comme «peu honnête, accessible à tous les compromis qui peuvent lui profiter».
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MiR 081 12; AD Nord, 1T 222.
-
CUVELIER Roland
Lille,(14 février 1934 –?,9 juillet 2010) Dessinateur Auteur notamment de grandes fresques historiques qui ont pendant plusieurs années les délices des gens du Nord-Pas-de-Calais, Roland Cuvelier avait un style reconnaissable entre tous. Ancien élève de l’école Saint-Luc à Tournai (Belgique), Cuvelier donne son premier dessin à La Voix du Nord en 1952. Ses dessins illustrent alors les colonnes de Nord-France, Jour de France et du quotidien L’Aurore. A partir des années 70, c’est dans La Voix du Nord que ses dessins accompagnent de nombreux articles. Dans les années 80, il est même l’un des premiers illustrateurs du concours organisé par le quotidien lillois, «Le Trucmuche». Non dépourvu d’humour et volontiers coquin, Roland Cuvelier aimait restituer de grandes scènes historiques parfaitement documentées. Il était également l’auteur d’une bande dessinée, Sagas des Flandres.
Source(s) :La Voix du Nord 11 mars 1987 et 11 juillet 2010.
-
CYR
Cf. Masquelier Henri
D
-
D’HERICAULT Charles
« Charles d’Héricault était, dans toute la force du terme, un traditionnaliste. […] En même temps qu’un patriote, il était profondément catholique », « Historien érudit, écrivain de bonne race et noble de caractère, les lettres perdent un des hommes de ce temps qui surent le mieux les aimer et les honorer. Chrétien convaincu et chevaleresque […], M. Charles de Ricault d’Héricault s’est montré le défenseur ardent de la foi, le champion intrépide de l’Eglise et de la Patrie. » Dans les premiers jours de novembre 1899, à l’instar de La Libre Parole ou de L’Autorité, toute la presse de droite, royaliste, catholique, conservatrice… rend hommage à Charles Joseph de Ricault, dit d’Héricault, historien et romancier, qui vient de mourir dans son Boulonnais natal, à Tingry, et laisse plus d’une quarantaine d’ouvrages.
Né en 1823, Charles Joseph d’Héricault est le fils d’un notaire de Boulogne-sur-Mer, Charles Déricault, dont le patronyme sera modifié par jugement en « de Ricault ». Dans un ouvrage inachevé, Souvenirs, publié en à la demande de sa veuve dans le quotidien La Vérité, Charles d’Héricault raconte ses années de jeunesse. Après des études au collège Saint-Bertin, il part faire son droit à Paris « pour répondre au vœu » de sa mère qui le rêvait président de tribunal en province. Il obtient sa licence et assiste également aux cours des historiens Jules Michelet et Edgard Quinet. Avec un groupe d’étudiants catholiques, il y porte la contradiction et défend l’historien catholique Frédéric Ozanam. Après un court passage dans l’étude d’un avoué parisien, Charles d’Héricault se tourne vers les Lettres, « non sans avoir fait […] son éducation théologique complète ». Il s’applique ainsi à vulgariser la littérature du Moyen-Âge. Parallèlement, il entame une série de collaboration avec diverses publications périodiques : Revue des provinces, Revue des deux mondes, Revue européenne, Revue de France, Revue diplomatique…, mais aussi de quotidiens La Presse, La Gazette nationale ou le Moniteur universel, La Liberté, Le Figaro, La Vérité…
Après la chute du second Empire, Charles d’Héricault se tourne vers l’étude de la Révolution française, livrant « une guerre sans merci […] jusqu’à son dernier jour contre les hommes et les choses de la révolution ». Comme l’écrit Le Correspondant en 1881, il « a deux manières de faire l’histoire : l’une par les faits, l’autre par la fiction », Charles d’Héricault passe ainsi de l’étude historique au roman. En 1876, son ouvrage La Révolution de Thermidor, salué par Henri Wallon, est récompensé par l’Académie française au même titre que ceux de trois autres historiens dont Ernest Lavisse. En 1883, il fonde avec l’historien conservateur Gustave Bord le mensuel La Revue de la Révolution destiné « à combattre le côté légendaire de la Révolution ». L’Administration interdit aux archivistes des départements d’y collaborer, même par la communication de documents. A partir de 1887, il fait paraître un Almanach de la Révolution française qui sort chaque année jusqu’en 1895. Inlassablement, il multiplie les publications laissant une œuvre abondante.
Dans les derniers mois de sa vie, Charles d’Héricault se retire dans le petit village de Tingry dans le Pas-de-Calais. Malade, il se prépare à la mort, mais n’en continue pas moins de travailler. En septembre 1899, il publie Liévin Liévinette un drame qui a pour cadre sa région natale. Le 31 octobre, il meurt laissant de nombreux inédits. En décembre, L’Univers annonce la sortie de La Grande Vie des saints et leurs amis.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 160/17 et 3 E 821/13; Le Correspondant, 1er janvier 1881; Le Figaro, 11 janvier 1883; Le Grand Echo du Nord, 26 septembre 1899; La Libre Parole, 3 novembre 1899; L’Univers, 19 décembre 1899; Edmond Biré, «Souvenirs et portraits», La Gazette de France, 1er septembre 1902.
-
DANCHIN Albert
Fils de l’avocat lillois François Emile Danchin, Albert Jean François Joseph Danchin s’orienta naturellement après l’obtention de son baccalauréat vers des études de droit. Après la soutenance de sa thèse, il devint directeur d’assurances dans sa ville natale. Passionné de musique, il fut président du comité de propagande pour cet art. A ce titre, il prit part à toutes les grandes manifestations musicales organisées dans la région Nord-Pas-de-Calais. Auteur de plusieurs ouvrages dont L’Exploitation théâtrale et la municipalité et Une Saison théâtrale à Lille 1843-1844, il fut également critique théâtral du Grand Echo durant l’entre-deux-guerres. Capitaine au service du chiffre pendant la Seconde Guerre mondiale, il est démobilisé en 1941. Il meurt quelques semaines plus tard à l’âge de 56 ans, le 5 mai 1941. Titulaire de la croix de Guerre, Albert Danchin était également chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :AD Nord, 1Mi EC 350R041 et 3 E 15283; Le Grand Echo du Nord, 14 mai 1941.
-
DANJOU Jules
Jules Danjou fit ses premières armes dans le journalisme comme correspondant à Lomme-Lambersart pour le quotidien lillois La Croix du Nord où il fut, par la suite, intégré comme journaliste. Jules Danjou gagna le 1 er novembre 1965 la rédaction tourquennoise de Nord-Eclair. Le 15 novembre 1970, il était embauché à La Voix du Nord où il travailla jusqu’à son départ en retraite, en 1982, comme localier dans la banlieue lilloise.
-
DANQUIGNY Jean
Né le 18 mars 1906, à Cambrai, Jean Danquigny fut d’abord journaliste avant de devenir imprimeur. Il fut, jusqu’en 1939, rédacteur à L’Indépendant installé place au Bois à Cambrai. Cette année-là, il reprit l’imprimerie Benoît à laquelle il donna son nom, et qu’il dirigea jusqu’à sa retraite.
Jean Danquigny fut également le président de la période la plus glorieuse de l’ACC section football. Entré au comité directeur du club en 1928, il en devint successivement secrétaire, vice-président avant d’être élu président en 1935. Il le resta jusqu’à 1970, période durant laquelle le club se distingua plusieurs fois en coupe de France notamment en 1963 où il atteignit les huitièmes de finale, et disputa la finale du championnat de France amateur en 1967.
Retiré à Calais, Jean Danquigny est mort à l’âge de 83 ans.
Source(s) :«L’A.C.C. a perdu le président de ses glorieuses années : Jean Danquigny», La Voix du Nord, édition de Cambrai, 8 décembre 1989.
-
DANTEN Emile
Né le 5 juillet 1851 à Paris, Paul Emile Danten est le fils de Louis Emile Alfred Danten, originaire d’Arras. En août 1876, il devient rédacteur en chef du quotidien royaliste Le Pas-de-Calais, fondé à Arras en octobre 1870 et édité par la Société du Pas-de-Calais. Il le reste jusqu’en octobre 1887, alors que Paul-Marie Laroche a pris la direction du journal deux ans plus tôt. Parallèlement, Danten est rédacteur en chef du Pas-de-Calais hebdomadaire et de Somme hebdomadaire créés en 1878 et 1883 par la Société du Pas-de-Calais. Pendant plus d’une dizaine d’années, Danten se montre un adversaire acharné de la République, «débord[ant], selon la police, de rage et de fiel de [la] voir se consolider». Gambetta et Jules Ferry sont ses cibles préférées. En 1883, il fait partie de la délégation de la presse du Nord et du Pas-de-Calais présente aux funérailles du comte de Chambord. En 1891, pressenti par le chanoine Joncquel pour devenir rédacteur en chef de La Croix d’Arras, de l’Artois et des pays houillers , il est écarté pour ne pas déplaire à Paul Marie Laroche, devenu patron du Courrier du Pas-de-Calais et de l’hebdomadaire Le Pas-de-Calais. Il meurt à Arras le 13 octobre 1906 à l’âge de 55 ans.
Source(s) :AD Pas-de-Calais 1J 1633; J.-P. Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2009.
-
DARIMON Alfred
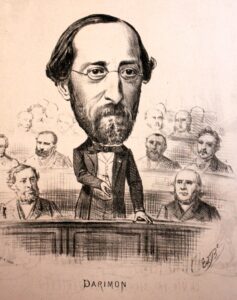 Fils d’un perruquier lillois, Francis Joseph Darimon, et de Sophie Isabelle Hornez, Alfred Darimon naît dans un milieu modeste. Il travaille pendant deux ans aux Archives départementales du Nord sous la direction du docteur Le Glay. Il publie dans La Revue du Nord, il collabore au journal Le Nord, il fonde, avec Pierre Legrand père, le périodique littéraire Jeanne Maillotte, puis crée la première Abeille lilloise. Journal littéraire, artistique, théâtral, agricole et commercial (1847-1853).
Fils d’un perruquier lillois, Francis Joseph Darimon, et de Sophie Isabelle Hornez, Alfred Darimon naît dans un milieu modeste. Il travaille pendant deux ans aux Archives départementales du Nord sous la direction du docteur Le Glay. Il publie dans La Revue du Nord, il collabore au journal Le Nord, il fonde, avec Pierre Legrand père, le périodique littéraire Jeanne Maillotte, puis crée la première Abeille lilloise. Journal littéraire, artistique, théâtral, agricole et commercial (1847-1853).Parti à Paris, il est secrétaire de Prudhon et collabore à divers journaux. En 1848, il est un des principaux rédacteurs du Peuple, fondé par le même Proudhon. Après la disparition de cette feuille, il devient rédacteur en chef de La Voix du peuple, puis du Peuple de 1850. En 1854, Darimon écrit dans La Presse de Girardin des articles à caractère économique, et résume sa pensée, qui aurait été en grande partie celle de Girardin, selon Vapereau, dans un ouvrage intitulé La Réforme banquière (1867, in-8).
Candidat de l’opposition démocratique à Paris (7e circonscription) en 1857, il est élu au Corps législatif à une assez forte majorité. Il fait partie du « groupe des cinq » qui, plutôt que de démissionner, comme le faisaient les élus de l’opposition pour ne pas avoir à prêter serment à l’Empire, préfère siéger et prêter ledit serment. Il est réélu en 1863. En 1864, il soutient Émile Ollivier, alors rapporteur de la loi sur les coalitions, et il se rapproche peu à peu du gouvernement. Il n’ose pas se représenter en 1869. Il est nommé consul à Rotterdam la même année. Darimon était chevalier de la Légion d’honneur depuis 1865. Il meurt dans le dénuement en 1902.
Source(s) :Vapereau, G., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers…, 4e éd., Paris, Hachette, 1870.
-
DARTOIS Louis
Cf. Robichez.
-
DASSONVILLE Paul
Paul Emile Dassonville était domicilié, avant la Première Guerre mondiale, à Friville-Escarbotin (Somme) où il vivait en concubinage avec sa compagne et les deux enfants qu’il avait eus d’elle. Il collaborait à cette époque au journal régional Le Combat (Tourcoing, Lille, Roubaix, 1905-1914). Considéré comme anarchiste notoire par la police, Dassonville fut arrêté pour insoumission dès le début des hostilités. Tout d’abord interné dans un dépôt de l’infanterie, il fut ensuite affecté dans une mine travaillant pour la Défense nationale, probablement à Trignac (Loire-Inférieure).
-
DAUREL Jacques
Cf. Lardeux Félicien.
-
DAVID Alidor
, patron de presse Né dans les Flandres françaises en 1838, Charles Hector Alidon David exerça son activité professionnelle dans le Pas-de-Calais. En juin 1879, David reprend le Journal de Béthune , fondé en juillet 1849 par le libraire Reybourbon. Il en assure la direction jusqu’à sa mort en 1902. David fut également l’imprimeur du Libéral édité par le Comité conservateur d’octobre 1880 à août 1881.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 3 E 119/102; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, Société des Amis de Panckoucke, 2009.
-
DAVID Alphonse
Fils de l’imprimeur Alidor David, Alphonse Marie Auguste David choisit une autre voieque son père : la médecine et son enseignement. Professeur à la faculté libre de médecine de Lille et à l’école des infirmières, il est également médecin chef du dispensaire antituberculeux de Lille. En 1914, il est mobilisé comme médecin-major. Parallèlement, il secrétaire général du Journal des sciences médicales de Lille édité de 1878 à 1981 par la faculté libre de médecine . Membre de plusieurs sociétés lilloises, il marque un intérêt tout particulier pour les arts et sera chroniqueur musical au quotidien La Croix du Nord. Son engagement professionnel lui vaut d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1931 et de recevoir la médaille de vermeil des épidémies; son dévouement au service des œuvres religieuses d’être fait chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Le professeur Alphonse David meurt à Lille à l’âge de 61 ans.
Source(s) :AD Nord, 3 E 18350; Le Grand Echo, 14 août 1931 et 11 janvier 1940; La Croix du Nord, 11 janvier 1940.
-
DAVID Auguste
Auguste Charles Aimé David naît à Caëstre le 21 novembre 1832. Son père Ancôme Anthime Aimé David est propriétaire et chef de bataillon de la garde nationale. En 1868, Auguste David devient propriétaire de L’Indicateur d’Hazebrouck et de son imprimerie qu’il dirige jusqu’en 1899. Au début des années 1880, la police le décrit comme «très hostile aux institutions républicaines» et «très riche» à la suite d’un «héritage de plus d’un million de francs à titre de cousin de Mlle Van Kempen d’Arnèke». Très impliqué dans la vie de la ville, il est élu conseiller municipal en 1884 et le reste jusqu’en 1912. Parallèlement, il est président ou membre de plusieurs associations: fédération des archers du Nord, de la musique communale d’Hazebrouck, Société Saint-Sébastien, Comité flamand. Il est également trésorier de la Commission Van Kempen d’Arnèke. Il meurt le 6 juin 1913, sa femme meurt quelques mois plus tard.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 035 R 008, 3 E 3939, 1T 222/11; Le Grand Echo du Nord, 9 juin 1919.
-
DAVID Henri
Fils de l’imprimeur Alidor David, Henri David, étudiant en droit et en lettres, fait ses premières armes dans le journalisme à la fin du xix e siècle. A la mort de son père, en 1902, il prend sa succession à la tête du Journal de Béthune . En 1905, il reprend Le Patriote de L’Artois créé à Béthune en 1902. Deux ans plus tard, il imprime La Plaine de Lens qui fournira une grande partie de son contenu au Patriote de l’Artois. Après la Première Guerre, dans l’esprit d’union nationale qui règne à l’époque, il remplace l’ensemble des périodiques politiques locaux qu’il éditait en 1914 par un seul titre, L’Avenir de l’Artois. En 1922, il cède son affaire à Célestin Basin. Militant catholique, il assurait depuis 1902, la gérance du bulletin L’Union de la Jeunesse catholique de l’arrondissement de Béthune dont il est le président. «Un des animateurs les plus fougueux du mouvement familial dans la région du Nord», selon Robert Hennart, il fonde le mensuel La Voix de la famille dont la diffusion sera nationale. En 1933, secrétaire-directeur de la délégation nationale des APEL (Associations des parents de l’enseignement libre), il prend également la direction de leur périodique Ecole et liberté, organe des droits familiaux , lancé à 50000 exemplaires. Ami de longue date de Paul Verschave, directeur de la section de journalisme des facultés libres de Droit et de Lettres de l’université catholique de Lille, il assure, avec Jules Dassonville, directeur de «La Presse régionale» l’essentiel des travaux pratiques de la nouvelle institution lors de sa création en 1924. Par ailleurs, il assume pendant plusieurs années la présidence, puis la vice-présidence du conseil de gérance de Radio PTT-Nord.
Source(s) :Robert Hennart, «Paul Verschave et l’Ecole supérieure de journalisme de Lille», Les Pays-Bas français, 1980, p. 204; La Croix du Nord, 7 et 21 septembre 1933, plusieurs numéros du Grand Echo du Nord.
-
DAVID Marc
Fils de Jean-Baptiste David et Catherine Roland, Marc Alexis David est né le 1 er octobre 1878 à Armentières. Epousant la profession de journaliste, il est rédacteur à L’Echo du Nord. Il meurt à l’âge de 38 ans le 3 juillet 1916 à Lille. En 1921, Emile Ferré, revenant sur la confection de sacs pour les Allemands pendant la guerre, le décrit comme «extrêmement dévoué, débrouillard dans la meilleure acceptation du terme, très répandu à Lille, qui voyait tout, qui savait tout».
Source(s) :AD Nord, 3 E 15409; Emile Ferré, Croquis et notes d’occupation…, p. 365, Emile Ferré, «L’affaire des sacs à terre en cour d’assises, Le Grand Echo du Nord, 1er, juillet 1921.
-
DAVIN Félix
Lors de la mort du journaliste saint-quentinois Félix Louis Davin, toute la presse, parisienne et départementale, était unanime : il ne lui manqua que du temps pour développer son talent. Quelques semaines auparavant, Le Temps, présentant son dernier roman Une fille naturelle : règne d’Henri II 1556-1557, saluait une « intelligence facile », un « jugement sain et développé par l’étude », une « imagination sobre et réglée dans sa fécondité », un « talent exercé ».
Fils de Pierre Abraham Davin, huissier au tribunal de commerce, et Marie Louise Sophie Adélaïde Desfresne, Félix Davin accomplit ses études à Paris et au collège de sa ville natale. Très tôt, à l’âge de 16 ans, il est remarqué pour ses qualités d’écrivain.
Dès 1823, il publie Le Crapaud, roman espagnol, en 1826 un Recueil de chansons et poésies diverses, en 1828 Poésies saint-quentinoises. En janvier de cette même année, il est le premier lauréat de la Société académique de Saint-Quentin pour un poème sur le siège de la ville en 1557, La Vision. Dans ce concours, il devance son ami d’enfance, le futur historien Henri Martin, récompensé d’un accessit pour Le Chant du siège. En 1830, les deux hommes publient en commun Wolfthurm ou la tour du loup.
Pendant ce temps, Félix David collabore au Figaro, au Journal des demoiselles et au Musée des familles. En septembre 1830, alors qu’à Saint-Quentin ne paraissent que deux feuilles d’annonces, ilfonde Le Guetteur. Ses responsabilités de directeur et de rédacteur en chef ne l’empêchent pas de continuer à publier poèmes et romans : Deux lignes parallèles ou frère et sœur (1833), Ce que regrettent les femmes : mœurs du Nord (1834), Histoire d’un suicide : mœurs du Nord (1835)… Il se fait le préfacier de Scènes de la vie privée d’Honoré de Balzac
En juin 1836, Emile de Girardin l’annonce parmi les collaborateurs de son futur quotidien, La Presse, aux côtés de Victor Hugo, Alexandre Dumas, Eugène Sue… Félix Davin meurt le 3 août 1836 à l’âge de 29 ans. Quelque temps auparavant, il avait remis les destins du Guetteur entre les mains de Calixte Souplet qui allait le diriger pendant vingt ans.
Source(s) :AD Aisne, 5 Mi 1255 et 5 Mi 1261; Le Temps, 12 juillet 1836; Le Guetteur de Saint-Quentin, 26 mai 1891 et 2 juin 1912; catalogue de la BnF.
-
DE BRABANDER Charles
Lillois, Charles De Brabander adhéra très jeune, dès 1891, au POF (Parti ouvrier français de Jules Guesde). Il vint s’installer à Roubaix comme cabaretier-barbier et vendeur de livres à l’occasion. En mai 1909, il fonda La Bataille avec Mahu et Henri Deschamps. Après la guerre, Jean Piat, qui a travaillé avec De Brabander à La Bataille ouvrière , écrit: «La rédaction, bénévole [de La Bataille ], est animée par De Brabander […] C’est sur un coin de table de son salon de coiffure, entre deux barbes ou deux coupes de cheveux, qu’il écrit ses chroniques. Il signe tantôt de son nom, tantôt de l’un de ses pseudonymes, Chander ou Père La Griffe. Sa plume acérée et spirituelle, fait merveille.»
De Brabander, élu au conseil municipal, devient adjoint aux finances de Lebas, de 1912 à sa mort, en 1938. Chargé du ravitaillement en 1914-1915, il est déporté à Güstrow, en qualité d’otage, après avoir invité les Roubaisiens à refuser de travailler pour les Allemands. Libéré en 1916, il est réinterné trois mois plus tard, libéré, puis arrêté de nouveau.
Après l’armistice, il participe au lancement du Cri du Nord, et des régions libérés, puis du Nord et du Pas-de-Calais. Organe d’union socialiste (Lille, 1919-1921). Il s’oppose aux communistes lors du congrès de Tours. Après la scission, il relance La Bataille: journal du peuple , qui devient organe officiel de la fédération du Nord du parti S.F.I.O . En 1929, il crée avec Louis Mahu La Bataille ouvrière: journal socialiste hebdomadaire de Roubaix et environs (17 juin 1928-? 1940) . Il dirige ces deux hebdomadaires jusqu’à sa mort, en 1938, sur les marches de l’hôtel de ville où il venait de travailler, comme chaque jour.
Source(s) :Maitron, dir., Dictionnaire du mouvement ouvrier; J. Piat Autant qu’il m’en souvienne…, [ Autobiographie d’un journaliste et militant S.F.I.O].
-
DE CAGNY Ernest
Ernest Armand De Cagny est né à Paris dans le 2e arrondissement sous la monarchie de Juillet. Lorsqu’il épouse, le 9 mai 1882 à Maubeuge, Elise Flavie Bayot, veuve de Floribert Adriensence, imprimeur-libraire, propriétaire de l’hebdomadaire La Frontière, il est domicilié à Lille et exerce la profession d’employé de commerce.
Devenu directeur-gérant du journal, il le dirige pendant plusieurs années avant le remettre à son beau-fils Gaston Adriensence. Il meurt le 4 mars 1906 à l’âge de 62 ans.
Source(s) :AD Nord, 3 E 10150, 1 Mi EC 392 R004.
-
DE SWARTE Victor
Étudiant en droit à Paris, Victor Cornil Henri De Swarte est républicain. Il est arrêté lors de la campagne des élections législatives de 1869 pour avoir envahi, avec d’autres protestataires, une réunion d’Émile Ollivier. Il collabore au Mémorial artésien , à La France du Nord et à L’Avenir d’Arras . En mai 1870, il mène à Saint-Omer la campagne pour le non au plébiscite. Il s’engage dans les Mobiles du Nord et fait la guerre sous les ordres de Faidherbe, devenant le plus jeune capitaine de l’armée, à 22 ans. Après la guerre, il fonde à Saint-Omer le Comité républicain, qui contribue à faire élire Faidherbe. Il aide à la création de la bibliothèque populaire, et à celle de la société de tir de la ville. En 1875, il est de retour à Paris. L’année suivante, il est secrétaire du Garde des sceaux. En 1877, il se présente à Hazebrouck, en remplacement d’un des 363, malade, et il fonde à cette occasion Le Journal d’Hazebrouck . Il est largement battu. Il retourne près du sénateur Mancel, son mentor, qui l’emploie à diverses tâches. Mancel devenu président du Sénat, De Swarte devient son chef de cabinet. Il donne alors des articles à L’Événement , à La Paix , au Temps , au Bulletin français , à La Grande Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg et à La Revue d’administration fiscale . En récompense de ses services, il est nommé trésorier-payeur général de la Haute-Marne, et reçoit la Légion d’honneur. Il termine sa carrière comme trésorier-payeur du Nord. Malheureusement il confondit sa caisse avec ses finances personnelles, et fut suspendu puis renvoyé (on lui refusera la liquidation de sa retraite) et mis en faillite. Pour gagner sa vie, il devient «chroniqueur financier» lui-même se qualifie de «feuilletoniste de bourse» au Matin et au Radical . Victor De Swarte a beaucoup écrit. La BnF présente soixante-deux titres d’ouvrages écrits par lui. On peut citer parmi d’autres, les livres dans lesquels il relate ses voyages : Six semaines en Russie , De Lille aux Portes de Fer ; ceux qui relèvent de l’histoire de l’art Les Tapisseries flamandes et les cartons de Raphaël, Rembrandt et Antoine Van Dyck , ceux quelquefois mâtinés de finances: Les financiers amateurs d’art au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Un banquier du trésor royal au XVIIIe siècle Samuel Bernard; enfin ceux qui concernent les finances publiques dont le plus célèbre se trouve être son Traité de comptabilité occulte et des gestions extraréglementaires. Législation, réglementation, procédure, jurisprudence, l’un des tous premiers ouvrages traitant de la comptabilité, au moment où les maires et les conseils municipaux acquéraient en 1884 de nouvelles responsabilités.
Victor De Swarte a été membre de la Société des Antiquaires de la Morinie, du Comité flamand de France, de l’Union artistique du Pas-de-Calais, mais aussi de l’Association amicale des enfants du Nord et du Pas-de-Calais, et de la Société de statistiques de Paris.
Source(s) :Matthieu De Oliveira, «Les comptabilités occultes, du trésorier-payeur général De Swarte», Comptabilité(S) : revue d’histoire des comptabilités, n°1, 2000; Charles Mallet, «Les hommes du Nord : Victor de Swarte», La Revue du Nord, 3e année, 1893, p. 163-169.
-
DEBERLES Kléber
Kléber Deberles commence sa carrière à Nord-Eclair avant de rejoindre, en février 1948, l’édition de Bruay-en-Artois de La Voix du Nord . C’est au sein de cette rédaction qu’en 1971, il suit pendant de longues semaines l’affaire dite de Bruay. En 1977, il devient chef d’édition dans cette même ville, poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite en 1988.
Alors qu’au début des années 1980, les chevalements et les bâtiments des mines de Bruay commencent à disparaître, Kléber Deberles envisage la préservation du site. Concurrencé par le projet des Houillères à Lewarde, il doit revoir ses ambitions à la baisse, mais n’en fonde pas moins le musée de la mine de Bruay dont il est le président jusqu’à sa mort en mai 2015.
Elu secrétaire de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais, il en devient président en 1968 et le reste pendant plus de vingt ans. C’est sous sa présidence qu’est organisé le concours «Presse à l’école» dont l’idée servira d’exemple aux premières actions de presse à l’école.
Vice-président de l’Association Mémoire de la Résistance, Il est l’auteur de deux ouvrages qui font référence 1940, la terrible année et La Grande Epopée des mineurs. Il était chevalier dans l’ordre national du Mérite.
-
DEBIEVRE Eugène
Bibliothécaire de la ville de Lille à partir de 1884, Eugène Debièvre collabora à L’Echo du Nord sous le nom de Delille. Erudit, secrétaire de la commission historique du Nord, membre de la sociétédes sciences et de la commission du musée de Lille, il est l’auteur de plusieurs publications sur l’histoire de sa ville natale. Parallèlement, Eugène Debièvre consacra une partie de sa vie au commerce et à l’industrie. Il était notamment secrétaire du comité linier.
Conseiller municipal de Lille de 1881 à 1884, il fut vice-président de la commission scolaire et de la caisse des écoles, mais aussi délégué cantonal. Ces diverses fonctions au service de l’enseignement lui valurent d’être nommé officier de l’Instruction publique.
Il meurt le 7 août 1909, après une courte maladie, à l’âge de 58 ans.
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord, 1893; Le Grand Echo du Nord de la France, 9 août 1909.
-
DEBUS Jean-Serge
Licencié ès Lettres, Jean-Serge Debus entre à L’Echo du Nord en mai 1923 après son service militaire au 146 e RI à Saint-Avold où il sort sous-officier. Il est«rédacteur chargé du grand reportageet des enquêtes ». Il est également correspondant pour le Nord du Figaro et des journaux anglais Daily Mail et Daily Telegraph . Parallèlement, il est l’auteur de plusieurs ouvrages régionalistes: La Grande Leçon: La rénovation du nord de la France, Métier d’Islande: Les travailleurs de la mer, édités par la revue franco-flamande Mercure de Flandre, Sous le panache de fumée noire… En juin 1924, il se marie avec Julienne Désirée Quagebeur, secrétaire de rédaction au Grand Echo dont il divorce en avril 1929. Secrétaire général des Amitiés franco-anglaises dans le Nord et des Amitiés franco-polonaises, il est, lors de l’exposition universelle organisée en 1937 à Paris, délégué à la propagande du comité Flandre Artois Hainaut et, lors de l’exposition du Progrès social en 1939, chargé des relations avec la presse. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier le 22 mai 1940. Libéré sanitaire en février 1941, il reprend son poste à L’Echo du Nord en septembre 1941. Selon sa déposition le 14 avril 1945, il a «peu d’activité au journal pendant la guerre. En fait, affirme-t-il, pendant mes moments de loisirs, je me suis occupé de l’entraide des prisonniers et j’ai poursuivi des études à la faculté des Lettres». Parallèlement, il tient, à partir de mai 1942, une chronique sur Radio-Lille, «Nos Peintres». En juin et juillet 1943, il est commissaire général de l’exposition Flandre-Artois présentant au Palais des Beaux-Arts de Lille «les œuvres des meilleurs artistes de la région». Les 6 septembre 1943, 7 novembre 1943 et 28 février 1944, il rend compte, dans Le Grand Echo du Nord , de la venue à Lille de Marcel Bucard, de l’acteur allemand Heinrich George et de l’équipe de Je suis partout . Ce qui lui est reproché à la Libération où il est condamné à un an de prison, à dix ans d’indignité nationale et à la confiscation de 30 % de ses biens. Jean Serge Debus n’obtient pas le renouvellement de sa carte de presse. D’abord correspondant régional du Figaro, il entame une nouvelle carrière au Comité interprofessionnel du logement (CIL) créé à Roubaix par Albert Prouvost. Il est fait chevalier dans l’ordre national du Mérite.
Source(s) :AD Nord, W 9W 261; plusieurs numéros du Grand Echo du Nord.
-
DECHRISTE Louis Ferdinand
Bien que né à Douai, Louis Ferdinand Dechristé descend par son père d’une vieille famille alsacienne. Celui-ci, homme de confiance, lors de la naissance de son fils, a épousé la douaisienne Rosalie Joséphine Pourret.
Ancien élève de l’Institution Saint-Jean, Louis Dechristé devient compositeur typographe, puis imprimeur. Sortent ainsi de ses presses en 1861 le premier numéro de Souvenirs de la Flandre wallonne. Recherches historiques et choix de documents relatifs à Douai et la province, puis la Jurisprudence de la Cour de Douai, en 1873 le Compte rendu de la Chambre de commerce de Douai, à partir de 1881 la Circulaire financière de la Banque Hippolyte Colpin qui devient L’indicateur financier, en 1882 l’Echo commercial et industriel, en 1886 le Bulletin de la Société photographique du Nord de la France… Après la chute de l’Empire en septembre 1870, il participe à l’importante éclosion de la presse politique en imprimant du 5 au 30 octobre Le Bon Douaisien auquel succède du 1 er novembre 1870 au 31 juillet 1871 le quotidien royaliste et catholique Le Petit Journal du Nord. A la suite d’une menace de poursuites par la Société qui édite à Paris Le Petit Journal , le quotidien douaisien devient Le Journal du Nord, imprimé jusqu’à sa disparition par le même Dechristé. Membre de la Société d’agriculture, sciences et arts du département du Nord, dont il sera médaille d’or, de la Commission historique du Nord, de la Société des amis des arts de Douai, Dechristé est aussi historien. Il multiplie les recherches notamment sur sa ville natale dont plusieurs donnent naissance à des publications: Souv’nirs d’un homme ed’Douai, del’ paroisse de Wios-Saint-Albin (1863), Les Tableaux, vases sacrés et objets précieux appartenant aux églises, abbatiales, collégiales de Douai et de son arrondissement au moment de la Révolution (1877), Douai pendant la Révolution (1880), Notes sur les curés constitutionnels de Douai (1885), Notes sur Gayant et ses fêtes depuis son rétablissement en 1801 (1886)… Son fils Maurand Paul lui succède, mais quelques années plus tard l’imprimerie Dechristé est reprise par Paul Delarra. Louis Dechristé meurt le 11 février 1896.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi EC 020 R045, 1Mi EC 178 R 043, Jean-Paul Visse, La Presse de l’arrondissement de Douai, Société des Amis de Panckoucke, 2007.
-
DECLERCQ Emile
Fils d’un inspecteur de police, Emile Declercq vient à peine de terminer ses études supérieures lorsqu’en 1914, il est surpris, à Lille, par l’invasion allemande. Le 7 avril 1915, il prend le chemin de la Hollande où, de Flessingue, il est acheminé, par l’Angleterre, à Boulogne-sur-Mer. Le 8 mai, il s’engage volontairement, à Fontainebleau, au 46 e RI pour partir sur le front. Le 10 avril 1917, il est grièvement blessé alors qu’il combat sur le plateau de Craonne et est cité à l’ordre de l’armée. Après sa convalescence, il est versé au 74 e RI et repart pour le front. Sa conduite pendant la guerre lui vaut la médaille militaire, la Croix de guerre avec palme et étoile, la médaille des combattants volontaires et la médaille des évadés, Démobilisé, il revient à Lille et entre au quotidien lillois La Dépêche comme secrétaire de rédaction. Quelques années plus tard, il est nommé chef du service d’informations où il se consacre particulièrement aux questions coloniales. Il se voit ainsi élevé au grade d’officier de l’ordre de l’Etoile noire du Benin. Parallèlement, Emile Declercq est défenseur de la profession, soucieux de son indépendance. Membre de la section du Nord du Syndicat national des journalistes, «il fut, écrit Le Journal de Roubaix au lendemain de sa mort, l’un des plus actifs constructeurs du statut professionnel des journalistes», en même temps qu’un conseiller écouté par l’organisation syndicale. Il était également syndic de l’Association professionnelle des journalistes du Nord. Marié, père d’un garçon, Emile Declercq était le beau-frère de Marcel Polvent, directeur des services du Réveil du Nord. Il meurt dans sa 43 e année le 4 mars 1939.
Source(s) :Le Réveil du Nord, L’Egalite de Roubaix-Tourcoing, et, Le Journal de Roubaix, du 5 mars 1939.
-
DECOBERT René
René François Joseph Decobert est entré à La Voix du Nord le 1 er août 1959. Rédacteur responsable de l’édition de Montreuil-sur-Mer lors de sa création en 1962 , il est ensuite nommé chef de l’édition arrageoise de La Voix du Nord. En 1982,il a rejoint le siège du journal où il a exercé jusqu’à sa retraite en 1994 les fonctions de chef du service des informations régionales.
-
DECOCK René
Ancien résistant, membre du mouvement Voix du Nord, René Decock est devenu patron du quotidien éponyme en 1947. Né à Annappes, il est d’abord comptable, puis représentant pour plusieurs firmes et enfin responsable de la Société coopérative de stockage des blés à Lille. Bien que père de famille, il est mobilisé à la déclaration de guerre en 1939, il combat dans les Vosges et est fait prisonnier près de Saint-Dié. Renvoyé dans ses foyers, le 22 août 1941, il rejoint dès septembre le réseau Pat O’Leary, puis quelque temps plus tard, il intègre le réseau Voix du Nord dont il diffuse le journal. En 1943, avec son frère, il travaille à l’installation du Bureau des opérations aériennes (BOA), œuvrant pour les services français de Londres, dont la direction pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de la Somme et de la Seine-Maritime a été confiée à Pierre Deshayes.
Après la parution de La Voix du Nord au grand jour, René Decock entre au conseil de gérance du quotidien lillois, dont il est élu président le 17 janvier 1947. Il le reste jusqu’en 1968, date à laquelle la société éditrice du journal se transforme en Société anonyme à conseil d’administration dont il devient président. En 1988, lors d’un nouveau changement de structure juridique, il est nommé président du conseil de surveillance tandis que le directoire est présidé par Jean-Louis Prévost. C’est sous sa présidence, marquée par de longs procès avec des résistants, que La Voix du Nord franchit des étapes importantes: le passage à la photocomposition en 1970, la mise en route de l’imprimerie de La Pilaterie à Marcq-en-Barœul en 1982. Il accompagne également la diversification de l’entreprise initiée par Jean-Louis Prévost, président du directoire, et Gérard Minart, vice-président.
Mort le 23 janvier 1996 à Sevrier en Haute-Savoie où il vivait depuis plusieurs années, René Decock était titulaire de la médaille de la Résistance (1945), de la croix du combattant volontaire, de la croix de la Libération, il était chevalier de l’ordre de la Couronne belge.Chevalier de la Légion d’honneur depuis 1951, il avait été promu officier en 1963, puis commandeur en 1972.
Source(s) :«René Decock, président du Conseil de surveillance de La Voix du Nord n’est plus», La Voix du Nord, 24 janvier 1996; Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021
-
DECOUT Robert
« Un rédacteur en chef soucieux de l’indépendance de son journal », « un journaliste rigoureux », ces expressions venaient spontanément à l’esprit de tous ceux qui ont connu ou travaillé sous la direction de Robert Décout, lors de sa disparition.
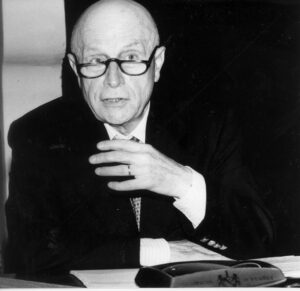
(Photo : Jean-Pierre Filatriau) Né le 13 août 1918 à Valenciennes, Robert Décout fut d’abord enseignant à l’école Saint-Jean de la Salle puis au collège Notre-Dame dans sa ville natale. Après quelques mois à Nord Eclair, il entre à la rédaction d’Avesnes-sur-Helpe de La Voix du Nord. Un an plus tard, il intègre le service des informations générales à Lille. En janvier 1953, il est nommé rédacteur en chef adjoint, puis en avril, après le départ de Gérard d’Orgeville, rédacteur en chef et éditorialiste, fonctions qu’il occupe pendant vingt-sept ans. Au cours de nombreux déplacements, Robert Décout rencontre les grands de ce monde, s’entretient avec les célébrités du moment. Durant cette période, le tirage du journal dépasse les 400 000 exemplaires, fleurte avec les 500 000 le dimanche. Avec une audience de 1 250 000 lecteurs, La Voix du Nord est le deuxième quotidien de province. En 1968, lors d’un changement de statut de la société éditant le quotidien et l’hebdomadaire La Voix des sports, Robert Décout avait fait son entrée au conseil d’administration en même temps que le directeur de l’imprimerie. En avril 1980, il quitte le journal à l’issue d’un conflit avec le Pdg, René Decock. Inquiet du retard pris par le quotidien, et soutenu par les chefs de service, il l’avait alerté sur l’urgence à accélérer la modernisation, face à la concurrence. Il réclamait également la nomination d’un directeur général exerçant effectivement la fonction et s’interrogeait sur la succession éventuelle du Pdg dont le mandat arrivait à expiration. Ce dernier avait répliqué en dépossédant son rédacteur en chef d’une partie de ses pouvoirs, notamment sur la rédaction, et en lui imposant une nouvelle hiérarchie. Robert Décout reviendra sur ce conflit dans un ouvrage. Toujours attentif à l’évolution de La Voix du Nord, il en publiera deux autres : en 1997 l’Imposture au pouvoir où il évoque le rachat de l’entreprise par ses salariés, La fin d’une mystification. Plus généralement, il revient sur sa carrière dans deux ouvrages : Ecrit sur les rouleaux de l’instant et Des journalistes en Nord, écrit en collaboration avec des confrères d’autres titres de la région Nord-Pas-de-Calais. Après son départ de La Voix du Nord , Robert Décout est éditorialiste à La Gazette du Nord-Pas-de-Calais. Auteur fécond, il a également publié plusieurs ouvrages politiques dont Chronique d’une élection bouleversante (2002) et plusieurs essais: Dieu, le hasard, l’action; L’alphabet de l’humain; Comment ils voient le monde (1989).
Officier de la Légion d’honneur et de l’ordre du Mérite national, Robert Décout meurt à l’âge de 97 ans.
Source(s) :Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021; La Voix du Nord, «Des confrères en nombre et une chaude amitié autour, …, Des journalistes en Nord» et «Huit journalistes à tous les pôles de l’opinion», 28 novembre 1986, «La mort de Robert Décout, ancien rédacteur en chef de, La Voix du Nord», 12 février 2015.
-
DEFOSSE E.
E. Defosse devient gérant de La Gazette de Béthune à la mort d’Ernest Frédéric en avril 1909. Il laisse la place à R. Hénin le 4 mai 1914.
-
DEFRANCE André
Licencié en Droit, diplômé de l’école des Hautes Etudes Commerciales, André Defrance commence sa carrière professionnelle au Journal de Roubaix publié jusqu’à la veille de la libération de Roubaix en septembre 1944 . Le 1 er octobre 1947, il entre à Nord Eclair, qui a pris la suite, comme secrétaire général. Quelques années plus tard, il est nommé directeur général du quotidien. Lors de l’arrivée de Robert Hersant à Nord Eclair en 1975, deux sociétés sont créées: Nord Eclair Edition qui assure le contenu du quotidien et la SA Nord Eclair qui en assure l’exploitation (fabrication, vente,…). André Defrance devient directeur général de cette dernière entité et membre de son conseil d’administration. Il le reste jusqu’à sa retraite. Lors de la création, en 1954, du magazine hebdomadaire Semaine du Nord par la société éditrice de Nord Eclair , il en avait également été nommé directeur gérant.
Source(s) :Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021.
-
DEFRANCE Michel
Fils d’un militant communiste, prisonnier de guerre, Michel Defrance est arrêté le 22 juillet 1942 à Paris avec sa mère. Emprisonné, il réussit à s’évader et rejoint, à 17 ans, la Résistance en Bretagne dans les rangs des FTP. Lors des combats de la Libération, il est en Seine-et-Marne où il est, à nouveau, arrêté. Tentant de s’évader en sautant d’un camion, il est fauché par une rafale de mitraillette qui lui brise une jambe. Hospitalisé, il réussit à s’évader grâce à la Résistance et la complicité du personnel hospitalier.
Revenu dans le Nord, Michel Defrance entame une carrière de journaliste au quotidien communiste Liberté.
Le 25 mars 2017, à l’âge de 92 ans, il reçoit les insignes de chevalier de la Légion d’honneur. Il meurt quelques semaines plus tard.
Source(s) :«Grand Résistant, Michel Defrance (enfin) décoré de la Légion d’honneur», La Voix du Nord, 30 mars 2017; «Michel Defrance, ancien résistant communiste du Nord, est décédé», L’Humanité, 18 mai 2017.
-
DEFRÉMERY Charles
Defrémery apprit l’arabe et le persan. Directeur d’études à l’École des langues orientales, membre de l’Institut, professeur d’arabe au Collège de France, il collabora au Journal des orientalistes .
Source(s) :Roton, Ad., Histoire du département du Nord, avec la biographie des personnages remarquables qui en sont originaires, Paris, G. Guérin 1890, 71 p. 18 cm.
-
DEGAND Henri
Fils de Théodore Charles Joseph Degand, négociant, et de Sophie Augustine Santerre, Henri Degand fait ses études secondaires au collège d’Arras, puis supérieures à la faculté de droit de Lille où il obtient le grade de docteur en droit. De 1895 à 1919, il est avocat à la cour d’appel de Douai et, à partir de 1898, il dirige le Recueil de jurisprudence . Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, sa conduite lui vaut la croix de Guerre et la médaille des évadés. En 1919, il devient avocat au barreau de Strasbourg. Parallèlement, il est chargé de cours et dirige la Revue juridique d’Alsace et de Lorraine. En 1930, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Henri Degand meurt à Strasbourg en 1950.
Source(s) :Léonore, base de données de la Légion d’honneur.
-
DEGEORGE Frédéric
Fils d’un adjudant major de l’armée de Hoche et d’une Béthunoise, Frédéric Degeorge naît le 12 septembre 1797, probablement en Westphalie. Enrôlé à seize ans dans le 2 e régiment d’infanterie de ligne, il fait les campagnes de 1814 et de 1815. Les Bourbons rentrés en France, il quitte l’armée et regagne Béthune. En 1819, il commence son droit à Paris. Opposant aux Bourbons, il est exclu de la faculté pour avoir participé à une manifestation contre le changement de loi électorale accordant le double vote aux plus fortunés. Membre de la Charbonnerie, il est notamment impliqué, en 1823, dans une conspiration visant à soulever les soldats de l’expédition d’Espagne contre le régime, et doit s’enfuir en Angleterre. Le 24 mars 1824, il est condamné à mort par contumace par la cour d’assises de Saint-Omer Réfugié à Londres, Frédéric Degeorge donne des cours de français, collabore aux journaux Le Globe et La Revue encyclopédique . En juillet 1828, l’exil lui pesant, il regagne Béthune et se constitue prisonnier. Rejugé quelques semaines plus tard, il est acquitté par la cour d’assises de Saint-Omer. Le 28 septembre, grâce au soutien de l’avocat Charles Ledru et l’aide financière de François Corne de Brillemont et Charles Harlé d’Ophore, il fonde le Propagateur du Pas-de-Calais, dont la devise est «le roi et la charte». Très vite, le journal se fait le porte-parole des libéraux. En application des ordonnances signés par le roi Charles X, en juillet 1930, l’autorisation de paraître lui est retirée, ses presses sont scellées. Il ne peut reparaître que le 4 août, Charles X ayant laissé la place à Louis-Philippe. Très rapidement, déçu par le nouveau régime, Degeorge s’affirme républicain et le journal est en butte à de nombreuses poursuites qui, à chaque fois, se soldent par un acquittement. Après la loi de septembre 1835, certains actionnaires ne consentent à payer l’augmentation du cautionnement exigée par la loi que si le journal modifie sa politique, ce que la rédaction refuse. En décembre, de nouvelles poursuites sont engagées après la sortie de L’Almanach populaire du Pas-de-Calais que la société éditrice du Propagateur publie depuis 1834. Cette fois-ci, elles sont fatales au Propagateur dont le dernier numéro paraît le 31 décembre 1834. Dès le 4 janvier 1836, Le Progrès du Pas-de-Calais prend la suite grâce au soutien de Corne de Brillemont et d’Edouard Degouves-Denuncques. Dès le mois de mai, Degeorge se retrouve devant la cour d’assises. Les poursuites continuent à bonne cadence, et, en mars 1842, le journal affiche vingt-sept procès et… vingt-sept acquittements. Cependant dès le mois d’août, il annonce «ne plus vouloir offrir aucun prétexte aux ennemis de la presse patriote de [le] traduire aux assises». En juillet de la même année, il ouvre ses colonnes au prisonnier de Ham, Louis-Napoléon Bonaparte, qui, en mai 1844, y publie une série d’articles sous le titre «Extinction du paupérisme». Le journal semble rencontrer un certain succès ouvrant une deuxième édition et passant à la périodicité quotidienne. Après la révolution de février 1848, Frédéric Degeorge est nommé commissaire du gouvernement dans le Pas-de-Calais, le 23 avril, il est élu à l’Assemblée constituante, mais est battu lors des élections législatives du 13 mai. Lors de l’élection présidentielle, il soutient Cavaignac contre Louis-Napoléon dont il ne conteste pas la sincérité, mais dans lequel il ne voit qu’un «instrument» aux mains de ceux qui veulent rétablir la monarchie. En 1851, pas question d’accepter la réforme de la constitution proposée par le prince-président et au lendemain du coup d’Etat du 2 décembre, Le Progrès est suspendu pendant deux mois . Encore ne peut-il reprendre sa parution, le 8 février 1852, que sur intervention de Louis-Napoléon. Candidat au Corps législatif, le 29 février 1852, alors que son journal est probablement à son zénith avec un tirage de 2200 exemplaires, Degeorge est battu et reprend sa place de rédacteur en chef. Le Progrès est averti plusieurs fois, la publication des annonces légales, source de revenus non négligeable pour tout périodique, lui est refusée par le préfets successifs du Pas-de-Calais.
A la fin de l’année 1853, la santé de Frédéric Degeorge se dégrade. En mars 1854, il est interné à Paris où il meurt le 22 juillet. Quelques jours plus tard, à Arras, une foule importante assiste à ses funérailles.
Membre de l’Académie d’Arras, Frédéric Degeorge avait également collaboré à plusieurs journaux nationaux. En 1834, il avait lancé avec le lillois Vincent Leleux, un éphémère journal populaire à dix centimes le numéro, L’Union.
Source(s) :André Fortin, Frédéric Degeorge, Université de Lille, faculté des Lettres et Sciences humaines, collection du Centre régionale d’études historiques, n° 5, Lille, 1964; Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise. Catalogue commenté des périodiques de l’arrondissement d’Arras, Bapaume et Saint-Pol-sur-Ternoise, Société des Amis de Panckoucke, 2009.
-
DEGEORGE Jean
Frère cadet de Frédéric Degeorge, Jean Degeorge succède à l’imprimeur Gustave Souquet lorsque celui-ci quitte Arras pour s’installer dans sa ville natale, Etaples. Il imprime successivement Le Propagateur du Pas-de-Calais et Le Progrès du Pas-de-Calais dont son frère est rédacteur en chef, mais aussi, à partir du 4 janvier 1834, L’Union. Journal des intérêts populaires du Nord de la France , fondé par Vincent Leleux, propriétaire de L’Echo du Nord à Lille, Frédéric Degeorge et Cassagneux, propriétaire de La Sentinelle à Amiens. Jean Degeorge est également l’imprimeur de nombreuses brochures dont les almanachs publiés par la société éditrice du Propagateur puis du Progrès du Pas-de-Calais. Il meurt en 1846, sa femme Florence prend alors sa succession.
Source(s) :Jean-Paul Visse, «L’Union, premier journal populaire dans le Nord, Revue du Nord, 2010/1, n° 384, p. 107-125; La Presse, arrageoise. Catalogue commenté des périodiques de l’arrondissement d’Arras, Bapaume et Saint-Pol-sur-Ternoise, op. cit.
-
DEGREMONT Paul
Entré comme apprenti typographe chez Brunelle, imprimeur à Cambrai, après l’obtention de son certificat d’études primaires, en 1893, Paul Constant Degrémont travaille dans diverses imprimeries parisiennes à partir de 1910. De retour à Cambrai en 1919, il devient typographe chez Brunelle. Rédacteur à l’hebdomadaire La Démocratie cambrésienne, organe du parti républicain démocratique et social (1925-1936), il est également correspondant du quotidien lillois Le Réveil du Nord de 1920 à 1935, année où il s’installe à son compte comme imprimeur, rue des Bleuettes à Cambrai.
Membre du comité de section de Cambrai de la Ligue des droits de l’Homme, il adhère à la SFIO en 1905. Probablement après son retour dans sa ville natale, il devient secrétaire de la section cambrésienne du syndicat CGT du Livre.
En mai 1940, dès l’occupation de la ville par les Allemands, il est, pendant quelques mois, membre du comité de guerre qui a remplacé le conseil municipal. A partir du 25 juin 1940, il publie Le Journal de Cambrai , hebdomadaire sous contrôle allemand, dans lequel il signe quelques éditoriaux. Cette publication cesse de paraître le 17 mars 1942. Après la Libération, il imprime L’Espoir de Cambrai. Le 5 novembre 1945, Paul Degrémont est condamné à trois mois de prison et cinq années d’indignité nationale.
Source(s) :AD Nord, M 149/142, 1 W 406.
-
DEHAY , Augustin
Ouvrier mineur à Lens, Augustin Dehay fut renvoyé après les grèves de 1902. Il se fit alors marchand de journaux en particulier du Grand Écho du Nord le matin, cordonnier l’après-midi. Il utilisa, comme d’autres de ses collègues, une charrette attelée à un chien pour vendre ses journaux. Il se vit refuser l’autorisation d’utiliser son attelage par Basly, maire de Lens, après qu’un arrêté préfectoral eut confié aux maires le soin d’accorder de telles autorisations, tout comme Louis Level, Bernard et Tinclercq, tous révolutionnaires et opposés à la politique de Basly. Ces tracasseries durèrent jusqu’à ce que cet arrêté soit rapporté le 9 janvier 1904. Quand Dehay fut rappelé pour une période militaire de vingt-huit jours, la mairie de Lens lui refusa l’indemnité de 10 F qu’elle versait à tous les rappelés, patrons compris ( L’Action syndicale , 28 avril 1904). Car Dehay était aussi trésorier du Jeune Syndicat (Fédération des mineurs du Pas-de-Calais). Membre du Parti ouvrier de Guesde, il refusa de rallier le Vieux Syndicat de Basly, malgré l’ordre donné aux syndicalistes socialistes par le parti après l’unification des différents courants socialistes lors de la création du Parti socialiste unifié en avril 1905. Tous les récalcitrants, dont Dehay, furent exclus ( L’Action syndicale , 20 janvier 1907). Ce qui n’empêcha pas Dehay de se joindre à Dumoulin pour proposer, lors du congrès de Marseille, de rejoindre la CGT en octobre 1908, au nom de l’efficacité. Le 8 janvier 1906, un article du Réveil du Nord , signé par Basly, intitulé «Au pilori», accusa la Fédération des mineurs du Pas-de-Calais, et donc en premier lieu Dehay, son trésorier, d’avoir détourné une partie de l’argent recueilli pour soutenir les familles de mineurs morts dans la catastrophe de Courrières. La Fédération des mineurs du Pas-de-Calais demanda que l’affaire soit portée devant un jury d’honneur. Ce dernier mit hors de cause la gestion de Dehay, en soulignant que Basly et ses amis s’étaient dérobés, ne pouvant apporter la preuve de leurs accusations. La Fédération des mineurs cita alors Le Réveil du Nord et Basly à comparaître en correctionnelle pour injures publiques et diffamation, Dehay se joignant à l’action à titre personnel (27 janvier 1907). À son métier de vendeur de journaux, Augustin Dehay joignait d’autres activités «d’homme de presse». Il participait à la vie de L’Action syndicale et faisait partie de la commission du journal. Il y publia, avec Dumoulin, des communications sur la vie du «Jeune Syndicat», et surtout signa avec Monatte, rédacteur de L’Action directe , un long feuilleton «La vérité sur la grève de 1906», la grève qui suivit le drame de Courrières, paru dans L’Action syndicale en février et mars 1908.
Est-il besoin d’ajouter que Dehay était membre de la libre pensée «Ni dieu ni maître» de Lens?
.
Source(s) :les numéros cités de, L’Action syndicale, (lisible dans Gallica); Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, …
-
DEHERRIPONT Jean
Fils de Charles Deherripon, employé de commerce, et de Marie Rousseau, Jean Désire Marie Joseph Deherripont est né le 30 septembre 1897 à Tourcoing. Elève au lycée Saint-Joseph à Lille, il évacue avec sa famille à Boulogne-sur-Mer quelques semaines après la déclaration de la guerre 1914-1918. Incorporé le 7 août 1916 au 127 e RI, il passe successivement au 43 e RI, au 220 e RI. Cité plusieurs fois à l’ordre du régiment, il est blessé le 19 août 1918. Sa conduite lui vaut la Croix de guerre et la médaille militaire. Démobilisé en août 1919, il est employé au Comptoir central des achats pendant un an, il travaille ensuite avec son père dans l’entreprise familiale jusqu’en septembre 1923 où il devient directeur commercial de la succursale lilloise de la maison d’édition Casterman, Il entre au Grand Echo du Nord comme reporter fait-diversier en septembre 1929. Lors de l’invasion allemande de 1940, il quitte Lille le 17 mai et il s’établit à Bagnoles-de-l’Orne où il séjourne /pendant deux ans. En juin1942, il reprend son poste au Grand Echo du Nord. Dès 1942, il participe à la Résistance notamment au sein du mouvement Libération. En septembre 1944, il entre à La Voix du Nord où il est nommé chef des services régionaux.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 599 R037, 1R 33 63, 3 E 15703, 9 W 261, pièces 46 et 84.
-
DELABRE Léon
C ultivateur Frère du maire de Rumilly-en-Cambrésis et conseiller d’arrondissement, Léon Delabre est rédacteur en chef du journal électoral L’Avant-garde. Organe quotidien de l’agglomération républicaine et socialiste du Cambrésis lancé en février 1900 par le Parti ouvrier français à l’occasion des futures élections. Il est destiné, selon la police, à combattre la politique républicaine du sénateur-maire de Cambrai, Paul Bersez. Secrétaire du groupe socialiste de Rumilly, N-Léon Delabre a déjà été plusieurs fois candidat lors des élections au conseil général et au conseil d’arrondissement lors des années précédentes, notamment en 1895 contre son propre frère. Agronome, N-Léon Delabre est membre de la Société des agriculteurs du Nord.
Source(s) :AD Nord 14 février 1900; plusieurs numéros du Grand Echo du Nord, et du Réveil du Nord.
-
DELAHOUSSE Henri
Henri Delahousse fut rédacteur à La Croix du Nord . En 1930, il reçoit la médaille d’argent de l’Education physique des mains d’Henri Jooris. Il meurt à Saint-André-lez-Lille le 1 er mars 1953 à l’âge de 82 ans.
Source(s) :La Croix du Nord, 1er, novembre 1930 et 3 mars 1953.
-
DELANNOY Aristide
Peintre il étudie avec Pharaon De Winter , et dessinateur de presse, Delannoy a travaillé pour de nombreux journaux parisiens, journaux légers: Le Frou-frou, le Sourire, La Vie pour rire etc., ou engagés: L’Assiette au beurre, L’Humanité, L’Almanach de la Révolution, La Guerre sociale, Le Libertaire etc. Deux séries de dessins intéressent directement la région: Notre-Dame de l’Usine (Roubaix) et celle sur la catastrophe de Courrières, parues dans L’Assiette au beurre .
Source(s) :Un crayon de combat : Aristide Delannoy, introduction Henri Poulaille, Saint-Denis, Le Vent du ch’min, 1982, 160 p., nombreuses reproductions, 1 photo de Delannoy en front.
-
DELARUE
Delarue est rédacteur au quotidien le Progrès du Nord à partir de juin 1909. Il vient de Douai.
Source(s) :AD Nord.
-
DELASSUS, abbé Henri
Ordonné prêtre le 29 juin 1862, Henri Delassus est nommé vicaire de la paroisse Saint-Géry à Valenciennes. En 1869, il rejoint la paroisse Sainte-Catherine à Lille, puis en juin 1872 celle de La Madeleine.
En 1870, il fait connaissance de l’abbé Clarisse, propriétaire de La Semaine religieuse de Cambrai qu’il a fondée en 1866. Ce dernier l’invite à participer à sa revue et lorsque, malade, il ne peut continuer sa tâche, il demande à Mgr Régnier, archevêque de Cambrai, de nommer Henri Delassus à la tête du périodique. Le 25 septembre 1874, déchargé du vicariat de La Madeleine, Henri Delassus devient chapelain de Notre-Dame de la Treille à Lille qu’il ne quittera plus. Il prend en charge La Semaine religieuse de Cambrai que l’archevêque lui a demandé d’acheter. Inspiré par l’exemple du jésuite Augustin Barruel, qui, au xviii e siècle, pour combattre les ennemis de la foi, publia Le Journal ecclésiastique , il est à la fois le propriétaire et le rédacteur d’un organe qui tire à 4000 exemplaires et dont la notoriété dépasse les limites de l’archevêché de Cambrai. Il le restera jusqu’à la Première Guerre mondiale. Inspiré par les philosophes traditionnalistes tels que Louis Bonald, Joseph de Maistre ou Frédéric Le Play, il fait de sa publication «un bastion contre le libéralisme, le modernisme et toutes les formes de la conspiration antichrétienne dans le monde». Contre-révolutionnaire, il prône la restauration de la famille, défend une société basée sur la hiérarchie et l’autorité. Antisémite, il dénonce également «les infiltrations collectivistes» à l’intérieur du catholicisme social. Auteur de nombreux ouvrages, dont le plus connu est probablement La Conjuration antichrétienne , il reçoit, à l’initiative du pape Pie X, le titre de docteur en théologie honoris causa de l’Université catholique de Lille. Chanoine honoraire de la cathédrale métropolitaine de Cambrai, il est élevé à la dignité de pronotaire apostolique en 1904. Lors de la division du diocèse de Cambrai, il devient le premier doyen du chapitre de la cathédrale du nouveau diocèse de Lille.
Source(s) :Louis Medler, Face à la conspiration antichrétienne, Mgr Henri Delassus (1836-1921). Un maître contre-révolutionnaire, Editions du SEL, 2005; «Mgr Henri Delassus», La Croix du Nord, 8 octobre 1921.
-
DELATTRE-GOURDIN
Libraire et imprimeur à Lens, Delattre-Gourdin est chargé de la fabrication du Régional en 1910-1911.
-
DELCAMBRE Julien
Industriel, ingénieur et mécanicien lillois, co-inventeur avec James Young de la première machine à composer utilisée dans une imprimerie en 1840.
Source(s) :Dictionnaire encyclopédique du livre, Éditions du Cercle de la librairie, 2002; Grelle, Bernard, «La pianotype, une invention lilloise?», L’Abeille, n° 12, septembre 2009, p. 15.
-
DELCLOQUE Jean-Baptiste Théophile
Libraire à Béthune depuis janvier 1842, Théophile Delcloque est présenté en 1848 par le préfet du Pas-de-Calais Degouves-Denuncques comme «un homme qui ne s’est fait connaître que par la violence et l’exagération de ses propos». Capitaine de sa compagnie de la garde nationale, il vient de refuser de s’associer aux félicitations adressées à celle de Paris «pour sa noble conduite dans la journée du 15 mai» où les républicains qui tentaient de prendre l’Hôtel-de-Ville avaient été chassés. Quelques semaines plus tôt, le 23 avril, il s’était présenté, en vain comme candidat radical, aux élections à la Constituante.
Le 4 septembre 1850, partisan de «la république sociale», Delcloque, publie un bihebdomadaire Le Furet. imprimé chez Desavary. Poursuivi par la justice dès octobre pour défaut de brevet de libraire, son journal n’y survit pas et disparaît au bout de soixante-quinze numéros. Cependant, si malgré un appel à Saint-Omer, sa librairie est vidée sur ordre du préfet, Delcloque réussit à la rouvrir. S’étant pourvu en cassation, il est, en 1851, relaxé, «l’exercice de la profession de libraire sans brevet ne le rend[ant] passible d’aucune peine et n’autoris[ant] contre lui que des moyens administratifs». Par la suite, il quitte le Pas-de-Calais, il se marie le 1 er avril 1859 à Paris avec Claudine Girard. Il meurt à l’âge de 60 ans à Meudon où il est déclaré propriétaire.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, Société des Amis de Panckoucke, 2010; Journal du Palais, 1er, juillet 1851; AD Pas-de-Calais, 5MIR 516/6; AD Hauts-de-Seine, E NUM MEU262.
-
DELCROIX Jean
Au terme de son service militaire effectué en Algérie au sein d’une unité de parachutistes, Jean Delcroix est entré à « La Voix du Nord» en 1962. Durant la majeure partie de son cursus, il a été attaché à la rédaction locale de Cambrai. Dans les mois qui ont précédé son départ à la préretraite, il a appartenu à la rédaction locale d’Arras de ce journal.
-
DELEBECQUE Marie Pierre Alphonse
Cousin de Robespierre, Marie Pierre Alphonse Delebecque est avocat stagiaire lorsqu’il devient, en 1832, rédacteur en chef du Libéral de Douai . Succédant à Martin Maillefer, il le reste jusqu’en 1848. Il est membre des journalistes patriotes et participe ou soutient la parution de L’Union. Journal populaire à deux sous. Sous la monarchie de Juillet, il est poursuivi en justice, son journal est même interdit de parution pendant plusieurs mois.
Lors du banquet organisé à Lille le 7 novembre 1847 en faveur d’une révision de la loi électorale, le Douaisien se retrouve du côté des plus radicaux: Bianchi, Delescluze, etc., qui entourent le républicain Ledru-Rollin.
Après la révolution de février, il est nommé sous-préfet de Cambrai, puis il est élu député du Nord à l’Assemblée législative le 13 mai 1849. Il abandonne la vie politique après le coup d’Etat de décembre 1851. Il revient à Douai où il s’inscrit au barreau.
En janvier 1843, il avait lancé un mensuel intitulé Jurisprudence de la cour royale de Douai qu’il rebaptise, sous l’Empire, Jurisprudence de la cour impériale de Douai et dont il assure la direction jusqu’à sa mort. Il meurt à Cambrai en 1867.
Source(s) :Lepreux Georges, Nos journaux, op. cit., p. 186; Le Libéral de Douai, ADN 1T 222.
-
DELECOURT Joseph
Ancien professeur à l’institution de Marcq-en-Barœul, Joseph Delecourt né en 1822 à Cysoing , est de sensibilité «légitimiste et cléricale». En juillet 1856, il entre au quotidien La Vérité puis en octobre 1860 passe au Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais (1860-1883). Père de six enfants, sa position est, selon la police «précaire».
Source(s) :AD Nord, 1T 222/18, n.d.
-
DELECROIX Henri
Entré à La Voix du Nord le 1 er octobre 1952, Henri Delecroix y a exercé le métier de reporter photographe pendant près de trente ans. La qualité de son travail lui avait valu très rapidement le prix régional du meilleur reportage, tandis que ses images de sport avaient été récompensées par la médaille de la Jeunesse et des Sports.
-
DELEHELLE Amant
Directeur de la «Sécurité Auchelloise», Amant Delehelle est correspondant de La Défense (1903-1912), du Petit Béthunois , du Réveil du Nord. Il collabore également au Petit Auchellois (1908-1914) .
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, Société des Amis de Panckoucke, 2010.
-
DELELIS O.
En 1850, O. Delelis collabore au Furet. de Jean-Baptiste Delcloque.
-
DELERUE Jacques
Etudiant à L’Ecole supérieure de journalisme de Lille, Jacques Delerue était entré dès 1949 à La Croix du Nord comme secrétaire de rédaction. Le 1 er avril 1959, il avait rejoint le service des Informations générales de La Voix du Nord .
Parallèlement, Jacques Delerue enseigna le secrétariat de rédaction et la mise en page à des générations d’étudiants. Il s’investit également dans de nombreuses associations, notamment le Secours catholique et, en faveur des mal-logés, au sein du Plan d’action contre les taudis (PACT).
Admis à la retraite le 31 mars 1990, il est mort quelques semaines plus tard, le 4 mai 1990.
.
Source(s) :La Voix du Nord, 6 mai 1990.
-
DELESALLE Edouard
Né le 7 mai 1857 à Lille, Edouard Delesalle exerce, comme son père, le métier de marchand de papiers peints dans sa ville natale 18, rue des Chats bossus.
Dès 1879, il entre dans la lutte politique. Lors des élections municipales de 1880 et de 1884, il soutient les candidats radicaux, contre la liste de Géry Legrand. En plein boulangisme, lors des élections de 1888, il défend l’alliance de tous les républicains.
Quatre ans plus tard, il est candidat pour la première fois sur une liste radicale et socialiste. En 1896, il réussit à se faire élire conseiller municipal sur une liste d’alliance entre les socialistes et les radicaux qui porte le socialiste Gustave Delory à la mairie de Lille. En 1900, il devient même adjoint délégué aux Finances.
Membre du Parti ouvrier, il en est exclu en 1901 pour avoir préconisé l’alliance de toutes les forces socialistes. Il devient alors membre du Parti socialiste français.
En novembre 1889, Delesalle fonde le quotidien lillois Le Réveil du Nord , «organe radical qui, selon la police, devient le moniteur officiel du syndicat des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais». Mis en difficulté après plusieurs procès, le journal fusionne avec Le Travailleur, l’hebdomadaire du POF, et il prend, en mars 1894, le sous-titre de «journal d’union socialiste». Le déficit comblé par Edouard Delesalle, celui-ci en devient, selon l’expression de la police «de fait même le propriétaire».
Durant la Première Guerre mondiale, Edouard Delesalle quitte le Nord. Il meurt à Paris le 18 juillet 1917.
J.-P.V.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/23, «Edouard Delesalle», La Vie flamande illustrée, n° 2, 31 janvier-7 février 1903, p. 2.
-
DELEUZE Edouard
Edouard Deleuze est rédacteur au journal communiste L’Enchaîné en 1929.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
DELEVALLEE Jacques
Né à Saint-Saulve, Jacques Delevallée fit ses études au collège Notre-Dame puis à l’EPS de Valenciennes où son père était professeur et où il obtint son brevet supérieur et son baccalauréat. En décembre 1944, il entrait à La Voix du Nord. Après ses débuts dans le Valenciennois, Jacques Delevallée a été dirigé, en février 1950, vers la rédaction de Cambrai . Quelques années de polyvalence ont été suivies par la conduite, dans cette édition, de la rubrique des sports couvrant l’ensemble de l’arrondissement. Il l’assurait en liaison avec plusieurs correspondants et relais.
Trop tôt disparu au terme d’une impitoyable maladie, il a laissé le souvenir d’un journaliste dont le dynamisme était attentif aux réalités du terrain.
-
DELFORTRIE Louis
Lors de sa mort prématurée le 13 mars 1943, après une maladie du cœur, à l’âge de 59 ans, Louis Achille Delfortrie, comptait 39 ans de métier. Fils d’un employé de commerce rpubaisien, i l avait commencé sa carrière de journaliste au Journal de Roubaix le 1 er février 1905 . Sept ans plus tard, il était entré au quotidien lillois La Dépêche comme secrétaire de rédaction. Après la Première Guerre où il avait été mobilisé comme sous-officier, il avait repris sa place à La Dépêche dont il était devenu chef des informations.Après la disparition de ce journal en 1940, il était revenu au Journal de Roubaix où il était directeur de l’agence de Lille. Également critique artistique et théâtral, il signait ses articles du pseudonyme de Eldé. Parallèlement, il était membre de l’Association radiophonique du Nord. Célibataire, Louis Delfortrie était fort impliqué dans les associations de défense des journalistes. Trésorier adjoint de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, il était administrateur de la section Nord-Pas-de-Calais du Syndicat national des journalistes, président-fondateur de la «mutuelle maladie et maternité des journalistes du Nord». Modeste, ne recherchant pas les honneurs, selon ses confrères, il avait été nommé officier de l’Instruction publique.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 512 R 023; Le Journal de Roubaix, et, Le Grand Echo du Nord, 14 mars, 1943
-
DELIGNY Henri
Docteur en sciences de l’information, Henri Deligny, journaliste, enseignant, écrivain, cultivait bien des talents.
Né en avril 1930, à Roubaix, il a débuté vingt ans plus tard à La Voix du Nord comme simple rédacteur à la locale de Lille. Il devint par la suite adjoint au chef de l’édition locale. En 1968, il était affecté comme journaliste parlementaire à la rédaction parisienne du quotidien lillois. Il est passé ensuite au journal Le Monde , quotidien pour lequel il avait travaillé comme correspondant régional pendant plusieurs années en même temps qu’il donnait des cours à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille.
Journaliste d’investigation, très rigoureux dans ses enquêtes, il multiplia les articles sur les luttes régionalistes, établissant le lien entre les conflits sociaux, le combat identitaire des écolos de l’époque et l’émergence d’une sensibilité des provinces face au parisianisme des élites.
C’est ainsi qu’il fut embauché au Canard Enchaîné en 1972 afin de mettre en valeur, sous la signature d’Hervé Terrace, le combat des paysans du Larzac, exemplaire des luttes engagées contre le modèle de la société industrielle et l’emprise de l’armée sur les terres du Causse. Licencié de l’hebdomadaire satirique en juillet 1975, à la suite d’une altercation avec le directeur, il partit animer le journal Gardarem lo Larzac avant de revenir s’installer dans le Val de Loire. Henri Deligny avait publié en 1961 un roman sur la vie des appelés en Algérie, intitulé H S , qui fut interdit à l’époque par le ministère de l’Intérieur pour «atteinte au moral de l’armée» et aussi en 1977, une biographie sur Jacques Chirac: La Fringale du pouvoir aux éditions Alain Moreau.
Sa thèse en sciences de l’Information à l’Université de Paris IV (CELSA), soutenue en 1986, était consacrée à « l’idéologie du métier» un discours des journalistes sur leur formation professionnelle.
-
DELILLE Louis Pierre
Fils d’Eloi Delille, garçon de magasin, et de Céline Hecquet, Louis Pierre Delille exerce d’abord la profession d’employé de bureau. Dans les années 1930, après son mariage avec Marthe Jeanne Danjoux, employée de bureau, il entre au quotidien Le Réveil du Nord où il est rédacteur pour le Cambrésis. Après la Libération, il poursuit son activité pour le compte du journal socialiste Nord-Matin. En 1961, il est nommé chef de l’édition de Cambrai, poste qu’il occupe jusqu’à l’âge de la retraite. Il collabore également à L’Espoir du Cambrésis, hebdomadaire d’information de la démocratie socialiste , fondé le 11 novembre 1944 par le député-maire de Cambrai Raymond Gernez. J-P. V.
-
DELLOYE Ernest
Catholique, légitimiste et cambrésien, tels sont les trois adjectifs qui, quel que soit leur ordre, qualifient Ernest Delloye qui, pendant trente ans, dirigea L’Emancipateur de Cambrai et s’évertua à en faire un journal dont la parole porta dans son milieu.
Fils d’un fabricant de sucre, président du tribunal de commerce de Cambrai, Ernest Charles est d’abord élève au petit séminaire de Cambrai avant de rejoindre, en 1856, son frère au collège de Marcq-en-Barœul, dans la banlieue lilloise, comme pensionnaire. Bachelier ès-lettres en 1863, le jeune Ernest Delloye souhaite, comme il l’écrit dans une lettre datée du 24 octobre 1864, «être utile aux autres, travailler au bien moral de la société», trouver «un poste où [il] aura assez de pouvoir pour faire triompher [ses] sentiments chrétiens, où [il pourra] agir et faire agir les autres comme tout catholique doit agir». Etudiant en droit et en théologie, il obtient, en août 1867, sa licence en droit, mais renonce au barreau et pense faire carrière dans la presse parisienne.
Cambrésien dans l’âme, il renonce là aussi, préférant écrire dans L’Emancipateur de Cambrai , journal légitimiste et catholique, qui répond à ses aspirations . La mort de Louis Carion, en août 1869, lui offre l’opportunité de prendre la direction de ce journal qu’il va transformer et agrandir. En 1877, la périodicité du journal passe à quatre jours par semaine. Dix ans plus tard, en août 1887, Delloye n’hésite pas à engager des fonds personnels pour en faire un quotidien et embaucher un rédacteur supplémentaire. Il organise un système de dépêches pour que les principales nouvelles de la journée soient publiées le soir même dans son journal. Dès sa fondation, en 1886, par Louis Veuillot, il est membre du conseil de la Corporation chrétienne des publicistes qui rassemble nombre de journalistes catholiques.
Royaliste, Ernest Delloye milite pour la restauration de la monarchie au profit du comte de Chambord, pensant ainsi travailler au bien de l’Eglise catholique. Partisan du drapeau blanc, il rejette les théories révolutionnaires, symbolisées par le drapeau tricolore. Par la suite, il s’aligne sur les positions d’Albert de Mun, qui, en 1885, réclame l’organisation d’un parti catholique. Peu favorable à la liberté de la presse, il défend toute sa vie la liberté de l’enseignement et sa diffusion. A ce titre, il fonde notamment l’œuvre du denier des écoles catholiques, prend part à la fondation de l’Institution Notre-Dame de Grâce à Cambrai.
Surnommé le «jésuite à robe courte» par le journal républicain Le Libéral de Cambrai, la police républicaine ne se montre pas tendre à son égard. Elle le présente soit comme «sectaire et fanatique, […] inaccessible à toute influence, même à celle des chefs du parti radical. Bilieux et méchant», soit, dans le meilleur des cas comme «très ardent en politique». Ernest Delloye quitte son journal en 1896. Il meurt deux ans plus tard, le 15 avril 1898 à l’âge de 56 ans. Lors de sa mort, La Croix du Nord écrit: «Al’apostolat par la presse, M. Delloye ajouta une active et infatigable coopération à toutes les œuvres de charité et de foi nombreuses à Cambrai.» Il fut notamment président de la Conférence Saint-Vincent de Paul de la paroisse Saint-Géry. Son engagement lui valut d’être nommé, en février 1897, chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand par le pape Léon XIII.
Profondément attaché à sa ville natale, il collectionna de nombreux écrits, plans, dessins et tableaux sur son histoire qu’il légua au musée. Il milita pour la réhabilitation du patrimoine de la ville et notamment pour la conservation et la restauration de la porte Notre-Dame, trouvant un mécène en la personne du fabricant de chicorée G. Black. Membre de la Société d’émulation, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la ville de Cambrai, sous son nom propre ou celui de Bernard de Marcq, en souvenir de son passage au collège de Marcq-en-Barœul.
Source(s) :AD Nord, 1T 217/8, 1T 222/3; La Croix du Nord, 17 avril 1898; Dransart (abbé), Ernest Delloye, notes biographiques, pages inédites, pages choisies, Cambrai, Oscar Masson, 1899; A. Berger, «Notice sur Ernest Delloye, membre résident», Mémoires de la Société d’émulation de Cambrai, 1899, tome 53, p. 251-259.
-
DELMAS Jean Gabriel
Né à Bègles en 1855, Gabriel Delmas aurait été avocat au Tonkin avant de devenir journaliste. Rédacteur au Nord maritime à Dunkerque, il est, selon la police, en 1895 «bien considéré», ne prenant que rarement part «aux polémiques violentes et haineuses de son journal», s’occupant «surtout de la rubrique locale».
Il en devient cependant rédacteur en chef, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort survenue en mars 1907.
.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord de la France, 15 mars 1907.
-
DELORY Gustave
 Ouvrier filtier, Gustave Delory fonde en 1879 le syndicat des filtiers. Il est alors renvoyé de son usine et exerce divers métiers. Dès 1882, il adhère au Parti ouvrier dont il fonde la section lilloise l’année suivante.
Ouvrier filtier, Gustave Delory fonde en 1879 le syndicat des filtiers. Il est alors renvoyé de son usine et exerce divers métiers. Dès 1882, il adhère au Parti ouvrier dont il fonde la section lilloise l’année suivante.usqu’en 1884, il est administrateur du journalLe Forçat fondé par Gustave Joncquez. Selon le Grand Echo du Nord, lorsque le Forçat cesse de paraître, il retourne à l’usine de Fives, puis devient cordonnier. Il tient ensuite un cabaret à l’enseigne de La Ferme , 21, rue de Béthune. Il fonde avec Carette, le maire de Roubaix, Le Cri du travailleur.En 1890, il crée l’imprimerie ouvrière.
En 1892, il est élu conseiller d’arrondissement dans le canton nord-est de Lille. Quatre ans plus tard, à la tête d’une coalition regroupant des radicaux et des socialistes, il prend la mairie de Lille. Il est ensuite élu conseiller général en 1898 et député en 1902. Victime de dissensions entre socialistes et radicaux, il perd la mairie en 1904 qu’il reprend en 1919.
Resté à Lille pendant la guerre, Gustave Delory est interné à la citadelle puis déporté à Holzminden en Allemagne. Député, vice-président du conseil général du Nord depuis 1922, il meurt en août 1925.
Source(s) :Grand Echo du Nord de la France, mardi 19 mai 1896; Bernard Ménager, Jean-Pierre Florin, Jean-Marie Guislin, Les Parlementaires du Nord-Pas-de-Calais sous la IIIeRépublique, CRHENO, Université Charles-de-Gaulle Lille 3, 2000.
-
DELORY Jules
Imprimeur-libraire à Lillers, Jules Delory est propriétaire de L’Eclaireur artésien de septembre 1870 au 16 juillet 1882, puis du Publicateur du 16 mars 1883 au 26 juillet 1884.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notices de, L’Eclaireur artésien, et du Publicateur
-
DELOURME Clotaire
Fils d’un cabaretier-charcutier de Cysoing, Clotaire Delourme devient instituteur. Après différents postes, il se fixe à Hellemmes, dans la banlieue lilloise, où il milite à la section socialiste. Grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale sur le front de la Somme, il reçoit la médaille militaire et la croix de Guerre. Il fonde la fédération du Nord de l’Association républicaine des anciens combattants dont il est successivement trésorier, secrétaire général et président.
Membre de la III e Internationale, il crée, en 1920, avec Joseph Hentgès et Florimond Bonte, Le Prolétaire, d’abord diffusé à Hellemmes puis sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ce périodique qui est l’un des premiers organes communistes donne, par la suite, naissance à L’Enchaîné. Secrétaire de la fédération du Nord du Parti communiste et secrétaire du Syndicat unitaire des instituteurs, Clotaire Delourme est élu député lors des législatives du 11 mai 1924 sous l’étiquette «Bloc ouvrier et paysan». Candidat dans la circonscription de Douai en 1928, il est battu au 2 e tour de scrutin par Jean Debève.
Malade, il se retire de la vie politique et syndicale au début des années 30. Il meurt à Hellemmes le 7 mai 1950.
Source(s) :www2.assemblee-nationale.fr>histoire>base de données des députés français depuis 1789; Bernard Ménager, Jean-Pierre Florin, Jean-Marc Guislin, Les Parlementaires du Nord-Pas-de-Calais sous la IIIeRépublique, CRHENO – Lille 3, notice Delourme
-
DELPIERRE Casimir Parfait
Fils d’Edouard Augustin Joseph Delpierre, marchand de fer, et de Marie Catherine Joseph Lardeur, Parfait Casimir Joseph Delpierre devient ouvrier typographe chez Lefranc à Arras. Après décès de la veuve Desavary, libraire à Béthune, il reprend son brevet. A la suite du rachat par adjudication de l’imprimerie détenue par Alphonse Desavary, il devient propriétaire de La Revue artésienne qu’il dirige du 10 août 1854 à septembre 1883. Il meurt à l’âge de 89 ans.
Source(s) :AN F, 18, 2032; AD Pas-de-Calais, 5 MIR 765/37; La Revue artésienne
-
DELPIERRE Edouard
Fils d’un compositeur d’imprimerie de Boulogne-sur-Mer, Adolphe Louis Edouard Delpierre, exempté du service militaire pour faiblesse , est ordonné prêtre en 1901. Il est nommé professeur à Aire-sur-la-Lys la même année . En 1905, il devient secrétaire particulier de Mgr Williez, évêque d’Arras, poste qu’il conserve jusqu’à l’arrivée de Mgr Lobbedey en 1911. Durant cette période, il dirige La Semaine religieuse devenue l’organe officiel de l’évêché d’Arras-Boulogne. Il est ensuite nommé directeur du petit séminaire de Boulogne. A la mort de l’abbé Boulinguez en octobre 1915, il prend la direction de La Croix du Pas-de-Calais . Il occupe ce poste jusqu’au 27 avril 1919 où il est remplacé par l’abbé Lefebvre.
Source(s) :AD Pas-de-Calais 1J 1633.
-
DELPIERRE Henri
Fils de Parfait Casimir Joseph Delpierre, imprimeur-libraire à Béthune, et de Joséphine Françoise Coquidé, Henri Ludovic Edouard Augustin Delpierre prend la succession de son père à la tête de La Revue artésienne. Il la dirige de septembre 1883 à juillet 1901 où il la cède à Delcroix. Parallèlement, il est le correspondant du Grand Echo du Nord dans l’arrondissement de Béthune.
Par la suite, on le retrouve juge de Paix à l’Isle-Adam en Seine-et-Oise. En août 1933, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Les insignes lui sont remises par son frère, Victor, maire d’Ansauvillers et sénateur du département de l’Oise.
Source(s) :Site Léonore, dossier de Légionnaire; Le Grand Echo du Nord, 4 décembre 1901.
-
DEMENY Paul
Etabli à Paris, Paul Demeny , fils d’un artiste-musicien de Douai, est codirecteur de la libraire artistique où il publie en 1870 son premier recueil de poèmes Les Glaneuses. Ami de Victor Hugo, il est, en novembre 1878, rédacteur en chef de l’éphémère Triboulet (6 octobre 1872-9 février 1873) , un journal satirique illustré de tendance légitimiste, publié à Douai.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 020 R 055; J.-P. Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, collection Kiosque 59-62, 2017.
-
DEMEY Jacques
Jacques Demey ne se destinait probablement pas au journalisme. Fils de l’avocat Julien Demey, il suit les cours de l’école libre de Sciences politiques de Paris et se prépare à une carrière diplomatique. Petit-fils de Mme Alfred Reboux, directrice du Journal de Roubaix, il s’oriente pourtant vers le journalisme à la mort de Jean Reboux, fils d’Alfred Reboux. Nommé rédacteur en chef du quotidien roubaisien, il en devient directeur en 1936, à la disparition de sa grand-mère. Mobilisé pendant la Seconde Guerre, puis prisonnier, il est libéré à la fin de l’année 1940 et fait reparaître Le Journal de Roubaix le 1 er janvier 1941. Parallèlement, en 1943, il prépare clandestinement un nouveau quotidien régional destiné à paraître dès la Libération, Nord Eclair. Ce journal a vocation à être l’organe des résistants d’inspiration chrétienne (R.I.C.) A la Libération, Jacques Demey est condamné à deux ans de prison, à la confiscation d’un quart de ses biens. Il bénéficie de plusieurs remises de peine, puis est amnistié. Il ne reprend ses activités à Nord Eclair qu’en 1952 où il est nommé directeur-gérant, puis président-directeur général. En 1966, il est administrateur du Syndicat national de la presse quotidienne régionale. Il quitte ses fonctions après le rachat du journal par le groupe Hersant en 1975. Il reste cependant vice-président de la S.A. Nord Eclair et administrateur de la société Nord Eclair Edition.
Jacques Demey fut très impliqué dans la vie culturelle régionale. Membre du Rotary club de Roubaix, il a été président de la Société de géographie de Roubaix, du comité du Nord de l’Association France-Italie. Il fut également vice-président des anciens élèves de Sciences politiques. Il été chevalier de l’ordre de la Couronne de Belgique.
Source(s) :«Nord Eclair en deuil. Mort de M. Jacques Demey, ancien président-directeur général de Nord Eclair, Nord Eclair», 17 janvier 1987, Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021.
-
DEMORY Henri
Né à Saméon, Henri Albert Demory est le fils d’un couple de cultivateurs, Jean-Baptiste Demory et Henriette Dupont. Il fut d’abord enseignant, avant d’entrer au quotidien catholique La Croix du Nord en 1891. Affecté au bureau de Tourcoing, il y officia pendant trente-six ans. Membre de l’Association professionnelle des journalistes, il en fut le syndic.
Resté dans le Nord envahi durant la Première Guerre mondiale, Henri Demory fournit des renseignements sur les mouvements de l’armée allemande aux états-majors français et anglais. Soupçonné d’espionnage par l’ennemi, il fut, en 1918, envoyé comme otage en Lituanie. Sa conduite durant la guerre lui valut la médaille de la Reconnaissance française ainsi qu’une décoration du gouvernement anglais.
Directeur de la maison des Œuvres de Tourcoing, Henri Demory fut l’un des organisateurs de pèlerinages à Lourdes pendant vingt-cinq ans. Son dévouement au sein des Œuvres catholiques fut récompensé par la médaille Pro Ecclesia et Pontifice.
Il meurt à l’âge de 67 ans après une longue maladie.
Source(s) :AD Nord, 3E 16304, 5Mi 024 R 037; La Croix du Nord et Le Grand Echo du Nord, 19 septembre 1933.
-
DENOLLET François
François Denollet (ou Donolet), fut gérant du journal Le Bandit du Nord , hebdomadaire anarchiste (n° 1, 9 février 1890, n° 2 et dernier, 16 février) qui parut à Roubaix et faisait suite à L’Écho de la misère . L’administrateur en était Vercruyze et le principal rédacteur Girier Lorion. Sur le choix du titre, on pouvait lire dans le premier numéro: «Epuisés, indignés et révoltés tout à la fois par l’examen que nous venions de faire de cette triste société, nous nous consultâmes des yeux, puis après un moment de silence, l’un de nous comprenant nos pensées se leva et dit: « Compagnons, l’honnêteté, la justice, la morale, la patrie, tout ça c’est tellement odieux que nos cœurs ne peuvent vivre sous ces drapeaux, il vaut mieux nous appeler Bandit. » Denollet fut inculpé dans l’affaire Girier-Lorion – ce dernier, condamné par défaut avait tiré sur des gendarmes venus l’arrêter – et fut condamné à six mois de prison le 17 décembre 1890, tandis que Girier-Lorion était condamné à dix ans de travaux forcés.
Source(s) :Dictionnaire international des militants anarchistes, (, http://militants-anarchistes.info, ); AD Nord, série M; J. Maitron, Histoire du Mouvement anarchiste, … op. cit; R. Bianco «Un siècle de presse…, », op. cit.
-
DENOYELLE Robert
Robert Denoyelle tâte du journalisme dès l’âge de 16 ans où il est apprenti journaliste, à partir du 15 décembre 1944, à l’agence de Valenciennes de La Voix du Nord. Après son service militaire, il est embauché comme rédacteur dans cette même édition. Quelque temps plus tard, à la demande du chef d’édition, Maxime Moirez, il ouvre le bureau de Denain où il suit, jusqu’en 1983, toute l’actualité du Denaisis. De l’actualité économique et sociale du secteur, il tire un ouvrage, Les Feux éteints publié en 1988 aux éditions Guy Cattiaux. .
-
DEPASSE Hector
Né à Armentières en 1842, Hector Depasse, licencié ès-lettres, commence sa carrière de journaliste dans le département du Nord. Il travaille notamment au Progrès du Nord dont il devient rédacteur en chef. Puis, à Paris, il collabore au Siècle , au Radical , au Rappel , etc. Il est également rédacteur en chef de la Gazette du village. Elu conseiller municipal de Paris, il se présente en vain aux élections législatives de 1885 et de 1889 dans le département du Nord, sous l’étiquette républicain progressiste, et dans la Seine en 1902. Durant cette période, il occupe diverses fonctions dans plusieurs cabinetsministériels : Instruction publique, Commerce et industrie… En 1906, il est élu député de la Seine, il est réélu en 1910. Il est l’auteur de nombreux ouvrages.
Source(s) :Base de données des députés français (www2.assemblée-nationale.fr>Histoire>base de données des députés français).
-
DEPRET Louis
S’il est né à Lille, Louis Pierre Frédéric Dépret, fils d’un marchand de fer originaire de Mortagne, passa la plus grande partie de sa jeunesse à Boulogne-sur-Mer et en Angleterre. De l’autre côté de la Manche, il ramena une bonne connaissance de la littérature anglaise, il traduisit les poètes Longfellow, Charles Lamb et côtoya Charles Dickens. Revenu en France, il acquit rapidement une certaine réputation avec son recueil de poèmes Etapes du cœur et un roman Jalousie en double partie. Très vite, il avait attiré l’attention de Sainte-Beuve. Publiciste, poète, romancier, moraliste, Louis Dépret écrivit sous le pseudonyme de Marc Oberlin dans La Revue du Nord . Il collabora ensuite, comme critique littéraire, à plusieurs journaux parisiens. «De 1855 à 1892, il publia, écrivait Le Figaro au lendemain de sa mort , de nombreux volumes où l’on retrouve la même acuité d’ironie qui se masquait volontiers de bienveillance courtoise, dont l’un Va-et-vient exprime, jusque dans son titre un aimable bohémianisme d’esprit.» Louis Dépret meurt à l’âge de 67 ans après une courte maladie. Nombreux furent les hommages rendus à ce «moraliste délicat, [cet] écrivain des plus appréciés». Membre de la Société des gens de Lettres, il avait été l’ami de Taine et de Jules Clératie.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 044 R 153; Le Figaro, Le Temps…, 22 mars 1905.
-
DEPREUX Théophile
Après des études secondaires à Douai et de droit à Paris, Théophile Depreux fut admis au barreau de Cambrai comme avocat. En décembre 1869, il fonde Le Libéral de Cambrai pour soutenir la candidature de Corne dans la 8 e circonscription du Nord. Journal d’opposition sous le Second Empire, le périodique devient républicain au lendemain de la défaite de Sedan.
Président du comité républicain de Cambrai, Théophile Depreux est maire de Viesly en 1874 à 1884, il est ensuite élu conseiller municipal de Cambrai jusqu’en 1888. A la suite du décès du douaisien Charles Merlin, il est élu sénateur du Nord. Il est réélu en 1897, mais ne se représente pas en 1906.
Retiré à Viesly, il meurt le 28 mai 1912. Son petit-neveu, Edouard Depreux, sera le fondateur du PSU.
Source(s) :Bernard Ménager et consorts, Les Parlementaires du Nord-Pas-de-Calais sous la IIIe République, Centre de recherche sur l’histoire de l’Europe du Nord-Ouest Université Charles de Gaulle – Lille 3, 2000; www.senat.fr/senateur-3eme, -republique.
-
DERMECH Geneviève, [Marguerite Mourier, épouse Robichez]
Fille d’un banquier de Limoges, disparu prématurément, Geneviève Dermech qui signait «Guite» dans ses articles à destination de ses lectrices avait commencé des études aux Beaux-Arts de Limoges. Ayant rencontré Gaston Robichez dit « Cyril» qui devait devenir le directeur du Théâtre populaire des Flandres, elle s’orienta vers la danse à «l’école Jeune France».
Ensemble, une fois mariés, ils se lancèrent, dès mai 1942, dans les techniques de l’art populaire. Nommés conseillers à la Jeunesse auprès du Protectorat à Tunis, ils pratiquèrent l’ébauche d’une formation artistique et de la mise en scène avant de revenir en métropole à la Libération de Paris.
Installée dans le Nord avec deux de ses enfants, Geneviève Dermech, dont le pseudo vient du nom d’un petit village tunisien, fut embauchée d’abord à l’hebdomadaire
 Nord France puis à Nord-Eclair avant d’entrer, le 1 er mai 1954, dans l’équipe rédactionnelle d’un nouvel hebdomadaire Semaine du Nord qui appartenait à La Voix du Nord.
Nord France puis à Nord-Eclair avant d’entrer, le 1 er mai 1954, dans l’équipe rédactionnelle d’un nouvel hebdomadaire Semaine du Nord qui appartenait à La Voix du Nord.A la disparition du périodique, elle parvint à intégrer la rédaction du quotidien régional qui lui confia la mission, entre autres, de nourrir une rubrique intitulée «Madame M.» chaque mardi, à destination des lectrices qui n’avaient, jusqu’alors, qu’une page consacrée à la mode et rédigée par une chroniqueuse parisienne. Elle entreprit aussi de lointains voyages pour décrire la vie des «Nordistes du bout du monde» et des enquêtes sociales et familiales sur le terrain de la Flandre et de l’Artois.
Elle prit sa retraite le 31 mars 1988 après avoir été décorée de la croix de chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.
En 1982, elle avait fondé une association qui rassemblait les femmes journalistes sous la bannière d’une des premières journalistes duxixesiècle : «Les Héritières de Séverine».
Elle est décédée deux mois après la disparition de son mari Cyril Robichez, atteinte de la maladie de Parkinson. Elle avait eu quatre enfants dont une de ses filles lui avait été enlevée tragiquement dans un accident de la circulation.
-
DERUYCK René
«Homme des 35 tours» comme le titra La Voix du Nord à l’occasion de sa mort survenue le 11 novembre 2016 à Saint-Joseph de La Réunion, René Deruyk fut l’une des figures et surtout l’une des plus belles plumes du cyclisme nordiste, du cyclisme tout court pendant une trentaine d’années, de 1957 à 1990. Au cours de ses reportages dans sa région natale, sur la Grande Boucle et ailleurs, il a côtoyé les plus grands champions, de Jacques Anquetil à Bernard Hinault en passant par Federico Bahamontès, Eddy Merckx, Laurent Fignon et bien d’autres. L’âge de la retraite venu, René Deruyk s’adonna à sa seconde passion, l’histoire. Il publia plusieurs ouvrages et notamment Lille dans les serres allemandes, Mourir pour la liberté, histoire du Comité Jacquet et une biographie de Louise de Bettignies. Cependant, le vélo était resté la grande affaire de sa vie. Ainsi publia-t-il une histoire de la course Paris-Roubaix, Les Dessous du pavé, puis retiré à Lavaur dans le département du Tarn, œuvra-t-il, par deux fois, à l’arrivée du Tour de France dans sa ville d’adoption.
Source(s) :J.-M. R., «L’homme des 35 tours», La Voix du Nord, 30 juillet 2002.
-
DESANTI Louis
Louis Desanti est rédacteur administrateur du Journal de Lens en 1928.
-
DESAVARY Alexandre Dominique Joseph
Fils d’Alexandre Joseph Desavary, cavalier, et de Marie Anne Lemaire, Alexandre Desavary est né le 11 février 1779 à Sainte-Croix, près de Béthune. Marié le 1 er octobre 1800 avec Alexandrine Florine Journey, il est imprimeur- libraire. A ce titre, il réalise Les Petites Affiches de la ville de Béthune qui, deviennent La Revue artésienne.
Source(s) :Ibidem.
-
DESAVARY Alexandre Joseph
Fils d’Alexandre Dominique Desavary, imprimeur-libraire à Béthune, et d’Alexandrine Journey, Alexandre Joseph Desavary est rédacteur-gérant de La Revue artésienne qui a succédé aux Petites Affiches de la ville de Béthune en 1832. Le périodique passe entre les mains de Casimir Delpierre en 1854, après la mort de sa mère Alexandrine. En 1850, Alexandre Desavary imprime également Le Furet. de Jean-Baptiste Delcloque.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, Société des Amis de Panckoucke, 2010.
-
DESAVARY Alexandrine Florine, née Journey
Alexandrine Desavary prend la suite de son mari aprèse son décès en 1830. Elle obtient son brevet d’imprimeur le 5 avril 1830 et celui de libraire le 10 juillet 1830. Installée 104, Grand’Place à Béthune, elle est imprimeur de la mairie. Elle imprime La Revue artésienne qui a pris la suite des Petites Affiches de la ville de Béthune. Elle est remplacée comme imprimeur le 3 avril 1849 et comme libraire le 5 juillet 1854, année de sa mort.
Source(s) :Ibidem.
-
DESCHAMPS Henri
Henri Clément Deschamps était né à Roubaix le 2 septembre 1840. Fils d’un artisan, il commença à travailler comme ouvrier en bâtiment pour terminer industriel et notable, vice-président de la Ligue républicaine, administrateur du Mont-de-Piété, de la Caisse des écoles, etc. Il entra dans le combat politique en luttant contre le coup de force de Mac-Mahon et le gouvernement d’Ordre moral du duc de Broglie. Il soutint Achille Scrépel, républicain, un des 363 dont la réélection força Mac-Mahon à se démettre, et Alfred Motte. Courageux, prêt à payer de sa personne, il participa au congrès collectiviste de la salle Dominique, provocant des « incidents tumultueux ». Il se fit élire conseiller d’arrondissement en 1889 et le resta jusqu’en 1892. En 1893, il fut candidat radical contre Louis Vienne, soutenu par Le Journal de Roubaix, et contre Guesde, candidat de la gauche.
Ami de Reboux – ils avaient tous deux servi au 48e régiment de mobiles du Nord en 1870 –malgré leurs divergences politiques, il se rapprocha politiquement de lui après le Ralliement à la République de ce dernier à la suite de la publication par Léon XIII, le 20 février 1892, de l’encyclique Inter sollicitudines (Au milieu des sollicitudes). Il anima, de 1893 à 1896, Le Roubaisien, un hebdomadaire satirique illustré destiné à soutenir la candidature de l’industriel Gaston Motte, chef de file de l’Union sociale et patriotique, contre Carrette et ses amis du Parti ouvrier français qui détenaient alors la mairie. Il fut l’un des promoteurs de l’Union sociale et patriotique, association anticollectiviste, et fonda Le Petit Roubaisien après l’échec électoral de Motte en 1906.
Deschamps n’hésitait pas à mettre la main à la pâte, si l’on en croit Achille Rousseau : « sa plume de journaliste improvisé était féconde… »
Source(s) :AD Nord, 3 E 16019; Le Grand Echo du Nord, 10 septembre 1910; Le Journal de Roubaix, 13 septembre 1910.
-
DESCHAMPS Marcel
C’est durant ses études à l’école industrielle d’Armentières que Marcel Aimé Henri Deschamps s’initie au socialisme. Fils d’Emile Armand Deschamps, marchand de vaches et débitant, et de Marie Angélina Leroy, Marcel Deschamps est, en 1902, élève à l’école nationale professionnelle d’Armentières où il a comme professeur d’économie politique Pierre Brizon (1878-1923) qui l’initie au socialisme. Dès l’année suivante, Marcel Deschamps collabore à l’organe armentiérois du POF. En 1905, il effectue son service militaire à Mézières dans les Ardennes. Sous la signature de Marcel Prolo, il donne des articles au Socialiste ardennais (1895-1939) , hebdomadaire de la fédération des travailleurs socialistes des Ardennes. De retour à la vie civile, membre du Parti socialiste, il rejoint Paris où il collabore au Socialisme (1907-1912) dirigé par Jules Guesde. En 1912, il participe au quotidien socialiste marseillais La Provence fondé par l’écrivain Paul-Marius André avec qui il a travaillé au Socialisme . Ce journal ne paraît que quelques mois et en septembre 1912, Marcel Deschamps prend la rédaction en chef de l’hebdomadaire socialiste lillois Le Travailleur (1900-1914). Il est poursuivi à plusieurs reprises pour ses articles. S’élevant contre la loi des trois ans, il est renvoyé en cours d’assises où défendu par les avocats Ernest Lafont, futur député socialiste puis communiste, et Léon Escoffier, futur député socialiste et maire de Douai, il est, en juillet, acquitté. Par contre, en octobre 1913, ayant refusé de payer une amende pour délit de presse, il est emprisonné. En avril 1914, lors des élections législatives, il se présente en vain dans la 4 e circonscription de Lille contre le député sortant Jules Dansette. Réfugié à Paris après l’occupation de Lille par les Allemands, en 1915, il fait partie de la CA «groupement socialiste du Nord» qui, autour de Charles Saint-Venant puis de Jean Lebas, souhaite maintenir une présence du Nord au sein du Parti socialiste. Le 4 juin 1918, il se marie à Paris avec Geneviève Jacquet, fille d’Eugène Jacquet, chef d’un réseau d’évasion de soldats anglais et de renseignements, fusillé avec trois de ses compagnons à Lille le 22 septembre 1915. Si Geneviève avait été inquiétée par les Allemands, elle fut rapidement libérée. Quelques mois avant la fin de la guerre, Deschamps collabore à La France libre, hebdomadaire de combat pour l’Union des gauches lancé en juillet 1918 et dirigé par Compère-Morel. Lors de la scission du Parti socialiste en 1920, il se tient, selon le journal La Vague, « à l’écartde toute activité militante, tout en continuant à prendre sa carte SFIO». Répondant à l’appel de son ancien professeur Pierre Brizon, fondateur du Bloc des rouges qui connaît des difficultés, il rejoint De Jaurès à Lénine. Journal d’union entre les petits et de lutte contre les gros qui, en 1924, devient La Vague ouvrière et paysanne. Organe du Bloc des rouges. Il regagne ensuite le Nord où il est rédacteur en chef du journal communiste L’Enchaîné. Là encore, Marcel Deschamps doit faire face à plusieurs poursuites intentées contre lui par des sociétés industrielles, des ecclésiastiques, Kléber Legay, le quotidien La Dépêche… Durant cet entre-deux-guerres, il se présente, sans succès, à plusieurs scrutins électoraux sous l’étiquette communiste: en 1931 aux cantonales dans le canton de Lille Nord-Est, en 1936 aux législatives dans la 1 re circonscription de Lille. Après la signature du pacte germano-soviétique, L’Enchaîné est interdit, Marcel Deschamps se retrouve sans travail. Il meurt à Lille le 10 mai 1940. Il était l’auteur d’un ouvrage paru en 1920, L’abandon de Lille. Il critiquait l’attitude, en 1914, du général Percin, qui, chargé de défendre la ville, l’aurait abandonnée.
Source(s) :AD Oise, 3 E 204/8; Arch. Paris, 18 M 41; AD Nord, 3 E 18350, M 149/142; Le Travailleur, de 1912, à, août 1914; L’Echo du Nord, 4 juin et 28 juillet 1913, 16 septembre 1931, 2 février 1936, 16 février 1939, 27 mai 1939; La Vague, 28 février 1925; Martine Pottrain, Le Nord au cœur. Historique de la fédération du Nord du Parti socialiste 1880-1993, Nord Demain, 1993.
-
DESMARCHELIER Lodois
«Actif, débrouillard, gai compagnon, répandu dans tous les milieux, jamais rebuté par la difficulté, toujours ingénieux pour la surmonter». Lodois Desmarchelier était, selon Jacques Demey, directeur du Journal de Roubaix , le type même du reporter. Né le 18 mars 1854 à Roubaix, Desmarchelier fut d’abord tisserand avant de devenir journaliste. Déjà, il rendait de menus services au Journal de Roubaix et, passionné de colombophilie, il y tenait une chronique, quand Alfred Reboux le repéra et en fit un reporter.
Trop âgé pour être mobilisé lors de la Première Guerre, il se proposa pour remplacer sur la liste des 120 otages déportés en Allemagne en juillet 1915, Lecomte-Screpel, président de la Caisse d’épargne. Sa conduite lui valut la médaille des victimes de l’invasion. Tout comme sa disponibilité à l’égard de ses concitoyens fut récompensée par la médaille de l’encouragement au dévouement.
Colombophile averti, il était président de plusieurs associations et organisa divers concours et expositions et à ce titre fut fait chevalier du Mérite agricole. Doyen des journalistes du Nord, lors de sa mort en mars 1939, Lodois Desmarchelier était également titulaire de la médaille de vermeil du Travail.
Source(s) :Journal de Roubaix, 3 mars 1939; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, 7 mars 1939.
-
DESMEDT Albert
Albert Desmedt commence à travailler dès l’âge de 13 ans aux papeteries Dalle et Lecomte,comme manœuvre, puis comme employé chimiste. En 1940, il entre à la mairie de Bousbecque où il est chargé du ravitaillement. Ce poste lui permet d’aider les réfractaires au travail obligatoire et les résistants.
Engagé dans la lutte contre l’occupant, il est arrêté, en septembre 1944, au cours d’une action menée avec un petit groupe de résistants, par une troupe de SS qui les prennent en otage pour passer la frontière. Arrivés à Halluin, les Allemands font feu. Grièvement blessé au poumon et à l’estomac, Albert Desmedt est laissé pour mort. Les médecins de l’hôpital de Tourcoing parviennent pourtant à le sauver. Son action dans la Résistance lui vaudra la Croix de guerre et la Légion d’honneur.
En 1945, Albert Desmedt découvre un autre métier. Cette année-là, il entre comme journaliste à Nord-Eclair . Le 1 er janvier 1959, il passe à La Voix du Nord qu’il ne quitte qu’à l’âge de la retraite, en décembre 1981.
Personnalité incontournable d’Halluin, à l’écoute de toutes les préoccupations des habitants, deux ans plus tard, Albert Desmedt entame une nouvelle vie. Lors des élections municipales de 1983, à la surprise générale, il bat le maire sortant. Le 17 mars 1985, candidat «d’opposition sans étiquette» il était élu conseiller général du canton de Tourcoing Nord, contre le candidat du Parti socialiste. Atteint par la maladie, Albert Desmedtmeurt en cours de mandat son le 25 juillet 1987.
Source(s) :La Voix du Nord, 28 juillet 1987.
-
DESMONS Gustave
Gustave Desmons ne se consacre au journalisme qu’après une carrière de médecin qui le mena en Algérie, au Tonkin, en Tunisie, mais aussi à Laon, Quimper, Dunkerque et Cambrai.
Né le 20 avril 1849 à Bailleul, Gustave Desmons fit ses études au collège de sa ville natale et au lycée de Lille avant d’être admis à l’école de médecine de Strasbourg et d’achever ses études à Paris où il obtint son doctorat en 1874. Il sert d’abord dans le sud algérien avant de rejoindre Lille où il est nommé aide-major en 1879.
Reçu maçon alors qu’il était en poste à Montpellier en 1869, il fonde dans la capitale des Flandres la loge La Fidélité qu’il préside de 1879 à 1881.
En 1882, il gagne la Tunisie, puis est affecté à Laon avant de rejoindre le Tonkin où son attitude durant une épidémie de choléra lui vaut d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. En poste successivement à Cambrai, Quimper, Dunkerque et enfin à l’hôpital de Mascara en Algérie, il prend sa retraite en 1900.
Gustave Desmons s’établit alors à Lille où il collabore au Réveil du Nord de Delesalle. Il en devient rédacteur en chef jusqu’en 1910 où une grave maladie l’oblige à renoncer. Il participe à la fondation de la fédération autonome du parti socialiste du Nord et du Pas-de-Calais avec Delesalle et Maurice Monier qui lui succède à la tête de la rédaction du Réveil du Nord.
Il meurt à Hazebrouck le 23 juillet 1929.
Source(s) :Jean-Marie Mayeur, Yves-Marie Hilaire, Dictionnaire du monde religieux, Tome 4, Lille-Flandres 1990.
-
DESMOULIEZ Ferdinand
Selon Douai républicain , Ferdinand Desmouliez a été le premier journaliste à avoir interviewé Georges Clemenceau après l’attentat commis contre lui par l’anarchiste Cottin le 19 février 1919. Rédacteur dans ce périodique douaisien avant la guerre, Ferdinand Desmouliez collabora également au Télégramme de Boulogne et à l’agence Havas à Paris. En septembre 1925, il entra au Grand Echo du Nord de la France où il assure le service de permanence de nuit. Il meurt le 21 février 1929, à l’âge de 59 ans, après une courte maladie.
Source(s) :AD Nord, 3 E 15459; Douai républicain, 24 février 1929; Le Grand Echo du Nord, 22 février 192.9
-
DESPREZ
Rédacteur au Progrès du Nord, syndic de l’Association professionnelle des journalistes du Nord en 1913
Source(s) :Grand Echo du Nord, 7 mai 1913.
-
DESRUISSEAUX
Rédacteur à La Croix du Nord, Desruisseaux intègre l’Association professionnelle des journalistes du Nord en juillet 1920
Source(s) :Le Cri du Nord, 8 juillet 1920.
-
DESSAINT Joseph Rémy
Fils d’Edmond Amant Ferdinand Dessaint, greffier de la justice de paix, et d’Aricie Marie Asselin, Joseph Dessaint est né le 14 mars 1868 à Doullens dans la Somme. En décembre 1888, il crée un hebdomadaire Le Petit Doullennais qu’il laisse à son frère Charles (1874-1941). Il devient alors rédacteur en chef du quotidien républicain l’Avenir de l’Arras jusqu’en 1905. Durant cette période, il milite au sein de l’Alliance républicaine démocratique dont il est l’un des délégués, des conférenciers et des rédacteurs de son bulletin hebdomadaire. En 1905, il rompt avec l’Alliance à qui il reproche, selon l’expression de Rosemonde Sanson, «son suivisme çà l’égard de Combes». Joseph Dessaint entre à l’hebdomadaire amiénois Le Progrès agricole. Membre du comité central de la Ligue pour la représentation proportionnaliste, il organise plusieurs congrès dans le Nord-Pas-de-Calais et la Somme. Mobilisé pendant la Première Guerre, il sert comme adjoint d’intendance. Ayant repris sa place au Progrès agricole, il en devient l’un des principaux éditorialistes. Dans ses écrits, il défend l’agriculture, dénonce le pacifisme, le syndicalisme et le socialisme qui font «triompher le droit à la paresse». Ronald Hubscher le décrit comme un «polémiste vigoureux [qui] pourfend les théories collectivistes et professe une germanophilie frisant l’hystérie». En 1925, il est condamné, ainsi que trois de ses confrères du Progrès agricole à 1000 F d’amende pour ses articles contre l’emprunt-or lancé par Joseph Caillaux. Lors de la création de la MCP (Masse de combat des paysans) par Le Progrès agricole , Dessaint organise des conférences pour rallier les paysans de Picardie, du Nord, de la Bretagne… Parallèlement, il devient secrétaire général de la rédaction de la Presse régionale, groupement de journaux catholiques. Durant l’Occupation, il se montre «le défenseur sourcilleux de la droite traditionnelle, notamment dans le domaine de la corporation paysanne». En 1942, au moment où les Allemands exigent des quotidiens du Nord-Pas-de-Calais un engagement en faveur de la collaboration, il est choisi comme éditorialiste par le conseil d’administration du Courrier du Pas-de-Calais. Sans jamais venir à Arras, il livre quelque deux cents éditoriaux où il s’en prend aux alliés et à la Résistance, prône la collaboration. Joseph Dessaint meurt trois mois après la Libération du Nord-Pas-de-Calais, le 5 janvier 1945, et ne sera donc pas poursuivi. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment de La Représentation proportionnelle (1910), Les Conservateurs républicains et leur mission, d’après Auguste Comte (1914), Les enseignements de la guerre (1916). Il était membre de plusieurs associations dont les Rosati de Picardie.
Source(s) :AD Somme, 5 MI D 660; Arch. de Paris, 17 D 275; Ronald Hubscher, «Le Progrès agricole; l’activisme au service de la Franceprofonde (1887-1970), Revue du Nord», 1982, n° 252, p. 93-143; Rosemonde Sanson, «L’Alliance républicaine démocratique dans le Nord et le Pas-de-Calais du tournant du siècle à 1940», Revue du Nord, 2007/2, n° 370, p. 377-398; Jean-Paul Visse, «La presse du Nord-Pas-de-Calais pendant l’Occupation. Le cas du Courrier du Pas-de-Calais», L’Abeille, septembre 2013, n° 24.
-
DEVAUX Arthur Charles, dit Le Diable boiteux
Arthur Devaux s’engage au sixième lancier en 1860. Cassé de son grade, il déserte en 1866. Il est condamné pour escroquerie en 1870. Il n’en rentre pas moins au ministère de l’Intérieur à la fin de l’année 1870. Il est chef de bureau sous la Commune. Il abandonne son poste huit jours avant l’entrée des Versaillais. Se constituant prisonnier, il est condamné à six mois prison avec sursis. En 1874, la police le décrit comme un «bonapartiste de bonne réputation, de bonne conduite et d’une moralité sans reproche».
En 1877, il est reporter et correspondant à Moscou pour Le Gaulois et L’Evénement . En 1881, il entre au Gil Blas où il publie des articles sur le sport, le cheval et les cavaliers, qu’il signe «Le Diable boiteux», empruntant ce nom à un roman de Lesage (1707). En 1895, il passe au Grand Journal . En 1900, il est propriétaire et rédacteur en chef de L’Illustré parisien . Il est alors devenu royaliste. Cependant, selon un rapport de police, il est dans la gêne, et écrit des articles diffamatoires contre les cercles hippiques, à des fins de scandale. Il meurt en décembre 1915, selon Mme Annie Stora-Lamarre. Arthur Devaux, «cerveau malade», selon cette dernière, a été surveillé par la police comme «barbouilleur» de la presse grivoise.
Il était chevalier du mérite agricole.
Source(s) :L’enfer de la IIIeRépublique : Censeurs et pornographes (1881-1914), Paris, Auzas-Imago, 1990, p. 181-182.
-
DEVOS Noël
De L’Indépendant du Pas-de-Calais, un bihebdomadaire à l’avenir incertain dans les années 1950, Noël Devos, journaliste puis président de la société éditrice, a fait, en quelque 50 ans, l’une des plus belles réussites de la presse hebdomadaire régionale.
Noël Devos commence sa carrière de journaliste au quotidien lillois La Croix du Nord, tout en collaborant au Figaro agricole. En décembre 1958, il entre à L’Indépendant du Pas-de-Calais, journal édité à Saint-Omer depuis 1849 et dirigé par l’imprimeur Vincent Frère. Il exerce alors les fonctions de rédacteur en chef et… d’unique journaliste. Ce n’est qu’en 1979 qu’il est secondé par un autre rédacteur Robert Bernard. Entretemps, le journal a adopté la périodicité hebdomadaire, abandonné le grand format, a changé sa ligne éditoriale, s’orientant vers l’information locale. Des changements, L’indépendant en connaîtra d’autres : emménagement dans de nouveaux locaux, renouvellement à différentes reprises de l’imprimerie… De 1 000 exemplaires en 1958, le tirage atteint, vingt ans plus tard, 12 000 exemplaires et il culmine à 20 000 exemplaires en 2013. Sous sa présidence, en 1995, La Voix du Nord devient actionnaire minoritaire. Deux ans plus tard, Devos entre au conseil de surveillance du quotidien lillois.
En 1987, il avait créé la filiale Maîtrise Médias, chargée notamment de la diffusion de NRJ sur Saint-Omer, Boulogne et Saint-Pol-sur-Ternoise, devenue une agence de communication multimédia.
L’heure de la retraite venue, il demeure président du conseil de surveillance de L’Indépendant. Homme de culture, passionné d’histoire, il continue à publier des chroniques dans son journal. Il meurt à l’âge de 82 ans.
Source(s) :Benoît Cailliez, «Noël Devos s’est éteint, L’Indépendant du Pas-de-Calais, 8 février 2013.
-
DEWOLF André
Fils d’un invalide de guerre, André Julien Dewolf entre au quotidien La Croix du Nord comme rédacteur alors qu’il est à peine majeur. Membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, il est élu au milieu années 1930 secrétaire général de la Mutuelle des journalistes du Nord. Avant la déclaration de guerre, il abandonne le journaliste tout en restant dans le milieu de la presse. Il est successivement sous-directeur puis directeur de la Caisse de compensation des industries polygraphiques. Après la Libération, il est directeur du Centre d’action sociale de la presse et des imprimeries du Nord et du Pas-de-Calais. Il est également secrétaire administratif des syndicats patronaux des maîtres imprimeurs. Dans les années 1950, il est nommé administrateur de la Caisse des allocations familiales de Lille et de l’Office des HLM de Lille. Marié le 21 juin 1930 à Armentières avec Mlle René Delattre, il est père de huit enfants, il meurt à Lille le 11 juin 1956.
Source(s) :AD Nord M 149/142, 3 E 14442; La Croix du Nord, 20 juin 1930, 29 juin 1935, 2 décembre 1950; Le Grand Echo du Nord, 2 septembre 1943.
-
DHOLLANDE Jean-Claude
Entré comme journaliste à La Voix du Nord le 1 er février 1972, Jean-Claude Dhollande fit toute sa carrière au bureau de Saint-Pol-sur-Ternoise . Il disparut tragiquement le 24 octobre 1993, par une voiture, au cours d’un reportage. Il faisait partie du conseil d’administration de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais.
-
DINAUX Arthur
Né à Valenciennes en 1795, Arthur Dinaux y fonde en 1821 les Petites Affiches de Valenciennes qui prend plus tard le titre de L’Echo de la Frontière . En 1829, il lance les Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi de la Belgique.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont une anthologie de la poésie lyrique au Moyen Âge qui devait couvrir tout le nord de la France jusqu’à la Somme. Si quatre tomes sont sortis, la mort ne lui permit pas d’aller au bout de son projet.
Arthur Dinaux était membre de plusieurs sociétés savantes: Société des antiquaires de France, Académie d’Arras, Société d’émulation de Cambrai, Société d’agriculture, sciences et art de Douai,…
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord, 1893.
-
DINOUART Joseph Antoine Toussaint
Ordonné prêtre du diocèse d’Amiens vers 1940, Dinouart montra dans sa jeunesse beaucoup de dispositions pour la poésie latine, mais il la négligea plus tard, lorsqu’il se fut adonné à la prédication, dans laquelle il obtint des succès.
Un opuscule en faveur des femmes l’ayant brouillé avec son évêque, l’abbé Dinouart vint à Paris et fut attaché à la paroisse Saint-Eustache. Il la quitta bientôt pour faire l’éducation particulière d’un fils de M. de Marville, lieutenant de police. Cet emploi lui valut une pension viagère de 600 francs et un canonicat à l’église collégiale de Saint-Benoît. L’aisance où il se trouvait lui permit alors de se livrer à son goût pour la littérature.
Dès 1755, Dinouart avait coopéré au Journal chrétien de l’abbé Joannet, mais ayant renouvelé dans cette feuille l’accusation de déisme, et même d’athéisme contre Sainte-Foix, celui-ci intenta aux deux associés un procès criminel au Chatelet, et ils furent condamnés à se rétracter.
En 1760, il entreprit seul le Journal ecclésiastique, qu’il continua jusqu’à sa mort. La collection de ce journal forme plus de 100 volumes. On y trouve des extraits de sermons et d’ouvrages de morale ou de piété, des recherches sur le droit ecclésiastique, les conciles, etc. Dinouart s’était fait recevoir membre de l’Académie d’Arcadie à Rome.
-
DODANTHUN Alfred
Fils d’Alfred Charles Joseph Dodanthun, professeur d’histoire à l’Institut Notre-Dame des Dunes de Dunkerque et bibliothécaire communal, et de Thérèse Isabelle Louise Vanhoutte, Alfred Armand Joseph Dodanthun naît le 22 octobre 1875 à Dunkerque. A partir de 1899, il devient propriétaire directeur de L’Indicateur des Flandres, hebdomadaire édité à Hazebrouck. Parallèlement secrétaire général de l’Union faulconnier dont son père est l’un des fondateurs, il publie des études historiques sur la région dans différentes revues, mais aussi dans le quotidien dunkerquois Le Nord Maritime sous le nom de Jules d’Anville. Membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord en 1902, il est reçu docteur en droit en novembre 1902, en soutenant une thèse sur les Affiches électorales. Quatre ans plus tard, il se marie avec Madeleine Louise Jenny Goldschmidt, également originaire de Dunkerque. Alfred Dodanthun abandonne la presse pour devenir directeur d’assurances à Lille. Il n’en continue pas moins de publier dans des revues savantes. C’est à ce titre qu’en 1926, il est nommé officier de l’Instruction publique. Il est également membre de plusieurs associations: Amis de Lille, Rosati de Flandre… Il meurt à Lille en mars 1948 à l’âge de 72 ans.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 027 R 083 et 3 E 18176; Le Réveil du Nord, 28 novembre 1911; Le Nord Maritime, 1er, mars 1926; La Croix du Nord, 9 mai 1948.
-
DOMBRAY Edouard Joseph dit DOMBRAY-SCHMITT
Fils de Charles Auguste Dombray, forgeron, et de Catherine Sontag, Edouard Joseph Dombray est né le 26 mars 1864 à Charleville.
Après son mariage avec Marie Léonie Schmitt dont il aura trois enfants, il ajoute à son patronyme le nom de Schmitt. Après la mort de son épouse en 1901 et son remariage avec Marguerite Bernard qui lui donne quatre enfants, il garde ce nom de Dombray-Schmitt.
Admirateur de Léon Harmel, il ambitionne dès 1893 d’organiser les ouvriers chrétiens des vallées de la Meuse et de la Semoy face aux socialistes. Il fonde l’année suivante l’Union démocratique des Ardennes qui rassemble des associations ouvrières et qu’il place «en dehors de tout parti politique». Cette union se dote d’un organe La Vérité sociale. Journal ouvrier qu’il dirige. Le 20 août 1893, Dombray-Schmitt se présente aux élections législatives à Charleville. Pour soutenir sa candidature, il sort un bihebdomadaire, La Défense sociale, organe des intérêts ouvriers républicains catholiques qui ne connaît que quatre numéros. Arrivé dans le Nord, à la suite de l’échec d’une grève des mineurs, il fonde en 1902 le Syndicat indépendant des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais qui aurait regroupé quelque 6000 membres. Il devient directeur et rédacteur en chef du Travailleur libre, périodique anticégétiste et antijaune, dont le titre a probablement été choisi pour faire pièce au journal de la section lilloise du parti ouvrier français Le Travailleur. Toujours domicilié à Nancy, mais en résidence à Douai, en 1903, il crée à Nancy un mensuel, L’Avenir social. Journal des œuvres sociales de la région qui ne connaît que six numéros. En mai 1906, il se présente aux élections législatives dans l’arrondissement de Douai. Soutenu par le journal L’Anti-bloc créé à cette occasion, il n’arrive qu’en troisième position à l’issue du premier tour et préfère se retirer. Il abandonne la direction du Travailleur libre. Rejoignant Nancy, il devient directeur du Nancy Illustré . Dombray-Schmitt est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Des Syndicats professionnels (1907), Le Val-du-Bois (1911), La Question du logement et les familles nombreuses à Nancy (1920), Les jardins ouvriers et les familles nombreuses (1921),…
Source(s) :AD Ardennes, 2 E 10581; AD Pas-de-Calais, M 960 et M 4915.
-
DORGERES Henri Auguste
Henri Auguste d’Halluin dit Dorgères est né le 6 février 1897 à Wasquehal où son père était boucher. Il poursuit ses études grâce à une bourse au lycée de Tourcoing. Très actif à l’encontre des occupants allemands, durant la Première Guerre mondiale, Henri d’Halluin est arrêté plusieurs reprises. Emprisonné à la forteresse de Bruges (4 février 1918), il s’en évade le 4 octobre et, à la faveur du désordre, il regagne les lignes alliées ce qui lui vaut la Croix de guerre (1914-1918). Après un baccalauréat ès-lettres, il suit pendant deux ans des études de droit.
Obligé de gagner sa vie, il abandonne ses études pour entreprendre une carrière de journaliste. En 1921 il se marie, à Lille, avec Cécile Cartigny, et entre comme rédacteur au Nouvelliste de l’Ouest à Rennes, un journal conservateur. En 1922, il s’installe définitivement en Ille-et-Vilaine, et y découvre les difficultés de la condition paysanne dont il devient un défenseur convaincu. A partir de 1925, Henri d’Halluin est directeur du Progrès agricole de l’Ouest dont il fait un important journal professionnel. C’est alors qu’il prend le pseudonyme de Dorgères pour signer ses articles. Homme de plume, il est aussi un homme d’action considéré comme un des militants d’extrême droite les plus connus de l’Ouest. Autour du Progrès agricole , il organise des mouvements d’action paysannecomme le «Comité de défense paysanne contre les assurances sociales» créé en 1929. Suivent les mouvements du Front paysan, de Défense paysanne, des Jeunesses paysannes puis des Chemises vertes. Il devient en 1935 secrétaire général de la Ligue des paysans de France et en 1936 délégué à la propagande du Syndicat agricole de défense paysanne. Mobilisé en 1939, prisonnier en 40, évadé, membre influent de la Corporation paysanne où il devient conseiller national, il fut décoré de la francisque par le maréchal Pétain. Il lance en mars 1941 la collection des Dossiers de documentation de la presse syndicale paysanne , publication qui se poursuit avec régularité jusqu’en août 1944. Arrêté par les Alliés en août 1944 et emprisonné à Paris, il est condamné à dix ans d’indignité nationale. Amnistié pour services rendus à la Résistance, il est libéré le 26 avril 1946. En 1948, il lance son nouveau mouvement Défense paysanne, édite La Gazette agricole imprimé à Rennes puis à Reims dont il est le gérant et le seul rédacteur. Elle draine 25 000 abonnés et tire à 40000 exemplaires. Il engage sa lutte sur des créneaux négligés par la FNSEA et est fortement implanté dans l’Ouest. Dans le Nord-Pas-de-Calais où il a quelques bastions, il est financé par les betteraviers. Il passe à l’action politique et est élu député de l’Ille-et-Vilaine de 1956 à 1958 sur les listes poujadistes mais il a perdu de son influence. Inculpé de très nombreuses fois par la justice française, auteur de très nombreux articles et de plusieurs ouvrages dont Au temps des fourches , une autobiographie et Haut les fourches. Il meurt le 22 janvier 1985 à Yerres dans l’Essonne.
Source(s) :Site de l’Assemblée nationale; AD Pas-de-Calais, 1W 19843.
-
DORGEVILLE Gérard
Licencié en philosophie après des études dans le collège de sa ville natale d’Aire-sur-la-Lys et à l’université de Paris, Gérard Auguste Arthur Paul Adolphe Dorgeville entame sa carrière de journaliste en 1927 au Réveil du Nord. Il quitte ce quotidien en 1932 pour Le Grand Echo du Nord de la France où il travaille comme secrétaire de rédaction aux informations générales. Le 19 avril 1934, il se marie à Roubaix avec Yvonne Bayart.
En 1939, il est mobilisé au 8e génie. A partir du 10 mai 1940, il participe à la campagne de Belgique et de la Somme. Sa conduite lui vaut la Croix de guerre
Après la Libération, il entre à La Voix du Nord toujours comme secrétaire de rédaction. Il en devient rédacteur en chef après le départ de Léon Chadé en 1948. Remercié cinq ans plus tard, il prend la direction de la rédaction de l’hebdomadaire illustré Nord-France, édité par la SA Nord Eclair, qui est absorbé en 1956 par Jours de France. Gérard Dorgeville quitte alors le Nord pour Paris où il travaille jusqu’à sa retraite pour L’Hôtellerie. Journal de l’industrie hôtelière et du tourisme.
Il est également l’auteur d’un roman Rue au Péterinck, paru en 1945. Il meurt à Paris en 1972.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 3 E 014/151; AD Nord, 9 W 261, pièce 67; Revue du Nord, 1972, vol. 54, n° 213, p. 265.
-
DORION Xavier
(Ally-le-Haut-Clocher, 2 avril 1835 – Roubaix, 19 avril 1904). Libraire, imprimeur, enseignant, journaliste Arrivé à Roubaix au début de l’année 1860, Xavier Dorion y manifeste une activité débordante. Libraire et imprimeur, sans imprimerie, il fut simultanément ou à la suite professeur d’anglais et d’espagnol aux cours municipaux, il enseignait aussi l’italien et le portugais. À compter de 1902, il se fait l’apôtre de l’espéranto, qu’un groupe fort actif essayait d’implanter à Roubaix. Il était également interprète juré auprès du tribunal de Commerce de Lille, et examinateur de l’École supérieure de commerce de Lille. Dorion était également un fervent propagateur de la sténographie (il fut longtemps le sténographe de la mairie de Roubaix), et il avait introduit à Roubaix la méthode Duployer, qui aura à Roubaix son journal en 1910. Mutualiste convaincu, il fut durant douze ans vice-président et président du Cercle des voyageurs et employés de bureau du commerce et de l’industrie. Il a aussi participé aux activités de la Société d’enseignement mutuel des travailleurs de Roubaix. Journaliste, il a été membre du Conseil de lecture et rédacteur des comptes-rendus commerciaux au Libéral du Nord ; il a collaboré à L’Ami du Progrès , jusqu’à ce que le rédacteur en chef le flanqu [e] à la porte, et a travaillé pour Le Progrès du Nord . Il a été aussi correspondant du Petit Nord . Il est par ailleurs l’auteur d’un pamphlet, intitulé Les Pantins radicaux / Tout pour nous, le reste aux autres , édité par lui-même, tiré à 4 000 exemplaires et vendu sur la voie publique le 11 mai 1883. Ce libelle, sous le couvert de pseudonymes, étrille Moreau et ses amis. Mais il fut surtout le rédacteur et gérant de Roubaix-républicain , hebdomadaire que l’équipe municipale en place lance pour répondre aux attaques de Moreau. L’impression de ce périodique est confiée au même Dorion, à qui la mairie accorde la plupart de ses travaux, alors même que Dorion surfacture ses prestations qu’il fait réaliser en Belgique, n’ayant pas d’imprimerie. Contre cet immonde Poussah , Roubaix-radical (18 novembre 1883), il n’a pas de mots assez durs et blessants. L’ayant un jour qualifié de pot à tabac, ce journal va créer une rubrique spéciale, les Tabatiana pour le moquer dans chaque numéro.
Source(s) :Entre autres : «Mort de M. Xavier Dorion, professeur de langues vivantes», Le Journal de Roubaix, 19 avril 1904.
-
DOURIEZ André
Fils de Gaston Douriez et de Rosine Drieux, André Douriez se marie avec Renée Schumann en 1924. Il commence sa carrière de journaliste comme secrétaire de rédaction à La Dépêche . Il en devient secrétaire général . Ce quotidien ne paraissant plus avec l’arrivée des Allemands à Lille en juin 1940, Douriez entre au Journal de Roubaix en février 1941, où il assure notamment la rubrique littéraire.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
DRAMAS Paul
Né à Lyon, fils d’un commerçant bénéficiant, selon la police, «d’une certaine fortune», Paul Dramas a une «bonne instruction», ayant notamment suivi des études en faculté des Lettres de Lyon durant lesquelles il adhère au socialisme.
Il commence sa carrière de journaliste à l’Ere nouvelle, puis collabore à plusieurs journaux socialistes: Le Socialiste, Le Peuple de Lyon… Il arrive à Lille en 1895 où il devient secrétaire de rédaction au Réveil du Nord, remplaçant Elysée Polvent. Selon la police, il mène «une existence retirée», ayant «l’ambition de devenir quelque chose». Il quitte le quotidien lillois dès 1897. Par la suite, il travaille dans diverses publications Le Mouvement socialiste, La Revue socialiste… Il quitte le POF au moment de l’affaire Dreyfus. Pendant la Première Guerre, il dirige L’Eclaireur de l’Est édité à Reims. Après la guerre, il adhère au Parti communiste.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/23.
-
DRANSART Henri Narcisse
Le docteur Henri Narcisse Dransart est déjà un spécialiste de renom lorsqu’il fonde en 1873 de l’Institut d’ophtalmique de Somain et des mines d’Anzin. Après des études à l’école de médecine de Lille, il est externe, puis interne des hôpitaux de Paris, et enfin chef de clinique.
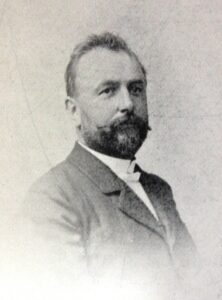 Il s’est notamment spécialisé dans les maladies et les accidents des yeux touchant à l’industrialisation de la région du Nord: les mines, la métallurgie, le chemin de fer et il a participé à de nombreux colloques internationaux. En 1879, il a inventé une opération de la cataracte qui porte son nom.
Il s’est notamment spécialisé dans les maladies et les accidents des yeux touchant à l’industrialisation de la région du Nord: les mines, la métallurgie, le chemin de fer et il a participé à de nombreux colloques internationaux. En 1879, il a inventé une opération de la cataracte qui porte son nom.En mai 1899, il sort avec son beau-frère, le Dr Paul Bettremieux, son ancien condisciple et associé dans plusieurs cliniques, le Journal d’oculistique du Nord de la France, un trimestriel qui paraît à 1 000 exemplaires jusqu’en novembre 1892.
Parallèlement, le Dr Dransart entame une carrière politique. En 1874, il est élu conseiller municipal et le reste pendant 34 ans. En 1898, il est élu conseiller général du canton de Marchiennes et le reste jusqu’en 1910. Lors de la Première Guerre, il est dénoncé pour avoir caché des soldats français du 24 août au 10 septembre 1914 et il est condamné par les Allemands à neuf mois de prison. Sa conduite pendant la guerre lui vaut d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur, en mai 1921, au titre du ministère de la Guerre.
Le Dr Dransart est l’auteur de nombreuses publications scientifiques. Il est membre de plusieurs sociétés savantes. S’il laisse la direction de l’Institut ophtalmique en 1925, il assure son service jusqu’à sa mort le 16 juillet 1930.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, collection Kiosque 59-62, 2017.
-
DREYFUS Georges Gaston
« Je suis grand, 1,80 m. J’ai des redingotes trop longues et des cheveux trop courts. J’ai toujours manqué de toupet. Je fume comme une cheminée, joue de la mandoline et fais des revues. » Ainsi se présente Jeandouzy, né Gaston Dreyfus, à La Vie flamande illustrée au moment de quitter le journalisme en 1903. S’il ajoute : « J’ai tellement cette profession dans le sang que même en plantant mes choux, j’en arracherai les feuilles pour les faire imprimer. J’ai un journal dans le ventre », sa carrière journalistique ne fut pourtant pas très longue. Après de brillantes études au lycée de Saint-Omer, Gaston Dreyfus s’inscrit à la faculté de droit de Lille. A une carrière juridique, il préfère le journalisme et entre au Mémorial artésien qu’il quitte pour le quotidien lillois Le Grand Echo du Nord. Il y est reporter jusqu’en avril 1895 où il aurait été, selon la police, remercié « pour indolence » alors que la direction semble se féliciter de son travail, Gustave Dubar n’est-il pas le témoin de son mariage ?
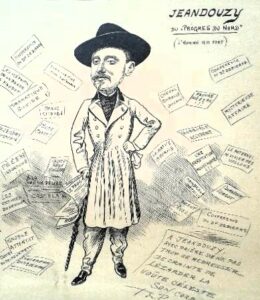 C’est à cette époque, à la suite de la condamnation et de la dégradation du capitaine Dreyfus pour espionnage au profit de l’Allemagne, que Gaston Dreyfus, qui appartient « à une famille catholique », demande au ministre de la Justice l’autorisation de changer son patronyme contre celui de Deraimont. Il faut croire qu’il n’eut pas gain de cause, mais quelque temps plus tard, il sera surtout connu sous celui de Jeandouzy. Ce nom lui a probablement été inspiré par le nom de jeune fille de sa femme, Jeanne Landouzy, qu’il a épousée en mai 1894 à Lille. Dreyfus-Jeandouzy sollicite la direction du Courrier populaire de Lille, mais ne réussit, toujours selon les termes de la police, à y entrer qu’« à titre d’amateur […] où il ne fait pas grand’chose ». La police qualifie, alors, joliment ce républicain de conviction de « journaliste impartibus ». En octobre 1898, il est embauché au Progrès du Nord où il devient chef des informations locales et même administrateur. A la surprise de tous ses confrères, il annonce, en juin 1903, abandonner le métier « un peu surmené par dix ans de profession […] où il avait marqué sa place de façon originale », ironise le Grand Echo. En 1904, on le retrouve pourtant comme rédacteur en chef de La Vie lilloise, journal mondain et théâtral lancé en 1901 comme supplément du Nord illustré. S’il ne s’éloigne pas du milieu de la presse, donnant notamment plusieurs « fantaisies » (poèmes, contes ou portraits) dans le quotidien sportif L’Auto, le journalisme n’est plus son activité principale : en 1909, il entre au secrétariat de la mairie de Lille dont il devient secrétaire adjoint trois ans plus tard. Il continue pourtant d’appartenir à l’Association professionnelle des journalistes du Nord. Lors de l’assemblée générale d’avril 1914, il propose même la création d’une Maison des journalistes, mais la guerre a raison du projet. Jeandouzy est également auteur de revues qui se taillent un beau succès à Lille : Ferme ta Deûle, Lille décorée, Citoyens, on vous trompe ! … de chansons dont L’Tarte à prones. En 1913, il est nommé officier d’Académie.Source(s) :
C’est à cette époque, à la suite de la condamnation et de la dégradation du capitaine Dreyfus pour espionnage au profit de l’Allemagne, que Gaston Dreyfus, qui appartient « à une famille catholique », demande au ministre de la Justice l’autorisation de changer son patronyme contre celui de Deraimont. Il faut croire qu’il n’eut pas gain de cause, mais quelque temps plus tard, il sera surtout connu sous celui de Jeandouzy. Ce nom lui a probablement été inspiré par le nom de jeune fille de sa femme, Jeanne Landouzy, qu’il a épousée en mai 1894 à Lille. Dreyfus-Jeandouzy sollicite la direction du Courrier populaire de Lille, mais ne réussit, toujours selon les termes de la police, à y entrer qu’« à titre d’amateur […] où il ne fait pas grand’chose ». La police qualifie, alors, joliment ce républicain de conviction de « journaliste impartibus ». En octobre 1898, il est embauché au Progrès du Nord où il devient chef des informations locales et même administrateur. A la surprise de tous ses confrères, il annonce, en juin 1903, abandonner le métier « un peu surmené par dix ans de profession […] où il avait marqué sa place de façon originale », ironise le Grand Echo. En 1904, on le retrouve pourtant comme rédacteur en chef de La Vie lilloise, journal mondain et théâtral lancé en 1901 comme supplément du Nord illustré. S’il ne s’éloigne pas du milieu de la presse, donnant notamment plusieurs « fantaisies » (poèmes, contes ou portraits) dans le quotidien sportif L’Auto, le journalisme n’est plus son activité principale : en 1909, il entre au secrétariat de la mairie de Lille dont il devient secrétaire adjoint trois ans plus tard. Il continue pourtant d’appartenir à l’Association professionnelle des journalistes du Nord. Lors de l’assemblée générale d’avril 1914, il propose même la création d’une Maison des journalistes, mais la guerre a raison du projet. Jeandouzy est également auteur de revues qui se taillent un beau succès à Lille : Ferme ta Deûle, Lille décorée, Citoyens, on vous trompe ! … de chansons dont L’Tarte à prones. En 1913, il est nommé officier d’Académie.Source(s) :AD Nord, 1T 222, 22 décembre 1896, La Vie flamande illustrée, juin 1903, différents numéros du Grand Echo.
-
DRILLON , Paul
Paul Drillon effectue ses études au collège de Boulogne, puis à la faculté de droit de Lille. Il prête serment devant la Cour d’appel de Douai le 30 mars 1893.
Gendre de Mme Reboux, directrice du Journal de Roubaix , il collabore au quotidien lillois Le Nouvelliste en 1929. Il est l’auteur de plusieurs articles pour des revues de droit et d’ouvrages dont La Jeunesse criminelle, Les Droits et devoirs d’un père de famille, Le rôle social de la charité,… Parallèlement, il est élu conseiller municipal de Lille et, en 1928, il est candidat malheureux aux législatives dans la 6 e circonscription de Lille.
Il avait été décoré de l’ordre de Léopold de Belgique.
S ource: AD Nord, M149/142.
-
DRUELLE Auguste
Ancien élève de l’Institution Saint-Jean à Douai, Auguste Marie Druelle poursuit des études à la faculté de droit où il soutient sa thèse De la communauté réduite aux acquêts en droit français en 1872, puis devient avocat. Acquis aux idées de la République, il s’oriente vers le journaliste et commence sa carrière au quotidien lillois Le Progrès du Nord, puis il rejoint Le Petit Nord , nouvellement fondé dans la préfecture du Nord par les frères Simon, En novembre 1880, il est nommé rédacteur en chef du journal douaisien fondé par Lucien Crépin, L’Ami du peuple . Il démissionne en janvier 1886 car, selon la police, «en épousant sa maîtresse, femme intrigante et puissante sur lui, […], il aurait perdu beaucoup de relations à Douai . ». Il prend la direction de L’Avenir du Pas-de-Calais qu’il quitte en 1892 pour faire son retour professionnel dans sa ville natale . Il entre alors au Douai républicain où il a souvent maille à partir avec Le Démocrate créé pour soutenir la liste radicale lors des municipales contre le maire Bertin. Ce journal le décrit ainsi en 1900: «c’est un homme mûr, fortement sel et poivre, onctueux au toucher comme la plupart des corps gras. Il voudrait être méchant, mais est plutôt ridicule. Ce monsieur pince-sans-rirese pose volontiers en républicain et en libre penseur; à l’instar de Méline, il flirte avec la réaction et ose considérer comme une grande victoire démocratique le succès de la liste Bertin. Capable de toutes les audaces, de toutes les calomnies, il accuse les radicaux et les socialistes qui ont rallié plus de deux mille voix de pactiser avec les libéraux.» En juillet 1901, il fonde L’Impartial de Douai , mais l’aventure tourne court et trois mois plus tard, il reprend place au Douai républicain. Auguste Druelle meurt à son domicile à Arras en mars 1904 à l’âge de 53 ans. Sources : AD Nord, 5 Mi 020 R 057, 1T 217/8, dossier L’Ami du Peuple , rapport confidentiel du 12 janvier 1886 ; AD Pas-de-Calais, 3 R 041/535.
-
DRUGBERT
Drugbert est rédacteur au Réveil du Nord pour la région d’Avesnes-Maubeuge en 1895.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/23.
-
DUBAR Gustave
D’origine modeste, Gustave Dubar fait ses études au lycée de Lille, puis, après son baccalauréat, au collège Sainte-Barbe à Paris. Après avoir échoué à l’entrée de l’Ecole normale supérieure, il renonce à l’enseignement.
Secrétaire du Comité linier à l’âge de 21 ans, il devient de fait le rédacteur en chef du Journal circulaire du marché linier de Lille créé en 1864. Il noue ainsi de solides relations avec le monde industriel régional et élargit son horizon à toutes les questions économiques. En 1871, il entre à L’Echo du Nord, dirigé par le fils du fondateur Alexandre Leleux, comme rédacteur économique. Très vite selon sa biographie officielle, il est appelé à s’occuper de comptabilité et d’administration aux côtés du directeur et du rédacteur en chef Hippolyte Verly.
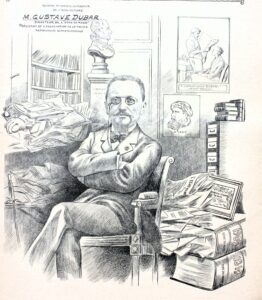
Gustave Dubar fera à plusieurs reprises la une de La Vie flamande illustrée. Il pose ici sous le buste de Vincent Leleux, fondateur de L’Echo du Nord, et à côté du portrait de Verly. A la mort d’Alexandre Leleux en 1873, la propriété du journal revient à ses neveux et nièces, Gustave Dubar en devient codirecteur avec Hippolyte Verly qui se retire en 1891, le laissant seul aux commandes. En quelques années, il fait d’un quotidien respecté dont le tirage est de 35 000 exemplaires en 1890 une belle affaire commerciale diffusant à la veille de la Première Guerre à 130 000 exemplaires. Sous sa direction, au fur et à mesure de sa modernisation technique, le journal qui comprend deux éditions, Le Grand Echo du Nord de la France, vendu le matin, et L’Echo du Nord, diffusé le soir, prend ses aises sur la Grand’Place de Lille rachetant plusieurs immeubles avoisinants, mais aussi rue Saint-Nicolas. En 1911, L’Echo du Nord est doté d’un vaste hôtel construit sur les plans de l’architecte Maillard et décoré par Boutry. L’équipement technique suit. En 1914, le journal est composé sur huit linotypes et il est imprimé par une triple rotative Hoé, une Marinoni et une Derriey. Le personnel se monte à plus de 200 personnes. Cette réussite vaut à Gustave Dubar la reconnaissance de ses pairs. Trésorier dès 1890, puis vice-président de l’Association de la presse républicaine départementale, il est élu le 27 mai 1900 président, fonctions qu’il exerce pendant quatorze ans, jusqu’au 28 juin 1914. Ses pairs lui confèrent alors la présidence d’honneur. Il est également vice-président du Syndicat général des associations de presse. Dans la région, il préside la chambre syndicale des imprimeurs du Nord depuis 1902, il est nommé président d’honneur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord. Le succès du journal tient peut-être à la politique prudente de son directeur qui affirme : « On ne peut être plus républicain que moi ou l’on touche au socialisme, on ne peut l’être moins sans paraître conservateur. » Sous sa direction, L’Echo du Nord, se situant dans la ligne modérée de Jules Méline et d’Alexandre Ribot, se fait le défenseur des intérêts économiques de la région et prône le protectionnisme. Travailleur opiniâtre, Gustave Dubar joue un rôle prépondérant dans bien d’autres domaines. Cofondateur de la Société des agriculteurs du Nord, il en est président à partir de 1880. Commissaire aux comptes, puis administrateur du Crédit du Nord, il préside le conseil d’administration de la banque nordiste de 1898 à 1921. Enfin, pendant trente-huit ans, il est membre de la Société des sciences de Lille. Après la guerre, il participe activement à la reconstruction de la région. C’est à lui que l’on doit la devise qui trône encore sur la façade de La Voix du Nord : « Défendre les intérêts du travail dans la région du Nord ». Alors qu’il tient une place importante dans la région, officiellement, il ne briguera jamais de mandat politique. En 1892, la fortune de Gustave Dubar évaluée à deux millions de francs, ses multiples fonctions lui valent d’être qualifiés avant la Première Guerre par ses confrères d’« hommes d’affaires », de « financier », de « charbonnier », d’« entrepreneur de pub », et, face au manque d’engagement idéologique de son journal, de « loque politique ».
Gustave Dubar a la réputation d’un homme fort autoritaire, voire distant : on ne lui parle qu’en audience. Il pratique pourtant un paternalisme apprécié par le personnel de son journal : nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1894, il emmène ses employés à Malo-les-Bains, lors de son mariage en 1896, il renouvelle son geste, en 1900 lors du passage du journal à 100 000 exemplaires, le personnel est reçu chez lui à « l’Assessoye » à Lambersart, dans la banlieue lilloise,…
Toutes ses activités furent récompensées par la croix de commandeur de la Légion d’honneur, remise à l’Elysée par le président Raymond Poincaré. Lors de sa mort, toute la classe politique et tout le monde de la presse lui rend hommage.
Source(s) :ADN, 1T; La Vie et l’œuvre de Gustave Dubar (1848-1921), Imprimerie Dubar, Ferré & cie, Lille, n.d., 273 p.; Jean-Paul Visse, La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de L’Echo du Nord, Presse universitaire du Septentrion, Lille, 2004, 279 p.; «L’économie, la presse et la région. La bonne fortune de Gustave Dubar, directeur de L’Echo du Nord», Bulletin de la Commission historique du Nord, tome 58, 2018-2019, p. 117-147.
-
DUBAR Gustave Eugène Louis
Fils de Jean Dubar, directeur du Grand Echo du Nord de la France, et d’Elisabeth Motte, fille d’Eugène Motte, ancien maire de Roubaix et député du Nord, Gustave Dubar est né à Lille, en 1927. Directeur de la SILIC, il lance, en octobre 1970, Nord Magazine dont la rédaction est dirigée par Patrick Calais. Ce mensuel cesse sa publication après deux années d’existence.
Gustave Dubar quitte la région du Nord en 1981 et s’installe à Cogolin dans le Var comme exploitant agricole. Il était marié à la journaliste Juliette Dubar
-
DUBAR Jean
Fils de Gustave Dubar, Jean Dubar est né le 8 septembre 1897 à Lille. Elève au lycée Faidherbe, il est bachelier, puis poursuit des études de lettres tout en suivant les cours d’une école de commerce. En 1916, il est mobilisé au 82 e RIA et, à sa demande, part au front jusqu’à l’armistice. Il fait partie de l’armée d’occupation comme brigadier interprète jusqu’à sa démobilisation en août 1919. Sa conduite est récompensée la croix du Combattant. Entré à L’Echo du Nord, il participe à la relance du journal qui, durant la guerre, avait été occupé par les Allemands qui y publièrent notamment la Liller Kriegszeitung . Nommé directeur en 1921, il s’attacha à la modernisation du quotidien lillois. De nouvelles rubriques sont créées, l’information locale développée, le quotidien se veut également un animateur de la vie régionale par l’organisation de manifestations économiques et sociales: exposition des petits inventeurs et artisans, concours du plus bel épi de blé, épreuves sportives, etc.
Parallèlement, il occupe plusieurs fonctions nationales, il est notamment membre du Syndicat des quotidiens régionaux, de la Commission exécutive de la Fédération nationale des journaux français, membre de la Commission paritaire des papiers de presse et d’édition. Il est par ailleurs administrateur du Crédit du Nord. Ses nombreuses activités lui valent d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1933.
A la même époque, Jean Dubar dote notamment son quotidien d’un splendide hôtel de style néoflamand. Homme aimant l’art, il a fait appel à l’architecte Ernest Willocquieaux, secondé par l’architecte Laprade et le dessinateur Bazin. La façade du bâtiment est décorée des blasons des principales villes du Nord, du Pas-de-Calais, de l’Aisne et de la Somme et est surmontée de la statue des Trois Grâces, symbolisant les trois anciennes provinces du Nord-Pas-de-Calais, signée Raymond Couvègnes. Des bureaux ont été décorés par Eugène Prinz tandis que la salle de réception du sixième étage est l’œuvre de Laprade. L’imprimerie s’installe dans des bâtiments de l’autre côté de la rue Saint-Nicolas. Véritable profession de foi en l’avenir de la région, ces locaux, à peine terminés, sont inaugurés en juillet 1936.
Après la déclaration de guerre, Le Grand Echo du Nord et son édition du soir L’Echo du Nord paraissent jusqu’au 17 mai 1940 où ils sont remplacés par un bulletin d’informations régionales commun au cinq quotidiens qui paraissaient à Lille. Rentré à Lille après l’armistice, Jean Dubar obtient l’autorisation de faire reparaître son journal, sous contrôle de l’occupant, à partir du 1 er août 1940. Mécontents de la ligne éditoriale du quotidien qui ne s’engage pas franchement dans la collaboration, les Allemands imposent, en juillet 1942, à Jean Dubar un directeur politique, Charles Tardieu. Désormais, celui-ci prône la collaboration, s’en prend aux résistants, aux alliés et à l’URSS. En août 1944, Jean Dubar qui n’avait plus qu’un rôle administratif est définitivement écarté du journal par les Allemands. Durant cette période, il a bien tenté de faire paraître un journal clandestin, Nord-Libre, mais trop tardivement. A la veille de l’arrivée des Anglais à Lille, il fait paraître une édition spéciale, Le Véritable Grand Echo, dans laquelle il tente de justifier l’attitude de son journal pendant l’Occupation. Le second numéro est interdit par le nouveau commissaire de la République, Francis-Louis Closon. Conformément aux ordonnances du général de Gaulle sur la presse, tous les journaux qui avaient continué de paraître sous l’Occupation sont suspendus. Dès le 3 septembre 1944, les locaux du Grand Echo sont occupés par La Voix du Nord et Liberté qui sortent de la clandestinité. En décembre 1944, commencent dans la région les procès de presse. D’abord celui de l’éditorialiste du Grand Echo qui échappe à la mort. En décembre 1945 a lieu celui du Grand Echo et de ses dirigeants. Jean Dubar est condamné à cinq ans de travaux forcés, à la déchéance de nationalité. Quelques années plus tard, sa peine est commuée à quatre mois de prison. Dès lors Jean Dubar n’a de cesse que d’obtenir sa réhabilitation. Il lui faut attendre 1964 où le jugement est cassé et l’Etat est condamné à un franc de dommages et intérêts. Eloigné de la presse, il dirige alors une imprimerie la SILIC. Il meurt à Marcq-en-Barœul, dans la banlieue lilloise, le 14 mars 1968 à l’âge de 71 ans.
Source(s) :Jean-Paul Visse, «La Presse du Nord sous l’Occupation», conférence donnée à la Commission historique du Nord en 2022.
-
DUBAR René
Fils d’Ernest Dubar, employé de commerce, et d’Elise Moreels, René Dubar est secrétaire de rédaction au quotidien lillois Le Grand Echo du Nord de la France pendant plusieurs années. Parallèlement, il cumule ces fonctions avec celles de rédacteur au Télégramme du Nord jusqu’à la disparition de ce quotidien implanté à Lille après la Première Guerre mondiale. Il est également rédacteur en chef de La Gazette de Cambrai. Il quitte ensuite le Nord-Pas-de-Calais. Il collabore à différents titres parisiens L’Intransigeant, La Patrie, La Presse… Il rejoint L’Ami du Peuple , grand quotidien de doctrine politique et d’information fondé à Paris en mai 1928 par le parfumeur François Coty. Si, bientôt, ce journal peut se vanter d’être le plus vendu au monde, il prend par la suite un ton xénophobe, antisémite et nationaliste. René Dubar y travaille jusqu’à sa mort. Parallèlement, il publie des nouvelles dans Le Petit Journal illustré. «Miné par une maladie inexorable, écrit Le Petit Journal illustré, aggravée encore par les mauvais traitements dont il avait souffert à Lille, pendant l’occupation allemande, il meurt à 34 ans chez son père à Nantes en 1934.
Source(s) :AD Nord, M 149/142; AM Nantes, 1 E 2610; L’Action française, 5 janvier 1925 et 25 novembre 1925; Le Phare de la Loire, 6 février 1934; Le Grand Echo du Nord, 7 février 1934; Le Petit Journal illustré, 11 février 1934., 4.
-
DUBOIS Armand
Gendre de Constant Joseph Viroux, fondateur de L’Observateur d’Avesnes, Armand Louis Dubois est d’abord négociant à Paris. Fils d’un horloger de Guise, dans l’Aisne, il succède à son beau-père en 1856 à la tête de l’hebdomadaire dont il était rédacteur depuis huit ans. En 1858, il obtient l’autorisation de le transformer en journal politique pour faire face au Nouvelliste devenu lui-même organe politique, favorable à l’Empire.
En mai 1877, Dubois est condamné à dix jours de prison et 2 000 F d’amende. Il est gracié en février 1878. Il meurt à Avesnes à l’âge de 77 ans.
Source s: AD Nord, 5 Mi 001 R 009, 1T 222/1.
-
DUBOIS Edouard
Fils d’Armand Dubois, directeur de L’Observateur d’Avesnes, Edouard Armand Dubois succède à son père à la tête de l’entreprise familiale.
Impliqué dans la vie politique locale, il est membre du conseil municipal de sa ville dès 1880, puis est élu, en 1892, conseiller d’arrondissement et, l’année suivante, conseiller général. Il le reste jusqu’à sa mort, à l’âge de 62 ans, en novembre 1905. Edouard Dubois était chevalier de la Légion d’honneur .
Sourc es : AD Nord, 3 E 7435; Le Grand Echo du Nord, 25 novembre 190 5.
-
DUBOIS Louis
Louis Dubois est rédacteur à L’Avenir d’Arras dans les années 1930.
-
DUBREUCQ Ernest
Fils d’un marchand installé rue d’Angleterre à Lille, Arthur Melchior Dubreucq choisit de devenir journaliste. Il publie, nous dit Hippolyte Verly dans son Essai de biographie lilloise contemporaine, « dans L’Echo du Nord, Le Journal de Lille et surtout dans Le Moulin à vent de très nombreux articles sur les mœurs lilloises et des études critiques ».
Arthur Dubreucq meurt célibataire à l’âge de 31 ans.
Source(s) :AD Nord 5 Mi 044 R 142 et 5 Mi 044 R 299; Verly, Essai de biographie lilloise contemporaine, Lille, Leleu, 1869, p. 76.
-
DUBURCQ
Reporter successivement au Petit Nord puis au Progrès du Nord à Lille, Duburcq abandonne pendant près de cinq ans le journalisme et mène, selon la police, «l’existence d’un désœuvré» à Maubeuge chez sa mère. En octobre 1886, il rejoint L’Avenir de Dunkerque , à la demande de son rédacteur en chef Tubert, «pour l’associer à la campagne qu’il vient d’entreprendre contre la réaction cléricale à Dunkerque».
Source(s) :AD Nord 1T 222/10.
-
DUCORRON René
C’est tout juste nanti du baccalauréat, obtenu quelques semaines plus tôt, et rêvant de devenir journaliste, que René Ducorron fut embauché, le 1 er janvier 1945, à la rédaction de Valenciennes du quotidien socialiste Nord Matin qu’il quitta quelques semaines plus tard pour celle de Douai. Revenu à Valenciennes, René Ducorron fut nommé chef d’édition, fonction qu’il exerça pendant plus de vingt ans. Le 1 er juin 1971, il rejoignit La Voix du Nord où il fut nommé secrétaire de rédaction, d’abord à Lille, puis à Valenciennes, poste qu’il occupa jusqu’à sa retraire en 1983. René Ducorron est l’auteur de trois ouvrages: Courouble au temps du vieux Bon Dieu, L’an quarante et J3 sous l’occupation, 1570 jours avec les «doryphores». Il laisse également un texte inédit sur ses années de journaliste à Nord-Matin.
Source(s) :La Voix du Nord, 9 décembre 2015.
-
DUCOULOMBIER Victor
Fils d’un « fabricant » tourquennois, Victor Joseph Ducoulombier rejoint le 26 février 1868 les zouaves pontificaux. Son engagement dans la défense des Etats du pape lui vaut, la même année, les grades successifs de caporal-fourrier et de sergent-fourrier. Après la prise de Rome, annexée au royaume d’Italie, il regagne la France où il est incorporé, en octobre 1870, dans les « Volontaires de l’Ouest ». Il est rendu à la vie civile avec le grade de sergent-major le 15 août 1871.
Ducoulombier s’installe à Lille où il est, lors de son mariage le 26 août 1874 avec Pauline Marie Joseph Caron, éditeur-gérant du quotidien royaliste et catholique La Vraie France. En 1885, il devient pendant quelques mois gérant et imprimeur de l’hebdomadaire antirépublicain, antimaçonnique et antisémite Le Lillois. Par la suite, il occupe les mêmes fonctions au sein du bulletin bimensuel des zouaves pontificaux, L’Avant-Garde lancé en 1892 et qui paraîtra jusqu’en 1932.
Chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire-le Grand, titulaire de la médaille papale Bene Merenti, remise à partir de 1891 à tous les zouaves pontificaux encore vivants, de la médaille militaire, Victor Ducoulombier meurt à Paris à l’âge de 77 ans. Ses funérailles sont célébrées à Lille le 7 octobre 1921.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 049 R 094 et 5 Mi 044 R 238; La Croix du Nord, 7 octobre 1921; Régiment des zouaves pontificaux. Liste des zouaves ayant fait partie du régiment du 20 janvier 1861 au 20 septembre 1870, tome II, Lille, imprimerie Morel, 1920, p.
-
DUCROCQ Louis (abbé)
L’abbé Ducrocq est d’abord enseignant à Saint-Pierre de Calais, puis au collège de Montreuil-sur-Mer. En 1895, il part pour La Réunion, un séjour dont il tire profit pour écrire plusieurs ouvrages. Lors de son retour en France métropolitaine, il est nommé en 1895 vicaire à Bapaume, puis aumônier des hospices civiles de Calais et à Roubaix. Il devient rédacteur-en-chef de La Chronique artésienne en 1910-1912, il collabore ensuite à La Croix d’Arras et des pays miniers dont il devient directeur. Ce journal cesse sa parution lors de la déclaration de la guerre 1914-1918. Lors de la Première Guerre, l’abbé Ducrocq est aumônier militaire, curé intérimaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Arras. Il collabore au Lion d’Arras, organe hebdomadaire d’union atrébate, fondé par l’abbé Aimé Guerrin le 1 er janvier 1916 pour soutenir le moral des Arrageois dont la ville est placée sous le feu allemand.
Après la guerre, il part en Louisiane où il reste une dizaine d’années. Rentré à Arras, il est nommé prêtre auxiliaire à Ronville-Saint-Sauveur où il exerce encore lors de sa mort à l’âge de 72 ans.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 3 E 041/592, La Croix du Nord, 27 et 29 novembre 1935; Le Grand Echo du Nord, 21 septembre 1902; Alain Nolibos, notice «Ducrocq Louis» in, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, Arras, Artois, Côte d’Opale, dir M. Beirnaert, X. Boniface, A. Cassan, Y.-M. Hilaire, Paris, Beauchêne, 2013; J.-P. Visse, La Presse arrageoise. Catalogue commenté des périodiques de l’arrondissement d’Arras, Bapaume et Saint-Pol-sur-Ternoise, Société des Amis de Panckoucke, 2009.
-
DUFOUR Guy
C’est à Nord-Eclair que Guy Dufour, à peine diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, commença sa carrière de journaliste le 21 juin 1965 à la rédaction de Tourcoing. Au fil des années, il exerça diverses fonctions au sein du journal roubaisien dont celles de chef de l’édition de Villeneuve d’Ascq où il accompagna le développement de la ville nouvelle. Embauché à La Voix du Nord le 15 mars 1976, il travailla d’abord à Gravelines, avant de devenir chef de l’édition de Lille I (banlieue). Le 20 décembre 1979, il était nommé rédacteur en chef adjoint, poste qu’il occupe jusqu’à son départ en retraite.
Source(s) :Presse Actualité, n° 147, juin-juillet-août 1980.
-
DUGARDIN Eugène Louis Julien
Descendant d’une famille de commerçants lillois – son père fut horloger, place des Patiniers –, Eugène Dugardin fit l’essentiel de sa carrière au Progrès du Nord dont il fut le directeur à partir d’août 1877. Il fut, selon le Dictionnaire biographique illustré du Nord , «un énergique défenseur des idées républicaines».
Officier de l’Instruction publique et chevalier de la Légion d’honneur en 1901,il avait été nommé peu de temps avant sa mort directeur de l’asile d’aliénées de Bailleul.
Source(s) :Dictionnaire biographique illustré du Nord, p. 399; dossier de chevalier de la Légion d’honneur.
-
DUGARDIN Henri Julien
Ouvrier horloger pendant six à sept ans à Tourcoing, Henri Julien Pierre Dugardin devient reporter à L’Avenir de Roubaix-Tourcoing édité par Le Progrès du Nord de Lille. Ses relations familiales lui ont probablement facilité l’entrée dans le journalisme, il est en effet le beau-frère du gérant du Progrès du Nord.
En 1895, la police ne tarit pas d’éloges sur ce «républicain très convaincu»: «homme sérieux, se conduisant bien, […] ennemi des polémiques», «très honnête, intelligent, actif».
Après vingt-cinq ans de journalisme, Henri Dugardin est nommé en février 1913 receveur buraliste des contributions indirectes à Roubaix.
Source(s) :AD Nord 1T 222/26, 3 E 16025; Le Grand Echo du Nord, 12 décembre 1913.
-
DUHAMEL Jules Arthur
Fils de Jules Duhamel et d’Aurélie Duviler, qui tiennent une pension de famille à Roubaix, Jules Duhamel fait ses études secondaires au lycée de Tourcoing. Il quitte l’établissement après son premier baccalauréat pour entrer, le 1 er juillet 1930, comme rédacteur au Réveil du Nord à Lille. En 1936, à la suite du décès d’un rédacteur, il est affecté à l’agence douaisienne du quotidien lillois. Mobilisé dès la fin du mois d’août 1939, il reprend, en septembre 1940, son activité de journaliste à Douai. A la Libération, il passe au quotidien socialiste Nord-Matin qui a pris la suite du Réveil du Nord. De février à juillet 1945, il est rappelé sous les drapeaux et à son retour de l’armée, il entre à l’agence douaisienne du quotidien roubaisien Nord Eclair . A la fermeture de celle-ci, en décembre 1946, il devient rédacteur unique de La Croix du Nord dans la même ville . Il y signe un certain nombre de chroniques sous le pseudonyme de Jean Gélon. Le quotidien catholique connaissant à son tour des difficultés abandonne Douai. Jules Duhamel crée alors un hebdomadaire, Douai-Scarpe . Impliqué dans la vie sociale de sa ville d’adoption, Jules Duhamel fut notamment président du club de ping-pong, membre de l’Association des sinistrés du Douaisis, puis du Nord dont il rédigea le bulletin de liaison, Sinistrés du Nord .
Source(s) :Collection particulière.
-
DUHAMEL Mme, Gabrielle Donaint
Fille de Mme Anne-Marie Reboux, directrice du Journal de Roubaix, Mme Gabrielle Duhamel, épouse en premières noces l’avocat parisien Julien Demey dont elle a un fils, Jacques, futur directeur du Journal de Roubaix, puis, quelques années après la guerre, de Nord Eclair . En secondes noces, elle se marie avec l’avocat parisien Jean Duhamel. A la mort de sa mère, en décembre 1934, elle devient présidente du conseil de gérance du Journal de Roubaix . Lors de l’invasion allemande en 1940, elle se réfugie dans sa propriété de Dordogne. C’est dans ce département qu’elle meurt le 3 septembre 1943.
Source(s) :Le Journal de Roubaix, 5 novembre 1943.
-
DUMONT Alphonse
Fils d’un conseiller de la préfecture de Limoges révoqué pour ses convictions politiques et religieuses, Léonard Alphonse Marie Dumont est employé de commerce lors du conseil de révision en 1872. Il s’engage le 19 février 1873 au 83e RI qu’il quitte le 10 mars 1874 avec le grade de caporal. Installé à Paris comme imprimeur, Dumont est condamné le 6 mai 1881 par la cour d’appel à six mois de prison et 500 F d’amende pour complicité d’outrage aux bonnes mœurs et publication du journal satirique, Alphonse et Nana, sans autorisation préalable. La même année, il se marie à Limoges avec Marie Catherine Henriette Beaubreuil. Lors de la naissance de son fils Gaston un an plus tard, il est toujours domicilié à Paris.
En 1893, il est rédacteur du Patriote orléanais. En 1898, Edouard Delpit quitte L’Echo douaisien pour raisons de santé et Dumont lui succède. Il dirige ce trihebdomadaire jusqu’en 1902 ainsi que les hebdomadaires La Scarpe et La Gazette de Douai. Il prend ensuite la direction de l’Echo de Pithiviers. Il meurt le 15 avril 1911 à l’âge de 59 ans. Le Grand Echo du Nord salue « un journaliste de talent que sa grande courtoisie faisait aimer de tous ses confrères ».
Source(s) :Arch. Paris; AD Haute-Vienne, 3 E85/201, 3 E 85/295 et 1 R 331; Le Grand Echo du Nord, 21 avril 1911; J.-P. Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Wambrechies, Société des amis de Panckoucke, 426 p.
-
DUMONT Louis
Louis Dumont est reporter photographe au Grand Hebdomadaire illustré, publié à partir de 1905. Incorporé au 243e RI lors de la mobilisation d’août 1914, il participe à la première offensive de l’Artois. Grièvement blessé lors de l’offensive de Champagne en 1915, le caporal Dumont meurt de ses blessures le 9 octobre 1915.
Source(s) :Grand Hebdomadaire illustré, 14 septembre 1919, site Mémoire des hommes.
-
DUPONT Ernest
Venu de la presse nationale, Ernest Jean François Dupont, âgé de 53 ans, devient en avril 1921 rédacteur parisien du quotidien dunkerquois Le Nord maritime dans lequel il publiait déjà des chroniques politiques. Quelques mois plus tard, il est rédacteur en chef du Phare du Nord (1901-1938), puis de Nord-Eclair, journal quotidien d’union des gauches créé en novembre 1922 par les fils du fondateur du Nord maritime, les frères Chiroutre,et qui disparaît le 14 juin 1924.
A partir de septembre 1924, il occupe les mêmes fonctions à l’Avenir du Pas-de-Calais édité à Arras. D’avril 1932 au 28 février 1933, il est rédacteur en chef de L’Appel républicain du Pas-de-Calais, organe des gauches du département. Durant son séjour à Arras, Ernest Dupont collabore à différentes revues : Arras-Spectacles (1929-1932), le Bulletin de l’Union des sociétés dramatiques et lyriques du Nord (1930-1935), La Semaine arrageoise (1933-1934), Artois. Cahiers littéraires et artistiques des Rosati d’Artois (1937-1939).
Le journaliste regagne Dunkerque où il retrouve Le Nord maritime. Il est tué dans les bombardements de Malo-les-Bains le 27 mai 1940.
Source(s) :AD Nord, 3 E 18263, Le Nord maritime, 23 avril 1921, 2 septembre 1924; J.-P. Visse, La Presse arrageoise, op. cit.
-
DUPONT Gaston
Ancien instituteur, il est reporter à l’édition roubaisienne de La Croix du Nord à partir juin 1895. De «conduite et de moralité bonnes», il est bien sûr pour la police «réactionnaire».
-
DUPUICH Paul
Paul Charles Henri Dupuich a été le dernier directeur et rédacteur en chef de La République libérale d’Arras et du Pas-de-Calais , de 1897 au 1 er janvier 1899. A l’âge de 19 ans, le 12 mars 1890, il s’était engagé au 21 e régiment de dragons qu’il avait quitté le 12 mars 1893 avec me grade de brigadier fourrier. Après la disparition du quotidien, le 7 janvier 1899, il s’est expatrié au Sénégal où il est devenu agent commercial en Cassamande. «Terrassé par les fièvres et l’anémie», selon Le Grand Echo du Nord, il est rentré à Arras à la mi-1901 où il est mort le 11 juin à l’âge de 30 ans.
Source(s) :AD du Pas-de-Calais, 3 E 041/532, 1r 7071; La République libérale; Le Grand Echo du Nord, 14 juin
-
DUPUIS Edmond
Employé à l’imprimerie du Courrier du Pas-de-Calais pendant 39 ans, Edmond Dupuis entre comme prote à l’Imprimerie de La République libérale d’Arras lors de sa création en 1893. Il devient également gérant du journal jusqu’à sa mort en septembre 1896.
Source(s) :La République libérale, 5 septembre 1896.
-
DURAMOU Albert
Originaire des Flandres, Justin Héliodore Albert Duramou accomplit toute sa carrière d’imprimeur et de journaliste à Douai, se faisant dans les publications qu’il édite le héraut du parti légitimiste.
Fils de François Thomas Duramou, cordonnier, et de Stéphanie Flavie Vanwelscappe, Albert Duramou naît le 6 mars 1846 à Morbecque, dans l’arrondissement d’Hazebrouck. Il fait probablement ses premiers pas dans le journaliste en 1871 au Journal du Nord passé sous la direction de l’imprimeur douaisien Louis Ferdinand Dechristé. Lorsque celui-ci reprend Le Courrier douaisien en avril 1873, pour soutenir le comte de Chambord, Duramou en devient le rédacteur politique, écrivant tant sous son nom que sous le pseudonyme d’Emile Durard. Ayant acquis Le Courrier douaisien en 1876 , il le transforme l’année suivante en Gazette de Douai et de l’arrondissement dont il est l’homme-orchestre jusqu’en décembre 1888. Parallèlement, Duramou crée La Petite Gazette de la Scarpe qu’il remplace en juillet 1883 par L’Echo de la Scarpe. En 1881-1882, il imprime l’ Indicateur théâtral et musical & moniteur des jeux et divertissements des œuvres catholiques. Les différents rendez-vous électoraux sont souvent, pour lui, l’occasion de créer des journaux éphémères soutenant les candidats royalistes ou conservateurs. Quelques mois avant les élections législatives de 1885, il lance, dans l’arrondissement de Lille, La Deûle et, dans les arrondissements de Cambrai et de Valenciennes, L’Escaut qui disparaissent respectivement en mai et en juin 1885, remplacés par L’Electeur du Nord jusqu’en octobre de la même année. Régulièrement, son concurrent républicain, Lucien Crépin, annonce dans ses publications que les journaux de Duramou connaissent des difficultés. En décembre 1888, La Gazette de Douai et L’Echo de la Scarpe disparaissent et tous les ouvriers sont licenciés. Duramou quitte, sans autre explication, Douai. Marié le 21 octobre 1873 à Morbecque avec Eugénie Vandenabeele, il était père de cinq enfants . Il meurt à Lille le 11 novembre 1894 à l’âge de 48 ans.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 036 R 014, 1 Mi EC 353 R 180; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, collection Kiosque 59-62, 2017.
-
DURANT Clément
Observateur, mais aussi acteur de la vie roubaisienne, Clément Durand, fils d’un fileur, collabora au Progrès du Nord , puis à son édition L’Avenir de Roubaix-Tourcoing mais aussi au quotidien socialiste Le Réveil du Nord. Il publia également dans La Fauvette du Nord et dans Le Canard. Acteur de la vie politique, il se présenta en vain aux élections municipales sur la liste de Concentration républicaine et cantonales de 1892. Président de la section roubaisienne de la Ligue des droits de l’Homme, il fut également délégué cantonal, membre de la caisse des écoles. Son attachement à l’école publique lui valut d’être nommé officier d’académie. Jusqu’à sa mort à l’âge de 71 ans, il resta correspondant local des quotidiens Le Temps et Le Petit Parisien. .
Source(s) :AD Nord, 3 E 16014; Dictionnaire biographique du Nord, 1893; Le Grand Echo du Nord, 31 juillet 1892, 9 janvier 1902, 7 août 1902, 17 et 18 janvier 1908.
-
DURIF Lucien
Issu d’une vieille famille douaisienne, Lucien François, Auguste Durif accomplit toute sa carrière professionnelle que ce soit comme journaliste ou comme agent d’assurances dans la cité de Gayant.
Journaliste dès 1898, Lucien Durif, plus connu sous le pseudonyme de Paul Erblay, prend, en 1902 après le départ d’Alphonse Dumont, la direction du trihebdomadaire L’Echo douaisien, des hebdomadaires La Scarpe, créée en 1899 à destination des ruraux, et La Gazette de Sin-le-Noble, fondée en 1900. Ces périodiques dont le contenu diffère peu défendent la politique des républicains libéraux. Plusieurs journalistes catholiques et nationalistes y apportent leur concours. Leur parution s’arrête lors de l’invasion allemande de 1914. Bien qu’exempté du service militaire, Durif s’intéresse aux problèmes de Défense, en janvier 1910, il lance, toujours sous le même pseudonyme, le mensuel Douai militaire qui entend combattre le pacifisme et l’antimilitarisme.
Durant l’occupation allemande de Douai, le journaliste, malade, obtient son rapatriement à Paris où il demeure jusqu’à la fin des hostilités. A son retour dans le Nord, son domicile a été pillé, ses documents et son importante bibliothèque ont disparu. Faute de retrouver dans sa ville un organe libéral, il devient correspondant du quotidien Le Télégramme s’aventure dans le Nord. Parallèlement, il devient agent d’assurances.
En mauvaise santé, Lucien Durif doit bientôt cesser ses activités et meurt en janvier 1922 à l’âge de 44 ans.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 178 R 010 et 3 E 6159; J.-P. Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, op. cit.; La Croix du Nord, 22 janvier 1922.
-
DUSAUTOIR
En décembre 1845, Dusautoir est rédacteur-gérant du Barbier de Lille , journal politique, littéraire, artistique et scientifique, fondé en 1843 par Alphonse Bianchi et François Fémy. Cet hebdomadaire devient, en 1846, Le Messager de Lille dont Dusautoir est toujours le gérant.
Source(s) :Visse, Jean-Paul, La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de L’Écho du Nord, 1819-1944, Villeneuve d’Ascq, Presses du Septentrion, 2004, 279 p.
-
DUTEMPLE Edmond
«Un lettré et un consciencieux.» Au lendemain de la mort d’Edmond Dutemple à la suite d’une longue maladie qui lui interdisait tout travail depuis plusieurs semaines, toute la presse était unanime pour saluer ses qualités. «Sa vie de journaliste, affirmait devant sa tombe l’un de ses confrères. a été surtout dépensée dans cette presse de province où le directeur et unique rédacteur du journal est tenu d’être constamment à l’œuvre.» Avant d’embrasser la carrière de journaliste, Dutemple, aux convictions républicaines bien affirmées, avait été attaché à la Chambre. De cette expérience, il avait d’ailleurs tiré un ouvrage La Marmite aux lois. A la fin de l’année 1875, il lançait avec Frédéric Damé un hebdomadaire consacré à la politique internationale L’Europe orientale. Il collaborait ensuite à L’Homme libre de Louis Blanc et au Bien public. Il n’en continuait pas moins de publier divers ouvrages politiques. Lors du gouvernement de l’Ordre moral, deux d’entre eux avaient d’ailleurs été saisis. En 1878, il faisait partie de la Commission d’enquête sur les élections législatives d’octobre 1877 où les républicains ont remporté la majorité des sièges. L’année suivante, il publiait La Vie politique et militaire du général Hoche, ouvrage unanimement salué par la presse et même recommandé par le ministre de la Guerre. En février 1880, après un grave accident de cheval, il était nommé vice consul à Brousse (Burca) en Anatolie. De ses années passées en Orient, il tira lors de son retour en France plusieurs ouvrages dont en 1883 En Turquie d’Asie, notes de voyage en Anatolie. Dutemple reprit ses activités de journaliste. En avril 1884, il arrivait à Arras comme rédacteur en chef de L’Avenir du Pas-de-Calais.. Victime de censure de la part de son directeur, dira-t-il, il démissionna en 1886 et quitta le Nord pour l’Est. Il fut alors rédacteur en chef et propriétaire du Petit Bourguignon et du Patriote bourguignon . Après la liquidation de ce journal, Edmond Dutemple rejoignit la presse parisienne collaborant notamment à L’Evénement. Malade, il dut abandonner tout travail. Il meurt à l’âge de 40 ans sans avoir pu terminer deux études sur l’Arménie et la Géorgie, et sur la Perse contemporaine.
Source(s) :Arch. Paris, V4E 10314; J.-P. Visse, La Presse, arrageoise, Société des Amis de Panckoucke; Le Temps, 4 septembre 1877; Le Figaro, 27 février 1880, La Nation, 21 avril 1884, 2 mai 1893, L’Evénement, 2 mars 1891; L’Intransigeant, 9 juillet 1894; Le Mot d’Ordre, 10 et 11 juillet 1894.
-
DUTHIL Jules
Cinquante-cinq ans de journalisme dont plus de cinquante dans le même journal! Né le 5 septembre 1855, Jules, Henri, Paul, Amory Duthil , fils d’un inspecteur de l’octroi, fit ses premières armes dans le journalisme, en 1878, à La Vraie France , journal légitimiste lillois, avant de passer au Journal de Roubaix. En 1882, il entra comme secrétaire de rédaction au tout nouveau quotidien lillois La Dépêche , créé de la fusion du Mémorial de Lille et du Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais. Il y gravit tous les échelons et, en 1911, il était nommé rédacteur en chef de La Dépêche et de son édition du soir Le Nouvelliste. Il le resta jusqu’en 1934, année de sa retraite, tout en continuant à exercer le métier jusqu’à sa mort en février 1936. Cette fidélité à la profession lui valut, non seulement le respect de tous ses confrères, mais aussi la médaille d’or du travail. Jules Duthil fut aussi l’inspirateur du Grand Hebdomadaire illustré fondé en 1905 dont il fut le directeur et l’ animateur jusqu’à sa retraite en novembre 1933.
Jules Duthil fut vice-président de l’Association professionnelle des journalistes du Nord et président de sa commission des fêtes, chargée notamment d’organiser la loterie de la Presse du Nord, permettant d’améliorer la retraite des journalistes. Son dévouement à cette cause lui valut de recevoir en 1928 la grande médaille de la mutualité. Historien, il laisse plusieurs ouvrages.
Source(s) :AD Nord 1T 222/12, 1er septembre 1895; Grand Hebdomadaire illustré, 5 avril 1928 et novembre 1933; Le Grand Echo du Nord, 31 décembre 1931 et 4 février 1936.
-
DUTHILLŒUL Hippolyte
Après deux refus d’autorisation en 1821 et en 1823, Hippolyte Duthillœul se voit enfin autorisé en 1823 à lancer le Journal d’agriculture du département du Nord qui cesse sa parution en janvier 1826. Quelques mois plus tard, en association avec l’imprimeur Wagrez, il lance Le Mémorial de la Scarpe. Après dépôt d’un cautionnement de 12000 F, en 1828, le périodique devient politique. Lorsque Charles X suspend la liberté de la presse en juillet 1830, Le Mémorial n’obtient pas l’autorisation de continuer à paraître. Soutien de la monarchie de Juillet, le journal est en butte à l’hostilité de ses concurrents douaisiens, en particulier Le Libéral de Douai. S’en prenant notamment au chroniqueur politique de ce journal, Edouard Degouves-Denuncque, Duthillœul est provoqué en duel par ce dernier en novembre 1833 et avril 1834. Après la chute de Louis-Philippe, Le Mémorial de la Scarpe cesse de paraître. Duthillœul le remplacele 19 mars 1848 par L’Indépendant . Défenseur de l’ordre, il trouve son homme en Louis-Napoléon Bonaparte qu’il continue de soutenir après le coup d’Etat du 2 décembre 1851, tout comme il lui reste fidèle après la proclamation de l’empire.
Juge de paix en 1830, Duthillœul est nommé bibliothécaire de Douai en 1834. Il est l’auteur de nombreuses monographies. Il est membre de la Société d’agriculture, de sciences et arts de Douai à partir de 1821 et en devient secrétaire en 1823, il est également secrétaire de la Société des Amis des arts.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, collection Kiosque 59-62, 2017.
-
DUTHILLŒUL Oscar Romain
Fils d’Hippolyte Duthillœul, fondateur du Mémorial de la Scarpe, Oscar Duthillœul naît le 23 février 1831 à Douai où il fait ses études secondaires. Il participe à partir de 1849 à la rédaction de L’Indépendant qui a succédé en 1848 au Mémorial de la Scarpe. Un an plus tard, il entre dans l’administration des Finances dont il démissionne en 1866, pour prendre la direction de la rédaction de L’Indépendant et de son imprimerie dont il est devenu propriétaire.
Sous la République, en 1895, la police décrit ce périodique comme un « journal soi-disant rallié, mais en réalité réactionnaire ». Quant à Duthillœul, toujours selon la même source, il s’occuperait « très peu de la rédaction de son journal qui, sauf en ce qui concerne les faits locaux, est presque entièrement rédigé à coups de ciseaux. Ce journal contient très rarement un article de fonds politique émanant de la rédaction. » Cependant, ajoute-t-elle, « M. Duthillœul jouit d’une belle fortune et se conduit bien. »
En 1902, Oscar Duthillœul vend son journal à Bassé qui change le titre en Courrier républicain . Il meurt en janvier 1903.
Source(s) :AD Nord, Rapport du commissaire de police de Douai, 21 octobre 1895; Dictionnaire biographique du Nord, 1893; Le Courrier républicain, janvier 1903.
-
DUTHOIT, abbé Jean-Baptiste
Ordonné prêtre en 1881, l’abbé Jean-Baptiste Duthoit fut d’abord professeur au Petit Séminaire de Cambrai. Nomméà Tourmignies, il se consacra, selon La Croix du Nord, la diffusion et à la propagande du quotidien catholique lancé en 1889 par l’abbé Masquelier. Lors des funérailles en août 1895 de son rédacteur en chef Mailhard de La Couture, le quotidien La Vraie France le dit rédacteur à La Croix du Nord . ce Fatigué, sur sa demande, il est nommé curé de Le Maisnil, puis de Caullery. En 1911, il renonce à son ministère et se retire à Ascq.
Source(s) :AD Nord, 3 E 14489; La Vraie France, août 1895; La Croix du Nord, 22 mars 1921.
-
DUTHOIT?
Duthoit fit-il long feu dans la carrière de journaliste? Selon la police, en septembre 1895, alors qu’il travaille comme rédacteur-reporter au quotidien lillois La Dépêche, «il ne présentait (sic) pas beaucoup d’aptitudes à son nouveau métier».
L’homme se serait distingué par «sa haine des juifs» et aurait voulu «que le journal polémique dans ce sens».
Source(s) :AD Nord, 1er septembre 1895.
-
DUVINAGE Madeleine née Fossier
Militante communiste dès l’adolescence, Madeleine Fossier épouse en 1939 Willy Dubois, instituteur et ancien des Brigades internationales. Alors que toute activité communiste est interdite après la signature du pacte germano-soviétique, elle est emprisonnée, de mars à juin 1940, pour espionnage à Loos d’où elle s’échappe à la faveur d’un bombardement. Elle rejoint alors son mari dans la clandestinité et devient résistante. Arrêté, son mari meurt en déportation.
A la Libération, Madeleine Fossier entre au quotidien communiste Liberté où jusqu’en 1983 elle couvre notamment l’actualité culturelle. C’est dans ce journal qu’elle rencontre René Duvinage qui devient son époux. Elle meurt à l’âge de 97 ans.
-
DUVINAGE René
Rédacteur au quotidien communiste Liberté.
C – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais E
-
ECHEVIN POL
Journaliste à La Croix à partir de 1955, Pol Echevin travailla ensuite à Ouest-France comme chef du service économique et social. Il exerça ensuite les mêmes fonctions à l’Express . En 1976, il participa au lancement du Matin de Paris , puis revint en septembre 1980 dans le Nord pour diriger l’équipe rédactionnelle du Matin du Nord . L’expérience tourna court et Pol Echevin fut mis en préretraite en 1982. Il participa alors, comme directeur de la publication, à l’aventure du magazine régional Dire lancé en 1984 et qui ne connut que dix numéros. Fils d’une famille ouvrière originaire d’Haubourdin, Pol Echevin débuta dans la vie active dès l’âge de 14 ans. Militant de la JOC, il fut président fédéral après la Libération. Membre du mouvement populaire des familles devenu Mouvement de libération du peuple, il en devint permanent après son licenciement de la SNCF. C’est dans cette organisation qu’il fit ses premières armes dans le journalisme, en étant rédacteur au Monde ouvrier . Plus tard entre 1951 et 1955, il fut rédacteur en chef de Pour la libération du monde ouvrier , organe du mouvement de libération ouvrière, baptisé par la suite Libé-MO . Militant de la CFTC, puis de la CFDT, Pol Echevin fut membre du conseil syndical puis du bureau du Syndicat des journalistes français dont il fut secrétaire général adjoint 1967. Il était également membre du Parti socialiste. En 1985, il publia Echec au roi .
Source(s) :André Caudron (dir.), Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, tome 4, Lille Flandre, Paris, Beauchesne et Centre d’histoire de la région du Nord et de l’Europe du Nord-Ouest, 1990..
-
ELOY Jules
Fils d’Alexandre Joseph Eloy, marchand bourrelier, et de Marie Blin, Jules Clément Joseph Eloy naquit à Arras le 28 janvier 1878. Après des études secondaires à l’Institution Saint-Joseph d’Arras, il fut admis à l’Institut catholique des arts et métiers de Lille (ICAM) où il sortit avec le diplôme d’ingénieur.
Entré à la Société du Pas-de-Calais qui éditait le quotidien Le Courrier du Pas-de-Calais et l’hebdomadaire Le Pas-de-Calais , il y seconda le directeur Paul-Marie Laroche à qui il succéda. Sous sa direction, l’outillage de l’imprimerie se modernisa avec notamment l’arrivée d’une rotative Marinoni qui permit le passage du quotidien de 4 à 6 voire 8 pages. Après la Première Guerre, il reprit sa place au sein de la Société anonyme du Pas-de-Calais, également imprimeur de nombreux bulletins paroissiaux, de La Croix d’Arras et du pays minier (1920), du Bulletin de la reconstitution industrielle (1919-1922) ,Commerce et industrie (1927-1938)… Jules Eloy fut également directeur du périodique La Grande Pitié des églises d’Artois (1919-1926).
En 1925, la Société anonyme du Pas-de-Calais, en proie à des difficultés financières, fut mise en liquidation judiciaire. Une nouvelle entité était créée, la Nouvelle Société anonyme du Pas-de-Calais qui poursuivit les activités de la précédente société et notamment la publication du quotidien et de l’hebdomadaire. Il ne semble pas que Jules Eloy fît encore partie de la direction.Il meurt à l’âge de 92 ans à Astaffort dans le Lot-et-Garonne.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise, Société des Amis de Panckoucke, 2007; AD du Pas-de-Calais, 5 MIR 041/41.
-
ELVIN Elie
Elie Elvin est rédacteur à La Plaine de Lens et Le Patriote avant la Première Guerre.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notice, La Plaine de Lens.
-
ESPARBIE Alfred
D’abord employé de préfecture, Alfred Esparbié arrive dans le Nord en 1845 où il fait ses premiers pas dans le journalisme à L’indépendant du Nord édité à Maubeuge. Il est ensuite rédacteur en chef du Journal de Lille de Danel qu’il quitte en 1847 pour devenir directeur des théâtres à Rouen. Ayant fait, selon la police, de mauvaises affaires, il revient au journalisme. On le retrouve ainsi collaborant à plusieurs quotidiens parisiens La Vérité, La Patrie, Le Pays , puis, à La Liberté à Arras jusqu’au 25 mai 1849. Alfred Esparbié se fixe ensuite à Lille où il reprend sa place au Journal de Lille , remplacé en 1857 par Le Mémorial de Lille , journal créé pour soutenir la politique impériale. En 1867, Esparbié en est nommé rédacteur en chef. Pourtant la police ne lui accorde guère de crédit, il ne jouirait «d’aucune considération personnelle» et ne serait qu’un «écrivain sans talent». Un jugement que contredit L’Echo du Nord qui, à plusieurs reprises, écrit que, bien que ne partageant «aucune des idées de M. Esparbié, on ne saurait nier son talent.» Dans une rédaction limitée à quelques personnes, Esparbié signe ses articles politiques de son nom et diverses chroniques des pseudonymes André Boni ou Louis Bignon. En 1872, Le Diable rose dit de lui «Esparbié a un air bon enfant, auquel il ne faut pas trop se fier.» En tout cas, il montre beaucoup de persévérance pour sauver son journal quand, après 1870, il se retrouve en mauvaise posture. Après la chute de Napoléon III, Le Mémorial de Lille poursuit la même ligne politique favorable à l’Empire et voit son lectorat fondre. En 1873, la rédaction est licenciée et, malgré l’action en justice portée par Esparbié, en mai 1873, la société éditrice est dissoute. Lors de la vente du journal en septembre, il parvient à en devenir propriétaire. Victoire probablement de courte durée. Finalement Alfred Esparbié quitte Lille et meurt en 1876. Romancier et auteur dramatique, il a signé plusieurs ouvrages. Quant au Mémorial de Lille, il est racheté, en 1883, par Reboux qui le fusionne avec Le Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais pour créer La Dépêche.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/7; Hippolyte Verly, Essai de biographie lilloise contemporaine, 1869; L’Echo du Nord, jeudi 29 mai et 23 septembre 1873
-
ESTAGER Jacques
Après des études de Lettres à Lille, Jacques Estager devient instituteur dans la Somme, puis répétiteur et professeur adjoint au lycée de garçons de Douai jusqu’en 1943.
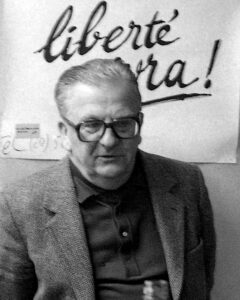 Membre des étudiants socialistes en 1937, il rejoint la fédération des étudiants révolutionnaires en 1939. Entré dans la Résistance en 1941, il fait partie du groupe de « La Pensée française » dirigée à Douai par Suzanne Lanoy. Il participe ainsi à la rédaction et à la diffusion de la revue dans le Nord et le Pas-de-Calais. Membre de la cellule des étudiants communistes, Jacques Estager rejoint la section du Front national de Douai dont il est le responsable en 1944. A ce titre, il siège au Comité de libération de l’arrondissement de Douai.
Membre des étudiants socialistes en 1937, il rejoint la fédération des étudiants révolutionnaires en 1939. Entré dans la Résistance en 1941, il fait partie du groupe de « La Pensée française » dirigée à Douai par Suzanne Lanoy. Il participe ainsi à la rédaction et à la diffusion de la revue dans le Nord et le Pas-de-Calais. Membre de la cellule des étudiants communistes, Jacques Estager rejoint la section du Front national de Douai dont il est le responsable en 1944. A ce titre, il siège au Comité de libération de l’arrondissement de Douai.Nommé en septembre 1944 rédacteur en chef du journal du Front national Nord-Libre, il intègre, lors de sa disparition, la rédaction du quotidien de la fédération communiste du Nord, Liberté . A partir de 1955, il occupe le poste de rédacteur en chef et, à partir de 1968, celui de directeur. Membre du bureau fédéral du Parti communiste, Jacques Estager est candidat lors des élections législatives de 1973 dans la 1re circonscription de Lille. Arrivé en troisième position, il se désiste en faveur du candidat socialiste lors du second tour.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages écrits seul : Ami entends-tu. La Résistance populaire dans le Nord Pas-de-Calais, ou en collaboration : avec J. Dimet Pologne , avec F. Crémieux Sur le Parti 1939- 940, avec Gustave Ansart De l’usine à l’Assemblée nationale, avec Henri Krasucki Un Syndicat nouveau, oui.
-
EVRARD Eugène
Ordonné prêtre en 1903, l’abbé Eugène Evrard fut d’abord enseignant à Cambrai, Roubaix, Marcq-en-Barœul et Hazebrouck. En 1923, il est appelé à seconder Mgr Masquelier comme rédacteur en chef de La Croix du Nord. Pendant dix-sept ans, il y signe de nombreux éditoriaux ou analyses à la fois sous son nom ou sous un pseudonyme.
A la mort de Mgr Masquelier, en 1936, il lui succède comme directeur général du quotidien catholique. A l’arrivée des Allemands à Lille, en mai 1940, il en interrompt la publication. Il meurt pendant l’Occupation.
Professeur à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille à partir de 1925, il est l’auteur de plusieurs ouvrages: Nos Mandarins (1920), Le Mystère des abeilles (1921), Le Monde des abeilles (1928), etc. A ce titre, il avait été récompensé par plusieurs prix littéraires. Eugène Evrard avait été nommé chanoine honoraire en 1936.
Source(s) :La Croix du Nord; André Caudron (dir.), Ibidem.
-
EVRARD Florent
Fils de mineur, Florent Evrard, né le 13 mai 1851 à Denain, travaille à la mine dès l’âge de neuf ans. De 1864 à 1892, il passe vingt-huit ans au fond, ne quittant la mine que pour s’engager lors de la guerre de 1870 où, chasseur à pied, il effectue la campagne du Nord sous les ordres du général Faidherbe.
Président de la section de Meurchin du syndicat des mineurs du Pas-de-Calais en 1889, il devient secrétaire général de la fédération régionale en 1892. Lorsque celle-ci se dote d’un organe en 1907, La Voix du mineur, Florent Evrard en est le gérant.
Parallèlement, il est conseiller municipal de Bauvin de 1889 à 1892, puis de Lens à partir de 1900. En 1907, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur dont les insignes lui sont remis par le docteur Desmons. Il meurt à Paris le 21 janvier 1917.
Source(s) :Dossier de la Légion d’honneur, site Léonore.
-
EVRARD Raoul
Fils du mineur et syndicaliste Florent Evrard, Raoul Evrard travaille à la mine dès l’âge de 12 ans, Congédié en 1893, il devient ouvrier agricole, puis garçon-boucher.
Militant socialiste, il crée les Jeunesses socialistes de Lens en 1902, devient secrétaire du député Raoul Briquet et collabore à divers journaux. En 1912-1913, il est administrateur de l’organe de la fédération socialiste du Pas-de-Calais La Bataille socialiste. Engagé volontaire en 1914, il est blessé à plusieurs reprises et démobilisé en 1916. Permanent de la SFIO, il assure à partir de juin 1917 le secrétariat de rédaction du Réveil , périodique qui regroupe La Voix du mineur et Le Prolétaire. En 1919, il est élu député du Pas-de-Calais et est régulièrement réélu jusqu’en 1936 où, devancé par le communiste Cyprien Quinet, il se retire en sa faveur. De 1921 à 1938, il est directeur politique de L’Eclaireur du Pas-de-Calais , l’hebdomadaire de la fédération SFIO.
Après les élections législatives de 1936, Raoul Evrard est nommé chef de cabinet du ministre de l’Intérieur Marx Dormoy.
Résistant durant l’Occupation, il meurt à Paris le 29 février 1944 d’une crise cardiaque alors qu’il est recherché par les Allemands.
Source(s) :Base de données des députés; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Ibid., notices, La Bataille socialiste, Le Réveil, L’Eclaireur du Pas-de-Calais
-
EYLENBOSCH Gustave
Ancien ouvrier typographe, Gustave Eylenbosch est rédacteur principal à La Croix flamande ( Het Vlamsch Kruiss ) en 1899. Il est alors conseiller municipal à Gand.
F
-
FAGE, André
Natif de Sedan où il vit le jour en 1883, André Fage commence sa carrière de journaliste en 1901 à La Dépêche des Ardennes , puis collabore à différentes publications Le Courrier des Ardennes, La Revue d’Ardenne et d’Argonne , La Jeune Champagne. Il gagne le Nord où il devient rédacteur au Grand Echo . En 1909, il fonde avec Emile Lante Le Nord illustré et l’année suivante La Vie sportive. Dès 1914, il fonde à Paris Le Journal des réfugiés du Nord qui paraît jusqu’au 1 er avril 1920. Il entre alors au Petit Journal qu’il quitte au milieu des années 20 pour Le Réveil du Nord où il exerce les fonctions de secrétaire général. Poète et romancier André Fage est l’auteur de plusieurs ouvrages dont notamment Lille sous les griffes allemandes . Il était chevalier de la Légion d’honneur et officier d’Académie.
-
FAIDHERBE, Alexandre
Autodidacte, Alexandre Faidherbe entre à l’Ecole normale de Douai. Instituteur public, il enseigne à Hasnon, à Fives et à Roubaix. Sous la monarchie de Juillet, la II e République et le Second Empire, il collabore à plusieurs journaux édités à Lille: L’Abeille , Le Moulin à vent , la Revue du Nord de la France , L’Education , le Journal des instituteurs du Nord , le Mémorial du Nord et du Pas-de-Calais , ou à Roubaix: Journal de Roubaix . Il participe aussi à L’Almanach de Roubaix et aux mémoires de la Société d’Emulation de Roubaix.
-
FARELLY Samuel
Pasteur de l’Eglise évangéliste de Béthune, Samuel Farelly est à partir de 1902 le rédacteur en chef de La Pioche et la truelle , revue de l’Eglise évangéliste 123, rue du Maine à Paris.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notice, La Pioche et la truelle.
-
FASSIAUX Paul
A la mort de son père en 1935, Paul Fassiaux prend sa succession à la tête de l’imprimerie familiale et de l’hebdomadaire qu’il éditait l’Eclaireur de Saint-Amand-les-Eaux. En 1937, il se présente aux élections cantonales sous l’étiquette radicale-socialiste.
Mobilisé de juin à juillet 1940, il est affecté dans les Landes. Revenu à Saint-Amand en novembre 1940, il reprend ses activités et obtient l’autorisation de faire reparaître son journal à partir du 1er juin 1941. Son tirage atteint 4 200 exemplaires en juillet 1943.
Parallèlement, Paul Fassiaux fabrique de faux papiers pour les prisonniers évadés. En février 1942, contacté par Paul Lisfranc et Eugène d’Hallendre, il participe à la création d’un groupe local de l’OCM. Il imprime sur les presses de L’Eclaireur des tracts pour la Résistance et cache des réfractaires. En mai 1943, contacté cette fois par Maurice Pauwels, il adhère au mouvement Voix du Nord. Le 19 juillet, il est arrêté et incarcéré une dizaine de jours à Valenciennes.
Capitaine FFI, il participe aux combats de la libération du 2 au 4 septembre. Les nouvelles autorités locales n’opposant aucune objection à la continuation de la parution de L’Eclaireur, l’hebdomadaire reparaît le 10 septembre, portant croix de Lorraine en Une.
En novembre 1944, la direction régionale à l’Information ordonne cependant l’arrêt de sa publication pour infraction au décret-loi du 1er septembre 1939. Ce décret interdit la publication de toute information de nature à favoriser les entreprises d’une puissance étrangère contre la France ou à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de l’armée et de la population. Une instruction est ouverte et il faut attendre fin 1945 pour que la cour de justice de Valenciennes, témoignages de plusieurs chefs de la Résistance à l’appui, décide le classement de l’affaire. Paul Fassiaux ne reprendra son activité de presse que le 17 novembre 1946 avec un nouveau titre L’Eclair. Cet hebdomadaire disparaît le 20 novembre 1949.
Source(s) :SHD GR, 1GP 216771; AD Nord, 10 W 812.
-
FELGERES Charles
« Jeune, mais déjà connu dans la presse », selon le quotidien catholique L’Univers daté du 30 août 1896, Charles Felgères succède à Ernest Delloye, emblématique rédacteur en chef de L’Emancipateur, à la tête de ce journal édité à Cambrai. Fils d’un maître de poste, Charles Pierre Marie Joseph Felgères n’a en effet que 27 ans. Né le 27 mars 1859, il est licencié en droit, il a déjà travaillé à La Mayenne, à L’Observateur français, à La Nouvelle Bourgogne et à L’Echo rochelais.
Il arrive à Cambrai avec l’intention de donner « une impulsion en même temps qu’une orientation nouvelles [à L’Emancipateur]. Défenseur de la religion, de l’ordre, de la propriété, cet organe va de plus, accentuer la note en faveur du progrès et des réformes réclamées pour l’avenir », toujours selon L’Univers. Malgré ses bonnes intentions, Charles Felgères ne semble faire que passer dans la sous-préfecture du Nord, siège de l’archevêché.
On le retrouve dès 1897 collaborant à l’hebdomadaire nationaliste Le Paris de Raoul Canivet, puis des quotidiens Le Gaulois de 1898 à 1900, Le Soir de 1900 à 1906, La Patrie de 1906 à 1912, La Presse de 1908 à 1916. Il entre ensuite à La Libre Parole qu’il quitte au milieu des années 1920.
Originaire d’Auvergne, Charles Felgères fut également un historien de sa région. On lui doit notamment Etudes historiques sur la baronnie de Chaudes-Aigues qui, en 1903, reprend une série d’articles publiés dans la Revue de Haute-Auvergne, Scènes et tableaux de l’histoire d’Auvergne dont Lucien Fevre écrit que « l’histoire économique, l’histoire sociale ont à glaner abondamment dans ce livre – trop fleuri souvent […] – mais la forme ne doit pas empêcher d’apprécier le fond solide et sérieux. » Cet ouvrage fut d’ailleurs récompensé par un prix de l’Académie française en 1931.
-
FELHOEN Hyacinthe, Delarre veuve
(Béthune, 2 juin 1830 -?,? Imprimeur Imprime Le Journal de Lens en 1875, puis Le Petit Béthunois d’avril à décembre 1880.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notices, Le Journal de Lens, et, Le Petit Béthunois.
-
FERRAND Charles
Né à Paris le 15 août 1864, Charles Ferrand, militant au Parti ouvrier, fut d’abord employé à la mairie de Lille, avant de rejoindre le Pas-de-Calais comme secrétaire général de la mairie d’Avion en 1902. Trésorier en 1905 de la fédération socialiste du Pas-de-Calais, puis secrétaire l’année suivante, il participe à la rédaction du Citoyen de 1906 à 1910, puis à La Bataille socialiste de mars 1912 à octobre 1913, enfin au Prolétaire de novembre 1913 à juillet 1914. Elu député en 1919, réélu en 1925, il est également conseiller général du Pas-de-Calais en 1920. Il tient une chronique parlementaire dans l’Eclaireur du Pas-de-Calais jusqu’à sa mort survenue le 15 juillet 1925.
Source(s) :site de l’Assemblée nationale, base de données des députés français depuis 1789; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2010, notices des périodiques cités.
-
FERRE Emile
Lorsqu’il arrive au Grand Echo du Nord de la France à Lille, Emile Ferré a déjà, malgré son jeune âge, multiplié les expériences dans la presse. Le fils du facteur rural de Levroux dans l’Indre, Paul Alexandre Ferré, et de Julienne Caroline Fauchais y a fait ses débuts, en 1883, comme correcteur d’imprimeur à Châteauroux, tout en collaborant, par diverses chroniques et critiques littéraires, à plusieurs journaux du Centre de la France. Après une année passée à Paris, il collabore au Démocrate du Loiret à Orléans, puis devient rédacteur principal au Progrès du Loiret. En 1886, il entre à L’Avenir de la Mayenne à Laval, comme secrétaire de direction. Deux ans plus tard, il est rédacteur en chef du quotidien Le Ralliement et de l’hebdomadaire L’indépendant de l’Ouest à Angers. Le 28 octobre, il se marie avec Jeanne Marguerite Kavanagh, fille du directeur de L’Avenir de la Mayenne. En 1889, il est rédacteur en chef du Phare de la Manche à Cherbourg où il reste jusqu’en 1893. Cette année-là, Hippolyte Verly, codirecteur et rédacteur en chef du Grand Echo du Nord étant sur le départ, Emile Ferré rejoint le quotidien lillois où il est rédacteur principal et éditorialiste puis rédacteur en chef. Républicain modéré, partisan de l’ordre et de la défense sociale, il défend avec acharnement la politique d’Alexandre Ribot et de Jules Méline qui préside l’un des plus longs ministères de la III e République. Il combat avec la même conviction le socialisme. Emile Ferré n’hésite pas à cumuler les fonctions, Dans son dossier de légionnaire, on trouve un curriculum vitae, non daté, mais probablement établi en 1910 avant sa nomination comme chevalier de la Légion d’honneur, il y signale être copropriétaire de L’Avenir de la Mayenne, du Patriote de Bretagne édité à Vitré, du Progrès de Château-Gontier et copropriétaire de l’imprimerie moderne à Laval. Resté à Lille durant la Première Guerre, il tente de s’opposer à l’impression du journal allemand, la Liller Kriegszeitung sur les presses du Grand Echo du Nord . Emprisonné à la citadelle de Lille, il est ensuite emmené comme otage en Lituanie. Au camp de Millejgany, il rédige, pour soutenir le moral de ses compagnons, L’Echo du Nord… et des steppes , journal manuscrit dont il lit les articles du haut d’un châlit. Lors de sa libération, il revient à Lille où, au lendemain du départ des Allemands, il sort, sur un format réduit, le premier numéro de la Délivrance de L’Echo du Nord . De l’occupation et de sa captivité, Emile Ferré tire plusieurs récits dont un ouvrage Croquis d’occupation. Vie intime et anecdotique de Lille de 1914 à 1918 , paru chez Taillandier, et un reportage publié par L’Illustration et couronné par le prix Montyon. En 1921, il est associé à la direction du journal.
 Avec Gustave Dubar puis, après sa mort, avec le fils de ce dernier, il dirige le plus important quotidien de la région jusqu’en 1939, date à laquelle il prend sa retraite. Membre du conseil d’administration à partir de 1930, il le reste jusqu’à sa mort. La longévité de sa carrière, sa fidélité au titre lillois et ses fonctions lui valent d’être associé à toutes les transformations d’un journal dont le tirage passe de 100000 exemplaires, avant la Première Guerre, à quelque 330000 exemplaires, en 1933. Il est également partie prenante tant dans les importants travaux que connaît le bâtiment du Grand Echo du Norden 1908 que dans la construction à partir de 1934 du nouvel «hôtel » dont la façade domine toujours la Grand’Place de Lille.Très impliqué dans la vie régionale, Emile Ferré l’était également dans la profession. Il présida, pendant plusieurs années, l’Association professionnelle des journalistes du Nord, puis l’Association de la presse républicaine départementale de France à partir de juin 1926. Il fut également vice-président du Comité général des Associations de presse.Titulaire de plusieurs décorations, il avait été fait commandeur de la Légion d’honneur en août 1929.Source(s) :
Avec Gustave Dubar puis, après sa mort, avec le fils de ce dernier, il dirige le plus important quotidien de la région jusqu’en 1939, date à laquelle il prend sa retraite. Membre du conseil d’administration à partir de 1930, il le reste jusqu’à sa mort. La longévité de sa carrière, sa fidélité au titre lillois et ses fonctions lui valent d’être associé à toutes les transformations d’un journal dont le tirage passe de 100000 exemplaires, avant la Première Guerre, à quelque 330000 exemplaires, en 1933. Il est également partie prenante tant dans les importants travaux que connaît le bâtiment du Grand Echo du Norden 1908 que dans la construction à partir de 1934 du nouvel «hôtel » dont la façade domine toujours la Grand’Place de Lille.Très impliqué dans la vie régionale, Emile Ferré l’était également dans la profession. Il présida, pendant plusieurs années, l’Association professionnelle des journalistes du Nord, puis l’Association de la presse républicaine départementale de France à partir de juin 1926. Il fut également vice-président du Comité général des Associations de presse.Titulaire de plusieurs décorations, il avait été fait commandeur de la Légion d’honneur en août 1929.Source(s) :L’Echo du Nord, 10 août 1929 et 22 août 1944; Léonore, dossier de Légion d’honneur.
-
FERRE Georges
Fils d’Emile Ferré, rédacteur en chef de L’Echo du Nord, Georges René Gustave Ferré est né à Lille le 22 novembre 1898. Mobilisé en 1918 comme observateur téléphoniste dans l’artillerie, puis commis greffier au 2e conseil de guerre de Lille, il est reste sous le drapeaux jusqu’en 1920.
Si Georges Ferré commence sa carrière professionnelle dans la presse, c’est d’abord comme attaché d’administration qu’il entre à L’Illustration. En 1921, il rejoint L’Echo du Nord où il est attaché à la direction. Il effectue également de nombreux reportages dont certains sont rassemblés en 1929 dans un ouvrage, Chroniques des temps d’après-guerre, préfacé par Henri Béraud. Il intègre ensuite le service du grand reportage du quotidien national Le Matin pour lequel il se rend en Angleterre, en Allemagne, en Afrique du Nord, au Soudan, en Ethiopie, en Australie… En 1936, il collabore à La République ainsi qu’à divers journaux de province : L’Ouest-Eclair, Le Petit Marseillais, La Petite Gironde… Plusieurs de ses reportages seront également le sujet d’ouvrages : Le Sahara sur quatre roues publié en 1931 et récompensé par la Société des gens de Lettres, Bagnards, colons et canaques paru en 1932, Tahiti toute nue en 1935… En 1938, Georges Ferré est fait chevalier de la Légion d’honneur.
Après la Seconde Guerre mondiale, il collabore au quotidien Paris-presse, L’Intransigeant.
Il meurt à Lille le 4 décembre 1971.
-
FESCH Paul (abbé)
A la mort de l’abbé Paul Fesch, des quotidiens catholiques saluent en l’auteur de Souvenirs d’un abbé journaliste « un pionner de la presse catholique ».
Fils de gendarme, Paul Martin Fesch est séminariste à Beauvais puis à Saint-Sulpice avant d’être ordonné prêtre en 1883, mais ne fait pas de service paroissial. Il collabore à L’Eclaireur, titre fondé par des partisans du comte de Chambord dans le département de l’Oise, il donne quelques articles à L’Anjou, « regardé comme le journal officiel de Mgr Freppel », puis il participe au Journal de l’Oise sous le pseudonyme Jean Pasquerel. En septembre 1891, fort de l’appui de l’évêque de Beauvais, Mgr Péronne, il fonde La Croix de l’Oise, qui, un an plus tard, selon ses dires, tombe « sous les efforts réunis de la Franc-maçonnerie et du conservatisme peureux, égoïste et réfractaire aux enseignements du pape ».
L’abbé Fesch quitte l’Oise pour Paris où il prend la direction de La Cocarde, du 6 mai au 4 septembre 1894. Il entre ensuite au Monde tenu par l’abbé Naudet et en devient le secrétaire de rédaction. Il demeure à ce poste, un peu plus d’un an jusqu’en 1896, avant de rejoindre le journal La Croix et de fonder la revue Jeanne d’Arc. Il meurt le 11 mai 1910, à Paris.
Auteur prolifique, écrivant sous divers pseudonymes : Jean Pasquerel, Jean-Paul Marybert, P.-M. Demouy, Paul de Clermont, il laisse de nombreux ouvrages dont Mortes au champ d’honneur, Le Panthéon des bonnes gens, Le Martyre de Jeanne d’Arc, La Faillite de l’enseignement gouvernemental, La franc-maçonnerie contre l’Armée…
Mort avant d’avoir pu faire imprimer sa Bibliographie de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes, il confie l’achèvement de son travail à son ami Joseph Denais (1851-1916), qui meurt lui aussi avant l’édition complète. Retrouvé, un exemplaire des épreuves d’imprimerie (sans les corrections de Denais) sert à l’éditeur belge G.-A. Deny pour son édition de 1976, tirée à 800 exemplaires.
Source(s) :Paul Fesch, Souvenirs d’un abbé journaliste, Paris, Flammarion; L’Univers, 14 mai 1910; https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul Fesch
-
FLAHAUT Alfred
Charles Noël Alfred Flahaut était le fils de Charles Flahaut, « tué à l’ennemi » en mars 1915. Il fut adopté « pupille de la Nation » en 1920. Rédacteur au Réveil du Nord, il fut mobilisé en 1939 comme canonnier au 101e régiment d’artillerie lourde automobile. Nommé maréchal des logis, il a été tué dès le 6 juin 1940 à Transloy, près de Bapaume.
Source(s) :Le Grand Écho du Nord, 4 septembre 1940, ministère des Armées.
-
FLEURY
En 1866, L’imprimeur Fleury-Lemaire est rédacteur en chef-gérant du Mémorial artésien de Saint-Omer.
-
FLEURY Georges
En 1923, Georges Fleury est secrétaire de direction au Réveil du Nord .
-
FLORIO René
Ancien étudiant de l’Ecole de journalisme de Lille, René Florio avait, en décembre 1955, succédé à R. Nobecourt comme directeur et rédacteur en chef de La Croix du Nord. En 1965, il était entré à Nord Eclair où il assuma les fonctions de secrétaire général de la rédaction jusqu’à sa retraite, veillant au respect de la ligne éditoriale et au bon fonctionnement du quotidien roubaisien, «journal démocrate et social d’inspiration chrétienne». Collaborateur au périodique Presse Actualité, René Florio fut également enseignant à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille.
-
FOLLET Louis
Rédacteur au Mémorial de Saint-Omer.
-
FONTAINE
Chef de la section du Parti ouvrier à Iwuy, Fontaine est rédacteur au journal L’Avant-garde , lancé à Cambrai en février 1900 par ce parti à l’occasion des élections municipales.
Source(s) :AD Nord, 14 février 1900.
-
FONTAINE MichelFils d’un père cheminot et d’une mère receveuse des postes, Michel Fontaine est le 9 juillet 1929 à Inchy dans le Cambrésis. Après des études secondaires à l’institution Notre-Dame à Cambrai, il est admis à l’Ecole supérieure de journaliste d’où il sort en 1950.
Il rejoint la rédaction de La Voix du Nord le 1 er août 1953 dont il devient quelques années plus tard c hef de l’édition valenciennoise. Il part en retraite le 30 septembre 1991.
-
FOSSIER Jean-Marie
, enseignant
D‘origine modeste, Jean-Marie Fossier débute sa carrière professionnelle comme professeur de lettres. Membre du Parti communiste à partir de 1930, il est en 1934 secrétaire général du comité de lutte contre la guerre et le fascisme créé un an plus tôt par Henri Barbusse et Romain Rolland. Dans de nombreux articles, il dénonce le régime nazi. Lors de la guerre d’Espagne, il s’engage dans les Brigades internationales. Revenu dans la région, il devient responsable de la presse communiste dans le Nord et le Pas-de-Calais.Lors de la dissolution du Parti communiste en 1939, il est révoqué de l’Education nationale et arrêté. A sa libération, en 1940, il s’engage dans le Parti communiste clandestin, il en devient, dans la «zone rouge», responsable ainsi que des Francs tireurs et partisans. Arrêté en mai 1942, il connaît une douzaine de prisons françaises avant d’être déporté à la forteresse de Huy, puis à Sachenhausen et à Buchenwald. Lors de son retour en France en mai 1945, Jean-Marie Fossier devient rédacteur en chef du quotidien communiste Liberté puis directeur de l’imprimerie. En 1960, il réintègre l’Education nationale comme professeur de lettres. Jean-Marie Fossier est élu conseil municipal de Lomme en 1945, 1947 et 1953. Il est candidat lors des élections législatives de 1962 dans la 5 e circonscription du Nord. En 1977, il publie Nord-Pas-de-Calais. Zone interdite. Mai 1940-mai 1945
Source(s) :Maitron, Dictionnaire du mouvement ouvrier.
-
FOUBERT Eugène
Devenu instituteur parce que son père l’était, Eugène Faubert se rêvait journaliste. Fils de Constant Victor Foubert et de Désirée Marie Olympe Berson, Eugène Constant Joseph Foubert, né le 13 septembre 1876 à Thorigné, entra donc à l’Ecole normale d’instituteurs de Laval. Un an après sa sortie muni de son CAP, il quittait l’enseignement et effectuait, à partir de novembre 1897, son service militaire au 124e RI où il était reçu chef de section.
En 1898, il entrait au Grand Echo du Nord à Lille dont la rédaction était dirigée par Emile Ferré ancien rédacteur à L’Avenir de la Mayenne. Edité à Laval, ce journal était la propriété de Kavanagh, beau-père de Ferré. Au Grand Echo, Eugène Foubert fut successivement reporter, rédacteur économique et secrétaire de rédaction.
Ambitionnant de revenir dans sa région d’origine, il quitta le quotidien lillois pour fonder à Angers un hebdomadaire mi-économique, mi-mondain Le Pays bleu. Ce qui ne l’empêcha jamais de se prévaloir de sa qualité d’ancien rédacteur de L’Echo du Nord. D’ailleurs, il ne rompit jamais avec le Nord de la France. Le 11 août 1905, il épousait à Saint-Amand-les-Eaux Marie Virginie Adèle Broutin, fille d’un négociant de la ville, et Emile Ferré fut son témoin.
Directeur du Pays bleu, il créa également le Courrier des plages (1907-1910) et l’Annuaire mondain de la vallée de la Loire. En 1910, il allait pouvoir donner la pleine mesure de son talent en créant avec Gaston Paré, directeur du Patriote de l’Ouest,un « quotidien régional républicain d’information rapide », L’Ouest, rayonnant sur l’Anjou, le Maine, la Vendée et le Poitou. La même année, il reprenait le mensuel illustré La Vie nantaise dont il faisait un hebdomadaire. Tout en conservant ses fonctions à Angers, il était appelé en juillet 1913 à diriger le quotidien lillois Le Progrès du Nord. C’est d’ailleurs à Lille que la Première Guerre le surprit.
Passé dans la réserve de l’armée active en novembre 1900, Eugène Foubert n’avait cessé d’accomplir des périodes d’exercices et avait été plusieurs fois promu. Le 1er août 1914, il accédait au grade de lieutenant. Mobilisé, il partit au front dès le 13 août. Après sept mois, il revint à Angers pour instruire la classe 1916, puis repartit combattre dans l’est. Le 30 avril 1916, il était tué lors d’un bombardement allemand à la côte 304, dans le secteur de Monzeville- Esnes. Agé d’à peine 40 ans, il était père de deux enfants.
Sources : AD Mayenne, R 1467 ; AD Nord, 1 Mi EC 526 R 009 ; Le Petit Courrier, 20 janvier 1907, 9 juillet 1913, 12 mai 1916 ; Le Patriote de l’Ouest, 26 novembre 1910 ; Le Phare de la Loire, 19 février 1910 ; L’Avenir de la Mayenne, 21 mai 1916.
-
FOUCRAY Léon
Léon Eugène Foucray est enseignant à l’Ecole supérieure de commerce de Lille. Lors du lancement du quotidien socialiste Le Cri du Nord, parallèlement, il en devient secrétaire de rédaction jusqu’à sa mort le 20 novembre 1920. Léon Foucray était officier d’Académie depuis juillet 1899.
Source(s) :Le Cri du Nord, 22, novembre 1920; Le Grand Echo du Nord, 21 juillet 1899 et 22 novembre 1920.
-
FOUJADOIRE Eugène
Eugène Foujadoire est chef du service publicité du Grand Echo du Nord en 1929.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
FOURRIER Hubert
Professeur pendant quelque deux ans à l’institution Sainte-Austreberthe à Montreuil-sur-Mer, Hubert Fourrier opta pour le journalisme en avril 1927 où il entra, à Lille, au Télégramme du Nord comme secrétaire de rédaction. A la disparition de ce quotidien, il passa au Réveil du Nord en qualité de premier secrétaire de rédaction, chargé des informations générales et de la mise en page de la «une». Le 1 er novembre 1930, il optait pour l’Echo du Nord où parallèlement au poste de secrétaire de nuit, il assurait la correspondance de plusieurs quotidiens: Le Petit Journal , Le Progrès de la Somme , etc. En octobre 1944, Hubert Fourrier ouvrit, seul en poste, l’édition de Boulogne de La Voix du Nord qu’il développa malgré une concurrence très rude. En mars 1959, il était nommé chef des éditions du littoral, poste qu’il occupa jusqu’à sa retraite en mai 1968. Membre du SNJ, depuis la création de la section Nord-Pas-de-Calais, il fut vice-président de l’APJ du Pas-de-Calais et de l’Amicale des journalistes lillois.
Source(s) :La Voix du Nord, 15 décembre 1981.
-
FRANCIOSI Charles de
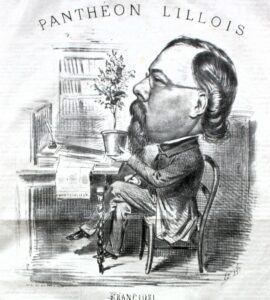
Portrait de Charles de Franciosi paru dans L’Abeille lilloise. Né à Arras, Charles de Franciosi fut élève au collège de sa ville natale, puis de Saint-Germer en Normandie. Préparant l’école des mines, il y renonça à la suite de problèmes de santé. Il entra dans l’administration départementale du Pas-de-Calais. En 1845, il rejoignit l’entreprise familiale, mise à mal par la crise de 1848.
Il intégra ensuite le quotidien La Liberté fondé par le marquis d’Havrincourt. A la fin de l’année 1849, il rejoignit le Journal de Lille de Danel, qui devint le Nord en 1852-1853 à la suite d’un changement de propriétaire. Ce périodique repris par Danel, Francosci en devint le rédacteur en chef. Parallèlement, il collabora à la Revue du Nord de Brun-Lavainne et dirigea l’éphémère Flandre illustrée en 1858. Il fut l’auteur de plusieurs livrets d’opéra : Le Siège de Lille, Les Plumes de paon, La Parodie du trouvère,… mais aussi d’ouvrages divers comme l’Histoire de la collégiale de Saint-Amé de Douai, l’Histoire du jubilé séculaire de Notre-Dame de la Treille, Itinéraire de Paris à Cologne,…
Dans sa nécrologie, parue le samedi 7 mars 1896 dans Le Grand Echo du Nord, on peut lire : « M. de Franciosi avait occupé une place importante dans la presse lilloise. Il a publié de nombreux travaux littéraires. »
Source(s) :l’Abeille lilloise , Dimanche 10 mars 1867; Le Grand Echo du Nord, Samedi 7 mars 1896, p.2.
-
FRANCQ Georges, Jules, Hyacinthe
Professeur de lettres et d’histoire au collège d’Arras puis au collège de Boulogne-sur-Mer à partir de 1914, Georges Francq remplace Chabé comme rédacteur en chef de l’ARN, L’Agriculture de la Région du Nord. Ecrivain érudit, il a collaboré à de nombreux quotidiens (L’Avenir d’Arras, La France du Nord… ) et périodiques avant de prendre la direction de l’ARN. Secrétaire de la section arrageoise de l’Alliance française, vice-président de la Société de géographie d’Arras, il fait de nombreuses conférences pour des associations et a prêté un concours actif aux œuvres agricoles. Il fut fait chevalier de la Légion d’honneur en 1922.
-
FRANQUET Gaston
Secrétaire général de la rédaction du Progrès du Nord qu’il quitte en juin 1909. On le retrouve après la Première Guerre comme rédacteur au Journal de Lens.
-
FRANS Charles
Agent d’assurances, Charles Frans dirige de 1897 à 1914 Le Journal d’Hénin-Liétard et du Petit Lens. Il collabore également au Carillon de Béthune et au Journal de Béthune où il écrit tant sous son nom que sous le pseudonyme de D. Frandsen . Très impliqué dans la vie locale, il est membre de la Société d’économie sociale et président de l’Union commerciale d’Hénin-Liétard. Militant catholique, il préside L’Union catholique. Membre de la Société des gens de Lettres, membre correspondant de l’Académie d’Arras, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont une histoire d’Hénin-Liétard.
Source(s) :L’Agriculture de la Région du Nord, 25 août 1928.
-
FREDERIC Ernest
Fils unique de Louis Frédéric, ouvrier imprimeur, et Eugénie Céline Boucheaux, marchande, Ernest Louis Joseph Frédéric naît le 24 mars 1861 à Béthune.
A la mort de son père avant 1881, il lui succède à la tête de l’imprimerie familiale et de La Gazette de Béthune . Il dirige le périodique jusqu’à sa mort en avril 1909, à l’âge de 48 ans.
Sa femme, Eugénie Caroline Marie Bonvarlet, épousée en 1899, prend sa succession.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 119/8 et 3 E 119/104
-
FREDERIC Louis
Né à Paris de père et de mère inconnus, le 27 mars 1835, Louis Frédéric s’établit à Béthune où il épouse Eugénie Céline Boucheaux, marchande. Imprimeur, Louis Frédéric lance le 19 octobre 1873 La Gazette de Béthune . Il meurt à 44 ans le 1 er mars 1880.
-
FREDERIC Mme née Bonvarlet
Femme d’Ernest Frédéric, imprimeur et directeur de La Gazette de Béthune , elle reprend l’imprimerie de son mari à la mort de ce dernier. A la veille de la guerre, elle est directrice du périodique.
-
FREMAUX Paul
Fils de Charles Jean Louis Frémaux, marchand de meubles à Lille, et de Marie Béatrix Dereuille, Paul Frémaux, ses baccalauréats obtenus, découvre l’imprimerie et le journalisme chez son beau-frère Charles Richard, propriétaire de La Revue artésienne, un hebdomadaire publié à Béthune depuis 1830. Après quelques mois passés au sein de ce périodique dont l’un de ses articles vaut à son beau-frère un duel, Paul Frémaux rentre en 1905 au quotidien L’Echo du Nord comme rédacteur régional pour les secteurs de Béthune, Hazebrouck et Saint-Pol-sur-Ternoise. Le 1 er octobre 1906, il effectue son service militaire au 73 e RI. Déclaré inapte physiquement, il est affecté, le 23 février 1907, à la 1 re section d’Etat major et de recrutement. Il est libéré le 29 juillet 1909 avec le grade de sergent fourrier. Paul Frémaux reprend sa place au Grand Echo du Nord jusqu’à la déclaration de guerre en août 1914.
Nommé officier de réserve, il est affecté comme gestionnaire de l’hôpital temporaire de Dunkerque, n° 3, puis il est nommé officier d’administration aux services d’Etat major et de recrutement alternativement des places fortes de Dunkerque et de Calais. Il est mis en congé le 13 avril 1919. Sa conduite pendant la guerre lui vaut la croix de Guerre, la médaille interalliée et commémorative de la Guerre, et d’être fait chevalier de la couronne de Belgique à titre militaire.Paul Frémaux reprend sa place de rédacteur au Grand Echo du Nord pour quelques mois avant de fonder avec l’un de ses confrères, Lucien Bauchat, un hebdomadaire économique Le Nord industriel dont le premier numéro sort en octobre 1919. Quelques années plus tard, les deux hommes créent également Le Nord charbonnier.
Parallèlement à ses activités journalistiques, Paul Frémaux est chargé de missions pour divers groupements économiques. Ses activités sont récompensées par diverses distinctions, il est notamment nommé chevalier du Mérite agricole, officier d’académie et, en 1925, chevalier de la Légion d’honneur par décret du ministre des Travaux publics.Mobilisé en août 1939, il se trouve à Limoges lors de la signature de l’armistice, il ne rentre à Lille qu’en 1942. Malade, il vend ses parts dans la Société Frémaux, Bauchat et Cie qui édite Le Nord industriel à son chef de publicité, Louis Gauche, et regagne la zone libre. A la libération, il devient directeur et rédacteur en chef du Progrès du Nord jusqu’à sa retraite. Durant la guerre, Paul Frémaux publie plusieurs ouvrages sous le pseudonyme de Paul André de Maufrey: L’abbé Cambronne en 1942, Quand l’amour s’en mêle en 1943, D’une femme à l’autre en 1944.
-
FRERE Emile
Imprimeur à Tourcoing à partir de 1879, Emile Frère fonde en mars 1881 Le Carabinier français qui devient Le Carabinier gymnaste . Secrétaire de la fédération des sociétés de tir à longue portée dès sa fondation en 1883, il crée en 1889 la Société municipale de gymnastique de L’union tourquennoise.Emile Frère était officier d’Académie depuis 1888.
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord, 1893.
-
FRERE VincentNé à Fleurbaix au sein d’une famille de catholiques fervents, Vincent Frère est d’abord directeur de l’école Saint-Joseph de Laventie, où il crée, en 1936, une imprimerie artisanale.
Mobilisé en 1940, il rejoint la zone interdite après sa démobilisation où il participe à la Résistance au sein des FTP. Dès 1941, il imprime des tracts ainsi que certains numéros du journal clandestin L’Indépendance. A partir de mai 1943, il participe au réseau de renseignements «Hunter Nord». Il fonde une seconde imprimerie à Fresnes-sur-Escaut d’où sortent plusieurs numéros du Nord Libre. A la demande de Jules Houcke, il imprime à Laventie les deux derniers numéros de La Voix du Nord clandestine. En 1945, il devient directeur-gérant de L’Indépendant, périodique publié à Saint-Omer. Jusqu’à sa retraite, en 1965, il s’efforce de développer ce journal dont la direction échoit à son beau-fils Noël Devos. De 1946 à 1953, Vincent Frère est membre du conseil de surveillance du quotidien La Voix du Nord. Il était titulaire de nombreuses distinctions.
Source(s) :La Voix du Nord, «Il avait imprimé les derniers numéros de «La Voix du Nord» clandestine. Vincent Frère n’est plus», 20 décembre 1996.
-
FRY Eugène Jules
Né à Douai le 7 février 1857, Eugène Jules Fry est le fils d’un inspecteur primaire, Auguste Jules Fry. Il est d’abord rédacteur en second d’un journal éphémère. Selon la police, il «est sympathique et estimé». Il est «républicain et sa conduite est bonne. Il vit du produit de son travail et sa mère [née Eugénie Joséphine Deregnaucourt] avec laquelle il reste, touche une pension de l’Etat en qualité de veuve des fonctionnaires».
Fry est ensuite rédacteur de l’édition douaisienne du quotidien lillois L’Echo du Nord . Célibataire, il meurt à son domicile 2, rue de l’Abbaye des près à Douai le 27 mai 1913.
Source(s) :AD Nord, 1T 222; Le Grand Echo, mercredi 1er janvier 1896, n° 1, 78e, année, p. 1.
-
FUMEL F.
Imprimeur-libraire à Lillers, F. Fumel crée en août 1884 Le Journal de Lillers qui passe entre les mains de Maurice Boussemaer en novembre 1889.
D – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais G
-
GABRIEL Paul
Fils d’un maître de chapelle, Paul Eugène Gabriel, né à Douai, consacra sa vie au journalisme. C’est au journal catholique L’Emancipateur de Cambrai, sous la direction d’Ernest Delloye, qu’il entama sa carrière professionnelle. Il passa ensuite à L’Indépendant du Pas-de-Calais édité à Saint-Omer. A la mort de Léon Brodel en février 1895 .il en devint rédacteur en chef.
Durant la Première Guerre mondiale, Paul Gabriel, resté à Saint-Omer située à proximité du front, continua à faire paraître son journal. Il dirigea le quotidien audomarois jusqu’à sa mort en octobre 1920.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 020 R 063; AD Pas-de-Calais, 3 E 765/431; Le Grand Echo du Nord, 30 octobre 1920.
-
GACHET, Édouard
Maître de pension de 1825 à 1830, principal du collège communal de 1830 à 1842, Gachet fut démis de ses fonctions par le ministère de l’Instruction publique en 1842. On lui offrit la direction de l’école normale de Douai, qu’il refusa. Il rouvrit son pensionnat, et la municipalité lui offrit, à titre de compensation, la direction de la bibliothèque municipale. En 1843 Gachet fut pris à partie par Hennebault, conseiller municipal, qui réclama qu’on le paie proportionnellement au temps qu’il consacrait à la bibliothèque, ses nombreuses fonctions maître de pension, instituteur primaire, professeur adjoint des écoles chrétiennes, membre du comité local d’instruction primaire, membre de la commission de surveillance du travail des enfants dans les manufactures, membre de la commission de surveillance des prisons, sans compter ses activités au sein de plusieurs associations pieuses et enfin collaborateur de La Gazette de Flandre et d’Artois et au Journal de Lille l’occupant fort par ailleurs. Gachet a aussi collaboré à La Revue du Nord de Brun-Lavainne de 1834 à 1836. On lui doit Du dévouement , un livre écrit pour réfuter les doctrines phalanstériennes, et plusieurs ouvrages didactiques, par exemple La Jeune fille chrétienne , (Vanackère fils, 1836), la Lecture par les couleurs, exposé de la méthode, avec les moyens de l’employer… (Paris : Delarue), un Petit trésor de l’enfance, ou Exercices gradués de mémoire à la portée des plus jeunes enfants, par deux amis de la jeunesse , en collaboration avec J. Deligne (Paris, E. Ducrocq, 1840), des Instructions et règlement pour une institution chrétienne , (L. Lefort, 1843) et des Instructions et règlement d’une maison d’éducation , (L. Lefort, 1846), etc.
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869…, Lille, Leleu, 1869; Le Moulin-à-Vent, (1843).
-
GAILHABAUD, Jules
De 1830 à 1839 Jules Gailharbaud dirige le commerce familial de textile à Lille puis à Paris. Il commence à réunir, dès le début des années 1830, livres, manuscrits et gravures en rapport avec l’histoire de l’architecture, notamment parisienne, et consacre sa fortune pendant plus de vingt ans à la publication d’une immense œuvre. Il conçoit, en effet, avec trois ouvrages distincts, une véritable encyclopédie de l’architecture, richement illustrée de gravures. Le premier, Monuments anciens et modernes , est diffusé en deux cents exemplaires de 1840 à 1850. Chaque livraison est constituée d’une succession de notices composées de plusieurs planches monumentales et d’un commentaire assez court. En 1844, il fonde la Revue archéologique qu’il dirige trois mois. En 1845, il crée la revue Bibliothèque archéologique, ou Recueil de documents sur l’histoire, l’archéologie, qu’il publie jusqu’en 1846. En septembre 1850, il publie les quatre tomes de son ouvrage Monuments anciens et modernes. En 1866, il vend à la Ville de Paris sa bibliothèque (25 000 gravures, 1 500 dessins et 8 500 manuscrits et imprimés), moyennant 125 000 francs et un emploi à vie. De 1866 à 1871, il est en conséquence fonctionnaire à la section des Travaux historiques de Paris. En 1867, il est chargé de la création du musée de l’Ustensillage, devenu plus tard, sur un tout autre concept, musée Carnavalet. Organisant les salles de la même manière qu’il a constitué ses séries monumentales, c’est-à-dire dans un but pédagogique avec une présentation chronologique puis thématique, constituant une «véritable encyclopédie de la vie quotidienne des Parisiens depuis la Renaissance» et annonçant le musée des Arts et Traditions populaires, Gailhabaud cherche à intéresser un large public. Aussi le musée connaît-il un vif succès sous la Commune, car le désir d’offrir une éducation artistique aux catégories sociales les moins cultivées trouve un écho dans les idéaux des communards. Cependant Gailhabaud est sacrifié avec son musée le 15 septembre 1871, par la première Commission des beaux-arts de la III e République. On l’accuse d’avoir «dénaturé l’idée première du musée et créé, par l’irrégularité de sa gestion, les plus graves embarras à l’administration municipale». En 1871, sa bibliothèque sera détruite dans l’incendie de l’Hôtel de ville. De 1877 à 1888, il subsiste grâce à des indemnités littéraires du ministère de l’Instruction publique.
Source(s) :D’après la notice de Peggy Rodriguez pour L’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), et Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869…, Lille, Leleu, 1869.
-
GAILLARD André
André Gaillard était un homme de caractère qui portait bien son nom. Dans son attitude, par sa façon de vivre et de parler, par l’autorité qui émanait de sa personne, par ses convictions monarchistes, c’était un gaillard, un vrai!
Né dans une famille d’artisan-commerçant dans l’Aube, il s’engagea dès 1939, lors de la déclaration de guerre, dans les troupes méharistes qui sillonnaient le Sud marocain et le Sahara occidental.
De retour en métropole, après l’occupation de la zone Sud par les Allemands en 1942, il vécut en clandestin avant de rejoindre les rangs de la 1 re Armée française du général de Lattre de Tassigny. Il obtint la croix de guerre 39-45 pendant la campagne d’Alsace. Sportif, il devint correspondant de plusieurs journaux locaux en Haute-Marne avant de devenir journaliste professionnel à L’Union de Reims. Il fut recruté par La Voix du Nord en 1954 et travailla à l’agence locale de Dunkerque plusieurs années, étant à l’origine de la course « les 4 jours de Dunkerque» qui prit une ampleur nationale chez les professionnels du cyclisme. Il intégra ensuite le siège lillois du quotidien, fut affecté au secrétariat de rédaction de nuit en collaborant, le jour à l’ORTF, radio et télévision ensuite. Durant plusieurs années, il présenta le journal TV régional le midi en même temps qu’il collaborait à l‘hebdomadaire Télé 7 Jours . Nommé grand reporter pour les faits-divers régionaux et nationaux, il prit en main la rédaction lilloise de La Voix du Nord pour terminer sa carrière le 30 juin 1985 comme chroniqueur gastronomique et titulaire de la rubrique Tourisme ce qui l’amena à voyager dans tous les plus beaux sites du monde. Il publia un Guide de la Gastronomie du Nord Pas-de-Calais et collabora avec un confrère, François Leclercq, à la rédaction d’un ouvrage historique sur les derniers jours de la Grande Guerre avec le témoignage des survivants pour le 50 e anniversaire de l’Armistice de 1918.
Quelques semaines avant sa disparition, il mettait la main à une plaquette sur « les combats de coqs en Flandre» malgré les séquelles d’un AVC qui l’avait laissé hémiplégique.
-
GALLOS Jules
F ils de Jules Charles Gallos, maître peintre, et d’Adèle Aimée Vanryssel, Jules François Joseph Gallos est né à Coukerque-Branche le 26 juillet 1901. Agé d’à peine 20 ans, il devient journaliste à la rédaction lilloise du Grand Echo du Nord . En 1925, il se marie à Boulogne-sur-Mer avec Renée Juliette Désirée Vincent, originaire de Rouen. Dans les années 1930, il fonde «La Tribune lilloise» qui propose une série de conférences tout au long de l’année.Il quitte Lille pour Paris où l’on retrouve sa signature dans Paris-Soir. Il meurt à l’âge de 40 ans le 23 février 1942.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
GARÇON Jules
Jules Garçon, qui prit pour nom de plume Georges Lertevanic, fit paraître de nombreux articles et poèmes dans des revues régionales. Il est tombé le 14 octobre 1918 à Neuvillette dans l’Aisne, près d’Origny-Sainte-Benoîte . Il est le fondateur d’un journal Les Cats Huants : « journal pour maintenir le bon moral des blessés et des camarades », et collabora au 120 court , journal de tranchée créé par Clovis Grimbert.
Source(s) :Association, Les Échos du Pas-de- Calais.
-
GARREAU Philippe Constant
Garreau prend la gérance du quotidien républicain arrageois L’Ordre le 1 er août 1870 . Mobilisé avec le grade de chef de bataillon de la garde nationale, il renonce à cette gérance qui est confiée à Léon Gramain. Blessé lors de la bataille de Saint-Quentin, il meurt à Arras le 6 février 1871. Il laisse deux orphelins qui perdent leur mère quelque temps plus tard. Philippe Garreau est fait chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, ibid; Site Léonore, dossier de Légion d’honneur.
-
GARREZ Frédéric
Membre de la fédération communiste du Pas-de-Calais, Frédéric Garrez collabore à L’Enchaîné. Il est assigné en justice par les Mines de Lens.
-
GAUCHE Louis
Né dans la région parisienne d’un père capitaine en retraite et chevalier de la Légion, Louis Gauche effectue l’essentiel de sa carrière professionnelle à Lille où il sera directeur commercial ou directeur des services de publicité de différents journaux.
Après trois années dans l’Armée comme engagé volontaire, Louis Gauche, blessé en service commandé, est réformé le 3 août 1907. Il entre alors à l’agence Jones. En janvier 1914, il est chef du service «publicité» du quotidien lillois Le Progrès du Nord dont il devient directeur commercial le 1 er septembre 1924. Parallèlement, il est chef des services de publicité des journaux Nord industriel, Nord charbonnier et La Renaissance agricole, mais également de L’Indépendant de Cambrai, du Courrier de l’Ain, de La Liberté de l’Ain, de L’Avenir de Pithiviers… Fort de ces différentes fonctions, Louis Gauche est élu président de la Chambre syndicale de la publicité du Nord de la France et de la mutuelle de la publicité du Nord. Il est également membre de plusieurs associations professionnelles ou culturelles. Il participe à l’organisation de la foire commerciale internationale de Lille et à l’exposition de Progrès social de Lille. En 1931, il est fait chevalier de la Légion d’honneur et en 1933 officier de l’Instruction publique. La même année, Louis Gauche est nommé directeur-administrateur délégué du Progrès du Nord , devenu hebdomadaire. Le journal ne paraît pas durant l’Occupation et son directeur peut donc le relancer à la Libération tout en cumulant les fonctions de directeur de la publicité dans d’autres journaux. En 1949, Louis Gauche est promu officier de la Légion d’honneur. Il meurt en 1973 à Wattignies dans la banlieue lilloise, Le Progrès du Nord avait cessé sa parution en 1965.
Source(s) :AD Nord, M 149/143 et M 149/143; Site Léonore, dossier de légionnaire.
-
GAUTHRIN Emile
Engagé volontaire au 106 e RI le 1 er mars 1899, alors qu’il est encore étudiant, Emile Auguste Gauthrin, fils d’un carrier et d’une institutrice publique, est réformé pour hystérie le 10 juillet 1900. D’abord rédacteur au Petit Calaisien , il succède en 1905 à Joseph Dessaint comme rédacteur en chef de L’Avenir d’Arras et du Pas-de-Calais où il ne fait que passer. La même année, il occupe les mêmes fonctions au Spectateur, moniteur démocratique de L’Est édité à Langres. En mai, il se bat en duel au revolver d’ordonnance contre un confrère du périodique En Avant , les deux hommes se réconciliant après l’échange de deux balles. Dès 1907, alors qu’il devient membre de l’Association professionnelle de la presse républicaine, il semble avoir délaissé le journal haut-marnais. L’année suivante, il est en effet domicilié à Paris. Gauthrin quitte la capitale pour la côte normande où il est directeur de L’Impartial de Dieppe . En septembre 1910, il est nommé officier d’Académie et février 1914, en chevalier du mérite agricole. Après la Première Guerre, il poursuit sa carrière de journaliste dans l’Est où il exerce dans différents journaux. On le retrouve directeur du Journal des Ardennes et du Nord-Est imprimé à Charleville. En octobre 1924, il arrive à Epinal où il est successivement rédacteur en chef du journal radical-socialiste La Tribune des gauches puis de L’Express de l’Est. Il gagne ensuite Belfort pour prendre la direction du Républicain de Belfort créé le 30 janvier 1926 pour soutenir la candidature d’André Tardieu dans ce territoire. C’est d’ailleurs lorsque Tardieu occupe son premier poste ministériel qu’il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. En octobre 1935 son retrait du Républicain de Belfort après plus de trente de journalisme serait, selon La Tribune de l’Aube , la cause de l’arrêt du quotidien belfortain. Cette retraite n’est cependant que de courte durée, Gauthrin prend en effet le 20 octobre 1937 la direction de la rédaction du Progrès de la Côte-d’Or fondé en janvier 1869. Si le quotidien dijonnais suspend sa publication à partir du 16 juin 1940, il la reprend une dizaine de jours plus tard et son rédacteur en chef se fait, durant l’Occupation, le héraut du régime de Vichy et de la collaboration. Le journal est interdit de parution le 4 septembre 1944 et Emile Gauthrin est condamné à mort le 27 février 1945. Bénéficiant de plusieurs remises de peine, il meurt dans sa 82 e année à Dijon.
Source(s) :AD Aube, 4 E 14310 et 3 R 549; La Patrie, 24 mai 1905; Le Petit Troyen, 7 septembre 1905; La Dépêche d’Eure-et-Loir, 20 septembre 1907; Le Bourguignon, 27 septembre 1910; Le Petit Courrier de Bar-sur-Aube, 17 février 1914; L’Express de l’Est, 12 et 13 octobre 1924, 14 août 1929; La Tribune de l’Aube, 24 octobre 1935et 14 novembre 1937; La Bourgogne républicaine, 28 février 1945.
-
GEOFROY Jules Paul
Fils de Lucien Geofroy, percepteur des contributions directes ,et d’Anaïs Camille Bertrand de Sivray, Paul Geofroy, originaire des Landes, était à la fois sculpteur et publiciste, si on en croit son acte de décès.
Secrétaire de rédaction et collaborateur de Th Bergès, rédacteur en chef du Progrès du Nord , Geofroy devient directeur et rédacteur en chef du Nord , organe de la politique radicale à partir de décembre 1887. Il meurt le 5 février 1890 à l’âge de 37 ans.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 350 R 106; Libéral du Nord, (Douai), 16 décembre 1887, Le Grand Echo du Nord, 31 janvier 1891.
-
GERARD , Alphonse
Alphonse Gérard publie, à 19 ans, ses premiers poèmes dans les Affiches, annonces et avis divers et feuille d’annonces de Boulogne-sur- Mer , il passe ensuite à L’Annotateur puis à La Boulonnaise. De 1827 à 1830, il étudie le droit à Paris et devient avocat au barreau de Boulogne. Bibliothécaire, il fut également secrétaire de la Chambre de Commerce de Valenciennes . Adolphe Gérard était l’ami du général José de San Martin, libérateur de l’Argentine, du Chili et du Pérou, retiré à Boulogne-sur-Mer où il meurt en 1850 dans la maison de l’avocat boulonnais, devenue Le Musée du Libertador . Retiré à dans le village Wirwignes, dans l’arrondissement de Boulogne-sur-Mer , il meurt le 6 octobre 1878. S ource: Ernest Deseille, Histoire-revue du journalisme boulonnais depuis son origine , Mémoire présenté à la Société académique de l’arrondissement de Boulogne dans les séances des 10 janvier, 7 mars, 7 novembre, 5 décembre 1866 et 6 mars 1867.
-
GERARD , Maurice,
Pseudonyme de Lafaille.
-
GEUS Jacques
Responsable des relations publiques du Port de Dunkerque, Jacques Geus embrasse la carrière de journaliste en entrant, en janvier 1970, au quotidien de Roubaix, Nord-Eclair . Il est par la suite nommé chef de l’édition de Roubaix, puis chef des informations régionales dans le même journal qu’il quitte en 1997 pour prendre sa retraite.
-
GHESQUIERE Henri
«Grand, maigre, figure et teint pâle, abord peu sympathique, […] tête d’un forçat», le portrait que la police dresse d’Henri Ghesquière, «le socialiste collectiviste le plus violent de son parti», est bien peu amène. Qui s’en étonnerait en 1895?
Patriote épris de justice sociale, ancien ouvrier textile, l’homme a été «marchand de journaux», puis il a collaboré à la rédaction de plusieurs journaux socialistes dont Le Travailleur. Organe du parti ouvrier de la région du Nord , puis au Réveil du Nord d’Edouard Delesalle , et à L’Égalité de Roubaix-Tourcoing et à Roubaix socialiste.
«On lui prête l’ambition d’être quelque chose» note également la police à la même époque. Membre du Parti ouvrier français, il a été élu, après plusieurs tentatives, conseiller général dans le canton sud-ouest de Lille le 4 août 1895. L’année suivante, il entre au conseil municipal de Lille. Enfin en 1906, il devient député de la deuxième circonscription de Lille. Otage pendant la guerre, il meurt en captivité.
On lui doit des brochures: A bas le socialisme!, La mine et les mineurs , Un budget bourgeois , La femme et le socialisme et deux pièces de théâtre à caractère social: Monsieur Pierre, pièce socialiste en deux actes et, en collaboration avec A. Salembier, Les irresponsables, drame en trois actes.
Source(s) :AD Nord; Vanneste, Bernard, Augustin Laurent, ou toute une vie pour le socialisme, Dunkerque, Ed. des Beffrois; M, énager (Bernard), Florin (Jean-Pierre), Guislin (Jean-Marc), Les Parlementaires du Nord et du Pas-de-Calais sous la IIIeRépublique, Centre de recherche sur l’histoire de l’Europe du Nord-Ouest, Lille 3, 2000; La Vie flamande illustrée, n° 90, 16 juin 1906.
-
GIBOUT Henri
Fils de Jules Gibout, instituteur à Pure dans les Ardennes et de Catherine Lesieur, Jean Antoine Henri Gibout arrive à Lille pour y suivre des études de Lettres, il rate le concours d’entrée à l’école normale supérieure et s’oriente vers le journalisme.
Il fait un bref passage au Réveil du Nord . Embauché à la fin du mois d’août 1895 pour remplacer Charles Bailleul, parti à L’Echo du Nord , il est, selon la police, «congédié le 25 septembre pour mauvais services, dettes, etc.» Il passe à L’Echo du Nord où il s’était fait remarquer en remportant un concours de littérature organisé par le journal. L’appréciation que la police porte sur lui n’est guère plus favorable: « c’est le type même du bohème, s’occupant de tout, ne s’arrêtant à rien, faisant la noce et négligeant beaucoup les devoirs de sa profession». Quelque temps plus tard, Henri Gibout quitte Lille pour Cambrai où le journal qui l’emploie cesse rapidement sa parution.
Chef du secrétariat particulier du député-maire de Cambrai, Paul Bersez, il garde le titre de publiciste bien qu’il n’exerce plus dans aucun journal. Titulaire des Palmes académiques, du Mérite agricole, il est également officier de l’Instruction publique.
Le 5 février 1912, Henri Gibout met fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête.
Source(s) :AD Nord 1T 222/12, La Vie flamande illustrée, 5 janvier 1904 et 2 mars 1907; Le Grand Echo du Nord, 7 février 1912.
-
GIBOUT Jacques
Longue silhouette et chevelure romantique, Jacques Gibout vivait uniquement pour le théâtre et était devenu, malgré son jeune âge, un érudit en la matière, comme l’écrivait, le 24 janvier 1925, Eugène Saillard dans Le Grand Echo du Nord . Un brillant avenir de chroniqueur théâtral s’ouvrait probablement pour lui qui venait d’être remarqué par un journal spécialisé parisien, lorsqu’il disparut accidentellement le 22 janvier 1925. Fils de Henri Gibout, qui fut lui-même journaliste à Lille et à Cambrai, Jacques Samuel Gibout était chroniqueur théâtral au quotidien Le Télégramme du Nord dirigé par Martin-Mamy, il collaborait également à l’hebdomadaire lillois Spectacles. C’est en sortant d’un taxi alors qu’il regagnait son journal qu’il fut renversé par une voiture et tué sur le coup. Sa mort causa une immense émotion parmi le monde artistique régional et parmi ses confrères qui lui élevèrent un monument dû au sculpteur Soubricas.
Sa fiancée, professeur à Armentières, ne supporta pas sa mort. Quelques jours après, elle se jeta sous l’express Calais-Lille à la hauteur d’Armentières.
Source(s) :AD Nord, 3 E 15447; Le Grand Echo du Nord, 24 janvier 1925.
-
GILLET Georges
Georges Gillet est rédacteur en chef de La République libérale d’Arras et du Pas-de-Calais lors de son lancement en 1893. Sa signature disparaît rapidement et il n’apparaît plus dans les effectifs du journal. Il signe à nouveau le billet politique en juin 1896 lors du départ du directeur Antoine Woisard. En juillet 1896, son nom accompagné de sa fonction, rédacteur en chef, apparaît à côté du titre. Le 19 septembre, La République libérale annonce son départ pour des raisons de santé.
Source(s) :La République libérale.
-
GIRARD Henry
Henry Girard est rédacteur en chef du Nord-Maritime en 1893.
-
GLASTER Claude
Entré à la rédaction tourquennoise de Nord Eclair le 1 er janvier 1961, Claude Glaster passe en octobre 1968 à La Voix du Nord où il travaille au bureau d’Etaples. Il est ensuite nommé chef du bureau de Seclin, poste qu’il occupe jusqu’à son départ en retraite.
-
GOBERT Léon
Léon Gobert commence sa carrière de journaliste à Nancy au Progrès de l’Est . Il témoigne, en 1903, dans La Vie flamande : «En 1887, il y a seize ans […], débuts dans la presse à Nancy. Pas sensationnel ces débuts! Reportage: police, gendarmerie, chiens écrasés, crimes et suicide, puis, peu à peu, initiation aux secrets du métier». Gobert arrive à Lille en 1891 pour travailler à L’Écho du Nord , dont il devient secrétaire de rédaction, puis secrétaire général jusqu’en 1914, tout en continuant d’écrire sur ses sujets de prédilection: grandes manœuvres, questions locales et théâtre. Pendant la guerre, il est rédacteur en chef du Journal des réfugiés du Nord , réalisé à Paris et diffusé chez les ressortissants du Nord et du Pas-de-Calais qui ont réussi à fuir l’occupation allemande. Parallèlement il entame une carrière politique. Il est élu conseiller municipal en 1904 et le reste quatorze ans. Selon la police, il «déteste les cléricaux, les socialistes et les sectaires, il a des théories à part qui sont celles de l’individualisme». En novembre 1919, il se présente aux élections législatives sur la liste d’entente conduite par Louis Loucheur, ministre de la Reconstruction industrielle sur laquelle se trouvent l’abbé Lemire et Henri Langlais. Placé en 16 e position, il n’est pas élu. Il travaille ensuite à Paris pour la Journée industrielle, financière, économique . Il meurt à Nice le 8 février 1942 à l’âge de 74 ans.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/12; La Dépêche, 16 novembre 1919.
-
GODEFROY Charles
Charles Godefroy est rédacteur à La Gazette de Flandre et d’Artois , puis à La Gazette de France de 1832 à 1846.
-
GOSSET Paul
Après avoir été sous-directeur dans un tissage, Paul Edouard Gosset, fils d’un employé du chemin de fer, se tourne vers le journalisme. Il travaille notamment au Petit Valenciennois dont il devient le rédacteur en chef puis le directeur. Il est également rédacteur et administrateur de La Vie nouvelle, organe de l’Association catholique de la jeunesse française du diocèse de Cambrai dont il est le président de 1931 à 1935. En 1931, il se présente en vain aux élections cantonales dans le canton de Valenciennes-Est sous les couleurs du Parti démocrate français.
Lors de l’Occupation, Paul Gosset rejoint la Résistance. Sa conduite sera récompensée par plusieurs décorations : médaille de la Résistance, des Français libres, croix des Combattants volontaires.
A la Libération, il est membre fondateur du MRP et il est élu à la première Assemblée nationale constituante où il est nommé membre de la commission de la presse, de la radio et du cinéma. Réélu en juin 1946, il l’est jusqu’en 1958. Il retrouve à chaque fois son poste au sein de la commission de la presse qu’il préside. Paul Gosset est également élu conseiller municipal, puis adjoint au maire de Valenciennes.
Féru d’histoire, le Valenciennois était membre de la Commission historique du Nord et vice-président du Cercle archéologique et historique de Valenciennes. Il est l’auteur des ouvrages Henri Harpignies, peintre paysagiste français et Le Père Lelièvre 1826-1889 : et les fondations des petites sœurs des pauvres à travers le monde publiés respectivement en 1982 et 1983.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 606 R 019; La Croix du Nord, 10 avril 1934 et 8 septembre 1934; Le Grand Echo du Nord, 5 mai 1935; Base de données des députés, site de l’Assemblée nationale.
-
GOSSIN Jean
S’il a travaillé dans plusieurs rédactions, Jean Gossin est toujours resté fidèle aux rivages de la mer du Nord et de la Manche. Né à Malo-les-Bains en 1911, il commence sa carrière de journaliste à L’Indépendant du Pas-Calais édité à Saint-Omer avant de rejoindre Le Phare de Calais, dirigé par Jules Pemeury . Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque et emmené en Allemagne. Il ne rentre en France qu’en 1945. Quelques mois plus tard, il reprend ses activités de journaliste au quotidien boulonnais Le Journal du Pas-de-Calais et de la Somme dont le premier numéro sort le 12 mars 1946. Il devient ensuite un éphémère rédacteur en chef de L’Echo de Calais et du Pas-de-Calais dont le premier numéro sort le 5 juillet 1950. En désaccord avec le directeur du journal, Fortuné Strassy, Jean Gossin le quitte en effet, avec d’autres rédacteurs, quelques mois plus tard. Il entre alors au Nouveau Nord . Le quotidien créé par Louis Burnod disparaît le 1 er janvier 1960, laissant place à La Voix du Nord maritime , l’édition dunkerquoise de La Voix du Nord. Jean Gossin rejoint la rédaction calaisienne du quotidien lillois où il prend sa retraite en avril 1976.
Membre de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais dès le début des années 30, il en sera élu membre du conseil d’administration.
Source(s) :Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les Quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021.
-
GOUBERT L.
Collabore au Journal de Béthune dans les années 1850.
-
GOUKENLEUQUE André
Correspondant de L’Emancipation nationale , journal du Parti populaire français, André Goukenleuque est rédacteur, en 1937, des éphémères Céramiste populaire , périodique de la section béthunoise du PPF, et du Libérateur du Pas-de-Calais.
-
GRAMAIN Léon
Journaliste à L’Echo du Nord le 2 décembre 1851, Léon Gramain condamne sévèrement le coup de force de Louis-Napoléon. Le journal est immédiatement suspendu et Gramain interné à la citadelle de Lille. La police le décrit en octobre 1852 comme « connu pour ses idées socialistes », fréquentant notamment Alphonse Bianchi, rédacteur du quotidien républicain Le Messager de Lille et « autres du même bord ». Alors que le journal d’Alexandre Leleux a obtenu l’autorisation de reparaître, Léon Gramain reste interné pendant plusieurs semaines. A sa libération, il se voit refuser par le ministre de l’Intérieur l’autorisation de séjourner à Paris ou à Versailles.
Plus tard, on le retrouve notamment au Progrès libéral de Toulouse qui est saisi pour avoir participé à la souscription pour l’érection d’un monument à la mémoire du député Baudin. Après la chute de l’empire, en septembre 1870, il est rédacteur en chef au quotidien républicain arrageois L’Ordre, fondé en avril 1867. Il occupe ce poste jusqu’en juin 1873 peu de temps avant la fusion du journal avec l’autre quotidien républicain de la préfecture du Pas-de-Calais L’Avenir d’Arras, créé à la veille des élections de février 1871.
-
GRATTEPANCHE Alfred
En 1907, le journaliste Alfred Grattepanche terminait un autoportrait, que lui avait demandé La Vie flamande illustré, par ces mots: «Ne possède ni désire aucune distinction honorifique.» Ironie du sort, c’est lors d’une prise d’armes, en février 1931, où la croix de chevalier de la Légion d’honneur venait de lui être remise à titre militaire que le capitaine d’infanterie territoriale Alfred Grattepanche mourut. Dès l’âge de 15 ans, Alfred Jules Adolphe Grattepanche , f ils d’Alfred Jules Grattepanche et d’Aglaé Clémence Beauvais, entra comme employé à la mairie de Cambrai où il resta jusqu’à son incorporation sous les drapeaux en octobre 1898. Affecté au 1 er régiment de ligne, il en sortit en mai 1901 avec le grade de sergent. Il rejoignit alors la chambre de commerce de Cambrai comme secrétaire-archiviste. En 1903, il opta pour le journalisme, devenant chroniqueur local au bihebdomadaire L’Indépendant . Quatre ans plus tard, il était nommé directeur du Petit Cambrésien. Très impliqué dans la vie locale, il cumulait les secrétariats dans plusieurs associations ou groupements: Comité républicain, Union française de la jeunesse, Patronages laïques, syndicat des brasseurs, Société des habitations bon marché,… Ce qui lui valut ses premières distinctions puisqu’il était nommé officier d’Académie et l’Instruction publique. Lieutenant de réserve, il rejoignit dès le 3 août 1914 le 201 e RI avec lequel il fit campagne jusqu’en 1915. Il fut alors affecté comme capitaine dans une formation d’infanterie territoriale. Il reçut la croix de guerre à l’issue du conflit. Démobilisé le 27 janvier 1919, Le Petit Cambrésien ayant été absorbé par L’Indépendant, Grattepanche assuma la charge de rédacteur en chef de ce titre tout en étant correspondant du Grand Echo du Nord pour l’arrondissement de Cambrai. D’autres distinctions vinrent récompenser son investissement au service de ses concitoyens ou de ses confrères: médaille de la mutualité et de la prévoyance, croix du mérite agricole.
Source(s) :ADN, 5 Mi 012 R 059 et, M 149/142; site Léonore, dossier de Légion d’honneur; La Vie flamande illustrée, 2 mars 1907; Le Grand Echo du Nord, 19 février 1931.
-
GRATTEPANCHE Armand
Armand Grattepanche est secrétaire de rédaction au quotidien lillois La Dépêche pendant plus de trente ans. Une fidélité qui est récompensée par la médaille du travail en 1936. Membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, il en sera secrétaire adjoint, puis vice-président.
Membre de la Société des agriculteurs du Nord, de la Société d’horticulteur, il est fait chevalier du Mérite agricole en 1930.
Source(s) :AD Nord, Mi EC 300 R 001; Le Grand Echo du Nord, 1er avril 1930 et 30 juillet 1936.
-
GRATTEPANCHE Raymond
Frère d’Armand Grattepanche, Raymond Grattepanche est rédacteur du Grand Echo du Nord à Tourcoing .
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 28 août 1944.
-
GRAUX Gustave Constant
Fils de François Gervais Graux, propriétaire, et de Sophie Constance Armande Foubert, Gustave Constant Graux, est né le 12 mars 1837 à Offoy dans l’Oise. Devenu très jeune journaliste, il ne n’exerça que brièvement la profession.
Collaborateur à La Causerie , aux Salons de Paris , à La Revue de Paris et au Figaro sous le pseudonyme de Buridan, Graux entra à L’Echo du Nord comme rédacteur politique le 1 er mai 1866. Il était notamment l’auteur de deux romans qui connurent un certain succès Les Haines de famille et en 1864 le Roman d’un zouave: scènes de la vie militaire.
Graux quitta le quotidien lillois deux ans plus tard pour regagner Paris. Brièvement capitaine des mobiles de l’Armée de la Loire, il fut nommé secrétaire général de la préfecture de la Vienne en septembre 1870 par Gambetta, mais démissionna en avril 1871. Elu conseiller municipal de Paris en octobre 1877, il rejoignit la préfectorale en 1879. Il fut ainsi successivement préfet de Constantine du 25 mars 1879 au 30 mars 1881, du Lot du 5 septembre 1881 à octobre 1885, de la Charente du 14 novembre 1885 au 28 février 1887 et enfin du Doubs du 5 mars 1887 à 1896. Nommé préfet honoraire, il devint receveur-percepteur à Paris où il mourut le 5 avril 1899.
Graux était officier de la Légion d’honneur, officier d’Académie et officier de l’Instruction publique.
Source(s) :BM de Lille, fonds Humbert, boîte 13, dossier 4; Base Léonore, dossier de Légionnaire.
-
GRAVELLE Émile
Émile Gravelle, peintre et illustrateur, qui habitait 22, rue Norvins à Paris (18 e ), fut l’un des animateurs dans les années 1890 du courant libertaire naturien au profit duquel il organisa plusieurs conférences. Il fut l’éditeur avec H. Beylie et H. Zisly de L’Etat naturel (quatre numéros de juillet 1894 à février 1898) qui sera le germe du courant naturien, végétarien et végétalien. Émile Gravelle arrivait alors d’un voyage où il avait rencontré les Amérindiens en Amérique du sud. En 1895, il était avec Bariol et Mombray l’un des responsables du Bulletin des Harmoniens (Paris, février 1895 à janvier 1896). Il collabora également à La Débâcle sociale (Ensival-Liège, dix numéros de janvier à avril 1896) de Jean Bosson et H. Sevron , L’Idée libre d’André Lorulot, Le Naturien (Paris, quatre numéros de mars à juin 1898) édité par Honoré Bigot, La Nouvelle Humanité (Paris, 1895-1898). Il fut aussi le gérant d’un autre bulletin naturien, Le Sauvage (Paris, deux numéros en novembre 1898 et mars 1899) qui portait en épigraphe «Pour la critique des solennelles âneries et des imposantes fariboles qui étayent la civilisation» . En 1904, il fut le signataire avec, entre autres, Hotz, Zisly, E. Armand, J. Marestan, etc. d’un Manifeste contre la guerre en Extrême Orient . Puis il collabora au numéro unique de L’Ordre naturel (Paris, novembre 1905) publié par Henri Zisly et sous-titré «Clameurs libertaires antiscientifiques» et à «La Vie naturelle» (Paris, 1907-1914) toujours publié par Zisly. Certaines de ses illustrations ont été reprises dans L’Almanach des ennemis de l’Autorité pour 1913 publié par A. Lorulot. Pendant la Première Guerre mondiale, E. Gravelle a collaboré à Pendant la mêlée (Paris, quatre numéros du 15 novembre 1915 au 15 janvier 1916) et à Par-delà la Mêlée qui lui fit suite.
Source(s) :Dictionnaire international des militants anarchistes, et d’autres sites sur l’Internet.
-
GREGOIRE?
Grégoire est rédacteur en chef du Progrès du Nord à la veille de la Première Guerre.
Source(s) :L’Echo du Nord, 1913.
-
GRENIER Emmanuel
C’est par idéalisme qu’en février 1848, Emmanuel Grenier choisit de devenir journaliste dans le Nord. Avocat et avoué à Bar-le-Duc, il souhaite suivre au plus près les premiers pasde la République et entre au Libéral du Nord à Douai. En janvier 1851, Emile Dupont lui cède la propriété du journal. Rédacteur en chef, Emmanuel Grenier réclame que «toutes les places soient soumises à l’élection ou obtenues par concours», «l’instruction obligatoire pour tous», et «l’amélioration du sort de tous». Ardent défenseur de la République, il est poursuivi en novembre 1851, et est condamné à 100 F d’amende et aux frais. Après le coup d’Etat de décembre 1851 qu’il a dénoncé, Le Libéral du Nord est suspendu et son rédacteur en chef est emprisonné à la maison d’arrêt de Douai. Libéré au bout de trois mois, il gagne la maison familiale près de Caen. Pour échapper à la surveillance policière dont il fait l’objet, Emmanuel Grenier choisit de quitter la France pour la Nouvelle Orléans.
Source(s) :Jean Grenier, «Le coup d’Etat à Douai», Revue du Nord, 1952, volume 34, n° 133, p. 5-11.
-
GRIMBERT, Clovis
Né en 1887 à Érin, clerc de notaire, journaliste et poète à Saint-Pol, le sous-lieutenant Clovis Grimbert fut tué le 11 juin 1918 à Courcelles-Épayelles dans l’Oise. Il avait créé un journal de tranchée, auquel collabora Jules Garçon: Le 120 » Court » , qui portait en sous-titre: Revue d’un jeune bataillon de chasseur / Seul journal relié par fil spécial «cordon détonnant» aux tranchées boches .
Source(s) :Association, Les Échos du Pas-de-Calais.
-
GRIMONPRE Jules
Grimonpré est ce que la police appelle un «rédacteur amateur». Chef d’entreprise, il collabore à la rédaction du Grand Echo du Nord en 1896. Sa conduite est jugé «très irrégulière».
Source(s) :AD Nord 1T 222/12.
-
GUERIN J.
Ancien commissaire de police à Nantes, J. Guérin arrive dans le Pas-de-Calais à Liévin où il donne cours particuliers pour l’entrée au lycée ou au collège. En février 1904, il devient rédacteur-gérant du Journal du peuple. Organe démocratique-socialiste du bassin minier , soutien zélé du député-maire Lamendin.
En 1911, il laisse la place à Amédée Polard, employé de mairie.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, notice, Journal du Peuple.
-
GUERIN Paul
Journaliste à la rédaction parisienne de La Voix du Nord, Paul Guérin meurt en 1999 à l’âge de 91 ans.
-
GUERMONPREZ Charles-Octave
L’Imprimeur Charles Octave Guermonprez reprend, en 1859, L’indépendant. Journal politique de l’arrondissement de Saint-Omer . De 1862 à 1864, il le fait paraître sous le titre Journal de Saint-Omer et de son arrondissement. Le 22 septembre 1864, il lui redonne son titre initial, puis le transforme en Indépendant du Pas-de-Calais. Durant les années suivantes le journal connaît un développement remarquable. Le 10 octobre 1870, sa périodicité devient quotidienne. Elle le restera jusqu’en 1940. Le 1 er juin 1871, Charles Guermonprez abandonne son journal qui passe entre les mains d’une société anonyme.
Source(s) :«L’Indépendant créé le 22 février 1849 a 125 ans», L’Indépendant du Pas-de-Calais, 23 février 1974.
-
GUIBERT
Ancien instituteur libre, Guibert a été chef d’une institution à Cambrai. On le retrouve «employé à Armentières». Il arrive à Tourcoing en 1883. Il collabore à L’Écho de Tourcoing et à La Croix du Nord jusqu’en 1895. C’est selon la police, un homme calme, se conduisant bien, mais un réactionnaire clérical.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/25.
-
GUILLAUME Eugène
Entré au Réveil du Nord en 1904, à l’âge de vingt ans, pour organiser le service de reportage, Eugène Guillaume signe de nombreux articles sous son nom ou sous le pseudonyme d’Alex Will.

Eugène Guillaume « croqué » par le journal communiste L’Enchaîné. Nommé rédacteur en chef, il devient le collaborateur du directeur-fondateur du quotidien lillois Edouard Delesalle et il est désigné comme son successeur. Après la mort de ce dernier durant la Première Guerre, lorsque le quotidien lillois reprend sa parution en octobre 1918, il est nommé directeur.
Entre-temps, il a travaillé au Comité de ravitaillement des régions envahies, a collaboré à différents ministères : Transports, Aviation, Instruction publique, Régions libérées, en qualité de chef ou d’attaché de cabinet, ainsi qu’à la présidence du Conseil durant le ministère Millerand.
Sous son impulsion, Le Réveil du Nord devient l’un des grands régionaux, rival direct du Grand Echo du Nord de la France, se dotant d’un hebdomadaire illustré, Le Réveil illustré , d’un périodique sportif, Les Sports du Nord. Eugène Guillaume est l’un des premiers patrons de presse à doter son journal d’une Société de secours mutuel et d’une caisse de retraite.
Respecté par ses pairs, il est élu président du Syndicat des quotidiens régionaux et secrétaire général de la fédération nationale des journaux français. Dans la région, il est vice-président de l’Association professionnelle des journalistes du Nord. Il est également membre de la Commission historique du Nord, de la commission de la bibliothèque de Lille, du conseil d’administration de la Société d’horticulture du Nord. Ses nombreuses activités lui avaient valu d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1920 et d’être promu officier en 1929.
Il meurt à Paris des suites d’une longue maladie à l’âge de 49 ans, il est enterré au cimetière du Père Lachaise.
Source(s) :AD Nord, M 127/42; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, 23 mars 1933.
-
GUILLEBAUD Jacques
Jacques Guillebaud est rédacteur en chef de L’Avenir d’Arras et du Pas-de-Calais vers 1880
-
GUILLEMIN Pierre-François
En octobre 1857, Florentine Tatar-Poulain, veuve de Jean-Baptiste Poulain, fondateur de L’Echo de la Lys , cède le journal à un concurrent de son mari Pierre-François Guillemin qui possédait une imprimerie rue de Saint-Omer à Aire. Celui-ci s’était opposé à L’Echo de la Lys en fondant Le Publicateur (1845- 1848). « L’Echo de la Lys changea de tendance. Contrairement à son prédécesseur, Guillemin était un de ces catholiques dont la fidélité à l’Eglise romaine était inaltérable. Son fils, le lieutenant des zouaves pontificaux Arthur Guillemin (1837-1867), fut tué à la bataille de Monte-Libretti, en voulant sauver les états du Pape.» Pierre-François Guillemin dirigea L’Echo de la Lys jusque vers 1860 où il le céda à son fils Léon Guillemin.
M. O.
Source(s) :Pierre Kerlévéo, «Une ville et son journal, Nouvelles chroniques locales, Revue historique et culturelle d’Aire et de sa région, n° 4, 1990, p. 21.
-
GUNG’L J. N.
Secrétaire général de la mairie de Roubaix jusqu’en décembre 1882, J.-N. Gung’l succède à Ardouin-Dumazet comme secrétaire de rédaction de L’Echo du Nord.
-
GUYOT Jules
Jules Guyot arrive dans le bassin minier du Pas-de-Calais après avoir été rédacteur au Phare de Dunkerque . Il travaille d’abord au Lens-Liévin comme rédacteur , puis, en novembre 1895, il tente probablement de lancer un périodique avec l’aide de membres du Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais. Si cette première tentative ne fut pas transformée, la suivante ne le fut probablement pas non plus. En mars 1896, plusieurs journaux annoncent que Jules Guyot va proposer un hebdomadaire, L’Eclaireur de Lens toujours avec la participation de membres du Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais, à l’occasion des prochaines élections municipales de mai, pourtant aucune collection connue n’atteste de l’existence de ce journal.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, notices, Lens-Liévin, L’Eclaireur du Pas-de-Calais.,
E – F dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais H
-
HACHIN, Pierre
, (Ascq, 30 avril 1912 – Tourcoing, 16 mars 1994) Distributeur et collaborateur de La Voix du Nord En 1940, Pierre Hachin, cheminot à la gare de Lille, est mobilisé. Sur sa demande, il est affecté à un corps-franc en qualité d’officier artificier. Fait prisonnier, il est libéré parce que cheminot. En 1941, il organise l’évasion et le transport de soldats alliés. Il entre en contact avec Natalis Dumez, et participe dès le premier numéro à l’impression et à la diffusion de La Voix du Nord clandestine, qu’il distribue selon les consignes données par le journal dans son numéro 15: « La Voix du Nord doit circuler rapidement de main en main. La garder longtemps chez soi, c’est s’exposer inutilement; la passer en public, c’est une imprudence la remettre à quelqu’un qui n’est pas un ami sûr, c’est une témérité. Le courage n’exclut pas la prudence.» En 1942, il devient responsable régionale du réseau NAP-FER (Noyautage des administrations publiques pour la S.N.C.F.) et se consacre au renseignement grâce à son poste à la Transportkommandantur , la direction allemande des transports militaires. Arrêté le 2 octobre 1943, et torturé, un tribunal allemand le condamne deux fois à mort, en sus de dix ans de prison. Déporté, classé Nacht und Nebel , il est un des sujets «d’expériences scientifiques» de médecins nazis. Interné à Dachau, il pèse trente-six kilos à son retour en France. Plus ou moins rétabli, il reprend son travail à la gare de Lille en 1946. Il se joint à Natalis Dumez pour défendre les droits des résistants spoliés par ceux qui ont lancé un nouveau quotidien baptisé La Voix du Nord à la Libération, et devient le fer de lance de ce mouvement. La bataille juridique durera trente ans, avant qu’un modus vivendi soit trouvé avec le journal. André Diligent, défenseur de ces résistants contre le journal lillois, écrira la biographie de ce «Cheminot sans importance».
Pierre Hachin était officier de la Légion d’honneur, de la croix de guerre avec palmes et trois citations, et de nombreuses autres distinctions françaises et étrangères.
Source(s) :Diligent, André, Un cheminot sans importance, Paris, France-Empire, 1975, 253 p.; rubrique «Pierre Hachin», brandodean over-blog.org sur wikipedia.
-
HANU José
Grand reporter à La Voix du Nord de 1946 à 1990 , José Hanu fut récompensé par le Prix Albert Londres en 1964 pour son livre Quand le vent souffle en Angola. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Non. Mais oui, à l’Eglise catholique , un livre d’entretiens avec l’évêque Marcel Lefebvre, fondateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X.
-
HARDY Paul, dit Pol
Né en 1908 à Saint-André, dans la banlieue lilloise, Paul Hardy est le fils de Léon Hardy, représentant chez Decoster-Agache, et de Mathilde Vanpevenage. Après une licence en droit obtenue à la faculté de Lille, il entre à la toute nouvelle école de journalisme (5 e promotion 1928-1931). Tout juste diplômé, il est embauché par le quotidien arrageois Le Courrier du Pas-de-Calais , Il le quitte en 1933 pour le bureau d’Arras du Télégramme du Pas-de-Calais et de la Somme. Le 1 er décembre 1941, il rejoint l’agence arrageoise du Grand Echo du Nord de la France où il est à la fois rédacteur et responsable de la publicité jusqu’au 31 août 1944. A la Libération, il poursuit sa carrière à l’édition d’Arras de La Voix du Nord. Il est nommé au siège du quotidien lillois en 1950. Critique théâtral et artistique, il assure également une rubrique quotidienne intitulée «Le sourire en coin», puis «L’Oreille du beffroi» et opère le choix des romans qui paraissent en feuilleton dans le quotidien nordiste. Dans les années 50, il participe même au Tour de France. Parallèlement, pendant plusieurs années, il assure une émission quotidienne d’un quart d’heure sur radio Lille commentant les événements du jour avec Josette Joudin. Près de deux décennies après sa retraite, prise en 1974, il assure encore fidèlement le compte rendu de pièces de théâtre ou d’opérettes. Paul Hardy donne sa dernière critique en 1992 pour la pièce Les monstres sacrés avec Michèle Morgan et Jean Marais au théâtre Sébastopol de Lille. Paul Hardy, dit Pol, possède en effet bien des talents dont il fait montre aussi bien dans le journal qui l’emploie que dans des revues littéraires ou artistiques régionales: L’Annotateur artésien, Artois, La Semaine à Arras, La Vie nouvelle du Pas-de-Calais dans lesquelles il donne des chroniques, des nouvelles et des contes, mais aussi des croquis de notables et des dessins sur la vie quotidienne. Paul Hardy était également un bon peintre amateur. Membre de l’académie d’Arras, il faisait partie des Rosati d’Artois.
Source(s) :archives personnelles de sa fille, Marie-Paule Hardy.
-
HATTU Anatole
Fils d’un marchand libraire, Anatole Auguste Albert Hattu, né le 25 octobre 1835 à Cambrai, est avocat dans sa ville natale. A la suite de la mort de Louis Carion, il devient rédacteur en chef du journal légitimiste catholique L’Emancipateur en décembre 1869. Il le reste jusqu’en décembre 1872 où il est remplacé par Ernest Delloye.
Il est par la suite libraire et avocat à Paris.Anatole Hattu était membre de la Société d’émulation de Cambrai et trésorier de «La Betterave», l’association amicale des enfants du Nord-Pas-de-Calais à Paris. Il meurt dans la capitale en 1893.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/, dossier, L’Emancipateur; Le Grand Echo du Nord, 14 avril 1893.
-
HAUSTRATE Gaston
D’abord compositeur-typographe à l’imprimeries Frère de Tourcoing, Gaston Haustrate devient journaliste à la locale de la même ville pour le quotidien Nord Éclair en 1956: « Une belle période de ma vie avec, à la clé, un bagage culturel que je n’avais pas », a-t-il déclaré aux Informations dieppoises , alors dirigées par Pierre Verbraeken, un autre ancien de Nord Éclair . Il y reste onze ans, avant de rejoindre la revue Cinéma en 1968, dont il devient le rédacteur en chef unique en 1972. Gaston Haustrate a beaucoup aidé les ciné-clubs, contribuant à la création de l’Institut de formation à la culture cinématographique. Il est également l’auteur d’une trentaine de livres, tout particulièrement plusieurs monographies sur Arthur Penn, Blier ou Mocky, et un Guide du cinéma en quatre volumes aux éditions Syros où il sera directeur de la collection. Il a également signé des livres de son nom ou du pseudonyme de Bernard Brissard, dont un roman pour enfant mettant en scène un apprenti imprimeur, et une autobiographie intitulée Mémoires d’un glouton optique .
Source(s) :Haustrate Gaston, Mémoires d’un glouton optique, variations autobiographiques, Envermeu, Éditions Caliban, 2003; Camille Larher, «Décès de Gaston Haustrate…», Informations dieppoises, 18 janvier 2019; Wikipédia.
-
HAUTEFEUILLE Jean
Jean Hautefeuille commença sa carrière de journaliste au Grand Echo du Nord de la France qu’il intégra le 1 er décembre 1937. A la Libération, il passa à La Voix du Nord où il fut nommé grand reporter.
-
HAVARD DE LA MONTAGNE Robert
Fils du journaliste et écrivain royaliste Oscar Havard et de Caroline Marcus de Rungs, Robert Havard naît à Paris le 11 novembre 1877. Après avoir été secrétaire du député catholique Denis Cochin, il s’oriente vers le journalisme en 1899 où il fait ses débuts à L’Express du Midi à Toulouse. En 1901, il devient rédacteur en chef du Nouvelliste de la Sarthe au Mans. Marié à une professeur de droit de l’Université catholique de Lille en 1903, il arrive dans la capitale des Flandres en 1909 pour prendre la direction de l’hebdomadaire Le Nord Patriote. Organe des libertés régionales et syndicales qu’il dirige de sa fondation le 5 janvier 1910 jusqu’à sa disparition le 2 août 1914. Disciple de l’Action française, Robert Havard, qui a ajouté à son nom le pseudonyme de son père, est déjà l’auteur de plusieurs ouvrages dont Examen de conscience (1905), Les Candidats à la présidence (1906), L’Action française, ses origines, son but, sa méthode. Durant la Première Guerre, il collabore au quotidien de Charles Maurras L’Action française où il tient notamment une copieuse revue de presse. En avril 1923, il fonde le mensuel Rome qui paraît dans la capitale italienne en français. En 1926, le périodique connaît quelques difficultés et sa parution doit être suspendue pendant plusieurs semaines. Parmi ses soutiens, on retrouve alors Mgr Charost, ancien évêque de Lille, et Mgr Chollet, archevêque de Cambrai, sympathisants de l’Action française. Parallèlement, Havard de la Montagne assure la correspondance pour Le Figaro. Une dizaine d’années plus tard, revenu en France, il tient la «Chronique de la quinzaine» dans La Revue universelle, fondée par Jacques de Bainville et Henri Massis, qui défend les positions de L’Action française, il collabore à La France réelle et à Je Suis Partout. En 1939, il fait son retour au quotidien L’Action française où il participe à la chronique politique et reprend la revue de presse. En août 1944, Havard de la Montagne prend la fuite et en octobre 1946, il est condamné par contumace à la dégradation nationale à vie et la confiscation de ses biens. Dans les années 1950, il collabore occasionnellement à l’hebdomadaire Aspects de la France qui, en 1947 sous la direction de Georges Calzant prend la succession du quotidien L’Action française interdit à la Libération. Robert Havard de la Montagne, qui fut un écrivain prolifique au moins jusqu’à la fin des années 1920, n’en continue pas moins de publier plusieurs ouvragesdont Histoire de la démocratie chrétienne de Lamenais à Georges Bidault (1948), Histoire de l’Action française (1950), Pie X (1953), Chemins de Rome et de France. Cinquante ans de souvenirs ( 1956). Il meurt le 11 août 1963 à Verneuil-sur-Avre dans l’Eure.
Source(s) :Archives de Paris, V4E 3312; L’Action française; Le Figaro.
-
HAYARD Napoléon
Fils de Pierre Hayard et Catherine Castel, Napoléon Ferdinand Hayard est né à Remicourt (Marne) le 16 décembre 1850. Il vécut à Lille de 1885 à 1892 au 1, rue des Bouchers. Ami de Carrette et de Delory, il fut l’imprimeur de La Marseillaise fourmisienne, qu’il fit placarder après le 1 er mai 1891, et l’éditeur du Vrai Lillois «journal indépendant anticlérical et de combat de la région du Nord» dont le premier numéro, imprimé à La Madeleine, parut le dimanche 15 mars 1885. Ce journal se voulait le contradicteur du clérical, antirépublicain et antisémite Lillois de Philibert Vrau puis Ducoulombier. Si, d’après la police, l’accueil fut favorable, il est déjà remplacé le 1 er mai 1885 par Le Réveil lillois qui ne connut qu’une dizaine de numéros. Il fut lui-même remplacé par le Citoyen lillois . Hayard fut également l’imprimeur du premier numéro de L’Anti – youtre et de Lille Lapin , journal amusant et hebdomadaire.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/24; Mollier, Jean-Yves, Le camelot et la rue, Fayard.
-
HAYNAUT Eugène
Fils de médecin, Eugène Haynaut devint naturellement médecin. Reçu docteur de la faculté de médecine de Paris en août 1868, il s’installa à Béthune où il fut médecin du service de bienfaisance pendant un an. Après les élections législatives de mai-juin 1869, ilfut révoqué pour avoir soutenu un candidat indépendant contre le candidat officiel. Le 4 septembre 1870, militant républicain, il était nommé sous-préfet de Montreuil-sur-Mer, poste qu’il occupa jusqu’au 11 mai 1871. Fondateur de la Société d’instruction républicaine de Béthune, il est élu, en 1877, conseiller municipal. En 1880, il est l’un des fondateurs du bihebdomadaire Le Petit Béthunois «nettement républicain, nettement anticlérical» selon son expression. Membre du conseil d’administration lors de la création du journal, il en devint président quelques années plus tard et directeur politique après son élection à la mairie en 1888.
Chirurgien-chef de l’hôpital de Béthune, médecin de l’Assistance publique, des Chemins de fer du Nord, du Parquet, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur en janvier 1889 et est élu député en septembre 1889.
Quelque dix ans après sa création, Le Petit Béthunois ne semble pas répondre aux espérances de ses fondateurs. En octobre 1891, la société éditrice est dissoute et le journal est repris par l’imprimeur Jules Logier. Cependant le docteur Haynaut et ses amis restent responsables du contenu. Le 19 décembre, il meurt à l’âge de 47 ans.
Source(s) :Site Léonore, dossier de légionnaire; Jean-Paul Visse, La Presse du Bassin minier du Pas-de-Calais, Société des Amis de Panckoucke, 2010.
-
HAZARD Victor, abbé
Né à Lille en 1854, Victor Hazard est élève au collège Saint-Joseph dans sa ville natale, puis au grand séminaire de Cambrai. Il est ordonné prêtre le 25 mars 1877. D’abord vicaire de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur à Valenciennes, il est ensuite nommé professeur de rhétorique au collège de Bailleul.
Vicaire de la paroisse Saint-Jacques à Douai, il y retrouve Henri Masquelier et l’abbé Jean-Baptiste Hégo et participe probablement en 1889 au supplément douaisien de La Croix , car, comme l’écrira le chanoine Masquelier, «c’est là que sa vie s’orienta vers l’apostolat de la presse». Curé successivement à Fontaine-au-Bois et Haspres, il rentre à La Croix du Nord en 1895 où, selon le chanoine Masquelier, «il porta le poids principal du service de nuit» pendant vingt ans.
Directeur du journal, il était membre de l’Association professionnelle de journalistes du Nord depuis sa fondation en 1902. Il était par ailleurs chanoine titulaire de la cathédrale Notre-Dame de la Treille depuis la création du chapitre.
Source(s) :La Croix du Nord, 20 septembre 1920.
-
HEDOUIN Pierre
Pierre Hédouin «fut, selon Ernest Deseille, le vrai journaliste demandé par l’époque et il servit à ses lecteurs des ingéniosités, des boutades, des jeux de l’esprit…» Avocat à Boulogne-sur-Mer, où il était né en 1789, Hédouin fonda L’Annotateur boulonnais (1823-1830), «celui qui inspira à l’imprimeur Hesse le désir de concurrencer la Feuille d’annonces de Le Roy».
Source(s) :Ernest Deseille, «Histoire du journalisme en Boulonnais», Mémoires de la Société académique de l’arrondissement de Boulogne, 1868, p. 165-405.
-
HEMERY Jean
Journaliste à l’édition béthunoise du quotidien socialiste Nord-Matin , Jean Hémery est nommé au siège à Lille et finit sa carrière comme rédacteur en chef adjoint.
A la retraite, il se retire en Bretagne où il meurt en septembre 2003.
-
HENNEQUIN Armand
Ancien proviseur du collège royal de Douai, Armand Hennequin, devenu inspecteur de l’Académie de Douai, lance en juillet 1838 L’Ouvrier, journal d’éducation pour les classes populaires . Imprimé par Vincent Adam à 300 exemplaires, ce mensuel entend s’atteler à «l’éducation morale de l’ouvrier». Il disparaît le 29 juin 1839. A la même époque, sort des presses du même Vincent Adam L’Instituteur du Nord et du Pas-de-Calais placé sous l’égide du recteur de l’Académie. Il est vraisemblable qu’Armand Hennequin participa à cette revue qui connut un meilleur sort que L’Ouvrier.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017.
-
HENRY Gaston
Fils d’un directeur d’école, Gaston François Marius Henry fait ses études au lycée d’Amiens. Il fait ses débuts dans le journalisme à Amiens puis entre en 1897 à la rédaction du Journal de Montreuil . Trois ans plus tard, il prend la direction du journal puis il achète Le Journal de Berck et crée en 1908 L’Avenir du Touquet . Très impliqué dans la vie locale, il exerce parallèlement de nombreuses fonctions. Administrateur des hospices de Montreuil-sur-Mer, il est membre de la Commission de surveillance des comptes de la Société d’agriculture, du Syndicat agricole, de la Caisse du Crédit agricole, de la Société coopérative agricole des producteurs de la région de Montreuil. Il est également président de la Société des courses de Berck. A sa mort à Montreuil dans sa 65 e année, son fils Jacques lui succède.
-
HENRY Jean
Entré à l’âge de 16 ans dans une imprimerie maubeugeoise qui publiait l’hebdomadaire La Frontière , Jean Henry devint le rédacteur de ce périodique jusqu’en 1934. Le 1 er mars, il assurait les fonctions de rédacteur détaché à Maubeuge du quotidien L’Echo du Nord. . Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier puis rapatrié pour maladie en octobre 1941. Il reprit alors son travail de correspondant et le 4 septembre 1944 il participait à la sortie de La Voix du Nord , comme chargé de l’édition de Maubeuge.
Il contribua à son développement et installa le bureau du quotidien lillois au cœur de la cité de la Sambre. Après quelque cinquante ans consacrés au journalisme, Jean Henry prit sa retraite en mars 1975.
Membre de plusieurs associations locales, il était titulaire de la croix de guerre 39-45, de la croix du combattant, de la médaille d’honneur du travail. Il était également officier des palmes académiques.
Source(s) :La Voix du Nord, du 15 septembre 1988.
-
HENRY Jean-Baptiste
Jean-Baptiste Henry prend la direction des Annonces, affiches et avis divers lorsque son fondateur Charles-Joseph Panckoucke renonce en décembre 1782. Il maintient ce périodique durant toute l’année 1783, puis il abdique à son tour.
-
HENRY Maurice
Né d’une famille cambrésienne aisée, profondément marqué par la guerre, Maurice Henry décide d’échapper à son milieu bourgeois. Il rencontre, Arthur Harfaux, Roger Daumal, Roger Vaillant et Roger Gilbert-Lecomte avec lesquels il fonde la revue Le Grand Jeu (trois numéros parus), qui voulait représenter « une folle tentative pour redonner un sens à un monde qui n’en avait plus » . En 1929, il se fait journaliste au Petit Journal pour gagner sa vie, tout en pratiquant le dessin d’humour. En 1932, le groupe se dissout et rejoint Breton, pour participer aux activités du groupe surréaliste, et Henry collabore à la revue Le Surréalisme au service de la révolution. Henry tenait une chronique régulière de critique cinéma depuis ses débuts dans la presse. En 1940, Harfaux et lui créent une société, les «Gagmen associés». Ils participeront à une vingtaine de films, parmi lesquels Madame et le mort de Louis Daquin, 120 rue de la Gare , d’après Léo Malet, Coup de tête , Les Aventures des Pieds Nickelés , Bibi Fricotin , Au petit bonheur et L’Honorable Catherine de Marcel L’Herbier, en qualité de gagmen ou scénaristes jusqu’en 1951. Après la Seconde Guerre, Henry recommence à dessiner. Déçu par la façon de ses dessins sont reçus, il décide de se consacrer uniquement à la peinture à la sculpture et aux collages sur la fin de sa vie. Maurice Henry a publié dans de très nombreux journaux ( France-Observateur, Le Figaro, L’Os à moelle, Combat, Paris-Match, Les Lettres nouvelles, Bizarre …), certains dessins étant repris dans la presse régionale. Entre 1930 et 1984, Maurice Henry aurait produit près de 25 000 dessins, publiés dans 150 journaux et une vingtaine d’albums. Pour caractériser son œuvre, citons simplement un avis de Jean Cocteau : « Les caricatures charmantes de Maurice Henry puisent leur force dans un contraste entre une sorte de conformisme du dessin et la fraîcheur de la légende. Le rire est provoqué par cette chute de la réalité dans le rêve. C’est un réflexe tout neuf de notre époque . » Maurice Henry a reçu le Grand Prix de l’humour noir en 1975 et le Grand Prix national des arts graphiques en 1983. Cet artiste polyvalent, ami de Breton, Dalí, Picasso et Cocteau, est mort à Milan en 1984.
-
HERBART Pierre Maurice
Petit-fils d’armateur, fils de clochard (état choisi par son père après que ce dernier eut dilapidé la presque totalité de la fortune familiale), Pierre Herbart travaille à dix-sept ans dans une compagnie d’électricité pendant deux ans. Il fait son service militaire en Afrique, se rendant en Afrique du nord, au Mali et au Niger. De retour à Paris, il rencontre Jean Cocteau, puis André Gide, dont il épousera une ancienne maîtresse. Il visite l’Indochine avec André Viollis, du Petit Parisien , puis, entré au P.C.F., se voit confier un reportage sur l’Espagne pour le compte du Parti (1933). En 1935, il est à Leningrad, où il dirige la revue Littérature internationale , remplaçant Nizan à ce poste. Nouveau voyage en URSS avec Gide, Guilloux Dabit, Schiffrin. Rentré à Paris, il part en Espagne, où la guerre vient d’éclater, pour discuter avec Malraux de l’opportunité de la publication de Retours de l’U.R.S.S . de Gide. L’année suivante, il accompagne en Afrique Gide, nommé membre d’une commission coloniale. Il en rapportera un témoignage terrible Le Chancre du Niger. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il entre dans la Résistance. Il participe à la mise en place d’un réseau qui aide les jeunes gens à échapper au S.T.O. Membre du réseau «Défense de la France», il est partie prenante du journal du même nom, qui deviendra France Soir . Chargé de la direction de la branche bretonne du réseau, il participe activement à la libération de Rennes. À la Libération, il rejoint Camus à Combat . Il est un des créateurs de Terre des Hommes , hebdomadaire, avec Jacques Baumel et Claude Bourdet. Puis il perd successivement son frère et son ami André Gide, et divorce de sa femme et dans le même temps des proches de Gide. Frappé d’hémiplégie, il meurt à Grasse dans le dénuement. Pierre Herbart a collaboré, outre aux journaux déjà cités, à différentes revues littéraires, ainsi qu’à Marianne et Vendredi . Il laisse une œuvre littéraire appréciée : Le Rôdeur (1931), L’Imaginaire (1984), Contre-ordre (1935), Le Promeneur (2000), En URSS 1936 (1937), Le Chancre du Niger (1939), Alcyon (1945), À la recherche d’André Gide (1952), L’âge d’or (1953), La ligne de force (1958 et 1980); La Licorne (1964), Souvenirs imaginaires (1968), Histoires confidentielles (1970), Les Cahiers rouges (1999); Inédits , Le Tout sur le tout (1986); Le scénario d’Isabelle , en collaboration avec André Gide, Textes retrouvés , Le Promeneur , (1999) On demande des déclassé (2000). En savoir plus: Paul Renard (dir.), Pierre Herbart, romancier, autobiographe et journaliste , Roman 20-50 , Hors série n°3, 2006, 90 p.; Paul Renard (dir) Pierre Herbart, Nord’ n° 37, juin 2001.
Source(s) :plusieurs sites sur l’Internet : Wikipédia, Babelio, Nuit blanche.
-
HOLLART Camille
Fils de Célestin Hollart, jardinier, et de Marie Amélie Adélaïde Lantoine, Camille Hollart devient rédacteur au quotidien lillois La Dépêche en 1888 où il rentre après cinq ans de service militaire et y avoir gagné le grade de sous-officier. Il fait toute sa carrière dans ce journal dirigé par Henri Langlais, notamment comme rédacteur régional en poste à Arras. Il est également correspondant pour le quotidien L’Echo de Paris.
Durant la Première Guerre, il est membre de la Croix-Rouge. Il est administrateur adjoint de l’hôpital auxiliaire 7bis à Arras. En septembre-octobre 1914, il est notamment chargé de la réception et de l’évacuation des blessés. En février 1915, il fonde une clinique ophtalmologique à Hesdin. Tout au long de la guerre, il effectue des missions périlleuses au service des blessés. Père de cinq enfants, Camille Hollart perd deux fils au cours du conflit. Sa conduite lui en 1921 d’être nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur au titre du ministère de la Guerre. En 1918, il devient directeur de l’œuvre de secours «Le Pas-de-Calais dévasté».
Il reprend son travail de journaliste. Membre de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais, il en devient président en 1935. En 1921, il est fait chevalier du mérite agricole.
Source(s) :Site Léonore, dossier de légionnaire; Le Grand Echo du Nord, 17 juin 1942.
-
HONORE Geneviève dite Geneviève Honoré-Lainé
Fille du Nord où elle est née en 1914, Geneviève Honoré arrive à Paris en 1936. Elle suit alors Louise Monnet, sœur de Jean Monnet, dans l’Action catholique féminine des milieux indépendants.
Après la guerre, elle est rédactrice des pages féminines des quotidiens La Croix du Nord à Lille et Ouest-France à Rennes. C’est nantie de la carte d’identité professionnelle qu’elle est embauchée en 1951 à La Croix par le père Gabel. Première journaliste femme au quotidien catholique dont la rédaction compte encore de nombreux prêtres, elle reste le seul élément féminin de la rédaction pendant douze ans. Elle signe alors ses articles du nom de Lainé.
Féministe, elle déplore, après l’ouverture du concile Vatican II, du peu de place accordée aux femmes.
Même après sa retraite à l’âge de 65 ans, elle continue, jusqu’à un âge très avancé, à mettre sa plume alerte au service de son ancien journal. Elle est également l’auteure de plusieurs ouvrages.
Source(s) :Isabelle de Gaulmyn, «Geneviève Honoré-Lainé, la plume alerte au service de l’Evangile», La Croix, 10 juin 2011 et «Geneviève Honoré-Lainé, la première journaliste femme d, e La Croix, est décédée», La Croix, 31 janvier 2017.
-
HOREMANS Jean-Baptiste
Arrivé de Belgique à Wazemmes, à côté de Lille, à l’âge de 12 ans, Jean-Baptiste Horemans est d’abord apprenti à l’imprimerie Lefort. Il y devient typographe puis compositeur. Par la suite, il entre comme prote et rédacteur chez Vanckère. Marié en 1831, il est naturalisé en 1845.
Etabli libraire, il publie plusieurs ouvrages: en 1848 Marie ou piété et résignation , en 1850 La Brodeuse de tulle , en 1854 Histoire d’un filtier de la rue Saint-Sauveur , en 1858 Le Fileur de Coton … Il édite également en 1858 les mémoires de son frère, soldat de l’Empire, sous le titre Mémoire d’un grenadier du 23 e ligne . Ayant acheté une imprimerie, Horemans lance plusieurs périodiques en 1849 un bihebdomadaire Le Papillon qui devient en mars 1851 Le Nouvelliste, en 1852 Le Moulin-à- vent dont l’existence est éphémère. En 1853, lors de la suspension du Moulin-à-vent, Horemans est même condamné à un mois de prison. En 1855, il lance La Gazette de Wazemmes qui disparaît trois ans plus tard. Dans ses différents périodiques, il rédige des articles sur les coutumes et traditions lilloises. Le 30 septembre 1864, il lance un quotidien Le Journal du peuple du Nord de la France qui fusionne le 8 décembre 1866 avec Le Courrier populaire du Nord de La France.
Source(s) :BM Lille, fonds Humbert, dossier 2, boîte 14.
-
HOTTIAUX Anne-Marie épouse REBOUX
Professeur de français, conférencière et journaliste, Anne-Marie Reboux-Hottiaux prendra la succession d’Alfred Reboux, qu’elle avait épousé en secondes noces. L’acte de mariage daté du 16 octobre 1890 indique qu’elle est professeur de français. C’est donc tout naturellement qu’elle contribue au Journal de Roubaix en mettant sa plume au service de petites chroniques qu’elle signait du
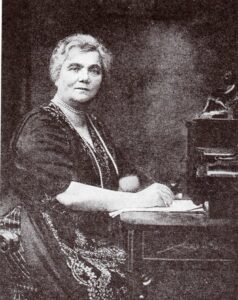 pseudonyme de “Pervenche”. « Tous nos lecteurs connaissent PERVENCHE pour avoir lu ses articles si finement écrits; elle y a traduit la dignité, la grandeur, la beauté du travail, elle s’est intéressée à toutes les œuvres de charité, au développement de toutes les sociétés de la région, au sort des humbles, à la situation sociale de l’ouvrière. Il n’est pas un de ses articles qui n’ait été rédigé dans un but humanitaire et social. » Au décès de son mari, Mme Alfred Reboux passe du rôle de discrète collaboratrice à celui de directrice de l’un des plus importants journaux de la région. Veuve à 48 ans, elle poursuit l’œuvre entreprise par son époux pendant près de trente ans. Elle s’affirme comme une directrice active et vigilante, et le Journal de Roubaix poursuit sa carrière de grand quotidien régional catholique et patriote. En 1914, il tire à 70 000 exemplaires. A l’arrivée des Allemands, de nouvelles rotatives venaient d’être installées dans des ateliers clairs, spacieux, munis du matériel de clicherie et d’imprimerie le plus perfectionné. L’invasion allemande entraîne le silence forcé, et le pillage du matériel récemment acquis. En 1916, Mme Veuve Reboux passe en France libre et donne une série de deux cents conférences dans les plus grandes villes de la France libre : « Elle apparaissait comme la personnification de nos provinces infortunées et frémissant sous le joug. Il faut avoir entendu cette parole si simple et si émouvante soulever une assemblée, faire couler des larmes et tirer de l’âme humaine ce qu’elle a de meilleur pour comprendre le pouvoir souverain de son éloquence. » En 1918, cinq heures après le départ des Allemands, le Journal de Roubaix reparaît avec des moyens de fortune. Dès 1919, le récit complet des quatre années d’occupation est édité comme un tragique feuilleton, d’abord dans les pages du quotidien, puis dans celles du Dimanche du Journal de Roubaix, un supplément hebdomadaire. Après l’armistice, elle fonde l’Œuvre de la livre de laine dont l’appel est entendu dans toute la France, qui envoie des petits paquets de laine destinée à constituer des matelas. Toutes ces activités lui valent d’être élevée à la dignité de chevalier de la Légion d’honneur le 12 août 1928. Elle est directrice du Journal de Roubaix jusqu’à sa mort, intervenue en 1934.Source(s) :
pseudonyme de “Pervenche”. « Tous nos lecteurs connaissent PERVENCHE pour avoir lu ses articles si finement écrits; elle y a traduit la dignité, la grandeur, la beauté du travail, elle s’est intéressée à toutes les œuvres de charité, au développement de toutes les sociétés de la région, au sort des humbles, à la situation sociale de l’ouvrière. Il n’est pas un de ses articles qui n’ait été rédigé dans un but humanitaire et social. » Au décès de son mari, Mme Alfred Reboux passe du rôle de discrète collaboratrice à celui de directrice de l’un des plus importants journaux de la région. Veuve à 48 ans, elle poursuit l’œuvre entreprise par son époux pendant près de trente ans. Elle s’affirme comme une directrice active et vigilante, et le Journal de Roubaix poursuit sa carrière de grand quotidien régional catholique et patriote. En 1914, il tire à 70 000 exemplaires. A l’arrivée des Allemands, de nouvelles rotatives venaient d’être installées dans des ateliers clairs, spacieux, munis du matériel de clicherie et d’imprimerie le plus perfectionné. L’invasion allemande entraîne le silence forcé, et le pillage du matériel récemment acquis. En 1916, Mme Veuve Reboux passe en France libre et donne une série de deux cents conférences dans les plus grandes villes de la France libre : « Elle apparaissait comme la personnification de nos provinces infortunées et frémissant sous le joug. Il faut avoir entendu cette parole si simple et si émouvante soulever une assemblée, faire couler des larmes et tirer de l’âme humaine ce qu’elle a de meilleur pour comprendre le pouvoir souverain de son éloquence. » En 1918, cinq heures après le départ des Allemands, le Journal de Roubaix reparaît avec des moyens de fortune. Dès 1919, le récit complet des quatre années d’occupation est édité comme un tragique feuilleton, d’abord dans les pages du quotidien, puis dans celles du Dimanche du Journal de Roubaix, un supplément hebdomadaire. Après l’armistice, elle fonde l’Œuvre de la livre de laine dont l’appel est entendu dans toute la France, qui envoie des petits paquets de laine destinée à constituer des matelas. Toutes ces activités lui valent d’être élevée à la dignité de chevalier de la Légion d’honneur le 12 août 1928. Elle est directrice du Journal de Roubaix jusqu’à sa mort, intervenue en 1934.Source(s) :Journal de Roubaix, du 12 août 1923; Le Monde Illustré, de mars 1923.
-
HOUCKE Jean
Fils de Jules Houcke, qui avait réalisé les dernières parutions de La Voix du Nord clandestine en 1944 , Jean Houcke intègre la rédaction du quotidien lillois le 1 er mai 1948. D’abord affecté dans la région lilloise, il rejoint la rédaction d’Hazebrouck après la disparition d’André Biébuyck et en prend la direction. Fidèle à sa Flandre natale, il y fera toute sa carrière professionnelle. A l’heure de la retraite en novembre 1988, il est nommé au conseil de surveillance du journal, puis de sa société holding, Voix du Nord Investissement (VNI), avant de présider le conseil de surveillance de Voix du Nord SA et d’en devenir président d’honneur . Homme cultivé, passionné d’histoire, il laisse de nombreuses chroniques historiques et d’un ouvrage Fruchart alias Louis XVII.
-
HOUCKE Jules
C’est à la demande de Jean Catrice, futur commissaire à l’Information,que Jules Houcke fait paraître en 1944 les deux derniers numéros du journal clandestin La Voix du Nord. Membre du Comité départemental de Libération, chargé de préparer la nouvelle presse dès la Libération, il fait, le 6 septembre, paraître le journal au grand jour. Né le 20 mai 1895, Jules Houcke s’engage en 1916 pour quatre ans, sa conduite lui vaut la croix de Guerre avec palme. En 1920, il reprend l’entreprise familiale de confection. Il est maire de Nieppe en 1939. Dès le début de l’Occupation, il s’oppose aux Allemands par diverses actions: fourniture de papiers aux réfractaires, aux récalcitrants au STO, aide aux aviateurs alliés, coordination des parachutages alliés,… Arrêté par les Allemands, il est ainsi condamné à six mois de prison, mais réussit à s’évader. Jules Houcke entretient également des contacts avec des résistants Voix du Nord, mouvement créé autour du journal clandestin fondé par Natalis Dumez et Jules Noutour. En 1944, le mouvement ayant été décimé, Jean Catrice s’adresse à lui pour le représenter au sein du Comité départemental de Libération où est évoqué en juillet l’avenir de la presse dans le Nord. Lors d’un voyage à Paris, Jules Houcke reçoit confirmation que La Voix du Nord doit bien paraître à la Libération dans les locaux du Grand Echo. Son action pendant l’Occupation est récompensée par la médaille de la Résistance avec rosette. Le 10 septembre 1944, Jules Houcke signe son premier éditorial dans La Voix du Nord. Le 28 février 1945, il est élu président du Conseil de gérance de la société éditrice La Voix du Nord-Houcke et Cie et devient directeur de la publication. Parallèlement, il entame une carrière politique: conseiller général du canton de Bailleul Nord-Est à partir de septembre 1945, membre de l’Assemblée constituante à partir d’octobre 1945. Lors du renouvellement de l’Assemblée en juin 1946, il ne se représente pas.
Le journal connaît alors des turbulences. En printemps 1946, Natalis Dumez, au nom de l’association «ceux de la Voix du Nord» entame une procédure judiciaire contre le conseil de gérance. Il revendique le titre et le droit de constituer une société avec les seuls résistants. Les relations entre le conseil de gérance et le directeur du journal, Léon Chadé, se sont également dégradées. En mars 1948, le personnel, apprenant son licenciement, se met en grève. Jules Houcke, mis en minorité à plusieurs reprises, démissionne de la présidence en 1948. Il laisse la place à René Decock. Malgré plusieurs tentatives, il ne parviendra plus à reprendre la présidence, mais reste administrateur.
Il reprend sa carrière politique. Le 7 novembre 1948, tête de liste du Rassemblement du peuple français, il est élu au Conseil de la République et réélu en 1952. Lors des législatives de 1956, candidat sur la liste de Paul Reynaud, il est battu et se retire de la vie politique. En novembre 1962, il est pourtant candidat contre Paul Reynaud et est, cette fois, élu.
Chevalier de la Légion d’honneur en 1946, il est promu officier en 1962. Il meurt à Nieppe le 12 mars 1968.
Source(s) :Jean-Paul Visse, Ces Quotidiens des Hauts-de-France. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021; AD Nord, 9 W 261, Lettre de Jules Houcke à la Cour de justice de Lille, le 5 novembre 1945; Jean Catrice, «Prise de pouvoir», Revue du Nord, tome 57, n° 226, juillet-septembre 1975; Dictionnaire des parlementaires français de 1940 à 1958, consulté sur le site de l’Assemblée nationale.
-
HOURIEZ Pierre
Inspecteur central des impôts indirects, Pierre Houriez découvre le monde de la presse au lendemain de la Libération de Lille, en septembre 1944, où Augustin Laurent le propulse directeur du nouveau quotidien socialiste Nord-Matin qui s’installe dans les locaux du Réveil du Nord, interdit pour avoir paru durant l’Occupation. Né à Iwuy en 1905, Pierre Houriez a fait toute sa carrière dans l’administration des finances à Landrecies, au Quesnoy,… Il est militant socialiste depuis 1932 et secrétaire de la CGT fonctionnaires. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque en mai 1940. Rapatrié en France en mai 1941, il passe quelque temps à Toulouse puis rentre en zone Nord où il prend contact avec Augustin Laurent. Chargé de reconstituer la Résistance dans le Valenciennois, il est l’un des fondateurs de Libération-Nord dans le secteur, il est également membre des réseaux Bordeaux-Loupiac et Brutus. Après la Libération, toujours membre de la SFIO, Pierre Houriez siège à la commission exécutive fédérale. Avec dix-neuf éditions, Nord-Matin atteint un tirage qui frise les 200000 exemplaires et se dote de suppléments: Nord-Sports, Entre-nous… qui disparaissent au début des années 50. La gestion de la société éditrice est chaotique et est à plusieurs reprises mise en cause par le personnel. En 1966, le journal est au bord du gouffre et pour éviter la banqueroute, il passe en novembre 1967 entre les mains du groupe Hersant. Dès lors, une nouvelle société se met en place avec à sa tête Roger Gruss. En outre ses fonctions de directeur administratif à Nord-Matin, Pierre Houriez fut administrateur du quotidien Nord-Soir de 1947 à 1949. Le 15 avril 1957, il est élu vice-président de l’AFP. De 1956 à 1964, il est vice-président du Syndicat national de presse quotidienne régionale. Titulaire de la Croix de guerre, de la médaille de la Résistance, il était également officier de la Légion d’honneur.
Source(s) :Témoignage de son fils Pierre Houriez; divers numéros de, Nord-Matin
-
HURET Jules
Né en 1853 (ou 1863 selon les sources) dans une famille de marins pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, Jules Huret a fondé une revue littéraire en 1881, collaboré à plusieurs hebdomadaires locaux et est correspondant de plusieurs journaux parisiens. En 1886, il s’installe à Paris où il est engagé au quotidien L’Événement , puis en 1890 à L’Écho de Paris pour lequel il fut chargé d’interroger les grands écrivains français du moment. Son Enquête sur l’évolution littéraire , publiée en 1894, fait lui un maître de l’interview littéraire. En 1892, il entre au Figaro où une enquête sur «La question sociale en Europe» le conduit à visiter une dizaine de pays. Ce travail paraît également en un volume en 1897 et en 1901. Il multiplie ensuite les reportages à l’étranger: États-Unis (1903-1904), Allemagne (1906-1907 et 1909), l’Argentine (1911). Mort à Paris le 14 février 1915, Jules Huret passe pour l’inventeur du reportage moderne. Ch. Def.
-
HUREZ Amand François
Fils de Jean-François Hurez, né le 31 décembre 1791 à Cambrai, Amand (ou Armand) François est formé à Paris chez Crapelet et chez Didot avant de revenir à Cambrai où il prend la succession de son père après sa démission en juillet 1817. Il poursuit la publication du Journal périodique de l’arrondissement de Cambrai qui, après une suspension, devient en 1819 La Feuille de Cambrai. Ami de Vincent Leleux, éditeur de L’Echo du Nord, Hurez est comme lui un défenseur de la charte. Alors que ce périodique a salué avec enthousiasme l’arrivée de Louis-Philippe en 1830, il devient l’un des opposants les plus virulents à la monarchie de Juillet. Le sous-préfet de Cambrai le qualifie d’ailleurs d’«égout de toutes les ordures de la ville». Dans les premières années du règne du roi bourgeois, Hurez est d’ailleurs membre du conseil municipal dirigé par Amédéé Lallier. Sous-lieutenant de la Garde nationale, il est membre de la loge Thémis. Il l’est également de la Société d’émulation. Il meurt à 40 ans le 16 juin 1832. Sa femme, qui est brevetée le 17 août 1832, prend alors le relais de son mari et La Feuille de Cambrai se poursuit jusqu’en 1842.
-
HUREZ Jean-François
Jean François Hurez ouvre une librairie à l’enseigne de la Bible de Rome , 12, Grande Place à Cambrai en 1803. Il fonde une imprimerie où il fait paraître le premier Almanach de la ville. L’année suivante, il lance unpériodique La Feuille de Cambrai. Journal d’affiches, annonces judiciaires et commerciales, avis divers, sciences, arts . Il fonde également une fabrique de dominos et d’images. Jean François Hurez démissionne en faveur de son fils Amand François en juillet 1817.
-
HURSEAU Paul
Passionné de football, Paul Hurseau mit son métier au service de ce sport qu’il avait pratiqué à l’Olympique lillois et au Racing-club lillois. Rédacteur sportif à Nord-Matin , il devint chef de la rubrique sportive. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le LOSC. Il était médaillé d’argent de la Jeunesse et des Sports.
-
HUS Roland
J Journaliste à l’édition d’Avesnes du quotidien Nord-Eclair , Roland Hus entre à l’hebdomadaire L’Observateur d’Avesnes lorsque le journal édité à Roubaix abandonne l’Avesnois. Il succède à Gaston Deloffre à la direction de L’Observateur . En conflit avec le nouveau propriétaire de l’hebdomadaire, Charles de Peretti, il donne sa démission. Le 1 er janvier 1955, il entre à La Voix du Nord comme secrétaire de rédaction, puis succède à Maxime Moirez comme chef des services régionaux. Il occupe cette fonction jusqu’à son départ en retraite.
-
HUSSON Alfred
Journaliste venu du quotidien parisien La Presse fondé en 1836 par Emile Girardin, Alfred Husson, qui collabore également au Tintamarre depuis sa création en 1843, arrive à Arras en 1848 pour diriger La Liberté dont le premier numéro paraît le 24 mars 1848. Trois semaines plus tard, il en devient l’unique propriétaire du quotidien et à la veille des élections d’avril, il crée une édition lilloise.
Le 12 août, Alfred Husson est condamné à 800 F pour «déclaration fausse et frauduleuse»; le 31, il vend l’édition lilloise à Victor Léopold Barchaud; puis le 12 septembre 1848, il démissionne de ses fonctions de rédacteur en chef et directeur-gérant du journal d’Arras.
Il est l’auteur de M. Emile de Girardin, la Chambre des pairs et le ministère (1847).
-
HUYGHE Louis
Louis Huyghe commence sa vie professionnelle dans l’administration avant d’opter pour le journalisme. Entré au quotidien arrageois L’Avenir du Pas-de-Calais , il en devient rédacteur en chef. En 1913, il fait partie des fondateurs de l’Association professionnelle des journalistes du Pas-de-Calais dont il est le premier président. Il quitte le Pas-de-Calais pour Paris où il entre au Petit Parisien comme chef des informations régionales. Il occupe ce poste pendant vingt ans, jusqu’à sa mort le 24 janvier 1935.
Il est le père de l’académicien René Huyghe, né à Arras en 1906, qui sera conservateur en chef du département des peintures au Louvre, professeur au collège de France.
G – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais I
-
ISABEL Christian
Fils du journaliste maubeugeois Gaston Isabel, Christian Isabel est embauché comme reporter au Grand Echo du Nord de la France le 1 er juin 1936. Mobilisé le 2 septembre 1939 dans le 1 er régiment d’infanterie de Cambrai, il est fait prisonnier à Rethel le 10 juin 1940 après une résistance de 48 heures jusqu’à épuisement des munitions, mais réussit à s’évader le 31 juillet et regagne le Nord. Démissionnaire en 1939, il est d’abord repris au service des expéditions du Grand Echo avant de réintégrer la rédaction. En janvier 1941, il rejoint le bureau de Roubaix où il travaille durant une grande partie de l’Occupation. Dans les derniers mois de la guerre, il retrouve l’armée où il est affecté au service de santé. Après la guerre, il entre à La Voix du Nord comme localier à Roubaix. En 1953, il est nommé rédacteur en chef du magazine Semaine du Nord fondé par la Société Hélio N.E.A., filiale de La Voix du Nord. Après la disparition de cet hebdomadaire illustré, il devient grand reporter pour le quotidien lillois, fonction qu’il assume jusqu’à son départ en retraite. Spécialiste des questions militaires et scientifiques, il a couvert plusieurs déplacements des présidents français et américains à travers le monde, il a suivi les opérations militaires lors de la guerre d’Algérie.
Capitaine de réserve, Christian Isabel était chevalier dans l’ordre du mérite, officier des Palmes académiques et médaille d’or du travail.retraite.
Source(s) :AD Nord, 1 W; Le Grand Echo du Nord, «Ancien grand reporter à la Voix du Nord, M. Christian Isabel nous a quittés», La Voix du Nord, juillet 199.
-
ISOARD Eric
, sous-préfet Parisien d’origine, Eric Isoard a été officier de marine. Arrêté comme socialiste en 1849, il est le premier rédacteur en chef du Libéral de Cambrai fondé par Depreux en 1869. Après la chute de l’empire, les républicains le nomment sous-préfet de Cambrai qu’il quitte pour Vienne. Nommé à Toulon, il est révoqué. Le Gaulois le présente alors comme «un communard mou et incapable, donnant des gages aux émeutiers». L’Emancipateur de Cambrai annonce son retour au Libéral. L’information est immédiatement démentie. Eric Isoard retrouve un poste de sous-préfet en septembre 1879 à Hazebrouck. Selon Le Grand Echo du Nord , il termine sa carrière professionnelle comme inspecteur des enfants assistés d’Ille-et-Vilaine. Il meurt à l’âge de 71 ans à Guipry, près de Rennes.
-
IZAMBARD Georges
Le nom de Georges Izambard reste à jamais associé à celui d’Arthur Rimbaud dont il fut le professeur, le protecteur et l’ami. Poète lui-même et dramaturge, il fut aussi journaliste et notamment dans la région du Nord-Pas-de-Calais où il fut rédacteur en chef du Grand Echo du Nord au début des années 1890.
Né à Paris le 11 décembre 1848, Georges Izambard arrive à Douai quelques mois plus tard après la mort de sa mère. Elève à l’école communale puis au lycée de la ville, il y obtient sa licence ès-lettres. Le 15 janvier 1868, il est nommé professeur de rhétorique à Hazebrouck. En janvier 1870, il occupe le même poste au collège de Charleville où il a comme élève le jeune Arthur Rimbaud. Dès juillet, bien que réformé pour myopie, il s’engage et sert notamment dans l’Armée du Nord où il contracte le germe d’une infirmité incurable, la perte de l’ouïe. A la fin des hostilités, il réintègre le lycée de Douai avant de gagner Cherbourg puis Argentan.
Menacé de surdité, il démissionne de l’enseignement et semble connaître quelques années difficiles. Républicain convaincu, il s’oriente vers le journalisme et devient rédacteur en chef du Journal de Caen, fonde L’Avenir de la Meuse, passe à L’Union républicaine . Jusqu’en 1898, il est chroniqueur au quotidien parisien La Liberté, tout en assumant la rédaction en chef du Grand Echo du Nord, si l’on en croit le quotidien lillois. Georges Izambard collabore ensuite au Globe, à La Petite République, à La Jeune France et au Voltaire. Les polémiques qu’il engage en faveur de la République lui valent d’ailleurs deux duels, l’un à Agen et l’autre à Evreux. Poète, il laisse de nombreux écrits dans différentes revues. Il est également l’auteur de trois ouvrages La mort d’Ivan le terrible, Collage et A Douai et à Charleville. Il était également président honoraire des «Amis de Verlaine» et des «Amis de Rimbaud». Il meurt le 22 février 1931 à son domicile quelques mois après une mauvaise chute qui l’avait tenu alité.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 28 février 1931; Le Figaro, 1, er, mars 1931; Le Mercure de France, 15 mars 1931.
J
-
JACQUET André
Entré à La Voix du Nord le 19 avril 1950, André Jacquet travailla à la rédaction de Valenciennes, puis fut nommé chef de la rédaction locale de Cambrai. En 1977, il était nommé chroniqueur judiciaire, assurant le compte rendu des assises de Douai.
-
JAGOT Henry
Henry Jagot débute sa vie professionnelle comme ouvrier typographe dans sa ville natale. De typographe, il devient journaliste et travaille pour différents titres. D’abord rédacteur au Journal de Bayonne en 1882, il rejoint l’année suivante Le Patriote de l’Ouest où il reste quatre ans. En 1887, il est nommé rédacteur en chef de L’Avenir de l’Orne qu’il quitte en 1892 pour le quotidien radical Les Pyrénées à Tarbes avant de passer en 1894 à La Liberté des Hautes-Pyrénées. La même année, il gagne ensuite La France de Bordeaux et du Sud-Ouest . En 1901, il revient à Angers où il dirige Le Patriote de l’Ouest . En 1904, il arrive à Lille pour prendre la direction du Progrès du Nord . Ce nomadisme journalistique dans des titres de diverses nuances lui vaut quelques remarques ironiques de ses concurrents. En 1905, Henry Jagot part exercer ses talents comme secrétaire général du quotidien Le Radical qu’il abandonne l’année suivante pour Le Petit Parisien dont il sera rédacteur jusqu’à sa mort en 1933. Parallèlement, il collabore au Petit Courrier d’Angers où il donne pendant quinze ans deux articles chaque semaine.
Le journaliste se double d’un homme de lettres. Sous son vrai nom ou sous les pseudonymes de Frédéric Valade – du nom de jeune fille de sa mère – ou de Paul Tobasse, il publie une trentaine d’ouvrages: études historiques ou romans dont certains sont repris en feuilleton dans la presse. Il est également l’auteur de plusieurs pièces de théâtre. En octobre 1926, Henry Jagot avait été fait chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :Site Léonore, dossier de légionnaire; Le Petit Courier, 14 août 1904 et 27 octobre 1933; La Gironde, 22 mai 1898, divers numéros du Grand, Echo du Nord, 29 mars 1905.
-
JAN Robert
Né à quelques kilomètres du Havre, en Seine-inférieure, d’un père commis principal aux contributions indirectes et d’une mère sans profession, Robert Jan s’engage dans la marine nationale en avril 1905 pour une période de cinq ans. Au sortir de l’armée, il devient employé à la Compagnie des chemins de fer du Nord à Cambrai dont il démissionne en février 1912 pour intégrer le journal L’Indépendant à la fois comme commercial et journaliste. Le 2 août 1914, il est mobilisé. Son attitude pendant la guerre lui vaut la croix du Combattant et les médailles commémoratives du Maroc et de la Grand Guerre. En 1919, il entre au quotidien socialiste lillois Le Cri du Nord . Lorsque le journal cesse sa parution le 1 er juillet 1921, Robert Jan passe au Progrès du Nord. En octobre 1924, il quitte Lille pour aller diriger l’hebdomadaire Le Journal de Fourmies où il ne fait qu’un passage de quelques mois. Le 1 er mars 1925, Robert Jan devient chef de l’édition douaisienne du quotidien Le Réveil du Nord . Il le reste jusqu’à sa mort survenue en août 1935 à Vittel où, souffrant, il effectuait une cure. Outre ses fonctions de chef d’édition à Douai, Robert Jan était le correspondant de plusieurs titres français ou étrangers: Le Courrier du Pas-de-Calais , Le Télégramme du Pas-de-Calais et de la Somme , Le Peuple , L’ œ uvre , La Liberté , le Daily Herald , l’United Press of America ,.. Officier d’Académie et de l’Instruction publique, il est l’auteur de L’Âme des rues. Histoire anecdotique de Douai .
Source(s) :AD Nord, M 127/45; AD Seine-Maritime, 4 E 12382; Le Grand Echo du Nord, 9 août 1935.
-
JAOUA Ezzedine
Sorti de l’ESJ en 1969, Ezzedine Jaoua, né à Sfax en Tunisie, a passé toute sa carrière de journaliste à La Voix du Nord. Il intègre en décembre 1969 la rédaction de Villeneuve d’Ascq d’où il suit la naissance et l’évolution de la ville nouvelle. Il passe ensuite la rédaction de Lambersart qu’il quitte en juin 2000 pour prendre sa retraite. Sa bonne connaissance de son pays natal l’avait amené à rédiger le chapitre «Tunisie» de l’ouvrage Les 50 Afriques publié au Seuil en 1979 sous la direction d’Hervé Bourges.
Source(s) :La Voix du Nord, jeudi 30 décembre 2010, édition métropole lilloise, p. 9.
-
JEANDOUZY
Cf. Gaston Dreyfus
-
JOFFRIN Maurice
Né à Troyes en 1889, Maurice Joffrin devient journaliste au lendemain de la Première Guerre au cours de laquelle il avait été grièvement blessé.
Résistant durant la Seconde Guerre, il devient à la Libération chroniqueur sportif au nouveau quotidien communiste Liberté , Il suivait particulièrement le LOSC. Il meurt en février 1957.
Source(s) :Liberté, 23 février 1957.
-
JOLY André
Après des études de médecine, André Joly s’oriente en 1960 vers le journalisme. Il effectue toute sa carrière à La Voix du Nord où il débute comme rédacteur à la locale de Lille. Il est ensuite secrétaire de rédaction à Lille, puis à Valenciennes comme chef de service.
Contrebassiste, André Joly assure également la critique de jazz. En 1991, lors de sa retraite, il s’installe dans le Vaucluse.
-
JOMAIN A.
Typographe et publiciste, A. Jomain collabora à L’Echo du Nord et au Moulin-à-vent au début des années 1840. A cette époque, il fonde avec Alphonse Bianchi et Célestin Schneider la Société des enfants de Béranger. Il est également gérant d’un cahier mensuel de chansons publié chez Leleux, Publications lilloises.
Après son départ de Lille, il fut commissaire de police dans sa ville natale, Nogent-le-Rotrou.
Source(s) :BM Lille, fonds Humbert, dossier 2, boîte 15; Jean-Paul Visse, La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de L’Echo du Nord, Presse universitaire du Septentrion, 2004, p. 61.
-
JONCIERES
Après une cascade de rédacteurs en chef, la rédaction du Courrier du Pas-de-Calais connaît un peu de stabilité avec l’arrivée en 1843 de Joncières. Venu jeune au journalisme, Joncières travaille d’abord pour un journal de Strasbourg, puis il collabore au Journal des Débats et à la Revue française publiée sous le patronage de Guizot . Lorsqu’il arrive à Arras, il travaillait au Droit . Parti couvrir les événements de février 1848 à Paris, il assiste à la chute de la monarchie. Malgré son intimité avec Tierny, le directeur du Courrier du Pas-de-Calais , il préfère rester dans la capitale plutôt que de revenir à Arras. Il entre à nouveau au Droit , puis passe à La Patrie.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er et 2 janvier 1928.
-
JONQUET Gustave
Comptable, puis filtier, Gustave Jonquet est renvoyé de l’usine où il travaillait, pour ses idées avancées. Il ouvre une petite librairie où il vend L’Egalité créé par le journaliste parisien Jules Guesde. En octobre 1879, il fonde avec Gustave Delory le syndicat des filtiers et fileurs de coton. En novembre 1880, il participe au IV e congrès ouvrier du Havre. Lors des élections cantonales de Lille sud-ouest, il se présente contre Achille Testelin et obtient plus de 1600 voix. Le 14 juillet 1882, il lance l’hebdomadaire Le Forçat dont le premier numéro est imprimé sur papier rouge. Constamment poursuivi, le journal change de noms plusieurs fois. Tuberculeux, Gustave Jonquet, que Le Cri du Peuple qualifie de «vaillant et dévoué lutteur à la cause de la Révolution sociale», meurt à l’âge de 32 ans.
Source(s) :Jean-Paul Visse, Ibidem; Le Cri du Peuple, 29 novembre 1883.
-
JOSSET ?
Josset est le rédacteur-gérant du bihebdomadaire L’Indépendant du Nord , imprimé chez Lesne-Daloin à Cambrai de mars 1833 à mars 1834. «Le but du rédacteur de ce nouveau journal, écrivait, le 6 mars 1833, Josset au préfet du Nord, est de soutenir de tous ses efforts la cause du gouvernement.» Représentant du «Juste Milieu», selon le sous-préfet de Cambrai, ce journal, qui a pour devise «Liberté, honneur et patrie, ordre public», fusionne cependant avec L’Emancipateur de Cambrai.
Source(s) :AD Nord, 1T 222.
-
JUBIN Alfred
Né le 22 décembre 1835 à Wanquetin, «Alfrède Olivier» Jubin,fut, si l’on en croit différentes sources, tour à tour, journaliste, géomètre, comptable, menuisier, rédacteur et cultivateur. Il a notamment été reporter à L’Avenir d’Arras et du Pas-de-Calais . Il est mort le 8 juin 1905.
R. B.
-
JUDET Ernest
Fils d’un officier en retraite, Ernest Judet entre premier de sa promotion à l’École normale supérieure en 1871. Nommé au lycée de Bastia en 1876, il en tirera Le Problème corse (1884). Mis à la retraite d’office pour avoir refusé une mutation en 1878, il se lance dans le journalisme. Il fut rédacteur au National, puis collabora successivement à La France , à La Nouvelle Presse , au Petit Journal sous la direction d’Hippolyte Marinoni (1886). En 1889, il en devint chef du service politique, jouant en fait le rôle de directeur. Farouche ennemi politique de Clemenceau ( Le Véritable Clémenceau , 1920), et des panamistes, il fut également un ardent antidreyfusard. Il fut condamné à 2 000 F d’amende pour avoir publié dans Le Petit Journal des articles diffamatoires à l’encontre du père de Zola, sur la base de documents altérés par Henry. En 1904, l’imprimeur Cassigneul ayant pris en main Le Petit Journal , il s’en va diriger L’Éclair. Il entretint des relations avec l’Allemagne et le Vatican. Pendant la Première Guerre mondiale, il dut vendre L’Éclair et s’enfuir en Suisse. Condamné par contumace (1923), il fut blanchi après être rentré en France. Il collabora à partir de 1925 à La Volonté d’Albert Dubarry.
Source(s) :Centre d’études du XIXe siècle français Joseph Sablé, Toronto.
K
-
KERLIDOU Gabriel
Embauché le 19 juin 1949 comme photographe à La Voix du Nord, Gabriel Kerlidou y a fait toute sa carrière. Il est mort à 93 ans en juin 2017.
-
KIEN Benjamin Pierre Guillaume
Fils d’un avocat, Benjamin Kien devient lui-même avocat. L’homme se double d’un homme de lettres, à 17 ans, en 1840, il publie son premier ouvrage en vers Fleurs du matin , d’autres suivent: en 1841 Le Tombeau de Napoléon, en 1849 Précis historique des journées de juin 1848 . Viennent par la suite des traductions en vers des œuvres complètes d’Horace (1850), des fables de Phèdre (1853), un drame en trois actes Vieux Comte et jeune roi (1852), un éloge à Jean Bart (1852). Benjamin Kien n’oublie pas de louer Louis-Napoléon par trois odes. Ces différents travaux lui valent de devenir membre de la Société d’agriculture, sciences et arts de Douai, correspondant de la société littéraire de Dunkerque. Collaborateur de La Dunkerquoise et du Commerce de Dunkerque qui paraissent jusqu’en 1853, Benjamin Kien change d’orientation et se fait imprimeur, tout en poursuivant ses travaux littéraires. Installé place Napoléon, le 27 décembre 1857, il devient propriétaire et rédacteur en chef de L’Autorité. Il meurt d’épuisement le 26 novembre 1863 à l’âge de 41 ans, sa femme prend alors sa succession à la tête de l’imprimerie.
-
KIEN Sophie Thérèse Clara
Cf. Zandyck Sophie Thérèse Clara
-
KNOCKAERT
En 1925, Knockaert est rédacteur en chef et gérant du mensuel La Lutte antireligieuse et sociale où il signe du pseudonyme de Jean Rouge. Ce périodique, qui se veut l’«organe de la libre-pensée et d’action sociale de la région du Nord», disparaît en 1936. Imprimé successivement à Lille, il a son siège à Marcq-en-Baroeul.
Source(s) :AD Nord, M149/142.
-
KWIATKOWSKI Michel Alexandre
Fils de Michel François Kwiatkowski, fondateur du journal en langue polonaise Narodowiec, Michel Alexandre Kwiatkowski est maître ès arts d’économie politique de l’université de Cambridge et licencié ès lettres de celle de Lille. Il fait ses débuts de journaliste dans le quotidien fondé par son père. En 1962, il en prend la direction. Victime de l’intégration des Polonais du Nord et du Pas-de-Calais, le journal cesse sa publication le 18 juillet 1989.
Catholique pratiquant, Michel Alexandre Kwiatkowski est l’auteur de deux ouvrages consacrés à Jean-Paul II.
Président des KSMP et vice-président de l’Union des Sokols, il est à l’origine de la rénovation du monument de La Targette, à Neuville-Saint-Vaast, érigé à la gloire des soldats d’origine polonaise ayant combattu à côté de l’armée française pendant la Première Guerre.
Source(s) :Griffon (Marie-Pierre) et coauteurs, 100 Figures du Pas-de-Calais – Témoins de l’immigration du Pas-de-Calais, Edition Les Echos du Pas-de-Calais p. 118-119
L
-
LA HIRE
Rédacteur militaire au Grand Echo du Nord, La Hire tient, avant la Première Guerre, la chronique «La Vie militaire». De la Délivrance jusqu’en 1939, il tient la correspondance militaire et des anciens combattants dans le même journal.
-
LABBE Jules
Né à Lille en 1826, Jules Labbe collabore à de nombreux journaux économiques de Paris. A l’issue d’un voyage de quelque quatre ans en Algérie pour y étudier les mœurs et le langage des populations, il publie dans Le Mémorial du Nord une série d’articles et, en 1865, un ouvrage Un mois dans le Sahara. De 1871 à 1873, il travaille pour L’Echo du Nord pour lequel il assure notamment une correspondance quasi quotidienne lors de la Commune de Paris. On le retrouve rédacteur en chef du Libéral du Nord pendant quelques mois, puis à partir de 1893, il collabore aux revues littéraires, artistiques et historiques Les Enfants du Nord et Armena des enfants du Nord, des Francs-Picards et des Rosati , publiées sous la direction d’Henry Carnoy.
Source(s) :Hippolyte Verly, Essai de biographie lilloise, 1869; Carnoy, Dictionnaire des hommes du Nord, 1899.
-
LABOURE Pierre
Fils d’un receveur des postes et d’une employée des postes, Pierre Labouré naît le 15 juin 1900 à Saint-Valéry-sur-Somme. Il est rédacteur au Progrès du Nord qu’il quitte en 1931. Après cette date, il est toujours mentionné comme «publiciste». En 1932, il est nommé chevalier du mérite agricole. Il meurt à Lille le 18 septembre 1978.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
LACQUEMENT Pierre François
Pierre François Lacquement devient rédacteur gérant du périodique légitimiste La Feuille de Douai en 1842. Lorsque ce journal devient, en 1849, Le Réformiste, il y occupe les mêmes fonctions . Sous le Second Empire, le journal est averti et Lacquemant est condamné pour diffamation à 50 F d’amende. Lorsque Le Réformiste fusionne avec L’indépendant en septembre 1854 pour donner naissance au Courrier douaisien , il reste rédacteur-gérant. Il participe également à l’éphémère Gayant. Echo douaisien qui parut de décembre 1857 à novembre 1858.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2017.
-
LAFFAILLE Gabriel
Originaire de la Gironde, Gabriel Laffaille entame sa carrière de journaliste dans le Nord en 1879 comme secrétaire de rédaction au Petit Nord. Il y rédige, sous le pseudonyme de Maurice Gérard, la «causerie hebdomadaire», la chronique artistique, publie des contes. Le 1 er janvier 1882, il crée, toujours sous le même pseudonyme, Le Nord, un bimensuel qui paraît jusqu’en octobre 1883. Il participe également à L’Almanach illustré du Petit Nord . En janvier 1886, il remplace Auguste Druelle comme rédacteur en chef du journal douaisien L’Ami du peuple. Six mois plus tard, à la suite d’un conflit entre l’imprimeur et les administrateurs du journal, ceux-ci lancent un nouveau titre Le Libéral du Nord qu’il dirige. En janvier 1888, la société éditrice du journal décide de se séparer de son rédacteur en chef qui leur réclame 25 000 F de dommages et intérêts et lui intente un procès. Si la presse conservatrice concède que «Lafaille est un écrivain habile, distingué, mais légèrement panier percé» Le Libéral du Nord le dépeint comme «obligé de quitter Lille par les méfiances que sa duplicité inspirait à ses collègues du Petit Nord , se réfugiant à Douai, s’accrochant comme à une planche à L’Ami du peuple qui agonisait.»
Source(s) :AD Nord, 1T 217/8; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2017.
-
LAGRILLIERE-BEAUCLERC Eugène
 Etudiant en médecine, Eugène Lagrillière-Beauclerc préfère, en 1879, le journalisme où il fait ses débuts à Marseille. Directeur de L’Avenir de Seine-et-Oise dès 1882, il gagne trois ans plus tard Paris où il travaille au Télégraphe et collabore au Gil Blas, au Voltaire, à La République libérale et à Lanterne. Arrivé dans le Nord en 1888, il passe par Le Petit Nord des frères Simon où il est secrétaire de rédaction, puis prend la direction du Phare du Nord à Dunkerque. Devenu rédacteur principal au Progrès du Nord à Lille en mars 1902, il reste rédacteur politique du journal dunkerquois et collabore à différents titres locaux. En décembre 1904, il est nommé rédacteur en chef et directeur de la Tribune du Nord. Il est vice-président de l’association des journalistes du Nord, membre de l’Association de la presse républicaine départementale de France. Il est l’un des fondateurs de l’Association de la presse coloniale française dont il sera le secrétaire général.
Etudiant en médecine, Eugène Lagrillière-Beauclerc préfère, en 1879, le journalisme où il fait ses débuts à Marseille. Directeur de L’Avenir de Seine-et-Oise dès 1882, il gagne trois ans plus tard Paris où il travaille au Télégraphe et collabore au Gil Blas, au Voltaire, à La République libérale et à Lanterne. Arrivé dans le Nord en 1888, il passe par Le Petit Nord des frères Simon où il est secrétaire de rédaction, puis prend la direction du Phare du Nord à Dunkerque. Devenu rédacteur principal au Progrès du Nord à Lille en mars 1902, il reste rédacteur politique du journal dunkerquois et collabore à différents titres locaux. En décembre 1904, il est nommé rédacteur en chef et directeur de la Tribune du Nord. Il est vice-président de l’association des journalistes du Nord, membre de l’Association de la presse républicaine départementale de France. Il est l’un des fondateurs de l’Association de la presse coloniale française dont il sera le secrétaire général.Auteur de plusieurs romans et de plusieurs pièces de théâtre et drames lyriques, Lagrillière-Beauclerc est membre de la Société des gens de lettres, de la Société des auteurs dramatiques, du Syndicat professionnel des auteurs.
Membre de la Société des agriculteurs du Nord, il était également officier de l’Instruction publique, il meurt en avril 1916.
Source(s) :AD Nord 1T 222/10; Le Bulletin de Lille, du jeudi 20 avril 1916; Dictionnaire biographique illustré du Nord, p. 620-622.
-
LAHAYE Kléber
Ouvrier métallurgiste et syndicaliste, Kléber Lafarge est élu conseiller municipal de Lille en mai 1929. Le 1 er septembre de la même année, il fonde le mensuel L’Insurgé, organe d’unité ouvrière et des forces révolutionnaires édité par le Parti socialiste-communiste et d’opposition (Section lilloise). Ce périodique paraît au moins jusqu’en 1931. Cette année-là, Kléber Lahaye devient président de l’Entente des comités de chômeurs de Lille. En 1932, il se présente en vain aux élections législatives, puis à l’élection sénatoriale partielle organisée dans le Nord après la mort de Charles Debierre. Lors des municipales de 1935, sa liste éliminée dès le 1 er tour, il soutient la liste socialiste au second tour. Par la suite, il est le candidat du Parti d’unité prolétarienne lors des élections cantonales et législatives.
Source(s) :AD Nord, M 149/142; Le Grand Echo du Nord, plusieurs numéros des années 1928 à 1940.
-
LALLEMANT Paul
Fils d’un directeur de sucrerie dans l’Oise, Paul Lallemant, après ses études secondaires, est admis à l’Ecole des industries agricoles de Douai, puis à l’Ecole pratique d’agriculture de Wagnonville dont il sort premier. En 1906, il opte pour le journalisme et rentre au Grand Echo du Nord comme chef du service économique. Il y tient notamment la chronique agricole hebdomadaire. Son intérêt pour l’agriculture lui vaut d’ailleurs plusieurs distinctions dont le mérite agricole dont il est fait chevalier en 1912 et est promu officier dix ans plus tard. Mobilisé pendant la Première Guerre, où il est officier d’administration du service de Santé, il reçoit en 1918 la croix de Guerre. Ayant repris ses fonctions au Grand Echo du Nord , il est notamment le créateur des concours annuels du «Plus Bel Epi de blé», des «Petits Inventeurs et artisans du Nord». Parallèlement, il est rédacteur en chef du Journal-circulaire du marché linier de Lille. En 1933, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur.
Paul Lallemant est membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, de la section du Nord du Syndicat national des journalistes et de l’Amicale des journalistes lillois. Il était également membre de la Société d’agriculture de Lille.
Source(s) :ADN, M149/142; Le Grand Echo du Nord, 30 juillet 1933; Site Léonore, dossier de légionnaire.
-
LALOU Charles
Né à Lille en 1841, Charles Lalou est le fils d’un haut-fonctionnaire. Directeur de mines de Bruay, il est engagé volontaire en 1870. Après la guerre, associé à Emile de Girardin, il se lance dans la presse. Propriétaire de La France , il dote ce quotidien de plusieurs éditions: La France de Bordeaux, La France du Nord ,… En 1889, il est élu triomphalement député boulangiste dans la 1 re circonscription de Dunkerque, mais il est battu en 1893. Lors de l’affaire de Panama, il est poursuivi par plusieurs tribunaux pour avoir publié la liste de 104 députés qui auraient touché de l’argent provenant de la Compagnie dirigée par Ferdinand de Lesseps. Condamné dans certains procès à plusieurs années de prison et à de fortes amendes, il abandonne le journalisme .
Charles Lalou meurt à Paris le 27 novembre 1918.
Source(s) :Jacques Néré, Le Boulangisme et la presse, A. Colin, 1964, Kiosque, n° 26, p. 230; Jean-Jolly, Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940.
-
LALOUETTE Télesphore
Né le 26 février 1901 sur la péniche Santa Fé en stationnement à Annay-sous-Lens de parents mariniers, Télesphore Lalouette est lui-même marinier. Il adhère au Syndicat unique de la batellerie (SUB) en 1929. Membre du Parti communiste, il en est exclu en 1936 et fonde à Douai une section du Syndicat des bateliers artisans, affilié à la CGT, dont les effectifs atteignent, en 1939, 1000 adhérents. Secrétaire général du SBA, il le dote d’un organe de presse, La Voix des bateliers. En mars 1937, Lalouette est condamné à 100 F d’amende et à 1000 F de dommages et intérêts au bénéfice du colonel de La Roque pour un article publié dans le journal L’Avenir du batelier.
Arrêté en 1941, il est interné, puis déporté à Auschwitz où il meurt le 15 août 1942.
Source(s) :https://maitron.fr/spip;php?article89588.notice, LALOUETTE Télesphore par Yves Le Maner et Michel Pigenet; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2017.
-
LALOUX Léon
Fils de l’avocat douaisien Charles Laloux, Léon Jules Aimé Lal oux est directeur du Triboulet , journal satirique, illustré de tendance légitimiste lancé à Douai en novembre 1878.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 020 R 058; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Ibid.
-
LANCIAUX Emile
Né orphelin de père le 7 décembre 1865 à Raismes, Emile Lanciaux est imprimeur à Somain où il a épousé le 20 août 1887 Gabrielle Marie Angélique Denimal. Il y lance en 1888 L’Utile. Organe indépendant des cantons de Marchiennes, d’Orchies et des environs. Il s’installe ensuite à Aniche où il sort en 1908 Le Semeur de l’Ostrevent qui devient en 1910 L’Avenir des cantons et le Semeur de l’Ostrevent.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 053 R 046; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des amis de Panckoucke, 2017.
-
LANGLAIS Henri
A peine sorti du collège, Henri Langlais est entré « en » journalisme dans la région du Nord et n’en sortira qu’empêché par la maladie quelque soixante ans plus tard.
 Né le 8 octobre 1858 à Neuilly-sur-Seine, il collabore en effet dès l’âge de 17 ans à L’Emancipateur de Cambrai puis à L’Echo de Douai. Licencié en droit, il est nommé, en 1885, directeur du quotidien lillois La Dépêche, dont son fondateur Alfred Reboux se sépare, et de son édition du soir Le Nouvelliste. Tout en restant à la tête de ces journaux lillois, en 1904, il dirige « à Paris » La Presse et La Patrie où il écrit sous le pseudonyme d’Alceste. En 1910, il crée le Grand Hebdomadaire illustré qui paraîtra jusqu’à la veille de la Seconde Guerre. Demeuré à Lille lors de l’invasion d’octobre 1914, il parvient à se faire rapatrier à Paris, en 1915, où il reprend la direction de La Presse et fonde, pour les réfugiés du Nord, La Dépêche du Nord. Son fils, Raymond, passé de la cavalerie à l’aviation, trouve la mort en juillet 1917. Parallèlement, il est membre de la Commission extraparlementaire de crédits aux régions libérées, membre du comité de reconstitution du Nord, membre du Comité de secours aux réfugiés lillois et aux prisonniers des régions envahies. Après la guerre, il mène dans son journal une « vive campagne » contre l’Administration centrale des régions libérées et le ministre lui-même et se voit refuser, en 1921, sa nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur. Par la suite, proposé en 1929, en 1935 et en 1936, il refusera toujours cette nomination. De retour à Lille, après la Délivrance, il fait reparaître La Dépêche et Le Grand Hebdomadaire illustré. Il crée, lui le spécialiste des questions économiques, le Nord financier.
Né le 8 octobre 1858 à Neuilly-sur-Seine, il collabore en effet dès l’âge de 17 ans à L’Emancipateur de Cambrai puis à L’Echo de Douai. Licencié en droit, il est nommé, en 1885, directeur du quotidien lillois La Dépêche, dont son fondateur Alfred Reboux se sépare, et de son édition du soir Le Nouvelliste. Tout en restant à la tête de ces journaux lillois, en 1904, il dirige « à Paris » La Presse et La Patrie où il écrit sous le pseudonyme d’Alceste. En 1910, il crée le Grand Hebdomadaire illustré qui paraîtra jusqu’à la veille de la Seconde Guerre. Demeuré à Lille lors de l’invasion d’octobre 1914, il parvient à se faire rapatrier à Paris, en 1915, où il reprend la direction de La Presse et fonde, pour les réfugiés du Nord, La Dépêche du Nord. Son fils, Raymond, passé de la cavalerie à l’aviation, trouve la mort en juillet 1917. Parallèlement, il est membre de la Commission extraparlementaire de crédits aux régions libérées, membre du comité de reconstitution du Nord, membre du Comité de secours aux réfugiés lillois et aux prisonniers des régions envahies. Après la guerre, il mène dans son journal une « vive campagne » contre l’Administration centrale des régions libérées et le ministre lui-même et se voit refuser, en 1921, sa nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur. Par la suite, proposé en 1929, en 1935 et en 1936, il refusera toujours cette nomination. De retour à Lille, après la Délivrance, il fait reparaître La Dépêche et Le Grand Hebdomadaire illustré. Il crée, lui le spécialiste des questions économiques, le Nord financier.Cofondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord en 1902, il en est le président pendant douze ans. Après la démission d’Emile Ferré qui lui avait succédé, il reprend cette présidence qu’il garde jusqu’à sa mort. Il fut également vice-président de la Fédération des journaux français.
Titulaire des médailles d’or de la Mutualité, de la Prévoyance sociale et des Assurances sociales, il était commandeur de l’ordre de Pie IX, de l’ordre d’Isabelle la catholique, de l’ordre serbe de Sainte-Sarah.
Henri Langlais fut tenté par la politique. Avant la guerre, libéral et catholique, il est membre de l’Action populaire libérale du Nord. Lors des législatives de 1919, il est candidat sur la liste d’Union nationale et républicaine du Nord sur laquelle on trouve Jean Plichon, Guillaume des Rotours, Constant Groussau et Victor Diligent. Il ne lui manque que quelques voix pour siéger au Palais-Bourbon.
Il meurt le 7 juin 1938 après une courte maladie qui l’avait obligé à laisser la direction de son journal.
Source(s) :AD Nord, M 127/47; La Dépêche, 7 juin 1938.
-
LANGLAIS Raymond Charles Louis
Né à Lille en 1889, Charles Louis Langlais est le fils d’Henri Langlais, directeur de La Dépêche et du Nouvelliste . Lors du lancement du Grand Hebdomadaire illustré en 1911, il en devient rédacteur en chef. Sous-lieutenant de réserve de cavalerie, il est mobilisé comme officier de liaison au 33 e RI, le régiment du colonel Pétain. Attaché à l’état-major de la 3 e brigade d’infanterie, il combat sur la Meuse, puis, après une opération de l’appendicite, il est placé à l’état-major de la 5 e armée commandée par le général Franchet d’Esperay.
A sa demande, il entre dans l’aviation. En 1917, lors de l’offensive de l’Aisne, près de Craonne, il est victime d’un accident où il est grièvement blessé. Rétabli, il passe, toujours à sa demande, dans une escadrille de chasse. Il trouve la mort à Enghien-les-Bains, alors qu’il réceptionnait un nouvel appareil.
Source(s) :Grand Hebdomadaire illustré, 14 septembre 1919, site : Mémoire des hommes.
-
LANNES Jean
Arrivé dans le Nord durant les premières années du xx e siècle, Jean Lannes est né à Toulouse en 1882. Mobilisé en août 1914, il accomplit toute la guerre dans l’infanterie. Fait prisonnier en février 1918 au chemin des Dames, il est emmené en captivité. Ce n’est que trente ans plus tard, en novembre 1937, qu’il reçoit la médaille militaire pour sa conduite durant la guerre. En 1926, Jean Lannes entre au Grand Écho du Nord comme photographe.
Durant la Seconde Guerre, membre du Front national, il confectionne, avec le concours de ses amis photograveurs et dessinateurs du journal des dizaines de faux tampons imitant ceux de la préfecture du Nord, des divers commissariats de la région et de la Kommandantur.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 13 novembre 1911; Jacques Estager, Ami entends-tu, … Paris, Messidor-Editions sociales, 1986
-
LAPETTE Louis
Sobriquet attribué par La Bataille à Louis Robichez, du Journal de Roubaix .
-
LAPLAUD Claude
Ancien résistant et déporté, Claude Laplaud a commencé sa carrière de journaliste en 1950 au quotidien communiste Liberté. En 1959, il rejoint la RTF à Lille devenue par la suite France 3. Il était surtout spécialiste en économie et en sports. Il cesse son activité en 1979. Claude Laplaud était également syndicaliste.
Source(s) :La Voix du Nord, 22 février 1997.
-
LARDET Alfred
Alfred Jacques Aristide Lardet arrive du Petit Bourguignon, journal édité à Dijon, dont il était rédacteur en chef lorsqu’il est nommé directeur du Mémorial artésien édité à Saint-Omer. En mai 1889, ayant soutenu lors de la campagne pour les élections législatives Alexandre Ribot contre Duhamel, il connaît une vive altercation avec le fils Duhamel qui l’insulte. Lardet le soufflette et les deux hommes se retrouvent sur le pré. En mai 1891, Lardet et le Mémorial artésien sont condamnés pour diffamation de l’aumônier de la maison de famille des militaires à 50 F d’amende chacun et 200 F de dommages et intérêts. Lardet quitte Le Mémorial artésien dans le courant du mois d’août 1891 pour raisons de santé. Il meurt quelques semaines plus tard le 6 septembre 1891 à l’âge de 50 ans.
Source(s) :L’Evènement, 5 et 6 octobre 1889; L’Autorité, 6 mai 1891; Le Progrès de la Côte-d’Or, 10 septembre 1891; L’Express du Nord et du Pas-de-Calais, 26 août 1891; Mémorial artésien, 8 septembre 1891.
-
LARDEUX Félicien
Fils d’un instituteur, Félicien Jacques Lardeux naît à Etriché dans le Maine-et-Loire en 1883. Il commence sa carrière de journaliste en février 1910 à L’Avenir de la Mayenne dont Emile Ferré, rédacteur en chef du Grand Echo du Nord, est le propriétaire, puis passe au Journal de Laval. En octobre 1912, il devient rédacteur parlementaire au Grand Echo du Nord. Mobilisé en août 1914 comme sous-lieutenant au 135 e RI, il est blessé en février 1915. Sa conduite pendant la guerre lui vaut plusieurs décorations dont la croix de chevalier de la Légion d’honneur. En 1931, il est promu officier. En 1919, lors du lancement du Télégramme du Nord, il quitte Le Grand Echo du Nord pour y revenir quelques mois plus tard et reprendre ses fonctions de rédacteur parlementaire. En 1944, après la Libération, bien qu’il ait continué à écrire pendant l’Occupation, il entre à La Voix du Nord. Toujours rédacteur parlementaire, il signe ses articles du pseudonyme Jacques Daurel. Après avoir quitté le quotidien lillois en 1948, il collabore à l’hebdomadaire Le Progrès du Nord sous le pseudonyme de Denis Claude. Il meurt en juillet 1962 à Milan.
Source(s) :Site Léonore, dossier de légionnaire; Le Grand Echo du Nord, 14 août 1931; Natalis Dumez, Le mensonge reculera…, Lille, 1946, p. 123.
-
LAROCHE Jean-Marie
Fils de Paul Laroche, directeur du Courrier du Pas-de-Calais, Jean-Marie Laroche est ordonné prêtre le 8 juillet 1906. Chapelain de l’église Saint-Louis-des Français à Rome pendant quatre ans, il est nommé curé de Sainte-Catherine-les-Arras en juillet 1910. Sa conduite pendant l’Occupation est récompensée par la Croix de guerre. De cette période, il laisse un ouvrage Histoire de la guerre à Sainte-Catherine-lez-Arras 1914, 1915, 1916. En 1922, il est nommé aumônier de l’hôpital d’Arras, et de l’Union catholique du personnel des chemins de fer dont il devient quelques années plus tard le directeur. A ce titre, il lance, en mars 1930, Le Nord ferroviaire. Parallèlement, l’abbé Laroche est membre du conseil d’administration de la Société anonyme du Pas-de-Calais qui édite le quotidien arrageois Le Courrier du Pas-de-Calais . En 1925, le journal connaît de graves difficultés et le conseil d’administration envisage la liquidation de la société, l’abbé Laroche lance alors une souscription d’un million de francs pour la création d’une nouvelle société et sauver le quotidien et son hebdomadaire Le Pas-de-Calais. En octobre, une nouvelle société est effectivement créée, présidée par Marc Scailliérez, entouré de Pierre Saudemont, juge au tribunal de commerce d’Arras, Fleury, industriel, Jules Dassonville, administrateur du groupement La Presse régionale. Membre du Syndicat d’initiatives et de tourisme de l’arrondissement d’Arras, créé en 1929, l’abbé Laroche collabore à sa revue, Les Amis d’Arras, imprimée à la Nouvelle Société anonyme du Pas-de-Calais. Le 20 juillet 1939, l’abbé Laroche est nommé chanoine honoraire de la cathédrale d’Arras. Installé à Paris durant l’Occupation, il ne siège à aucune réunion du conseil d’administration de la Nouvelle Société anonyme du Pas-de-Calais. Si Le Courrier du Pas-de-Calais est interdit à la Libération, dans les années qui suivirent, l’abbé Laroche n’avait, semble-t-il, pas perdu espoir de relancer un quotidien. En 1946, il est nommé prélat de sa sainteté. Il meurt en juillet 1957 à Paris. Chevalier de la légion d’honneur depuis 1951, il était également officier d’Académie, titulaire de la médaille commémorative de la catastrophe de Messine pour son dévouement lors de ce séisme, de la médaille de vermeil de la Couronne de chêne du Luxembourg. Il était également l’auteur de plusieurs ouvrages: La Question romaine, son histoire, sa solution (1929), La Côte d’Opale. Promenade anecdotique sur le littoral du Pas-de-Calais (1932) et d’un Petit Guide de poche de Rome (1950).
Source(s) :Site Léonore, dossier de légionnaire; Archives diocésaines Arras, 4 Z 899, article nécrologique dans, L’Avenir de l’Artois, juillet 1957, Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2009.
-
LAROCHE Paul Joseph Marie
Fils d’Antoine Benoît Camille Laroche, propriétaire, ancien magistrat ayant démissionné après la révolution de 1830, et de Marie-Thérèse, Louis Dubois de Hoves de Fosseux, Paul Laroche est né le 19 janvier 1839 dans une famille légitimiste.
Âgé d’à peine 20 ans , il collabore à La Revue du Pas-de-Calais en 1859-60, puis fait ses classes auprès de l’éditeur Casterman à Tournai. En 1878, il prend la direction de la Société anonyme du Pas-de-Calais à Arras qui édite le quotidien légitimiste éponyme depuis 19 octobre 1870. Il prend également en main Le Pas-de-Calais hebdomadaire sorti le 20 janvier 1878 à destination des populations rurales. Devant le succès de ce périodique, il lance dans le département du Nord Nord hebdomadaire qui n’a qu’une courte existence, puis dans le département de la Somme Somme hebdomadaire qui est diffusé jusqu’à la veille de la Première Guerre. En mars 1890, il rachète Le Courrier du Pas-de-Calais . Donnant une couleur royaliste au vieux quotidien bonapartiste, il poursuit sa publication au détriment du quotidien Le Pas-de-Calais qui disparaît après ce rachat. Sous son impulsion, le journal, quittant l’ancien refuge de l’abbaye de Marœuil, situé 33, rue d’Amiens, se dote d’un nouvel hôtel, place de la Gare, puis il est pourvu de nouvelles machines. Quelques mois après avoir célébré le centenaire du Courrier du Pas-de-Calais, héritier de la Feuille hebdomadaire du Pas-de-Calais , créée en 1803, Paul Laroche laisse la direction de la Société du Pas-de-Calais à Jules Eloy qui le secondait depuis quelques années. Il meurt le 11 juillet 1909 au château de Clairefontaine à Duisans.
Elu à l’Académie d’Arras en 1884, il avait été fait chevalier de Saint-Grégoire-le-Grand. Il était par ailleurs conseiller municipal de Duisans, village dont son père avait été maire à trois reprises.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er et 2 janvier 1928, Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Op. cit.
-
LAS FARGUES Noël
Etudiant de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, Noël Las Fargues débuta dans la profession à La Croix du Nord en 1951 puis il passa à Nord Eclair avant de devenir grand reporter au quotidien parisien La Croix de 1958 à 1986.
Il consacra sa vie à l’Amérique latine et à l’Amérique centrale qu’il découvrit et sillonna pour des reportages et des ouvrages, consacrés surtout aux minorités indiennes opprimées. Il présida l’Association des journalistes spécialistes de l’Amérique du Sud et des Caraïbes ( AJALC) de 1981 à 1983. Il suivait également les événements du Portugal, de l’Espagne et du pays Basque dont il maîtrisait les langues.
Aux éditions Karthala, il avait publié une douzaine d’ouvrages consacrés à l’Amérique latine et, aux Editions ouvrières, d’autres livres sur le Portugal et Salazar. Il est également l’auteur de La Liberté couleur d’œillet (Fayard 1980) et Euskadi, une nation pour les Basques (Encre 1985). Christian Rudel était son nom de plume.
-
LASSUS Robert
Robert Lassus commence sa carrière de journaliste à l’âge de 19 ans, au quotidien de Calais Nord Littoral où il est à la fois reporter, caricaturiste, concepteurs de jeux… Parallèlement, il assure la correspondance pour le journal France-Soir. Il entre ensuite à Radio Luxembourg où, la station devenue RTL quelques années plus tard, il sera rédacteur en chef adjoint des informations.
Il participe ou anime plusieurs émissions de télévision. Il est surtout l’auteur prolifique de nombreux ouvrages humoristiques. La retraite venue, il revient dans sa région d’origine et collabore encore à plusieurs hebdomadaires locaux.
-
LAUT Ernest
Après ses études dans sa ville natale, Ernest Laut est journaliste à L’Impartial du Nord. En 1887, il quitte Valenciennes pour Paris où il est d’abord secrétaire des éditions Ernest Leroux qui publie des ouvrages sur l’Inde et le bouddhisme. Laut devient ensuite secrétaire général de La Revue du Nord , paraissant deux fois par mois de 1890 à 1896. Il y donne de nombreux articles. En 1897, il entre comme secrétaire de rédaction au supplément littéraire du Petit Journal. En 1902, il en devient le rédacteur en chef et y signe ses articles sous les pseudonymes de Jean de Famars ou de Lacarre. Il collabore occasionnellement à L’Illustration. A partir de 1906, il signe également «Les Propos d’actualité» du Petit Journal sous le nom de plume de Jean Lecocq. Dans l’entre-deux-guerres, il tient une chronique dans Le Grand Echo du Nord. Auteur de plus d’une soixantaine d’ouvrages: Contes du cousin Zéphyr, Les Villes décorées, Le Passé anecdotique,… Ernest Laut est membre de la Société des gens de lettres. Dans la capitale, il a toujours milité pour défendre sa région d’origine, c’est ainsi qu’il a été président de l’Union valenciennoise de Paris, président puis président honoraire de La Betterave, la plus ancienne et la plus importante société des nordistes à Paris, mais aussi membre des Rosati. Il a été secrétaire général ou président de comités formés pour l’érection de monuments de Watteau, La Clairon, Talma,…
Officier de l’Instruction publique en 1902, Ernest Laut est promu chevalier de la Légion d’honneur en 1921 et élevé au grade d’officier en 1929.
Source(s) :Dictionnaire biographique illustré du Nord, Flammarion, 1909, p. 638-639; site Léonore, dossier de légionnaire; plusieurs numéros du Grand Echo du Nord.
-
LE MASSON Jacques
Fils de Lucien Le Masson, rédacteur en chef du Réveil du Nord , Jacques Le Masson entre aux Sports du Nord en octobre 1930 à l’âge de 17 ans. Après son service militaire, il passe au Réveil du Nord où il est rédacteur à la locale Lille puis secrétaire de rédaction au secrétariat général chargé de la «une» et des pages d’informations générales. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque le 6 juin 1940. Retenu en Prusse orientale pendant cinq ans, il regagne Lille en 1945. Il choisit de rejoindre Nord-Matin , installé dans les locaux du Réveil du Nord , suspendu pour faits de collaboration. Il y réintègre la locale Lille avant d’être muté au secrétariat de rédaction pour avoir repris le témoignage de la veuve de Jean Lebas, ancien maire de Roubaix, mort en déportation, en faveur d’un ancien commissaire de police. Jacques Le Masson reste au secrétariat de rédaction jusqu’à sa retraite en 1978. Syndiqué au SNJ dès 1933, il est après la guerre secrétaire adjoint puis secrétaire de la section de Nord Matin . En application des accords de Grenelle prévoyant une revalorisation des salaires, il contraint à l’issue de trois procès le groupe Hersant à rembourser toutes les augmentations légales intervenues durant les quelque six années de procédure et à aligner les salaires des journalistes de Nord Matin sur les tarifs de la presse quotidienne de province.
Source(s) :«Jacques Le Masson, l’homme qui fit tomber Robert Hersant», SNJ Infos, Supplément du Journaliste, n° 5, mars 1998, p. 15.
-
LE MASSON Lucien
De correcteur à rédacteur en chef, Lucien le Masson a gravi tous les échelons de la profession de journaliste au sein du même journal, Le Réveil du Nord. Né le 16 novembre 1884 à Roubaix, il entre au quotidien le 1 er octobre 1906, très rapidement, il passe secrétaire de rédaction, pui
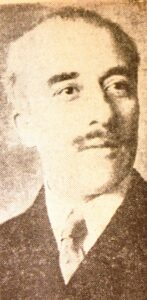 s il est chargé de l’organisation des reportages pour l’arrondissement de Lille. Mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, il est fait prisonnier près de Valenciennes et y reste jusqu’à la fin des hostilités. Lors de son retour au Réveil du Nord, Lucien Le Masson devient «reporter général», le 1 er janvier 1923, il est nommé secrétaire général de la rédaction et, deux ans plus tard, rédacteur en chef, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort survenue dans sa 58 e année. Il était également membre du conseil d’administration de la Presse populaire, société éditrice du Réveil du Nord et L’Egalité de Roubaix-Tourcoing dont il assurait parallèlement la rédaction en chef.
s il est chargé de l’organisation des reportages pour l’arrondissement de Lille. Mobilisé lors de la Première Guerre mondiale, il est fait prisonnier près de Valenciennes et y reste jusqu’à la fin des hostilités. Lors de son retour au Réveil du Nord, Lucien Le Masson devient «reporter général», le 1 er janvier 1923, il est nommé secrétaire général de la rédaction et, deux ans plus tard, rédacteur en chef, poste qu’il occupe jusqu’à sa mort survenue dans sa 58 e année. Il était également membre du conseil d’administration de la Presse populaire, société éditrice du Réveil du Nord et L’Egalité de Roubaix-Tourcoing dont il assurait parallèlement la rédaction en chef.Cofondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, il en fut pendant plusieurs années vice-président. Il était également vice-président de la Société des secours mutuels du Nord et membre de plusieurs associations d’enseignement postscolaires et d’œuvres laïques.
Ses années au service de la presse et des autres avaient été récompensées par la croix de la Légion d’honneur en 1926, la médaille d’argent de la Mutualité, de la Ligue du Bien public. Il était également officier d’Académie et titulaire de plusieurs distinctions étrangères.
Source(s) :Le Réveil du Nord, 1er octobre 1941; Le Grand Echo du Nord, 1er octobre 1941; Suite Léonore, dossier de légionnaire.
-
LE ROY Alfred
Propriétaire terrien, Alfred Hector Lucien Le Roy est issu d’une vieille famille républicaine. Secrétaire général du Comice agricole de l’arrondissement de Cambrai, il est élu conseiller municipal de Lesdain en 1900, puis maire en 1904. Deux ans plus tard, il est élu député gauche démocratique de la 1 re circonscription de Cambrai où il est réélu en 1910 et en 1914. Pendant la guerre, il sert comme lieutenant au 15 e bataillon territorial et demande à être affecté au front. En 1919 et en 1924, il ne parvient pas à retrouver son siège de député et se retire de la vie politique. Président du comité républicain de l’arrondissement de Cambrai, Alfred Le Roy est directeur politique du Petit Cambrésien, hebdomadaire qui paraît jusqu’à la veille de la Première Guerre.
Source(s) :Dictionnaire bibliographique illustré du Nord, Paris, Flammarion, 1910; Site de l’Assemblée nationale, dictionnaire des députés.
-
LEBLEU Philippe-Ezechiel
Fils de médecin, Lebleu fit ses études au collège de Douai. Polytechnicien, il était en garnison à Arras en 1830. À la nouvelle des ordonnances de juillet, il se prononce pour la résistance. En 1832, il manifeste sa sympathie aux ouvriers de Lyon. En 1833, nommé à Dunkerque, il contribue à la création d’un journal républicain, La Vigie . Puis il sert en Afrique.
En 1848, il est en poste à Béthune. Ses opinions républicaines connues lui valent d’être nommé représentant du peuple. Il est alors un partisan de Cavaignac. N’étant pas réélu à l’Assemblée législative, il est nommé à nouveau à Dunkerque, en qualité de chef du génie. Admis à la retraite en 1862, il était officier de la Légion d’honneur.
Source(s) :Gustave Vapereau dir., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, etc. 4e éd., Paris, Hachette, 4e éd., 1870.
-
LECHANTRE Jean
Fils de Georges Gustave Lechantre, photographe à Roubaix, et de Berthe Augustine Sophie Lavallard, Jean Lechantre entame sa scolarité dans sa ville natale, à l’institut Turgot, puis à l’école primaire supérieure à Lille. De 1933 à 1936, il est surveillant d’internat à Sedan. En 1937, il revient dans le Nord où il travaille au bureau d’affrètement de Valenciennes.
Militant socialiste, il a adhéré aux jeunesses socialistes de Roubaix en 1934, puis à la section sedanaise de la SFIO. Durant cette période, il a collaboré au Socialisme ardennais, puis à L’Avenir du Nord dirigé par Marcus Ghenzer. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en juin 1940 puis démobilisé quelques semaines plus tard. De retour dans sa région d’origine, il reprend son travail aux Voies navigables. Il entre en résistance, distribuant le journal clandestin L’Homme libre, organisant un réseau de renseignement et de sabotage, rattaché au réseau Brutus.

Jean Lechantre dans son bureau à Nord-Matin. (Collection Pierre Lechantre) C’est ainsi qu’il rencontre Pierre Houriez, inspecteur des impôts, futur directeur administratif de Nord-Matin. Il fonde également un groupe affilié à Libération-Nord. Membre du Parti socialiste clandestin, il fait la connaissance, en 1943, d’Augustin Laurent. A la Libération, il est président du Comité de libération de Fresnes-sur-Escaut. Sa conduite pendant l’Occupation lui vaut la Croix du combattant 1939-1945, la Croix du combattant volontaire de la Résistance, et la médaille commémorative 1939-1945. Erudit, passionné d’histoire, Jean Lechantre entre à la rédaction valenciennoise du nouveau quotidien socialiste Nord-Matin. Arrivé au siège du journal à Lille, il est nommé rédacteur en chef et éditorialiste après le départ de Jean Piat, en décembre 1944 . Lors du rachat de Nord-Matin par Robert Hersant, Jean Lechantre reste éditorialiste jusqu’en 1974, date à laquelle il doit cesser toute activité pour raisons de santé.
Membre de la fédération du Nord de la SFIO, il fut le président fondateur de la section du Nord de la LICRA, membre de l’Association des Français libres, de l’Alliance France-Israël. En 1983, Jean Lechantre avait été fait chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :La Voix du Nord, 6 novembre 1999; Nord Eclair, 9 novembre 1999; Pierre Bertrand, «Hommage à Jean Lechantre, un grand journaliste militant», mars 2000.
-
LECHEVIN Gilbert
Fils de Léon Lechevin, cabaretier à Valenciennes et de Marie Quénoy , Gilbert Lechevin entre en juillet 1940 au Petit Béthunois dont il est l’unique rédacteur . Après la Libération, il est embauché à La Voix du Nord . .
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 491R 002; 7 W 295.
-
LECLERCQ Albert
Le journalisme bien sûr, mais aussi le syndicalisme et la politique. Albert Leclercq mena de front ses trois activités.
Sa carrière de journaliste commença à Nord-Matin à la rédaction régionale à Lille. Elle se poursuivit dans le même quotidien à la rédaction de Dunkerque. Après le rachat du journal socialiste par le groupe Hersant, Albert Leclercq entra à Nord-Eclair à la rédaction de Roubaix couvrant particulièrement les secteurs de Wattrelos et de Leers, puis il passa au secrétariat de rédaction où il officia jusqu’à sa retraite. Délégué du personnel à Nord-Matin dès les premières années de sa vie professionnelle, Albert Leclercq occupa diverses fonctions au sein du Syndicat national des journalistes pour finir président de la Caisse de retraite des cadres de la presse.
C’est à Dunkerque, où il fut élu conseiller municipal, qu’il entama une carrière politique. Après avoir parcouru professionnellement le secteur de Wattrelos, il intégra l’équipe municipale de la ville en 1983 et devint adjoint au maire, poste qu’il occupa jusqu’en 1999.
Son dévouement à sa profession et plus généralement à la chose publique lui avaient valu d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. Albert Leclercq est mort dans sa 92 e année à Guerlesquin en Bretagne où il s’était retiré.
Source(s) :Blog de Dominique Baert, maire de Wattrelos, le 3 septembre 2013; faire-part de décès paru dans, La Voix du Nord, le 31 août 2013.
-
LECLERCQ Fernand
Ouvrier mécanicien à la Compagnie des chemins de fer du Nord, puis mécanicien préparateur à la faculté catholique des sciences de Lille en 1882, Fernand Leclercq s’installe à son compte comme opticien. Membre de l’Œuvre des cercles et des conférences Saint-Léonard, il fonde, en 1891, un cercle d’études sociales en 1891, relayant les revendications des ouvriers. En juin 1893, il fonde à Lille l’Union syndicale textile et l’Union syndicale métallurgique, puis suscite toute une série de syndicats indépendants à Fourmies, à Armentières,… En novembre 1893, il fait paraître un hebdomadaire Le Peuple de la région du Nord , appelé par la suite Le Peuple . Ce journal, qui bénéficie du soutien financier du négociant Ch. Rogez et du filateur Thiriez, appuie le programme de la Démocratie chrétienne, puis devient l’organe de premiers syndicats chrétiens, réunis en 1895 dans l’Union démocratique du Nord, présidée par Leclercq. Favorable à l’abbé Lemire, Le Peuple participe à la constitution, en 1896, du Parti démocrate chrétien dont Leclercq devient membre du conseil national en 1897. L’hebdomadaire, devenu en 1900, «journal démocratique chrétien», puis «organe des intérêts démocratiques et professionnels», cesse sa parution en 1908. Fernand Leclercq est fait chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, le 6 mai 1937, lors du cinquantenaire du syndicalisme chrétien dans le Nord. Il meurt le 8 novembre 1940 à Honfleur.
Source(s) :AD Nord, M 154/40; André Caudron, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, tome 4, Lille – Flandres, Beauchêne, CHRENO université Charles de Gaulle-Lille III, 1990; L’Echo du Nord, 12 décembre 1940
-
LECLERCQ François
A la fois journaliste, romancier et historien, François Leclercq, fils d’un petit industriel de La Madeleine, avait passé sa jeunesse en Mayenne avant de revenir dans le Nord pour achever ses études secondaires. A 18 ans, il fut embauché à La Voix du Nord , le 16 septembre 1946 comme rédacteur itinérant dans la banlieue lilloise, puis à Saint-Omer. Après quelques années de chevauchée motocycliste, il fut affecté au service des informations générales qu’il quitta pour vivre de sa plume de romancier.
Il avait le sens du détail et se plaisait à croquer des décors exotiques dans lesquels évoluaient de jeunes couples qui cherchaient l’amour à travers une série de péripéties romanesques.
Sous le pseudonyme de Stéphane Murat, il publia aux éditions Tallandier, dans la série « les Sept Couleurs» plus de vingt romans de ton sentimental qui lui valurent, pour Qui sème la vengeance, le prix du Roman populaire en 1961.
Parallèlement, sous le pseudonyme de François Debergh, il écrivait des récits historiques pour les éditions «France Empire», notamment en 1968, pour le cinquantième anniversaire de 1918.
François Leclercq retrouva la Voix du Nord où il dirigea le service des archives tout en effectuant des reportages.
-
LECLERCQ Jules
Né à Anserœul en Belgique le 25 février 1866, Jules Leclercq est naturalisé français le 25 décembre 1939. Cette naturalisation intervient alors qu’il est déjà très impliqué dans la vie de la ville où il s’est installée, Lys-lez-Lannoy. Depuis 1919, il est vice-président de l’harmonie «Les Amis réunis de Lys», il est le fondateur de la société colombophile «La Concorde de Lys-lez-Lannoy». A l’échelon de la région, il est vice-président de la fédération des archers. Ses nombreuses activités lui ont d’ailleurs valu d’être nommé chevalier du mérite agricole.
Jules Leclercq est surtout directeur de l’hebdomadaire Le Lannoyen, journal littéraire, commercial, agricole et financier qui parut de 1899 à 1939.
Source(s) :AD Nord, M 127/80.
-
LECLERCQ Robert
Membre de la presse lilloise depuis la fin de l’année 1918, Robert Leclercq fut notamment rédacteur à La Croix du Nord où il avait notamment créé une rubrique TSF. Il s’est tué en moto, le 8 décembre 1928, sur le Grand Boulevard de Lille à Roubaix au lieu-dit La Planche-Epinoy alors qu’il partait en reportage.
Il était membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, de la section du Nord du Syndicat national des journalistes depuis sa création, de l’Amicale des journalistes lillois.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 9 et 13 décembre 1928.
-
LECLERCQ Roger
Roger Leclercq a appris son métier de photographe au studio Raphaël Mischkind, à Lille, qui l’employa en qualité de retoucheur. Il travailla ensuite pour un autre studio lillois, Cassette.
Il appartenait au département photo de l’usine Fives-Lille-Cail, constructeur de matériel ferroviaire, quand il fut engagé à La Voix du Nord, à Lille, en septembre 1958.
Il a marqué une époque au service photo du journal alors dirigé par Serge Contesse. Il excellait, entre autres, dans les reportages instantanés, au bord des rings, des combats de boxe. Il prit sa retraite en 1982.
Son savoir-faire et sa disponibilité professionnels, associés à sa gentillesse et à son art dans la culture des relations humaines, ont laissé un souvenir durable, sympathique parmi ses collègues aujourd’hui à la retraite.
-
LECLUSELLE Adolphe Joseph
Né à Chercq en Belgique, Adolphe Lecluselle fut pendant plus de cinquante ans journaliste à Lille et à Cambrai. Après avoir travaillé au Mémorial de Lille, il rejoignit le journal catholique de Cambrai L’Emancipateur. Il passa ensuite à La Gazette de Cambrai. En 1888, Lecluselle devient rédacteur en chef du trihebdomadaire «républicain catholique» L’Echo du peuple qui paraît à Cambrai de 1888 à 1914. Il meurt le 18 février 1905, toujours en activité, à l’âge de 81 ans. Adolphe Lecluselle fut également un historien. Il est notamment l’auteur d’une Histoire de Cambrai et du Cambrésis et de La Guerre dans le Nord 1870-1871.
Source(s) :AD Nord, 3 E 6536; Le Grand Echo du Nord, 21 février 1905.
-
LECOCQ André
Né dans une famille d’imprimeurs, imprimeur lui-même, André Lecocq quitte l’entreprise familiale en 1943 pour rejoindre, comme journaliste, l’équipe qui prépare la sortie au grand jour de Nord Eclair . En 1950, il rejoint La Voix du Nord comme chef de l’édition de Roubaix. Sa formation et sa passion pour l’art en font l’un des meilleurs connaisseurs du «groupe de Roubaix». En 1963, sur intervention du patronat roubaisien, il est muté à la rédaction de la banlieue lilloise.
En 1968, il est nommé à la rédaction lilloise où il suit avec le même talent les informations religieuses et culturelles. Eternellement souriant et enthousiaste, André Lecocq, amateur d’art éclairé et bienveillant, est l’ami de nombreux artistes de la région. Il prend sa retraite le 30 juin 1976. Son travail avait été récompensé par le prix des Amis de Lille.
Catholique convaincu, ce père de six enfants consacre une partie de sa retraite à la rédaction de journaux paroissiaux.
Source(s) :La Voix du Nord, 22 juillet 1986, lettre de son fils Yves.
-
LECOCQ Marie Jules Napoléon Hippolyte
Né à Douai en 1857, Hippolyte Lecocq quitte la ville de Gayant à l’âge de 11 ans à la suite d’une mutation de son père, commissaire de police, prénommé lui-même Hippolyte. Il n’y revient qu’en octobre 1895 où il est nommé rédacteur du nouveau journal le Douai républicain.
Marié et père de famille, il est, selon la police «attaché à la rédaction de plusieurs journaux de Paris pour des articles littéraires et scientifiques». Toujours selon la même source, «les quelques articles qu’il a fait paraître jusqu’ici sont le produit d’un homme intelligent et d’un ferme républicain».
Source(s) :AD Nord, 1T 222/8.
-
LEFEBVRE Albert
Albert Lefebvre est rédacteur au Réveil du Nord en 1919-1920.
Source(s) :Le Cri du Nord, 8 juillet 1920
-
LEFEBVRE Fénelon
Rédacteur, puis secrétaire de rédaction au quotidien lillois La Croix du Nord , Fénelon Lefebvre en fut également le gérant jusqu’à la déclaration de la Seconde Guerre.
Source(s) :AD Nord M 149/142
-
LEFEBVRE Henri
Orphelin de père à 13 ans, Henri Lefebvre se fait vendeur de journaux, puis ouvrier textile, pour nourrir sa mère et ses deux sœurs. A 19 ans, en 1893, il adhère au Parti ouvrier de France. En 1904, il lance avec De Brabander et Mahu La Bataille. Il récidive en 1928 avec les deux mêmes en sortant La Bataille ouvrière pour faire pièce au Journal de Roubaix et l’hebdomadaire communiste L’Enchaîné.
-
LEFEBVRE Jules Henri
Fils d’un maître tonnelier et marchand de vins, ayant fait fortune, Henri Lefebvre fit de brillantes études au collège de Lille où, sous la direction de Gachet, il devint professeur. Il le suivit lorsque, contraint d’abandonner ses fonctions, il fonda un pensionnat libre. A la mort de Gachet, en 1845, il prit la direction de l’établissement qui, quelques années plus tard, fusionna avec le collège de Marcq-en-Bar œ ul. Henri Lefebvre y fut alors professeur jusqu’en 1860. Lors du rachat par le parti légitimiste lillois du Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais fondé par Ayraud-Degeorge, Henri Lefebvre fut nommé rédacteur en chef de ce quotidien dont Verly dit en 1867 qu’il est «le mieux rédigé des journaux flamands, artésiens et picards.» Si la police le présente comme «légitimiste et cléricale», elle reconnaît également que c’est un «écrivain distingué».
Source(s) :L’Abeille lilloise, 10 mars 1867.
-
LEFRANC Fernand
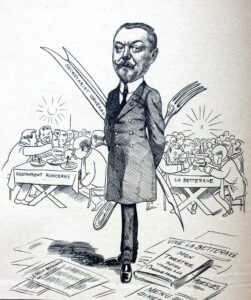 Fernand Lefranc collabore à plusieurs revues littéraires et artistiques parisiennes ou de province. Enfant de Béthune où il est né en 1863 d’un père horloger, il participe à la rédaction du Petit Béthunois dès 1887 et en devient rédacteur en chef en 1895 après le départ d’Ovide Blanchard. Il signe ses articles politiques aussi bien sous son nom que sous le pseudonyme de Ferfranc. Il interrompt sa collaboration pendant huit ans pour la reprendre à partir de février 1919. Avant d’être journaliste, le Béthunois est d’abord fonctionnaire. Il est en effet, selon le Petit Béthunois, « directeur du personnel, de la comptabilité et du matériel à la préfecture de police de Paris ».
Fernand Lefranc collabore à plusieurs revues littéraires et artistiques parisiennes ou de province. Enfant de Béthune où il est né en 1863 d’un père horloger, il participe à la rédaction du Petit Béthunois dès 1887 et en devient rédacteur en chef en 1895 après le départ d’Ovide Blanchard. Il signe ses articles politiques aussi bien sous son nom que sous le pseudonyme de Ferfranc. Il interrompt sa collaboration pendant huit ans pour la reprendre à partir de février 1919. Avant d’être journaliste, le Béthunois est d’abord fonctionnaire. Il est en effet, selon le Petit Béthunois, « directeur du personnel, de la comptabilité et du matériel à la préfecture de police de Paris ».Parallèlement, il mène une activité de militant politique. De 1901 à 1913, il est secrétaire de la fédération radicale du Pas-de-Calais qu’il a fondée. Il devient membre du comité national du Parti radical et radical-socialiste de France et à ce titre secrétaire de la commission de discipline. En 1924, il se présente aux élections législatives dans sa région d’origine, mais n’est pas élu.
A Paris, Fernand Lefranc est secrétaire général de l’Association amicale des enfants du Nord-Pas-de-Calais (La Betterave), de l’Alliance septentrionale, de la Société septentrionale de gravure, mais aussi de bien d’autres associations.
Ses nombreuses activités lui valent d’être titulaire de plusieurs distinctions, notamment d’être nommé officier de l’Instruction publique. Fernand Lefranc meurt le 22 mars 1949 à Nice.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 119/8; La Vie flamande illustrée; Le Petit Béthunois.
-
LEFRANC Louis Alexandre Ernest
Fils de Louis Joseph Lefranc, marchand de vin à Arras, et de Magdelaine Lavallée, Ernest Lefranc obtient son brevet d’imprimeur le 8 février 1848 et prend la succession de Gorillot-Legrand. A partir du 24 mars, il imprime La Liberté. Journal du Nord de la France, quotidien dirigé par Alfred Husson. Après le départ de celui-ci, en septembre, Lefranc en reprend la direction. Rallié à l’Empire, le journal qui a vu ses abonnés fondre disparaît le 22 septembre 1852. L’année suivante, le 2 août, Ernest Lefranc fonde La Société. Journal-Revue religieux politique, littéraire et commercial où il tient la rubrique locale, donne «les nouvelles religieuses». Le journal ne rencontre pas le succès espéré et Lefranc met fin à sa parution le 31 décembre 1855. Par ailleurs, il imprime le bulletin des délibérations du Conseil général du département du Pas-de-Calais (1853-1854), les Bulletins de la conférence d’Arras de la Société de Saint-Vincent-de-Paul (1854-1858), mais aussi de nombreux ouvrages. En 1858, l’imprimerie est reprise par Rousseau-Leroy.
Engagé dans la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul dès l’âge de 20 ans, Ernest Lefranc est responsable du patronage des jeunes apprentis. En 1846, il crée l’Œuvre des ouvriers ou Cercle Saint-Joseph dont «le but est de fournir à la classe ouvrière, outre le bon exemple et l’instruction religieuse, les moyens de se récréer honnêtement les jours de repos». En février 1855, il crée une caisse de prévoyance et de secours pour les ouvriers malades.
Source(s) :Michel Beirnaert, notice Lefranc, in, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, Arras – Artois – Côte d’Opale, Beauchesne, Paris, 2013; Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise, 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2009.
-
LEGLAY André, Joseph, Ghislain
André Leglay fit des études de médecine à Paris, et vint se fixer à Cambrai. Il abandonna peu à peu son métier pour se consacrer à sa passion, les recherches historiques. Il publia nombre de ses recherches dans les recueils de la Société d’émulation de Cambrai, dont il devint secrétaire, puis président. Après avoir occupé le poste de bibliothécaire municipal de Cambrai, Guizot le nomma conservateur des archives du Nord. Il fut également membre correspondant de l’Institut.
Il a publié de nombreux travaux historiques sur le Nord et Cambrai en particulier dans les Mémoires de la Société impériales des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille , dans le Bulletin de la Commission historique du Nord , dans La Revue agricole et littéraire de Valenciennes , Le Messager des sciences de Gand , Les Archives littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique , l’Annuaire statistique du Nord , La Gazette de Flandre et d’Artois , La Revue du Nord , et les bulletins des sociétés savantes de nombreuses villes (Cambrai, Dunkerque, Douai, etc.). Il est également l’auteur de nombreuses monographies. Il est chevalier de la Légion d’honneur (1838).
Source(s) :Hippolyte, Verly, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, op. cit.
-
LEGLAY Edward, André, Joseph
Fils d’André Leglay, Edward Leglay suivit les cours de l’École nationale des chartres. Conservateur adjoint des archives municipales de Lille, il passa dans l’administration en qualité de conseiller de préfecture. Il fut nommé par la suite sous-préfet de Gex, de Moissac et de Libourne. Il a collaboré à diverses revues publiées dans le Nord ( Annales du Comité flamand de France , L’Art en Province, La Revue universelle , Dictionnaire de la conversation, L’Encyclopédie du xix e siècle ). Il est l’auteur de travaux historiques remarqués.
Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1852.
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de bibliographie lilloise contemporaine 1800-1869, op. cit.
-
LEGRAND Albert-Jean
Rédacteur au Progrès du Nord aux côtés de Martin-Mamy et de Paul-T. Pelleau en 1918, Albert-Jean Legrand passe par la suite au Grand Echo du Nord.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 16 mai 1919.
-
LEGRAND Géry
Fils de l’avocat et homme politique Pierre Legrand, président du Conseil de la préfecture du Nord, révoqué lors du coup d’Etat de décembre 1851, puis député du Nord, Géry Legrand quitta Lille pour suivre des études de droit à Paris où il se lance dans le journalisme. A la mort de son père en 1859, il revient à Lille.
En novembre 1860, il fonde, avec Gustave Masure, un mensuel La Revue du mois auquel collabore Emile Zola. Ne pouvant obtenir l’autorisation de le transformer en journal politique, il préfère y mettre fin en 1863. Le 22 novembre, secondé par Masure et Bergeret, il lance Le Journal populaire de Lille , quotidien non politique, de petit format, vendu cinq centimes, avec lequel il a, comme il l’écrit à Zola, l’intention «de couper l’herbe sous le pied[du Petit Journal ], du moins dans le Nord, en donnant un jour plus tôt les nouvelles qu’il offre aux lecteurs». Legrand s’est fixé un objectif:«établir la situation morale et matérielle de nos populations ouvrières de Lille». Zola y tient d’ailleurs, jusqu’à sa suppression, une «Bibliographie», qui reprend les commentaires qu’il a écrits pour le Bulletin du libraire et de l’amateur de livres , publié par la maison Hachette où il est chef de la publicité. En janvier 1865, Le Journal populaire , dirigé par Alphonse Bianchi, est supprimé pour avoir traité de politique dans un article intitulé «Comment tombent les empires». Le lendemain, ce journal est remplacé par L’Echo populaire de Lille qui est supprimé en décembre 1866. Lui succède alors Le Courrier populaire de Lille qui passe aux mains de l’imprimeur Jules Petit. Le 12 juillet 1866, Géry Legrand fonde avec Gustave Masure Le Progrès du Nord qui d’hebdomadaire devient, l’année suivante, quotidien politique dont l’objectif est la chute de l’empire. En 1872, l’hebdomadaire satirique Le Diable rose dit de lui: «Géry n’est pas agressif, mais je ne voudrais pas me trouver en face de son fleuret, de sa haute taille et de son courageux sang-froid»
Conseiller municipal à partir de 1876, Géry Legrand est maire de Lille dès 1881. Il marque fortement la ville de son empreinte. Il achève le plan d’urbanisation lancé sous le Second Empire, il fait construire le palais des Beaux-Arts, il est l’artisan du transfert des facultés des Lettres et de Droit de Douai à Lille. Le 21 juin 1888, il devient sénateur et le reste jusqu’à sa mort en août 1902.
Source(s) :ADN, M149/142; Pierre Pierrard, Lille et les Lillois, Bloud & Gay, 1967; Jean-Paul Visse, La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de L’Echo du Nord, Presses universitaires du Septentrion, 2004; Colette Becker, «Zola écrivain-homme d’affaires», Revue d’histoire littéraire de France, 2007/4, vol. 107, p. 825-833.
-
LEJEUNE Jean-Patrick
Entré à la rédaction lensoise de La Voix du Nord le 1 er août 1970, Jean-Patrick Lejeune trouve la mort, le 20 avril 1992, ainsi que trois autres personnes, dans un accident d’avion dans les monts des Sudètes, à l’occasion d’un convoi affrété par le Secours populaire, «l’escadrille de la Solidarité», transportant du matériel médical en Roumanie et en Biélorussie.
-
LEJEUNE Raymond
A vingt ans, il est reporter à L’Avenir de Roubaix-Tourcoing . Homme de bonne moralité, il est noté comme «républicain sincère».
Source(s) :AD Nord 1T 222/26.
-
LEMAIRE Auguste
L’imprimeur Auguste Lemaire est rédacteur en chef-gérant du Mémorial artésien fondé en 1830 à Saint-Omer.
-
LEMAIRE J.-B.
Imprimeur à Saint-Omer, J.-B. Lemaire fonde en 1830 Le Mémorial artésien.
-
LEMARCHAND Eugène Clément
, directeur
Fils de Jean-Baptiste Lemarchand, facteur rural, et d’Anne Victoire Gelet, Eugène Clément Lemarchand naît en 1834 à Alençon dans l’Orne.
Bijoutier à Béthune, il collabore au Journal de Béthune après son rachat en juin 1879 par l’imprimeur David. En octobre 1880, lors du lancement du Libéral. Journal du comité conservateur de l’arrondissement de Béthune, il est déclaré propriétaire, gérant et rédacteur de ce périodique royaliste. Selon la police, il ne serait qu’un prête-nom. Ce périodique disparaît le 21 août 1881.
Source(s) :AD Orne, 3NUMECEC1/3, E, 2 0001 39; AD Pas-de-Calais, 10T 23; Jean-Paul Visse, La Presse du bassin minier du Pas-de-Calais, Société des Amis de Panckoucke, 2010.
-
LEMIERE Georges
Médecin et professeur à la faculté catholique de médecine, Georges Lemière collabore au Nouvelliste en 1929.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
LENGLET Émile Eugène
Etudiant en droit, Emile Lenglet prit une part active à l’insurrection de 1830. Devenu avocat à Arras, il fut l’un des animateurs du parti radical dans la région. Élu en 1848 à la Constituante, il siégea sur les bancs de la gauche modérée, ne votant pas avec les socialistes. Il démissionna après l’élection de Louis-Napoléon Bonaparte, et ne fut pas réélu.
Il a été le défenseur habituel du Progrès du Pas-de-Calais de Frédéric Degeorge, auquel il collaborait régulièrement.
Source(s) :Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains…, op. cit.; Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne-%C3%89mile Lenglet
-
LENGLET Lucien
Fils d’un membre du Conseil des Anciens, Lucien Lenglet fait ses études au collège de Douai. Avocat dans cette ville, il devient un des principaux rédacteurs du Progrès du Pas-de-Calais journal arrageois.
Après 1830, il devient magistrat (1840), mais reste dans l’opposition, et prend une part active à la campagne des banquets. Nommé procureur général à Amiens, il est élu à la Constituante, où il travaille au Comité de l’Instruction publique. Il combat la politique du prince-président. Non réélu, il reprend sa place à la cour de Douai.
Source(s) :Gustave Vapereau, dir., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, etc., op. cit.
-
LENOIR Georges
Docteur en droit, Georges Lenoir est avocat aux barreaux de Dunkerque et d’Hazebrouck. A ce titre, en 1906 à Lille, il défend le capitaine Magniez qui, lors des inventaires à Saint-Jans-Cappel, avait refusé d’obéir aux ordres.
Georges Lenoir fut également rédacteur en chef du Courrier du Pas-de-Calais de 1907 à septembre 1914 où il démissionne.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er et 2 janvier 1928.
-
LEON Marc
Rédacteur au Libéral pendant quinze ans, Léon Marc quitte ce périodique cambrésien pour un emploi dans une mairie d’arrondissement à Paris. De retour dans sa ville natale, il est embauché au journal L’indépendant du Nord dont il est le rédacteur en chef pendant plus de dix ans.
Républicain, il traîne, selon la police, la réputation d’un «brave homme», d’un «vieux philosophe».
Source(s) :AD Nord.
-
LEPEZ Ferdinand
Fils de Charles Louis Joseph Lepez, maréchal-ferrant, et de Palmire Derchez, Ferdinand Lepez est rédacteur en chef et propriétaire du quotidien L’Impartial de Valenciennes qu’il a fondé avec l’imprimeur Ayasse. En 1884, il devient maire de Raismes, fonction qu’il occupe pendant trente-cinq ans. Deux ans plus tard, il est conseiller de l’arrondissement de Valenciennes et le reste jusqu’en 1919. De 1893 à 1906, il siège au Palais-Bourbon comme député radical-socialiste de la 2 e circonscription de Valenciennes.
Le 23 septembre 1924, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :Leonore, dossier de la Légion d’honneur; Site de l’Assemblée nationale, base de données des députés depuis la Révolution.
-
LEPREUX Jules Charles Joseph
Fils d’Etienne Nicolas Lepreux, capitaine d’Infanterie né à Paris, chevalier des ordres royaux de Saint-Louis et de la Légion d’honneur, et de Marie Justine Flandryn, née à Bourbourg, Jules Charles Joseph Lepreux voit le jour à Bergues le 25 octobre 1828.
Après la révolution de 1848, il entre comme rédacteur au quotidien catholique La Liberté à Arras. Il quitte la préfecture du Pas-de-Calais, en septembre 1852, pour Bergues lors de la suppression de ce quotidien après trois avertissements. Dans sa ville natale, il fonde un bihebdomadaire non politique, le Journal de Bergues. Moniteur du commerce et des marchés du Nord . En butte à l’hostilité de la municipalité, il renonce en décembre 1853. Lepreux s’installe alors à Valenciennes où il rejoint la rédaction du journal conservateur créé par Arthur Dinaux L’Echo de la frontière. Il abandonne le journalisme et devient archiviste. Après Valenciennes, le 30 août 1872, il est nommé archiviste communal à Douai. Il participe à plusieurs revues savantes dont les Souvenirs de la Flandre wallonne , édité par Crépin . Il démissionne de son poste le 1 er juin 1882 en raison de problèmes de vue. Il meurt quelques mois plus tard. Jules Lepreux était le père de l’érudit Georges Lepreux, auteur de l’ouvrage Nos Journaux paru en deux tomes chez l’imprimeur Crépin à Douai en 1896.
-
LEQUELLEC
Lequellec crée en avril 1896 à Cambrai l’hebdomadaire Démantèlement imprimé par Deligne et Lenglet, imprimeurs rue des Rôtisseurs. Selon le sous-préfet de Cambrai, ce journal «est appelé à défendre la politique du parti réactionnaire».
Source(s) :AD Nord, dossier, Démantèlement, 2 avril 1896.
-
LEQUETTE Georges
Georges Lequette fait ses débuts dans le journalisme au Journal de Roubaix puis passe au Télégramme de Boulogne . Mobilisé dans l’infanterie lors de la Première Guerre, il combat à Verdun et est fait prisonnier. Il entre en 1920 au quotidien Le Courrier du Pas-de-Calais dont il devient le rédacteur en chef en mars 1922. Il assume les mêmes fonctions dans l’hebdomadaire Le Pas-de-Calais . Dans ses éditoriaux, il s’en prend courageusement à Hitler et à son régime, aussi après la défaite de la France en mai 1940 préfère-t-il entrer dans la clandestinité. Le 2 mars 1945, il devient rédacteur en chef du nouveau quotidien Libre Artois qui, après La Liberté du Pas-de-Calais , journal provisoire créé le 1 er septembre 1944, prend la succession du Courrier du Pas-de-Calais interdit de parution. Il meurt en novembre 1946.
Georges Lequette fait partie en 1913 des fondateurs de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais dont il assure le secrétariat, puis la vice-présidence. Il était également le président de l’Association des prisonniers de la guerre 1914-1918.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er et 2 janvier 1928.
-
LEROY Aimé Nicolas,
Leroy exerça d’abord la profession d’avocat à Douai (1815), avant de devenir conservateur de la bibliothèque de Valenciennes. Il fonda, avec Dinaux L’Écho de la frontière (1821), et la revue Archives historiques et littéraires du nord de la France et du midi de la Belgique .
Source(s) :Ad. Roton, Histoire du département du Nord, avec la biographie des personnages remarquables qui en sont originaires, Paris, G. Guérin, 1890, 71 p.
-
LEROY Albert
Le pays de Montreuil eût-il meilleur chantre, comme le qualifia La Voix du Nord, qu’Albert Leroy ? Journaliste, il en fut le chroniqueur pendant quelque quarante ans, historien local, l’un des meilleurs selon la Revue du Nord, il est l’auteur de plusieurs monographies sur les monuments de son terroir, mais aussi d’études de longue haleine, souvent illustrées par lui-même.
Fils d’un marchand briquetier, Albert Joseph Cyriaque Leroy naît à Neuville-sous-Montreuil dans le Pas-de-Calais au moment où le monde s’apprête à basculer dans le xxe siècle. Commis d’entreprise de travaux publics lors de son incorporation, il sert sous les drapeaux d’avril 1918 à mars 1921. Si on le retrouve quelque temps à Lyon, il regagne sa ville natale à la fin des années 1920 où il devient journaliste d’abord au Télégramme du Pas-de-Calais, puis après la guerre au Journal du Pas-de-Calais et enfin pour La Voix du Nord jusqu’en 1966. L’heure de la retraite venue, il continue à fournir articles, photos et dessins au quotidien lillois mais aussi au Journal de Montreuil. L’historien collabore à diverses revues historiques locales. Lors du lancement des Cahiers du pays de Montreuil en août 1983, il fait partie du comité de rédaction et y apporte régulièrement sa contribution.
Mû par la volonté de servir, Albert Leroy est élu conseiller municipal de sa ville natale dès 1945, puis adjoint à partir de 1960. Il est maire pendant un mandat, de 1971 à 1977. Il est l’un des fondateurs du district urbain de Montreuil. créé en 1964. Conscient de l’importance du développement du tourisme dans sa région, il anime le syndicat d’initiative de la vallée de la Course pour en favoriser la valorisation et l’animation.
Reconnu pour ses travaux d’histoire parmi lesquels on peut citer Les Vieilles Fermes du Pays de Montreuil, ouvrage en deux tomes, une Histoire de l’abbaye de Saint-Josse, il était membre de la Commission supérieure des monuments historiques. En janvier 1986, il préparait encore un répertoire historique et dessiné des vieilles églises du Pays de Montreuil.
Albert Leroy était chevalier de l’Ordre du mérite et officier des Palmes académiques.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 3 E 610/3 et 1 R 9347; La Voix du Nord, «Journaliste honoraire de La Voix du Nord et chantre du pays de Montreuil, Albert Leroy n’est plus», 7 janvier 1986, p. 4; Hubert le Bourdellès, «Albert Leroy, historien de la région de Montreuil», Revue du Nord, 1986, n° 268, p.249-251.
-
LEROY Arthur
Né à Cléty dans une famille d’agriculteurs, Arthur Leroy entre au petit séminaire de Boulogne en 1896 puis au grand séminaire d’Arras en 1903 avant d’être ordonné prêtre en juillet 1907. Il est désigné par l’évêque d’Arras pour suivre des études d’agriculture à l’école de Genech où il passe deux ans. Dès sa première année d’études, il donne des conférences et il écrit son premier article en 1909 dans L’Echo des Syndicats agricoles où il tient une chronique hebdomadaire, «Les travaux de la semaine».
Professeur à l’institution Saint-Joseph à Arras et directeur des Œuvres agricoles en 1919, il impulse la création de caisses rurales, encourage la fondation de syndicats agricoles, poursuit son activité de conférencier pour présenter les techniques et le syndicalisme agricoles. Il démissionne de ses fonctions en 1933, se retire dans sa famille. Puis devient aumônier à Anchin où il assure des cours.
En 1955, il se retire à Vitry-en-Artois où il décède le 19 décembre 1957. L’abbé Leroy était considéré comme «un ami et un serviteur des paysans».
Source(s) :Archives diocésaines d’Arras, La Revue du Nord, tome 89, n° 369, janvier-mars 2007, p 61-80; M-C Allart, L’enseignement et la formation professionnelle des agriculteurs dans le Pas-de-Calais sous la III° République.
-
LESNE-DALOIN
En 1838, Lesne-Daloin est rédacteur gérant de la Revue cambrésienne. Journal des intérêts du Nord de la France.
-
LESPES Léo, dit Timothée TRIMM
Timothée Trimm, alias «L’homme capable d’écrire sur n’importe quoi», alias Baronne Jenny d’Erdeck, alias Marquise de Vieux-Bois, alias Yorrick, etc., était né Napoléon (dit Léo) Lespès à Bouchain(Nord) le 18 juin 1815.
Conscrit au 55 e de ligne en 1832, il signe alors une boutade en vers de son titre de fusilier. En 1840, il travaille pour les petits journaux, signant «Le commandeur» ou Léo Lespel. Il publie alors dans L’Audience des romans ( Les Yeux verts de la morgue , par exemple). Puis il fonde divers périodiques littéraires ou d’actualité (dont un Journal des prédicateurs , qu’il rédige entièrement). En 1852, il est l’un des principaux fondateurs et collaborateurs du Petit journal , qui atteint les 200 000 exemplaires en moins de deux ans. Lespès, devenu Timothée Trimm, fournit au Petit journal une causerie quotidienne en guise de premier-Paris, qui fut l’un des éléments du succès du quotidien. Début 1869, Lespès abandonne Le Petit Journal pour écrire deux chroniques quotidiennes dans Le Petit Moniteur . On lui offrit pour ce faire, dit-on, les appointements fabuleux de 100 000 F par an. Il est, entre autres, l’auteur de Histoires roses et noires (1842, in-32); Les Mystères du grand Opéra (1843, in-8); Histoires à faire peur (1846, 2 vol. in-8); Les Esprits de l’âtre (petit roman, 1848, in-fol.); Les soirées républicaines (1848, in-folio); Histoire républicaine et illustrée de la Révolution de 1848 , (1848); Paris dans un fauteuil (1854); Les Veillées de la Saint-Sylvestre (1856); Les quatre coins de Paris (1863, in-18); Les Filles de Barrabas (1864, in-4); Avant de souffler sa bougie (1865, in-18); Spectacles vus de ma fenêtre (1864,6, in-18) – mais il ne faut pas lui attribuer les œuvres illustrées pour enfants signés Trimm, pseudonyme de M. Ratisbonne. Ceci sans compter les feuilletons et les innombrables articles écrits pour les journaux auxquels il a collaboré ( Le Petit Journal , Le Petit Moniteur , Le Figaro par exemple), ou ceux qu’il a fondés ou dirigés, tels: La Revue des marchands de vin ; Le Magasin des familles ; Le Journal des loteries ; La Presse Théâtrale ; le Journal monstre.
La ville de Bouchain lui a élevé un monument qui est toujours visible.
Source(s) :Gustave Vapereau et al., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, op. cit.; Victor Fournel, Deux écrivains populaires Ponson du Terrail et Timothée Trimm, in, Figures d’hier et d’aujourd’hui, Paris, C. Lévy, 1863, pp. 236-, 243; Charles Monselet, Mes souvenirs littéraires, Paris, Librairie illustrée, pp. 239-253; Eugène de Mirecourt, Timothée Trimm, Paris, Librairie des contemporains, 1869, 71 p.
-
LESPINARD Joseph Paris de
Se disant natif du Surinam Joseph Paris, chevalier de Lespinard, est probablement originaire d’Annecy où il serait né le 23 juin 1744. Quelque vingt ans plus tard, on le retrouve à Marseille où il est codirecteur des Annonces, affiches et avis divers de Marseille et obtient son brevet de libraire. En 1769, il fonde à Aix-en-Provence les Annonces, affiches et avis divers. Première feuille hebdomadaire d’Aix qui paraît jusqu’au 13 juin 1773. Menacé d’arrestation pour violation des règlements sur la presse, il s’enfuit aux Provinces-unies et ne rentre probablement en France que vers 1776. Sa présence à Lille est attestée dès le 28 mars 1778 à l’occasion de la naissance de son fils Louis François Henry. Le 3 août 1781, il obtient l’autorisation de faire paraître un hebdomadaire, la Feuille d’affiches, annonces, nouvelles et avis divers pour la province de Flandre , vendu au prix de sept livres et dix sols l’abonnement annuel, imprimé par Lemmens. Le 1 er août 1873, le journal change de titre, devenant les Feuilles de Flandres , il est imprimé d’abord par De Boubers, puis par Lemmens. S’il rédige lui-même une grande partie de sa feuille, il bénéficie de quelques collaborations, celle de l’abbé Bouvet, aumônier du régiment de Brie, celle de Taranger, professeur à l’université de Douai, celle de Louis Beffroy de Reigny, etc. Parallèlement, Lespinard crée un cabinet de lecture dans les locaux du journal, 489, rue de l’Abbaye de Loos, aujourd’hui rue Jean-Jacques Rousseau, où l’on peut se procurer, lire ou recopier des journaux français et étrangers. En avril 1784, il crée un service postal pour distribuer son journal dans Lille et la banlieue qui fonctionne jusqu’au 30 avril 1793. Lespinard a quelques démêlées avec la censure. Le 10 juillet 1784, le Parlement des Flandres ordonne notamment la destruction du n° 70 de son journal qui est brûlé par le bourreau. Le 16 septembre 1785, Les Feuilles de Flandres rendent compte de la 14 e expérience aérostatique que Jean-Pierre Blanchard effectua le 26 août avec le chevalier de Lespinard du départ du Champ de Mars de Lille à Servon-en-Clermontois, 500 kilomètres plus loin, et que Watteau immortalisa par deux tableaux toujours exposés à l’hospice Comtesse à Lille. A cette occasion, le Magistrat de Lille lui offrit une cafetière en argent massif, œuvre de l’orfèvre lillois François-Joseph Baudoux, mise en vente en 2005 par Christie’s à Paris. En 1790, les provinces ont été supprimées au profit des départements, le chevalier de Lespinard qui a jugé plus prudent de se faire appeler Lespinard, transforme son journal en Gazette du département du Nord qui paraît trois fois par semaine, puis quotidiennement à partir du 1 er janvier 1792. Le périodique est doté de suppléments que Lespinard imprime lui-même dans son imprimerie. Dans la nuit du 5 au 6 août 1793, devenu le citoyen Joseph Paris, il est arrêté comme suspect ainsi que sa femme. Paris était le nom d’un des assassins de Louis-Michel Lepeletier, tué en janvier 1893 alors qu’il vient de voter la mort du roi. Le 26 août, La Gazette du département du Nord se termine par l’avis suivant: «Le rédacteur à ses souscripteurs. Le public n’ignore pas ma détention. J’espère qu’on ne trouvera pas mauvaise la suspension de La Gazette du département du Nord jusqu’au recouvrement de la liberté.»
Si sa femme est rapidement relâchée, Lespinard est transféré à Paris le 21 août où il est détenu pendant quinze mois. Il est libéré le 26 vendémiaire an III (17 octobre 1794), grâce aux interventions des représentants Legendre et Bourdon de l’Oise. Si en 1797, il est toujours à Paris, il quitte ensuite la France. Pour la Suisse ou les Etats-Unis?
Source(s) :Danchin, II, LXVI, p. 223-231, Louis Trénard, «Pâris de Lespinard», in Jean Sgard (dir.), Dictionnaire des journaux 1600-1789, Paris, Universitas, 1991, notice 455.
-
LESTIBOUDOIS Thémistocle (
Lille, 1897 – Paris, 22 novembre 1876) Médecin , député Docteur en médecine, Thémistocle Lestiboudois exerce à Lille, et prend la direction de l’asile d’aliénés. Botaniste, il publie Etude sur l’anatomie et la physiologie des végétaux . Membre du parti libéral, il est nommé conseiller municipal de Lille en 1830, et, la même année, est élu député du Nord. Votant avec la gauche, il demande la suppression de l’impôt du timbre qui pèse sur les journaux et écrits périodiques. Il est également élu conseiller général en 1843. En juillet 1846, il est parmi les victimes de la catastrophe ferroviaire; blessé, il n’en soigne pas moins les autres victimes. Il ne fut pas élu à la Constituante, mais le fut à l’Assemblée législative en 1855. Il se rallia à l’Empereur, ce qui lui valut son entrée au Conseil d’état. Lestiboudois était chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :Gustave Vapereau, Gustave, dir., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, op. cit.
-
LETELLIER A
Venu du Journal des Débats, Letellier ne fit qu’un court séjour comme rédacteur en chef du Courrier du Pas-de-Calais . Il quitta le périodique arrageois en 1837 pour regagner Le Journal des Débats . En 1848, il poursuivit sa carrière dans le journal légitimiste l’ Assemblée nationale , suspendu en 1857 et qui reparut sous le titre Le Spectateur. Plusieurs fois averti, ce journal fut interdit en janvier 1858 après l’attentat d’Orsini contre l’empereur Napoléon III, tout comme La Revue de Paris dont Letellier était également rédacteur en chef.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er et 2 janvier 1928; Le Journal des Débats politiques et littéraires, 21 janvier 1858.
-
LEVAVASSEUR
Levavasseur est le premier rédacteur en chef de L’Indépendant de Saint-Omer lancé le 22 février 1849 par Chanvin fils.
Source(s) :«L’Indépendant créé le 22 février 1849 a 125 ans», L’Indépendant du Pas-de-Calais, 23 février 1974.
-
LEVEL Louis
Louis Level, marié, un enfant, marchand de journaux à Lens, est mort à 34 ans. Il était militant de la Fédération révolutionnaire du Pas-de-Calais, membre de la Libre pensée, de la Fédération des mineurs du Pas-de-Calais, et administrateur adjoint de L’Action Syndicale .
Source(s) :L’Action syndicale, du 3 avril 1904; Louis Level ne figure pas au Maitron.
-
LEVÊQUE
Lévêque est rédacteur, au moins de 1927 à 1937, à l’hebdomadaire L’Eveil social diffusé dans le Cambrésis et l’Avesnois, puis au Cateau-Cambrésis diffusé au Cateau.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
LEVÊQUE Claude Thomas Pierre
Originaire de Rouen où il est né le 24 nivôse an V, Claude Thomas Pierre Levêque rachète à Julien Chanson, le 21 janvier 1842, La Gazette de Cambrai. Echo du Nord et du Pas-de-Calais . Quelque vingt ans plus tard, le 22 avril 1861, il revend ce journal à Hyacinthe Renoud, propriétaire et agent d’assurances. En octobre 1863, il figure pourtant encore comme rédacteur de ce périodique.
Source(s) :AD Nord, 1T 222; AN F/18/297, 9 octobre 1863, rapport 53.
-
LEVÊQUE DE LA BASSE MOUTURIE Louis Charlemagne (
Sin-le-Noble, 18 avril 1784 –?,21 juin 1849) Journaliste Ancien officier démissionnaire après la révolution de Juillet, Louis Charlemagne Lévêque de la Basse Mouturie participe à la rédaction du périodique légitimiste La Boussole lancé le 1 er janvier 1831 par Jean-Baptiste Reboux-Leroy. A la suite d’articles dans lesquels Lévêque de la Basse Mouturie a traité les trois couleurs de «livrée des palefreniers de Philippe Egalité», les deux hommes sont frappés d’une peine de six mois de prison et de 1000 F d’amende, et le journal disparaît en mars 1833. Lévêque de la Basse Mouturie participe ensuite à La Gazette de Flandre et d’Artois qui sera supprimée en 1854. Il meurt en 1849. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont les plus connus sont: Itinéraire du Luxembourg et Esquisses biographiques des tablettes généalogiques de la maison de Goethals.
Source(s) :Hippolyte Verly, Essai de la bibliographie lilloise contemporaine, op. cit.; Jean-Paul Visse, La presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de l’Echo du Nord, op. cit.
-
LHERMINIER
Arrivant du Journal du Loiret où Mellon-Pradoux du Courrier du Pas-de-Calais lui succède, Lherminier ne fit lui aussi que passer dans le journal arrageois. Nommé le 3 août 1838, il est remplacé en juin 1839 par Bajux.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er et 2 janvier 1928.
-
LHERMITTE Julien-Henri
Archiviste paléographe, auteur d’un mémoire sur l’hospice de Seclin Un hôpital au Moyen-Age. Fondation et organisation de l’hôpital Notre-Dame, dit comtesse de Seclin , Julien Lhermitte collabore à L ’Echo du Nord en 1888-1889.
-
LHOTTE Gustave Adolphe
Fils d’Edouard Edmond Lhotte, marchand de nouveautés à Lille, et de Sophie Amélie Deroulers, Gustave Lhotte collabore à divers journaux de Lille et de Paris, avant d’entrer à L’Echo du Nord en 1872. Il y reste cinq ans, il le quitte pour devenir, de 1877 à 1879, à Douai, rédacteur en chef de L’Ami du Peuple puis, de 1879 à 1882, du Républicain à Saint-Omer et du Bonhomme flamand à Lille. A cette date, il dirige la rédaction du Petit Nord des frères Simon, jusqu’en 1887. Durant ces quinze années, il collabore à différents journaux parisiens ou de province: Le Voltaire, Le Petit Marseillais, L’Evénement, Lyon républicain, Le Petit Lyonnais, Le Petit Var de Toulon, Le Petit Centre de Limoges.
Parallèlement, Gustave Lhotte mène une carrière d’élu local comme conseiller municipal de Lille dès 1884 et d’adjoint au maire en 1888. Il abandonne ses fonctions électives lorsqu’il est nommé sous-préfet d’Hazebrouck le 21 juin 1888. Le 13 septembre 1897, il est nommé secrétaire général de la Seine-inférieure, poste qu’il n’occupe que jusqu’au 31 mai 1898. Nommé sous-préfet honoraire, il termine sa carrière comme percepteur à Boulogne-sur-Mer, puis à Croix, et enfin à Tourcoing. Il meurt en 1907 à Mons-en-Barœul dans la banlieue de Lille.
Gustave Lhotte était chevalier de la Légion d’honneur depuis le 30 décembre 1886. Il est l’auteur de deux ouvrages, Le Théâtre à Lille avant la Révolution et Le Théâtre à Douai avant la Révolution , couronnés par la Société des sciences, de l’agriculture et des arts de Lille.
Source(s) :Léonore, dossier de légionnaire; Dictionnaire biographique du Nord, 1893
-
LIAGRE Charles
Après des études au collège de Bailleul et au collège Saint-Joseph de Lille, Charles Joseph Pierre Liagre entre, le 1 er novembre 1901, à La Croix du Nord comme rédacteur. Il y fait toute sa carrière de journaliste jusqu’à sa retraite en 1934. A cette date, il conserve néanmoins ses fonctions de secrétaire général de l’Association professionnelle des journalistes du Nord qu’il exerçait depuis 1919. Membre de la commission historique du Nord, il est l’auteur de plusieurs communications et publications, notamment sur l’abbaye de Loos. Pendant la guerre, il avait également publié deux romans: Les Roseaux sous la tempête et Marthes et Maries. En janvier 1931, il a reçu la grande médaille d’or de la Société des sciences, de l’agriculture et d’arts de Lille pour ses travaux d’histoire. Il était également officier d’Académie.
Il meurt le 27 décembre 1938 après une courte maladie.
Source(s) :«Mort de M. Charles Liagre, secrétaire général de l’Association professionnelle des journalistes du Nord et du Pas-de-Calais», Le Grand Echo duNord, 28 décembre 1938.
-
LIAGRE Edouard
Fils d’un médecin installé à Seclin, Edouard Jean Baptiste Pierre Liagre est reçu licencié en droit en août 1872. Pendant plus de vingt ans, il est rédacteur aux quotidiens lillois La Dépêche et Le Nouvelliste où il signe ses articles sous le pseudonyme d’O de la Deûle.
Il meurt le 22 octobre 1913 à l’âge de 61 ans.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 048 R 051, 3 E 15397; Le Grand Echo du Nord, 27 octobre 1913.
-
LIESSE Achille
Achille Liesse avait effectué ses débuts journalistiques avant la Seconde Guerre à La Dépêche du Nord . A la Libération, il avait participé à la sortie de Nord-Eclair , puis en septembre 1949 il était entré à La Voix du Nord . Chef des informations lilloises, il prit sa retraite le 31 décembre 1971.
Source(s) :La Voix du Nord, 22 juillet 1979.
-
LIGNON Noël
Noël Lignon est gérant de La Croix du dimanche et de La Croix d’Arras et des mines du Pas-de-Calais en 1904-1905, il est rédacteur en chef de ce périodique en 1907.
Source(s) :La Croix d’Arras.
-
LIMBOUR Jules
Né à Hargnies dans les Ardennes, Jules Limbour est admis à l’école normale d’instituteurs de Charleville à l’âge de 15 ans, puis il suit les cours de l’école normale secondaire de Cluny. En 1877, il est nommé professeur d’allemand au collège d’Armentières, puis au lycée de Saint-Quentin. En septembre 1885, il arrive au lycée de Douai et deux ans plus tard, il est reçu à l’agrégation d’allemand.
Conseiller municipal radical-socialiste de 1892 à 1900, il est président du Cercle démocratique de l’Union républicaine et rédacteur au journal d’opposition Le Démocrate de 1900 à 1902. En janvier 1905, il est initié à la loge douaisienne « Le Réveil». Après la guerre, de 1919 à 1925, il est élu premier adjoint au maire chargé de l’Instruction publique et des travaux.
Jules Limbour sera président de la Société républicaine des conférences populaires, trésorier puis président du Comité du denier des écoles laïques, président de la Société des bains douaisiens. Officier d’Académie en 1907, il est membre de la Société d’agriculture, sciences et arts à partir de 1927. Il meurt le 27 janvier 1933.
Source(s) :Roland Allender, Jules Limbour, un Douaisien très occupé, Mémoires de la Société nationale d’agriculture, sciences et arts, Douai, 5e, série, tome XVII, 2014.
-
LINEZ Edouard
Imprimeur, journaliste, directeur de journaux, Edouard Joseph Linez est un personnage incontournable de la presse républicaine douaisienne des premières années de la république opportuniste. Fils d’Emile Edouard Linez, peintre en bâtiment, et d’Aglaé Joséphine Cramette, il naît le 14 mars 1845 à Douai. Lorsqu’il se marie le 24 février 1873, avec Clémence Hecfenille, blanchisseuse, il est typographe.
En février 1876, alors que L’Ami du peuple reparaît après plus d’un an d’interdiction, Linez en devient le copropriétaire et le gérant. Imprimeur de Gayant & sa famille qui prend, en mars 1882, le titre de Journal de Denain, il imprime et dirige ce périodique. En septembre de la même année, il fonde Le Petit Douai pour contrer l’influence des journaux Le Vrai Gayant et La Gazette de Douai. Si ce périodique ne répond pas à ses espérances et doit arrêter sa publication dès décembre, quelques mois plus tard, le 1 er octobre 1883, Linez crée et dirige L ’Ouvrier mineur. Moniteur des chambres syndicales ouvrières du Nord et du Pas-de-Calais qui devient en janvier 1884 l’organe officiel du Syndicat des mineurs du Pas-de-Calais. En 1883, Linez a adhéré à la Ligue révisionniste, créée en juillet à Paris par Georges Clemenceau et Camille Pelletan, pour réclamer des réformes constitutionnelles. Après la disparition de L ’Ouvrier mineur , Linez devient, en mai 1885, imprimeur, rédacteur et gérant du Progrès de Denain , derrière lequel on trouve Emile Basly. Lors de l’élection de celui-ci à l’Assemblée nationale, il assume les fonctions de directeur. En février 1887, il est condamné à 500 F d’amende et 500 F de dommages et intérêts pour diffamation. Quelques mois plus tard, en juillet, il annonce l’arrêt de la parution du Progrès de Denain. Il n’en continue pas moins son activité d’imprimeur. Sortent ainsi de ses presses le Bulletin de la société d’instruction militaire et de gymnastique Pro Patria de Douai (1894-1895), Le Patriote (1896-…). En février 1900, L’Echo douaisien (1891-1914), journal «réactionnaire», a son siège à l’imprimerie Linez, devenue l’imprimerie moderne. De son côté, Linez lance en 1893 La Feuille d’annonces de l’arrondissement de Douai qui paraît jusqu’en 1898.
L’imprimeur douaisien meurt le 17 décembre 1900 à l’âge de 55 ans.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 020 R 056, 1Mi EC 178 R0004, 1 Mi EC R 045; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, op. cit.
-
LIONET François
Diplômé de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, François Lionet entame sa carrière de journaliste au bureau régional d’information de l’ORTF à Lille en 1970. Deux ans plus tard, il rejoint le bureau d’Amiens, puis il travaille à Saint-Etienne et à Lyon. En septembre 1978, il revient à Lille où il est nommé rédacteur en chef adjoint. En mars 1984, il devient rédacteur en chef de B.R.I. de France 3 Lille.
De 1986 à 1990, il est directeur adjoint de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille. En septembre 1990, il est nommé rédacteur en chef d’Europole TV, une antenne locale pour l’agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing.
-
LIZOT
Lizot est la cheville ouvrière de La Fauvette , dont il assure tout à la fois l’administration et la direction littéraire. Né à Montaigu d’un père officier de cavalerie, puis administrateur des Domaines, bachelier ès lettres, licencié en droit, Lizot fils fut rédacteur au Bon Diable et à La Presse commerciale de Paris. Il voyage, se marie en Bourgogne, passe à Bruxelles, et ouvre un cabinet d’affaires à Roubaix en 1848, cabinet qui va vite péricliter. Il devient correspondant de La Liberté , journal lillois. En 1857, il est comptable, et le sera quinze ans, jusqu’à sa mort le 22 février 1872. Pris dix heures par jour par son travail, c’est après qu’il se consacre à son courrier et à La Fauvette du Nord , qu’il a fondée en 1860 avec quelques amis. C’était, paraît-il, un homme «gai, sans façon, affable, sympathique, amoureux de son jardin de Croix». Lizot publie dans sa revue sous son nom, mais il signe aussi Noël Itzol , ou Toliz-Enol , ou Le Solitaire des Flandres .
Source(s) :Bernard Grelle, Le, Commerce des imprimés à Roubaix, Lire à Roubaix; Bernard, Grelle, Catalogue presse roubaisienne, Lire à Roubaix.
-
LODIEU
Rédacteur au Progrès du Pas-de-Calais à Arras, Lodieu devient le correspondant arrageois du Furet. , journal béthunois dirigé en 1851 par Delcloque.
Source(s) :Le Furet., 16 août 1851.
-
LOGIE Michel
Fils d’un pharmacien audomarois, Michel Logié est entréà La Voix du Nord en 1945. Il faisait partie de la 15 e promotion de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille 1938-1941.
Il devint rapidement le chef des services techniques de la Rédaction où sa rigueur professionnelle et ses compétences lui acquirent une reconnaissance unanime à la fois des dirigeants du journal, des membres du Conseil de surveillance et de ses confrères pendant plus de trente ans.
Professeur à l’ESJ puis secrétaire général de l’Association des anciens étudiants de cette école, il a formé des générations d’étudiants à Lille de même qu’à l’Institut français de presse à Paris.
Sa passion de l’information, juste, claire et précise, l’a amené à diriger la plupart des commissions et des stages de formation professionnelle jusqu’à son départ en retraite en décembre 1978. Il était chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.
-
LOMON Alexandre
Avocat de formation, le parisien Alexandre Lomon s’oriente vers le journalisme à la fin des années 1840. Il est notamment rédacteur au Charentais, journal édité à Angoulême, puis au Courrier de la Gironde. En 1852, il arrive à Lille et entre au journal Le Nord que venait de fonder à Lille Guillaume Delamare, pour soutenir le régime impérial. En janvier 1854, il est notamment condamné à vingt et un jours de prison et 300 F d’amende pour avoir blessé le directeur du théâtre de Lille lors d’une querelle . Après deux ans de collaboration au Nord , il quitte Lille pour Toulouse où il travaille pour L’Aigle . En 1861, il regagne Paris où il passe successivement au Pays, à L’Evénement pour revenir en 1867 au Pays. En septembre 1870, il est incarcéré quelques semaines. En 1871, il rejoint la rédaction de La Patrie . Il meurt à son domicile d’Asnières le 26 novembre 1873. Il est l’auteur de plusieurs publications.
Source(s) :BM Lille, fonds Humbert, boîte 17, dossier 4; Hippolyte Verly, Essai de biographie lilloise contemporaine 1800-1868, op. cit.
-
LORIDAN Julien, dit LOREDAN Jean
Né à Armentières le 1 er avril 1853 de Julien Eugène Théophile Loridan, capitaine au 9 e régiment d’infanterie légère de Reims, et de Céline Louise Duthoit, l’homme de lettres Julien Loridan, plus connu sous le pseudonyme de Jean Lorédan, collabore à de nombreux journaux. On retrouve notamment sa signature dans les quotidiens parisiens Le Siècle, La République française, Le Petit Journal, mais aussi dans des titres de province: L’Echo du Nord, Lyon républicain, L’Echo du midi, Le Salut public…
Auteur de romans et de nouvelles, il était membre de la Société des gens de lettres et officier d’Académie. Il meurt à Paris le 26 mai 1937.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 039 R 018; Dictionnaire biographique du Nord, 1893.
-
LOTH Arthur
Avocat, ancien élève de l’Ecole des chartes, Arthur Loth se tourne vers le journaliste. Il est rédacteur en chef de L’Univers, puis fonde, avec Roussel, un nouveau quotidien catholique La Vérité. On retrouve sa signature dans plusieurs périodiques départementaux notamment L’Echo douaisien. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La Charité catholique en France avant la Révolution, Saint-Vincent-de-Paul et sa mission sociale,…
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord, 1893; Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des, contemporains, op. cit.
-
LUBAC Henri SONNIER de
Henri de Lubac, jésuite, théologien et cardinal français, entre dans la Compagnie de Jésus après ses études Il est ordonné prêtre en 1927. Il combat lors de la Première Guerre mondiale, et est blessé à la tête en 1917. Cette expérience ne le quittera jamais. Professeur de théologie à Lyon, au début de la Seconde Guerre mondiale, il s’engage dans la Résistance, et participe à la création des Cahiers du Témoignage chrétien . Il y publie: «Antisémites» (Cahiers VI-VII avril-mai 1942, R.P. Chaillet , Ganne, J. Hours, de Lubac) ; «Droits de l’homme et du chrétien» (Cahiers VIII-IX, juin-juillet 1942, R.P. Chaillet, de Lubac), «Collaboration et fidélité» ( Cahiers X-XI, octobre-novembre, 1942, R.P. Chaillet, Vialatoux, Chaillet, de Lubac), etc. Ces textes seront repris dans le vingt-quatrième tome de ses œuvres complètes, Résistance chrétienne au nazisme . Ses écrits théologiques ont fait scandale. Il fut soupçonné de «modernisme» par le Saint Office, et implicitement critiqué par l’encyclique Humani Generis (1950). Le général des jésuites lui interdit alors de professer, interdiction qui dura sept ans. Mais il revint en grâce avec Jean XXIII, et prit une part active au Concile Vatican II en tant qu’expert. Il a été nommé cardinal en 1983.
Source(s) :plusieurs sites internet.
-
LUNVEN André
Fils d’Eugène Joachim Marie Lunven et de Marie Mathide Duclos, André Lunven naît à Vannes dans le Morbihan le 6 décembre 1883.
Ingénieur des Arts et Manufactures, sorti de l’Ecole centrale de Paris en 1906, il devient co-gérant de l’Imprimerie Crépin, 11, rue de Valenciennes à Douai à partir de 1923. Après la mort de Gaston Crépin en 1933, il exerce seul jusqu’en 1939. André Lunven est également membre du conseil d’administration du quotidien arrageois Le Courrier du Pas-de-Calais. Il se marie le 1 er septembre 1913 à Douai avec Louise Céline Marie Andrée Bassée, fille de l’imprimeur Achille Bassée. En 1914, il est mobilisé et participe aux combats durant toute la durée de la guerre. Le 5 décembre 1938 à Paris, il se remarie avec Andrée Marie Juliette Bourdon. Lors de la Seconde Guerre, il est mobilisé comme chef d’escadron, mais démobilisé en 1941. André Lunven était chevalier de la Légion d’honneur depuis 1939.
Source(s) :Site Léonore, dossier de légionnaire; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, op. cit.
-
LUSSIEZ René
Fils d’un instituteur en poste dans le quartier de Fives à Lille, René Lussiez commença sa carrière professionnelle à la Compagnie des chemins du fer du Nord, avant d’entrer dans la presse en 1925. Il fut rédacteur au Réveil du Nord, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre. En 1938, il reçut, en même temps qu’André Carton du Grand Echo du Nord , le prix du meilleur reportage de la presse lilloise décerné par Les Amis de Lille. Engagé dans de nombreuses associations dont l’Amicale Paul-Bert de Fives, il était titulaire de plusieurs médailles: des Assurances sociales, de la Prévoyance sociale. Il était également officier d’Académie et chevalier du Mérite agricole. Le 19 juillet 1949, il avait été embauché à La Voix du Nord où il avait effectué des remplacements dans plusieurs rédactions détachées. Il avait pris sa retraite en 1955.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 27 février 1929, 9 septembre 1930, 18 avril 1935, 20 mars 1936, 10 avril 1938; La Voix du Nord, 16 septembre 1956.,
I-J-K – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais M
-
MABILLE Charles
Fils d’un notaire et conseiller municipal de Valenciennes, Albert Mabille, et de Julienne Lefevre, Charles Mabille naît à Valenciennes le 6 juin 1846. Licencié en droit, il devient avocat. En avril 1884, après le départ de Jules Bruyelle, il est nommé directeur et rédacteur en chef de L’Echo de la Frontière . Il le reste jusqu’à sa mort le 27 janvier 1891 où il est remplacé par Camille Viton de Thorame.
Source(s) :L’Echo de la Frontière, des 18 avril 1884 et 12 février 1891; L’Express du Nord et du Pas-de-Calais, 21 février 1891.
-
MAGNIER Edmond
«Personnalité imprécise» écrit d’Edmond Magnier l’historien de la presse Pierre Albert dans le tome III de l’ Histoire générale de la presse française . Né le 20 avril 1841, la vie du fils de Pierre Joseph Magniez, cordonnier à Boulogne-sur-Mer, et de Marie Marianne Stubert fut pour le moins romanesque, voire rocambolesque. Selon les documents conservés aux Archives départementales du Pas-de-Calais, le 1 er janvier 1869, il fonde dans sa ville natale le quotidien politique La France du Nord dont le tirage atteint plus de 2000 exemplaires. En mars 1871, il devient également propriétaire rédacteur en chef de l’hebdomadaire L’Union républicaine de Calais. En mai 1871, on le retrouve dirigeant l’éphémère quotidien amiénois La Somme. Le 3 novembre, il est condamné à trois mois de prison, 200 F d’amende et 2000 F de dommages et intérêts pour diffamation du général Henry, commandant de la subdivision de la Somme. En janvier 1874, Magnier revend La France du Nord à Nathan Berr, imprimeur à Boulogne-sur-Mer. Chassé du Figaro en 1870 par Villemessant – nous suivons ici Pierre Albert –, il fonde en avril 1872, avec Auguste Dumont, lui-même administrateur du Figaro, L’Evènement . Après la démission d’une grande partie de la rédaction et de Dumont, il en devient propriétaire en décembre 1872, le faisant évoluer du centre gauche au radicalisme. A la suite d’articles parus dans son journal , il doit au cours des années suivantes répondre aux injonctions de plusieurs personnes qui lui demandent réparation pour diffamation les armes à la main: le comte Albert de Dion, Georges Legrand, Thomeguex et Joseph Reinach. A plusieurs reprises, on retrouve, pour d’autres motifs, son nom à la rubrique judiciaire de la presse. Si, par ailleurs, l’homme mène grand train, il a la réputation de«ne pas payer ou si peu et si difficilement ses collaborateurs». Edmond Magnier a également des ambitions politiques. En octobre 1877 et en août 1881, il se représente en vain aux élections législatives à Nice et à Draguignan. Afin de mieux s’enraciner dans le département du Var, il achète le château de San Salvadour à Hyères qui, en avril 1892, reçoit la visite de la reine Victoria. En 1880, il est élu conseiller général à Saint-Tropez et est réélu à plusieurs reprises. De août 1890 à août 1892, il préside même le conseil général du Var. En 1887, il est élu maire de Hyères. Par contre, il échoue lors des élections législatives de 1889, mais il est élu sénateur du Var en janvier 1891. «Des dépenses exagérées et le goût du luxe bruyant et inutile ne tardèrent, selon Le Figaro , pas à mettre le désordre dans ses affaires.» En avril 1895, le tribunal de commerce de la Seine prononce sa faillite. L’Evènement est racheté par G. Laplace, cependant, Magnier reste rédacteur en chef. En quelques semaines, les ennuis s’accumulent. Rattrapé par le scandale des Chemins de fer du sud, en août, il est accusé d’avoir reçu illégalement quelque 87500 F de la société. Mis en accusation, il prend la fuite alors que son domicile parisien est surveillé par la police. Quelques jours plus tard, il se constitue prisonnier. Il est finalement condamné à six mois de prison et est déchu de son mandat en décembre 1895. Ses propriétés, dont son château, sont mis en vente. Ruiné, il meurt le 29 mars 1906 à la maison des frères Saint-Jean-de-Dieu à Paris. Il est inhumé à Boulogne-sur-Mer.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 10T 23 et 2Z 718; Pierre Albert, «La Presse française de 1871 à 1940», in Claude Bellanger, et al., Histoire générale de la presse française; plusieurs numéros du Temps, du 3 novembre 1871 au 31 mars 1906; Le Figaro, du 31 mars 1906.
-
MAHAUT Pierre
Rédacteur au Grand Echo du Nord , Pierre Mahaut meurt le 12 mai 1942 à l’âge de 53 ans. Il était le parolier de plusieurs chansons et l’auteur de revues jouées au théâtre Sébastopol. Simons illustra plusieurs de ses chroniques parues dans Le Grand Echo du Nord. Membre de la Société des auteurs-compositeurs, il était officier d’Académie, Croix de guerre 1914-18, médaille du Bien public.
Source(s) :Grand Echo, du 13 mai 1942, ADN, M149/142.
-
MAHIEU
Rédacteur judiciaire au Grand Echo en 1896. S ource: Le Grand Echo , 1 er janvier 1896.
-
MAHIEU Amand
Fils de Désiré Mahieu, boulanger à Béthune, et de Marie-Ange Dufossé, Amand Mahieu est journaliste au bureau de Lens du Grand Echo du Nord à partir de 1928. A la Libération, il passe au quotidien La Voix du Nord dont il est nommé chef de la rédaction lensoise. Secrétaire de l’Association des journalistes du Pas-de-Calais, il en est le président de 1947 à 1952. A la fin des années 40, il est également président de la section Nord-Pas-de-Calais du Syndicat national des journalistes. Il est l’auteur de deux ouvrages: Drôle de guerre. Récit vécu (1951) et, en collaboration avec Marius Levisse, Jean Manoir, militant historique du syndicalisme minier (1964).
Source(s) :Différents numéros du Grand Echo du Nord, blog de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais.
-
MAHU Louis
Autodidacte, ancien tisserand devenu facteur de pianos, Louis Mahu a adhéré au POF avant 1900. Il s’y révèle un ardent polémiste utilisant différents pseudonymes: Louis Hamas, Robert le Diable, Marra… Sa chronique patoisante eut un énorme succès.
-
MAILHARD DE LA COUTURE Gabriel
Né à Fontenay-le-Comte le 25 juin 1851 où son père Joseph Bernard Mailhard de La Couture était sous-préfet, Gabriel René Mailhard de La Couture est un ancien élève de l’école des Chartes, ce qui l’amena à visiter les principales bibliothèques d’Europe. En 1870, il s’engage dans les zouaves pontificaux du colonel de Charette pour défendre les derniers restes des états pontificaux contre l’armée italienne. En janvier 1871, il est volontaire pour combattre en France contre l’armée prussienne. Il est démobilisé le 15 août de la même année. Après avoir collaboré à plusieurs journaux catholiques, notamment à L’Emancipateur de Cambrai, il devient rédacteur en chef du journal La Vraie France en septembre 1889. Il est l’acteur du Ralliement, en 1892, du journal royaliste financé par Philibert Vrau à la République.«Royaliste par tradition et par conviction, mais en même temps profondément dévoué à l’Eglise, il répondit l’un des premiers aux désirs du pape en se plaçant sur le terrain constitutionnel», peut-on lire dans La Vraie France au lendemain de sa mort, survenue à l’âge de 43 ans, le 2 août 1895, après une maladie de quelques mois. Gabriel Mailhard de La Couture est l’auteur de plusieurs ouvrages littéraires ou historiques, il publia également dans plusieurs revues: Le Grand Almanach catholique, La Revue de Lille, etc.
Source(s) :La Vraie France, 3 août 1895 et 4 août 1895; René Choquet, La Vraie France. Journal royaliste, légitimiste et catholique lillois de la fin du, xie siècle, Lille, III, 1994, Bernard Ménager (dir.).
-
MALLET de CHAUNY Paul Ernest Joseph
Fils de Henri Mallet de Chauny et de Valentine de Lespinay de Pancy, Paul Mallet de Chauny est né à Cambrai le 24 septembre 1868. Il est propriétaire et rédacteur du Patriote du Cambrésis qui paraît du 23 janvier 1894 au 28 décembre 1913. La police qualifie cet hebdomadaire de «journal socialiste catholique». Lorsqu’il se marie le 22 septembre 1923 à Paris, Paul Mallet de Chauny est toujours journaliste.
Source(s) :AD Paris, 7 M 223; AD Nord, 1T 222.
-
MALOU Brigitte
Ancienne élève de l’école supérieure de journalisme de Lille (30e promotion, 1956), Brigitte Malou fut d’abord rédactrice à La Croix du Nord pour laquelle elle suivit notamment les affaires algériennes. Ses reportages lui valurent, en 1956, le prix de la plus jeune journaliste. Entrée à la rédaction lilloise de Nord-Matin en 1957, elle y couvrit pendant quelque vingt-deux ans tous les événements de la capitale des Flandres, puis elle passa à Nord-Eclair où elle termina sa carrière professionnelle. Brigitte Malou qui signait sous ce nom était l’épouse d’Henri Delecroix, reporter photographe à La Voix du Nord. Membre de l’association «Les Héritières de Séverine», elle était titulaire de la médaille du Travail. La médaille de l’Encouragement au dévouement, du Mérite philanthropique ainsi que la croix de chevalier dans l’ordre du Mérite étaient venues récompenser son implication dans les œuvres sociales, notamment le comité d’entraide du quartier Saint-Sauveur.
-
MANIEZ Eustache-Louis
Fils de Ignace Maniez, marchand, et de Victoire Bernardine Delattre, Eustache Louis Maniez est né à Merville le 19 octobre 1802. Licencié en droit en août 1826, il est reçu avocat quelques jours plus tard à Douai. Nommé juge auditeur au tribunal d’Hazebrouck en janvier 1827, il revient à Douai un mois plus tard. En avril 1829, il est nommé à Boulogne-sur-Mer., puis en décembre de la même année conseiller auditeur à la cour de Douai. C’est là qu’il crée le Recueil des arrêts de la Cour royale de Douai qu’il dirige jusqu’en 1842, date où il est nommé conseiller à la cour Bastia. En 1847, il quitte la Corse pour Poitiers. En août 1852, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Maniez est l’auteur de plusieurs ouvrages juridiques.
Source(s) :Archives nationales, LH/1778/17
-
MANSUY E.
Rédacteur en chef de L’Avenir d’Arras pendant un an, E. Mansuy devient rédacteur en chef gérant du quotidien arrageois L’Ordre le 1 er juin 1873. Les deux journaux fusionnent le 1 er septembre 1875.
Source(s) :L’Avenir d’Arras, et, L’Ordre.
-
MARC Alfred
Lors de la revente en 1871 de L’Indépendant du Pas-de-Calais par Charles Guermonprez, Alfred Marc devient rédacteur en chef du quotidien audomarois.
Source(s) :«L’Indépendant créé le 22 février 1849 a 125 ans», L’Indépendant du Pas-de-Calais, 23 février 1974.
-
MARC Léon
Né à Cambrai, le 18 mars 1829, Léon Marc est rédacteur au Libéral pendant quinze ans. Il quitte sa ville natale pour Paris où il est employé dans une mairie d’arrondissement. C’est probablement à cette époque qu’il rencontre Mallarmé. Il revient à Cambrai où il est rédacteur au journal L’Indépendant au moins jusqu’en 1903 .
Source(s) :AD Nord, 1T 222.
-
MARIETTE Auguste François
Auguste Mariette est plus connu comme égyptologue que comme journaliste. Le jeune Boulonnais collabora pourtant quelques années à plusieurs titres édités dans sa ville natale et fut même rédacteur en chef de l’un d’eux. Né le 11 février 1821, il effectue ses études au collège de Boulogne. Il obtient son baccalauréat en 1841 et devient maître d’études, puis maître de français. Parallèlement, ses premières chroniques paraissent dans La Boulonnaise. A partir de 1842, il publie dans L’Annotateur . Selon Ernest Deseille, le 27 juillet 1843, il succède à Gérard comme rédacteur en chef de L’Annotateur dont il annonce son retrait le 10 octobre 1844. Remplacé par Bernard, il reprend la rédaction le 12 décembre. Il quitte définitivement le journal le 27 août 1845. S’ouvre alors pour lui une carrière qui fera sa notoriété quelques années plus tard. C’est cependant dans sa ville natale, après avoir découvert la momie du musée de Boulogne, que naquit sa vocation pour l’égyptologie.
Source(s) :Ernest Deseille, Histoire du journalisme en Boulonnais, Mémoires de la Société académique de l’arrondissement de Boulogne, 1868, p. 165-405.
-
MARISSAL Michel
Entré à La Voix du Nord le 1 er août 1945, Michel Marissal fut rédacteur au service des sports dont il devint le sous-chef. Il prend sa retraite en 1977 et meurt en 1994
-
MARMET Francis
Typographe, imprimeur, puis reporter, Francis Marmet devient rédacteur au Petit Béthunois et au Journal de Saint-Pol . Il est ensuite directeur de plusieurs publications. En 1905, il acquiert La Revue artésienne et L’Echo de La Bassée . Il est également imprimeur gérant du journal socialiste Le Citoyen. En 1909, il laisse La Revue artésienne à Jules Logier.
Source(s) :La Revue artésienne, AD du Pas-de-Calais.
-
MARON Albert
Albert Maron est rédacteur en chef du journal La Vraie France du 12 septembre 1882 à septembre 1889.
Source(s) :René Choquet, Ibidem.
-
MARTIN Arthur
Né à Bar-sur-Aube le 16 juin 1855, Arthur Elysée Martin est le fils d’Antoine Martin, bourrelier, et d’Anne Léonie Prêt. Rédacteur au quotidien lillois La Vraie France pendant neuf ans, il entre en 1889 au quotidien royaliste Le Pas-de-Calais comme rédacteur en chef . Après le rachat, le 20 février 1890, du Courrier du Pas-de-Calais par la Société du Pas-de-Calais, dirigée par Paul-Marie Laroche, il en devient rédacteur en chef. Royaliste, ardent défenseur de l’Eglise, Arthur Martin meurt à sa table de travail le 15 janvier 1907 à l’âge de 51 ans.
Source(s) :AD Aube, 4, E 03324; AD Nord, 3, E 041/538; Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er et 2 janvier 1928.
-
MARTIN Jacques
Entré à La Voix du Nord le 1 er mai 1965, Jacques Martin fut journaliste à la rédaction de Villeneuve d’Ascq. Il meurt à l’âge de 54 ans le 28 décembre 1994.
-
MARTIN-MAMY Eugène
Né à Nice en 1881 de Louis Marius Martin et de Joséphine Noëlia Musy, Eugène Martin, dit Martin-Mamy, commença sa carrière de journaliste à L’Aurore de Georges Clemenceau. En 1910, il arrive à Beauvais où il est rédacteur en chef de La République de l’Oise qu’il quitte en 1913 pour prendre la succession de Georges Robert à la tête de la rédaction du quotidien lillois de sensibilité radicale, Le Progrès du Nord. A la veille de la guerre, Martin-Mamy est également un écrivain reconnu. Après notamment Païens d’aujourd’hui paru en 1908, Le Pessimisme d’Anatole France en 1911, son dernier ouvrage Les Nouveaux Païens vient d’être primé par la critique littéraire. Resté à Lille lors de la prise de la ville en octobre 1914, il fait partie des otages désignés par les Allemands. De ses années d’occupation, il tire un ouvrage Quatre ans avec les barbares paru en 1919. Il reprend sa place au Progrès du Nord dont il devient directeur-administrateur. Il se fait notamment un ardent défenseur des intérêts de sa région d’adoption particulièrement sinistrée. Il est fondateur et membre de plusieurs associations: secrétaire de l’Amicale des otages lillois, de l’Association des sinistrés du Nord, président de la Caisse familiale interprofessionnelle, secrétaire général de l’Union régionaliste du Nord-Pas-de-Calais,… Tenté par la politique, il se présente en vain à plusieurs reprises aux élections cantonales sous l’étiquette de l’Union républicaine. En novembre 1920, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. En désaccord avec le conseil d’administration présidé par Louis Loucheur, il quitte, en novembre 1921, un Progrès du Nord en situation délicate. Quelques mois plus tard, il fonde avec Crouan et Roques une imprimerie située rue de Paris à Lille. Lors de la création de la nouvelle société du Télégramme du Nord présidée par Eugène Mathon, il prend la direction de ce quotidien qui était à l’origine une édition du Télégramme du Pas-de-Calais et de la Somme édité à Boulogne-sur-Mer. Ce journal se distingue notamment par son anticommunisme, ce qui attire l’attention du parfumeur François Coty qui, lors de la création de L’Ami du Peuple du soir en novembre 1928, fait appel à Martin-Mamy pour le diriger. Après quelques années à la direction de ce journal, il occupe les mêmes fonctions à L’Echo de Paris jusqu’à sa disparition en 1939. Après la Libération, Martin-Mamy revient à Lille pour s’occuper de son imprimerie. Il meurt à Paris en novembre 1949.
Source(s) :Différents numéros du Grand Echo du Nord, notamment celui du 2 novembre 1920; de, La Croix du Nord, en particulier celui du 25 septembre 1949.
-
MASQUELIER Henri
Né à Hem dans une famille de cultivateur, Henri Masquelier fait ses études secondaires au collège épiscopal de Tournai. En 1874, il entre au grand séminaire de Douai. Ordonné prêtre le 2 avril 1881, il est successivement vicaire à Armentières, Lille, Roubaix. Vicaire à la paroisse Saint-Jacques de Douai, il s’initie au journalisme en participant au supplément douaisien de La Croix. Le 11 novembre 1889, il fonde à Lille La Croix du Nord dont il veut faire un véritable journal populaire face notamment à La Vraie France . Appelé un temps à diriger La Croix de Paris , il revient vite à Lille où quotidiennement, dans son journal, il signe des articles sous son nom ou les pseudonymes de Cyr ou de Dem. Il dirige ce quotidien pendant plus de quarante-cinq ans. Parallèlement, Henri Masquelier est chanoine honoraire de la cathédrale de Cambrai en 1903, prélat de Sa Sainteté en 1922, supérieur de la maison de retraite de Mouvaux en 1924
Source(s) :Articles de, La Croix du Nord, à partir du 11 janvier 1936.
-
MASSINON Lucien
Entré au service des sports de La Voix du Nord le 27 juin 1946 , Lucien Massinon passe ensuite aux Informations générales dont il devient le chef de service jusqu’à sa retraite.
-
MASURE Gustave
Fils d’un directeur de banque, devenu négociant en toile après avoir été ruiné, Gustave Masure doit renoncer, pour des raisons de santé, à l’école des Arts et Métiers où il venait d’être reçu. Lors de sa convalescence qui dure plusieurs mois, il répond à une petite annonce et se retrouve rédacteur au très gouvernemental Mémorial de Lille qu’il quitte en 1860 pour L’Echo du Nord. Pendant cinq ans, Masure y exerce les fonctions de rédacteur politique et entame une mue politique.
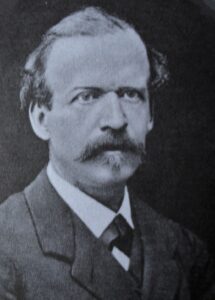 Selon la police, il s’y « dépouille de son enveloppe gouvernementale » et se montre « un adepte de la démocratie la plus avancée ». Il fait, selon la même source, du vieil Echo pourtant bien assagi « l’organe violent des idées démagogiques de toutes les mauvaises passions ». Sa rencontre avec le journaliste Géry Legrand, fils de l’ancien député au Corps législatif, rentré à Lille en 1859, est-elle la cause de son évolution ? Masure collabore en effet à La Revue du mois, lancée en 1861 par le futur maire républicain de Lille. En tout cas, le pouvoir incite Alexandre Leleux à se défaire de son rédacteur qui, en mai 1865, est élu conseiller municipal démocrate. Surveillé, Masure se fait plus prudent. En juillet 1866, il lance un hebdomadaire imprimé à Bruxelles Le Progrès du Nord. « Il serait bien difficile de trouver un caractère de sympathie pour le gouvernement » note la police impériale à propos de ce périodique. Toutefois elle reconnaît que « soit par crainte de ne pouvoir pénétrer en France, soit pour tout autre motif […] Le Progrès est assez sagement rédigé. » En 1867, les données changent, Napoléon III se déclare favorable à une réforme de la législation sur la presse. Au prix d’une lettre dynastique, Masure entend profiter de l’occasion pour transformer son hebdomadaire en quotidien politique. L’autorisation lui est accordée et le 3 mars 1867, Le Progrès affirme ainsi qu’il entend être « attentif aux mouvements qui transforment peu à peu les bases de la société ». Comprenne qui voudra ! Le divorce avec le pouvoir est vite consommé. En janvier 1868, lors d’une élection partielle au Corps législatif à Lille, le journal soutient Géry Legrand contre le candidat officiel qui l’emporte aisément. En novembre 1868, il relaie la souscription lancée dans Le Réveil de Paris par Charles Delescluze. L’ancien rédacteur en chef de L’Impartial de Valenciennes entend faire ériger un monument à la mémoire du député Baudin, tué le 2 décembre 1851. Cette provocation entraîne la saisie du journal et la poursuite en justice de Masure. Celui-ci est alors défendu par un jeune avocat, Léon Gambetta, qui, conseil de Delescluze, vient de dresser un véritable réquisitoire contre le Second Empire. Masure qui a déjà connu la prison en avril 1868 pour avoir « appelé les militaires à la désobéissance », la retrouve plusieurs fois. Ce qui ne l’empêche pas, en janvier 1870, de lancer une nouvelle souscription en faveur, cette fois, d’un monument à la mémoire du journaliste Victor Noir, tué par un cousin de l’Empereur, Pierre Bonaparte. Décrit comme un polémiste au style net, froid, acéré, il ne sourit, selon Le Diable rose , qu’une seule fois dans sa vie : « Ce fut quand il entendit, au 4 septembre 1870, sortir d’une poitrine humaine un cri : Vive la République ! » Masure retrouve alors Gambetta, devenu ministre de l’Intérieur du gouvernement de Défense nationale, qu’il accompagne en octobre 1870 à Tours et à Bordeaux. De retour à Lille, il reprend le combat à la tête d’un journal qui n’est toujours pas épargné par le Pouvoir et notamment en 1877 pour avoir reproduit le mot de Gambetta à l’adresse de Mac Mahon le 15 août à Lille lors de la campagne électorale : « Quand la France aura fait attendre sa voix souveraine, croyez-le bien, Messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre… » Masure est alors député de Lille. Elu en mars 1876, il est réélu en octobre 1877 où les républicains obtiennent la majorité à la Chambre, puis en septembre 1881. Il meurt en octobre 1886 après avoir refusé de mener une dernière bataille électorale. Ses obsèques, le 19, sont suivies par quelque 3 000 personnes. Anticlérical, Masure est pourtant accompagné par un prêtre.Source(s) :
Selon la police, il s’y « dépouille de son enveloppe gouvernementale » et se montre « un adepte de la démocratie la plus avancée ». Il fait, selon la même source, du vieil Echo pourtant bien assagi « l’organe violent des idées démagogiques de toutes les mauvaises passions ». Sa rencontre avec le journaliste Géry Legrand, fils de l’ancien député au Corps législatif, rentré à Lille en 1859, est-elle la cause de son évolution ? Masure collabore en effet à La Revue du mois, lancée en 1861 par le futur maire républicain de Lille. En tout cas, le pouvoir incite Alexandre Leleux à se défaire de son rédacteur qui, en mai 1865, est élu conseiller municipal démocrate. Surveillé, Masure se fait plus prudent. En juillet 1866, il lance un hebdomadaire imprimé à Bruxelles Le Progrès du Nord. « Il serait bien difficile de trouver un caractère de sympathie pour le gouvernement » note la police impériale à propos de ce périodique. Toutefois elle reconnaît que « soit par crainte de ne pouvoir pénétrer en France, soit pour tout autre motif […] Le Progrès est assez sagement rédigé. » En 1867, les données changent, Napoléon III se déclare favorable à une réforme de la législation sur la presse. Au prix d’une lettre dynastique, Masure entend profiter de l’occasion pour transformer son hebdomadaire en quotidien politique. L’autorisation lui est accordée et le 3 mars 1867, Le Progrès affirme ainsi qu’il entend être « attentif aux mouvements qui transforment peu à peu les bases de la société ». Comprenne qui voudra ! Le divorce avec le pouvoir est vite consommé. En janvier 1868, lors d’une élection partielle au Corps législatif à Lille, le journal soutient Géry Legrand contre le candidat officiel qui l’emporte aisément. En novembre 1868, il relaie la souscription lancée dans Le Réveil de Paris par Charles Delescluze. L’ancien rédacteur en chef de L’Impartial de Valenciennes entend faire ériger un monument à la mémoire du député Baudin, tué le 2 décembre 1851. Cette provocation entraîne la saisie du journal et la poursuite en justice de Masure. Celui-ci est alors défendu par un jeune avocat, Léon Gambetta, qui, conseil de Delescluze, vient de dresser un véritable réquisitoire contre le Second Empire. Masure qui a déjà connu la prison en avril 1868 pour avoir « appelé les militaires à la désobéissance », la retrouve plusieurs fois. Ce qui ne l’empêche pas, en janvier 1870, de lancer une nouvelle souscription en faveur, cette fois, d’un monument à la mémoire du journaliste Victor Noir, tué par un cousin de l’Empereur, Pierre Bonaparte. Décrit comme un polémiste au style net, froid, acéré, il ne sourit, selon Le Diable rose , qu’une seule fois dans sa vie : « Ce fut quand il entendit, au 4 septembre 1870, sortir d’une poitrine humaine un cri : Vive la République ! » Masure retrouve alors Gambetta, devenu ministre de l’Intérieur du gouvernement de Défense nationale, qu’il accompagne en octobre 1870 à Tours et à Bordeaux. De retour à Lille, il reprend le combat à la tête d’un journal qui n’est toujours pas épargné par le Pouvoir et notamment en 1877 pour avoir reproduit le mot de Gambetta à l’adresse de Mac Mahon le 15 août à Lille lors de la campagne électorale : « Quand la France aura fait attendre sa voix souveraine, croyez-le bien, Messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre… » Masure est alors député de Lille. Elu en mars 1876, il est réélu en octobre 1877 où les républicains obtiennent la majorité à la Chambre, puis en septembre 1881. Il meurt en octobre 1886 après avoir refusé de mener une dernière bataille électorale. Ses obsèques, le 19, sont suivies par quelque 3 000 personnes. Anticlérical, Masure est pourtant accompagné par un prêtre.Source(s) :AD Nord; Jean-Paul Visse, La Presse du Nord-Pas-de-Calais au temps de L’Echo du Nord (1819-1944), Presses universitaires du Septentrion, 2003.
-
MATHIEU Emile
Fils d’un instituteur, Apollon Joseph Mathieu, Jean Emile Victor Mathieu fut journaliste à la rédaction de La Croix du Nord pendant près de vingt-cinq ans. Spécialiste des questions sociales et économiques, il signa de nombreux reportages et analyses sous les initiales de J. S. Né à Eclaibes dans l’Avesnois , il avait débuté au Libéral d’Avesnes où il avait été repéré par le directeur de La Croix du Nord. En janvier 1933, Emile Mathieu, père de neuf enfants, eut la douleur de perdre sa femme et deux de ses filles, victimes d’une émanation d’oxyde de carbone. A la suite de cet accident dramatique, sa santé s’était progressivement dégradée. Il meurt le 8 juillet 1934 à l’âge de 50 ans. Participant actif aux Semaines sociales, son engagement en faveur de L’Eglise lui avait valu la Croix de Saint-Grégoire-le-Grand. Sources : AD Nord, 1 Mi EC 187 R 001; La Croix du Nord , 10 juillet 1934.
-
MATHON Jean
En juin 1833, Mathon obtient des brevets de libraire d’une part, d’imprimeur d’autre part, à la résidence de Tourcoing. Il y ajoute, en avril 1837, un brevet d’imprimeur lithographe. En 1840, il obtient l’autorisation de publier un hebdomadaire, et dépose à titre de cautionnement, la somme de 7 500F. Le nouveau périodique prend le titre de L’Indicateur de Tourcoing. Feuille d’annonces commerciales et industrielles . Mathon s’attache alors l’aide d’un jeune homme, Jules Laurent, qui avait déjà publié quelques articles dans La Boussole à Lille. Jules Laurent deviendra par la suite conseiller général, puis député à l’Assemblée nationale. Le 4 janvier 1846, L’Indicateur de Tourcoing entre dans sa septième année. Il annonce à cette occasion qu’ayant autant d’abonnés à Tourcoing qu’à Roubaix, il portera désormais le titre d ’Indicateur de Tourcoing et Roubaix . L’hebdomadaire, tout en reflétant les idées de son créateur reste généralement en dehors de la mêlée politique. En septembre 1875, L’Indicateur devient bihebdomadaire. Il cesse sa publication en 1913. Mathon participe par ailleurs , en 1843, à l’aventure collective du Chemin de fer français. En 1850 L’Indicateur tirerait à 300 exemplaires. En 1874, Le Figaro publie un supplément sur la presse de province. L’Indicateur de Tourcoing et Roubaix se voit qualifié de légitimiste , et gratifié d’un tirage de 800 exemplaires, cent de moins que son rival Le Journal de Roubaix . Mathon est un homme d’ordre avant tout, légitimiste en politique, mais bonapartiste sous l’Empire, fervent défenseur de la foi catholique toujours. Il est même prêt à excuser la censure. En 1848, Mathon entre en guerre contre les idées socialistes. À partir de 1852, l’ordre étant rétabli, L’Indicateur rentre dans le rang. Il avait pourtant réussi à déclencher une manifestation d’hostilité des républicains, qui le brûlèrent en effigie devant sa maison. Son journal exècre la Commune, il n’a pas un mot pour les morts de Fourmies, et qualifie ses confrères républicains d’ organes de la démagogie inférieure . Jean Mathon fut administrateur de la Caisse d’épargne de Tourcoing jusqu’à sa mort, caisse, dont il avait obtenu la création à la suite d’une campagne menée par son journal en 1843. Il était également membre de la fabrique de Saint-Christophe. Enrichi par son journal, il légua à ladite fabrique 5 000 F – auxquels sa femme, décédée peu après lui, ajouta 2 000 F. Philantrophe, il légua également 40 000 F au Bureau de bienfaisance, et autant aux hospices de Tourcoing. Jean Mathon avait reçu du pape la croix de l’ordre du Saint-Sépulcre. La Ville de Tourcoing a donné son nom à une rue.
Source(s) :Jacques Ameye, «Le legs Mathon», Pages du Broutteux, n° 252; Nord-Éclair, 13 décembre 1984; «Tourcoing», Journal de Roubaix, 1er août 1884; Bernard, Grelle, Catalogue commenté de la presse roubaisienne 1829-1914, Roubaix, Lire à Roubaix, [2004]. 221 p., Les Cahiers de Roubaix, 10.
-
MATTE Julien
 Fils d’instituteurs né le 17 juin 1882 dans la Somme, il commence sa carrière au Journal de Rouen et le quitte en 1906 pour entrer à L’Echo du Nord où il fut secrétaire de rédaction puis secrétaire général. Il démissionne en 1919 pour monter une imprimerie et fonder la Terre du Nord qui donna vie à La Renaissance agricole , hebdomadaire de la vie aux champs dans le Nord, l’Ouest et le Nord-Est puis organe de la Société des Agriculteurs du Nord. Il édite aussi un journal humoristique, Le Petit Quinquin . Il consacre sa vie au journalisme agricole et anime un grand nombre de sociétés agricoles. Il fut secrétaire général des Agriculteurs du Nord, mit ses talents de journaliste au service d’associations spécialisées: celle des Planteurs de pommes de terre et celle des Planteurs de chicorée qui éditaient toutes deux un bulletin. Il appartint au bureau de la Basse-Cour familiale et de la Société d’horticulture du Nord de la France, fut membre de la Société de botanique et de l’Association des membres du mérite agricole. Rédacteur fondateur de Nord agricole en 1944 jusqu’à sa mort en 1949, il était aussi président de la presse périodique, secrétaire général de l’Association des journalistes du Nord. Cet habitant de Lambersart, pratiquant l’anglais et l’allemand, possédait un talent de conteur et aimait beaucoup converser. Les services qu’il rendit à l’agriculture lui valurent la Légion d’honneur et le grade d’officier du Mérite agricole. Source principale: Notice nécrologique dans Le Nord agricole , octobre 1949.
Fils d’instituteurs né le 17 juin 1882 dans la Somme, il commence sa carrière au Journal de Rouen et le quitte en 1906 pour entrer à L’Echo du Nord où il fut secrétaire de rédaction puis secrétaire général. Il démissionne en 1919 pour monter une imprimerie et fonder la Terre du Nord qui donna vie à La Renaissance agricole , hebdomadaire de la vie aux champs dans le Nord, l’Ouest et le Nord-Est puis organe de la Société des Agriculteurs du Nord. Il édite aussi un journal humoristique, Le Petit Quinquin . Il consacre sa vie au journalisme agricole et anime un grand nombre de sociétés agricoles. Il fut secrétaire général des Agriculteurs du Nord, mit ses talents de journaliste au service d’associations spécialisées: celle des Planteurs de pommes de terre et celle des Planteurs de chicorée qui éditaient toutes deux un bulletin. Il appartint au bureau de la Basse-Cour familiale et de la Société d’horticulture du Nord de la France, fut membre de la Société de botanique et de l’Association des membres du mérite agricole. Rédacteur fondateur de Nord agricole en 1944 jusqu’à sa mort en 1949, il était aussi président de la presse périodique, secrétaire général de l’Association des journalistes du Nord. Cet habitant de Lambersart, pratiquant l’anglais et l’allemand, possédait un talent de conteur et aimait beaucoup converser. Les services qu’il rendit à l’agriculture lui valurent la Légion d’honneur et le grade d’officier du Mérite agricole. Source principale: Notice nécrologique dans Le Nord agricole , octobre 1949. -
MATTHIEU Pierre-Joseph
Rédacteur à L’Echo du Nord, Pierre Joseph Matthieu fonde en 1840 une gazette intitulé Le Moulin-à-vent. Peu de temps après, il cède son journal à Dayez père et quitte Lille pour entrer comme chimiste dans un établissement industriel parisien.
Source(s) :BM de Lille, fonds Humbert, boîte 18, dossier 3.
-
MAURER J
Rédacteur en chef du quotidien La République libérale à Arras en 1894, Maurer donna sa démission, le 26 mars 1895, à la suite d’un article du rédacteur en chef de L’Avenir Vaillant rappelant qu’il avait été condamné en 1877 à un mois de prison pour un délit de droit commun – un vol de deux bijoux à sa maîtresse. Avant d’être journaliste, Maurer avait été en 1888 et 1889 au service du baron de Mackau, député rallié au général Boulanger en octobre 1888.
Source(s) :La République libérale, 22 et 24-25 mars 1895.
-
MAUROY Roger
Entré à La Voix du Nord le 1 er juillet 1963, Roger Mauroy travaille au bureau de Villeneuve d’Ascq. Parallèlement, Il a été trésorier du CIPJ.
-
MELIN Pierre
Né en Seine-et-Oise, Pierre Melin est d’abord commis de recettes à l’octroi de Paris. En 1892, il s’installe à Valenciennes où il est fabricant d’instruments de musique. Membre du Parti ouvrier français, il fonde en 1897 Le Franc Parleur , premier journal socialiste de Valenciennes, qui ne paraît qu’un an. Candidat socialiste malheureux aux élections municipales en 1899, législatives en 1902 et cantonales en 1904, il participe au journal L’Emancipation socialiste dont il devient rédacteur en 1905. Un an plus tard, il est élu au second tour député socialiste de la 1 re circonscription de Valenciennes. En 1910, il est battu au second tour, mais est réélu en 1914. Pendant la guerre, il reste à Valenciennes jusqu’en janvier 1915. A l’approche de la victoire, il veut regagner sa ville avec son ami, le député Henri Durre. Il est blessé par des mitrailleurs allemands à la Croix d’Anzin tandis que Durre est tué. Lors des élections législatives de 1919, Pierre Melin est battu, il se retire de la vie politique et meurt à Paris en 1929 à l’âge de 66 ans.
Source(s) :Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940; divers numéros du Grand Echo du Nord, en particulier celui du 25 novembre 1929.
-
MELLON-PRADOUX
Originaire de Tulle, Mellon-Pradoux a été journaliste à L’Impartial de Paris où il a côtoyé Dupin, Petit de la Lozère, Teste. A la disparition de ce journal, en 1837, il est nommé rédacteur en chef du Courrier du Pas-de-Calais . Il quitte le périodique arrageois le 3 août 1838 pour Le Loiret.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er et 2 janvier 1928.
-
MENART Charles
En 1895, Charles Ménart demeure 118, rue Lacroix à Tournai. C’est le correspondant pour la Belgique du Journal de Roubaix . «Il ne se mêle pas de politique en France» remarque la police.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/25.
-
MENEY Adolphe
Fils de François André Meney, employé d’hôtel, et d’Honorine Amélie Houteer, Alphonse Jules Auguste Meney entame des études de droit après l’obtention de son baccalauréat ès-lettres. Il devient ensuite répétiteur au collège de Boulogne. En septembre 1894, il est condamné à 15 jours de prison et 25 F d’amende pour la publication « d’un article pornographique sur Jeanne d’Arc ». Il entre au Progrès du Nord comme rédacteur-reporter où il y signe ses articles sous le pseudonyme de Raymond Dargis. Bien qu’on lui reconnaisse « beaucoup d’aptitudes pour le journalisme », il ne semble guère donner satisfaction dans le quotidien nordiste où il ne serait « ni exact, ni zélé ». Adolphe Meney quitte Lille et s’installe à Calais où il devient rédacteur au Petit-Calaisien . Le 27 août 1900, il se marie avec Berthe Alice Cazelle, confectionneuse. Il meurt à Paris le 28 décembre 1949.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 160/27; 3 E 193A/187; AD Nord, 1T 222/19.
-
MESSELIN André
Dès les premiers numéros de La Vie sportive du Nord et du Pas-de-Calais , André Messelin apparaît parmi les collaborateurs de l’hebdomadaire illustré lancé par André Fage et Emile Lante en novembre 1912. En janvier 1920, il est appelé par les nouveaux propriétaires du périodique comme secrétaire de rédaction. L’aventure ne dure que quelques semaines et le 27 avril 1920 La Vie sportive du Nord et du Pas-de-Calais suspend sa parution. En 1921, Messelin rentre comme rédacteur sportif au Grand Echo du Nord dont il devient par la suite chef des services sportifs. En 1927, il participe, comme rédacteur en chef, à la brève aventure de La Vie sportive du Nord lancée par Pierre Pouillard, gendre du propriétaire du Petit Béthunois . Il est également correspondant du quotidien sportif L’Auto. En 1940, après l’occupation allemande, il participe au journal à cinq titres qui paraît jusqu’en juillet 1940 En 1946, lorsque les journaux sportifs sont à nouveau autorisés à paraître, André Messelin fait partie de l’équipe de l’hebdomadaire Nord-Sports , lancé par la Société populaire et démocratique de presse, et qui, en changeant de jour de parution, devient le 25 juillet 1949, Nord-Matin Sports . Toujours président de l’Association des journalistes sportifs du Nord, il est en 1951 secrétaire général du Comité pour l’érection du monument à Henri Jooris, ancien président du LOSC. Il meurt à Lille le 17 octobre 1954.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 512 R 064, 3 E 16235, 1 R 3158, différents numéros du Grand Echo du Nord, de, La Vie sportive du Nord, et de, La Croix du Nord.
-
MESSIAEN Alfred
La fiche de police d’Alfred Messian, journaliste au Journal de Roubaix, établie en 1895, ne porte pas de signalement. «D’origine belge, il est censé ne pas écrire [alors qu’il signe des articles en 1883], néanmoins on dit que, assez souvent, des articles non signés sont inspirés par lui.» Il habite Roubaix depuis longtemps. Marié, deux enfants, il a une conduite et une moralité irréprochables. Dans le numéro du 22 novembre 1908 du quotidien roubaisien, il est qualifié du titre de «secrétaire général de la rédaction du journal» , fonction qu’il occupe encore en janvier 1928.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/25; Grand Hebdomadaire illustré, 15 janvier 1928, p. 42
-
MEURANT Hoche
Fils d’Aristide Meurant, vendeur de journaux, militant socialiste et ami de Lebas, Hoche Meurant fut élevé dans une famille profondément républicaine (ses frères se nommaient Marceau, Kléber, Philogone, etc.), anticléricale et antisocialiste. Ouvrier peigneur très jeune, il se forgea une solide culture d’autodidacte, et fréquenta les milieux anarchistes. Il exerça divers métiers (maçon, photographe…) avant d’être appelé au service militaire. Comme il refusait les exercices quotidiens, un conseil de guerre le condamna à trois ans de prison, et on l’envoya au pénitencier de Daya-Bossuet en Algérie. Là, se révoltant contre les mauvais traitements et les humiliations, il s’en prit à un surveillant; un nouveau conseil de guerre, devant lequel il affirma son antimilitarisme, le condamna à mort. Après plus de trois mois d’attente, sa peine fut commuée en dix ans de travaux forcés, et il fut renvoyé à Dayat-Bossuet. En 1903, il s’évada, mais fut repris. Il fut enfin gracié en 1910 grâce au Dr Dupré, et enfin réformé. De retour à Roubaix, il reprit ses activités anarchistes. Meurant assista à tous les congrès anarchistes nationaux et régionaux, ainsi qu’à plusieurs congrès internationaux. Après la Première Guerre, il est mineur et secrétaire de la section CGT de Libercourt. Admirateur de la Révolution russe, il passe à la CGTU, mais est exclu par la majorité communiste. Il adhère alors à la CGT-SR (socialiste révolutionnaire) et collabore au journal du syndicat, Le Combat syndicaliste, de 1925 à 1929. Mais c’est avant tout un anarchiste, un des principaux militant de la région. En 1926, il s’installe à Croix, exerce la profession d’artisan bonnetier et de vendeur ambulant. Ses convictions antimilitaristes lui valent des ennuis avec la justice, car il aide déserteurs et objecteurs de conscience à passer en Belgique. Il soutient activement les républicains espagnols, faisant passer des armes destinées à l’Espagne de Belgique en France, quêtant pour la CNT, hébergeant de nombreux militants espagnols. Résistant pendant l’Occupation, il fournit du matériel d’imprimerie et servit de boîte aux lettres. Après la guerre, Meurant relança les groupes anarchistes dans la région. Hostile aux assurances sociales, qu’il considérait comme une escroquerie, il mourut dans la misère. Sa compagne, dans le même cas, dut travailler sur son métier jusqu’à 73 ans! Meurant a collaboré à nombre de journaux anarchistes, régionaux ou nationaux. Outre Le Combat syndicaliste , déjà mentionné, Hoche Meurant a été l’un des «rédacteurs en chef» du Combat, responsable de la rédaction du mensuel Le Combat , organe de la Fédération anarchiste du Nord (Lille-Wasquehal, 13 numéros de mai 1923 à avril 1924), administrateur de Germinal pour l’édition du Nord-Pas-de-Calais à partir du 25 septembre 1925(ce journal, avait paru à Amiens de 1904 à 1913. Réapparu le 29 août 1919, il s’étendit ensuite à l’Oise, au Nord et au Pas-de-Calais. Germinal tirait, en 1925 à 3 500 exemplaires pour la Somme, 5 000 pour l’Oise et 1 000 pour le Nord et Pas-de-Calais. Il disparut après juillet 1933, mais eut une brève résurrection en 1938). Meurant collabora à plusieurs reprises, entre 1923 et 1939, au Libertaire . E n 1933, il administra le Flambeau , mensuel, paru de juin 1927 au 5 juin 1934 (quatre-vingts numéros). Ce journal eut un prolongement dans Terre libre (Aulnay-Nîmes, 1934-1936) dont Meurant fut responsable en 1934 pour l’édition Nord-Nord-Est. Il collabora aussi à La Revue anarchiste (Paris, 1929-1936) à l’ Almanach de la Paix pour 1934 édité par La Clameur , journal de l’Union des intellectuels pacifistes, à L’Espagne nouvelle (Nîmes, 1937-1939), à L’Eveil social (Aulnay-sous-Bois, 1 er janvier 1932 à mai 1934), à La Revue internationale anarchiste (Paris), à Simplement: vagabondage social et littéraire (Ivry), à l’organe régional de la Fédération anarchiste Monde nouveau (Marseille, février à octobre 1946), et à Ce Qu’il Faut Dire (Paris 1944-1948). Il est également l’auteur d’un fascicule, Bas les armes! (Imprimerie Germinal, 16 p., s.d.)
Source(s) :Dictionnaire des militants anarchistes, http://www.militants-anarchistes.info/spip.php?article3876; Maitron, Jean, Pennetier, Claude dir, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article107829.
-
MICHEL Guy
Guy Michel, après avoir été reporter photographe à La Croix du Nord, rejoignit Nord Éclair lorsque le quotidien catholique disparut en 1966. Il y travailla jusqu’à sa retraite au début de l’année 1990. Depuis il participait bénévolement au journal de la paroisse de Mons-en-Bar œ ul.
-
MILLER Jack
Jack Miller est secrétaire de rédaction au Libre Artois.
Source(s) :Libre Artois, 10 novembre 1946
-
MILLET Yves
Originaire des Ardennes, après des études au lycée Henri IV à Paris, puis en Sorbonne où il obtient une licence de lettres et de philosophie, puis un diplôme supérieur de géographie, Yves Millet est nommé professeur d’Histoire au collège d’Avesnes-sur-Helpe où il reste une dizaine d’années. Fait prisonnier pendant la Seconde Guerre, il s’oriente vers le journaliste à son retour en France. Toujours à Avesnes, il est embauché à L’Observateur , puis passe à la rédaction locale de Nord Matin. Le 1 er juillet 1949, il entre à La Voix du Nord où il est affecté à la rédaction de Dunkerque, puis au secrétariat de rédaction au siège, à Lille, avant d’être nommé chef du service des Archives. Parallèlement, il assure, pendant une vingtaine d’années, la critique des disques. Fils d’un instituteur et d’une institutrice, Yves Millet est un militant de l’école publique. Délégué départemental de l’Education nationale dès 1951, il devient secrétaire de la fédération du Nord, puis membre du comité national. Régionaliste, Yves Millet est élu vice-président de la fédération des provinces françaises. Homme de culture, il est membre de plusieurs cercles littéraires et est notamment l’auteur d’un ouvrage sur la révolution de 1848 dans l’Avesnois qui lui vaudra la médaille d’or de l’Académie d’Arras. En outre, Yves Millet fut secrétaire général de la section Nord-Pas-de-Calais du SNJ de 1956 à 1968. Il siège au Comité national, puis au bureau national du syndicat de 1963 à 1965. Ses nombreuses activités lui ont valu plusieurs distinctions. Il est notamment titulaire de la croix du Combattant, chevalier du Mérite agricole, chevalier des Arts et Lettres, commandeur des Palmes académiques. En retraite en 1976, il n’en continue pas moins d’être un défenseur de l’école publique jusqu’à sa mort en 1990.
Source(s) :La Voix du Nord, 13 mars 1976, 12 mars 1989; Le Journaliste, n° 215, 3e trimestre 1990, p. 15.
-
MINET Gaston
Mort à l’âge de 52 ans, Gaston Minet fut journaliste au Grand Echo du Nord pendant vingt-cinq ans. Né à Boulogne-sur-Mer, il se «spécialisa dans l’étude et la critique maritime» selon l’expression employée dans l’article nécrologique que lui consacra son journal au lendemain de sa mort. Il appartenait à de nombreuses œuvres ou associations philanthropiques. Son engagement avait été salué par la remise de plusieurs décorationsdont les Palmes académiques et le Mérite maritime. Il était notamment président de la Fédération des pêcheurs à ligne du Pas-de-Calais, membre des associations «France-Portugal» et «France-Portugal».
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 15 septembre 1936.
-
MINEUR Jean
La figure de Jean Mineur est indissociablement liée à l’image d’un galibot lançant son pic au centre d’une cible et à un numéro de téléphone: «Jean Mineur Publicité, Balzac 00 01». Pourtant avant de conquérir Paris en 1936 et de devenir l’un des publicitaires les plus connus, Jean Mineur fut journaliste. Elève de l’institut Notre-Dame à Valenciennes jusqu’à l’âge de 14 ans, Jean Mineur fut d’abord conducteur de camion, puis aide-comptable. En 1920, il entre au quotidien lillois Le Progrès du Nord . Parallèlement il travaille pour Le Guetteur de Valenciennes et est également correspondant pour Le Petit Parisien . Il fait la connaissance du peintre sur toile Vermeulen. Dès 1924, il propose aux commerçants du Valenciennois des publicités sur les toiles de cinéma. En 1927, il crée à Valenciennes l’Agence générale de publicité Jean Mineur. La grande aventure commence en 1938 lorsque, installé à Paris depuis deux ans, il ouvre des bureaux sur les Champs-Elysées dont le numéro de téléphone est «Balzac 00 01». En 1951, son galibot crève l’écran. Vingt ans plus tard le cinéma connaît des difficultés et l’agence de Jean Mineur fusionne avec d’autres pour former Médiavision. Le Valenciennois se retire à Cannes où il meurt en 1985.
Source(s) :La Voix du Nord, 10-11 septembre 2006.
-
MINISCLOUX René
Lorsque René Emile Joseph Miniscloux meurt à Douai à l’âge de 38 ans des suites d’une longue maladie, l’émotion est forte dans le milieu de la presse du Nord tant l’homme semble apprécié pour ses qualités personnelles que professionnelles. « René Miniscloux était un journaliste parfait, écrit L’Egalité de Roubaix-Tourcoing. Sa finesse d’esprit, son intelligence ouverte à tous les problèmes du jour, son amour pour la cause des humbles en avait fait le défenseur de la région douaisienne. »
Fils de Horace Miniscloux, instituteur à Dorignies, concepteur d’une carte de France en relief, et de Léonie Gouy, René Miniscloux entre à la rédaction lilloise du Réveil du Nord après son service militaire accompli en 1907. L’édition douaisienne du quotidien socialiste se développant, il est nommé, en 1912, rédacteur principal dans la cité de Gayant. Mobilisé en 1914 dans l’infanterie avec le grade de sergent, il est, selon les propos tenus lors de ses funérailles par le rédacteur en chef du Réveil du Nord, blessé et emmené en captivité.
En 1919, il reprend sa place à la rédaction de Douai. Malade, il doit cesser toute activité et meurt le 28 juin 1926. Ses funérailles sont suivies par « un cortège extrêmement nombreux ».
Source(s) :AD Nord, 3 E 6163; Douai sportif, 28 juin 1926; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, 29 juin 1926 et 2 juillet 1926 .
-
MOCHE Edouard abbé
Vicaire à La Madeleine, l’abbé Moché est un collaborateur régulier du quotidien La Croix du Nord où il signe ses articles sous le pseudonyme de L’Ecuyer ou Colibri. A partir de 1897, il est directeur des œuvres de presse et administrateur du journal. A partir de 1924 et jusqu’à sa retraite, en 1936, il est professeur à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille.
-
MOIRET Maxime
Après des études de droit à Paris, Maxime Moiret est embauché comme journaliste à L’Echo du Nord avant la Seconde Guerre mondiale, et devient chef de l’édition à Valenciennes. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier et interné en Allemagne. Lors de son retour en France, il rejoint La Voix du Nord où il est chef de l’édition de Valenciennes. Il est ensuite nommé chef des services régionaux, poste qu’il occupe jusqu’au début des années 60. Maxime Moiret est l’auteur de plusieurs ouvrages religieux et philosophiques. Il meurt le 9 juin 1986 à Rouret dans les Alpes-Maritimes.
-
MOLLET Jean-Pierre
Souriant, affable, les mots reviennent naturellement chez tous ceux qui ont connu Jean-Pierre Mollet, journaliste, conseiller municipal et chrétien engagé. D’abord enseignant en histoire-géographie, Jean-Pierre Mollet est entré à La Voix du Nord le 1 er novembre 1969 à la rédaction de Cambrai dont il devint chef adjoint en 1977. En 1989, il est nommé au secrétariat de rédaction à Valenciennes. Mais à la disparition de ce dernier lors de l’informatisation des rédactions, il redevient rédacteur d’abord à Valenciennes, puis à Cambrai où il reste jusqu’à sa retraite. Très impliqué dans son quartier, il entre au conseil municipal de Cambrai où il siège jusqu’en 2015. Parallèlement, il participe au Comité communal d’action sociale dont il est le vice-président, mais aussi à l’Association des donneurs de sang. Chrétien, il était particulièrement impliqué dans la vie de l’Eglise et plus particulièrement de sa paroisse où il avait notamment créé une Association pour la rénovation de l’église de l’Immaculée-Conception. Après avoir livré plusieurs combats contre la maladie, Jean-Pierre Mollet meurt le 28 septembre 2018 à l’âge de 78 ans.
Source(s) :La Voix du Nord, édition de Cambrai, 30 septembre 2018.
-
MONGRUEL Jules
D’abord compositeur typographe à Paris, Jules Victor Mongruel entre à la rédaction du Courrier du Pas-de-Calais en 1868. Il en devient gérant le 1 er mai 1871. «Homme tranquille, qui fait son métier», il meurt à l’âge de 43 ans.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 041/60; Le Courrier du Pas-de-Calais, 10 septembre 1890.
-
MONIER Maurice
Fils de Maurice Juste Monier, universitaire, et de Laure Eugénie Joséphine Dewuez, Maurice Monnier est né à Douai le 16 novembre 1877. Elève au lycée de sa ville natale, il est bachelier en 1895 et entame à Lille des études de droit qu’il abandonne deux ans plus tard pour la politique et le journalisme.
 Il devient en effet secrétaire du député Emile Basly et entre, en janvier 1897, comme rédacteur au quotidien lillois Le Réveil du Nord dirigé par Edouard Delesalle. Revenu à Douai pour y organiser l’édition locale du quotidien, il regagne Lille, en janvier 1898, comme secrétaire de rédaction et couvre pour Le Réveil tous les grands congrès ouvriers. Lors de la catastrophe de Courrières en 1906, il prend la direction du service d’information, faisant du Réveil du Nord l’un des journaux les mieux renseignés sur les évènements qui suivirent. Cette couverture exceptionnelle valut à Maurice Monier d’être nommé secrétaire général de la rédaction et délégué au conseil d’administration. Habitant toujours Douai, Maurice Monier y continue son travail de journaliste. En 1907, il devient rédacteur en chef de l’hebdomadaire Le Petit Douaisien dont le directeur politique est le député socialiste de la circonscription et président du syndicat des mineurs, Charles Goniaux. Parallèlement, le journaliste continue son action de militant et propagandiste socialiste, participant à des veillées et des conférences. En juillet 1907, il est élu conseiller d’arrondissement de Douai, puis quelques semaines plus tard, il fait partie des quatre socialistes qui entrent au conseil municipal. En juillet 1911, il est élu président du conseil d’arrondissement. Egalement très attaché à la défense de sa profession, il est membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, et du Syndicat de la presse républicaine départementale. Incorporé le 9 août 1914 à la 23e compagnie du 43e RI, il est successivement secrétaire du chef d’état-major de la 1re région militaire, puis agent de liaison avec l’état-major de Foch à Cassel et les QG anglais à Saint-Omer et belge à Furnes, et enfin appelé au ministère de la Guerre. De juin 1915 à mars 1917, il est nommé sous-préfet d’Albertville. De 1917 à 1918, il est chef de cabinet du secrétaire d’Etat à l’Aéronautique , puis du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ; en décembre 1917, il est détaché au ministère des Affaires étrangères. En septembre 1919, pour service rendus pendant la guerre, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Après sa démobilisation, il revient dans le Nord et prend la direction du nouveau journal socialiste Le Cri du Nord et des régions libérées, créé en juillet 1919. Après la disparition de ce titre en juillet 1921, il devient en novembre 1922 directeur du quotidien dunkerquois d’union des gauches Nord-Eclair qui disparaît en juin 1924. Maurice Monier quitte alors le Nord pour Paris où il est nommé secrétaire général du quotidien L’Ere nouvelle, créé en 1919. Dix ans après sa nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur, il est promu officier en mars 1929. Franc-maçon, Monier est membre de la Grande Loge de France de 1925 à 1928 et de 1930 à 1931. Il est également membre de la Société des gens de lettres. Il meurt le 16 février 1931 à Paris.Source(s) :
Il devient en effet secrétaire du député Emile Basly et entre, en janvier 1897, comme rédacteur au quotidien lillois Le Réveil du Nord dirigé par Edouard Delesalle. Revenu à Douai pour y organiser l’édition locale du quotidien, il regagne Lille, en janvier 1898, comme secrétaire de rédaction et couvre pour Le Réveil tous les grands congrès ouvriers. Lors de la catastrophe de Courrières en 1906, il prend la direction du service d’information, faisant du Réveil du Nord l’un des journaux les mieux renseignés sur les évènements qui suivirent. Cette couverture exceptionnelle valut à Maurice Monier d’être nommé secrétaire général de la rédaction et délégué au conseil d’administration. Habitant toujours Douai, Maurice Monier y continue son travail de journaliste. En 1907, il devient rédacteur en chef de l’hebdomadaire Le Petit Douaisien dont le directeur politique est le député socialiste de la circonscription et président du syndicat des mineurs, Charles Goniaux. Parallèlement, le journaliste continue son action de militant et propagandiste socialiste, participant à des veillées et des conférences. En juillet 1907, il est élu conseiller d’arrondissement de Douai, puis quelques semaines plus tard, il fait partie des quatre socialistes qui entrent au conseil municipal. En juillet 1911, il est élu président du conseil d’arrondissement. Egalement très attaché à la défense de sa profession, il est membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, et du Syndicat de la presse républicaine départementale. Incorporé le 9 août 1914 à la 23e compagnie du 43e RI, il est successivement secrétaire du chef d’état-major de la 1re région militaire, puis agent de liaison avec l’état-major de Foch à Cassel et les QG anglais à Saint-Omer et belge à Furnes, et enfin appelé au ministère de la Guerre. De juin 1915 à mars 1917, il est nommé sous-préfet d’Albertville. De 1917 à 1918, il est chef de cabinet du secrétaire d’Etat à l’Aéronautique , puis du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts ; en décembre 1917, il est détaché au ministère des Affaires étrangères. En septembre 1919, pour service rendus pendant la guerre, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Après sa démobilisation, il revient dans le Nord et prend la direction du nouveau journal socialiste Le Cri du Nord et des régions libérées, créé en juillet 1919. Après la disparition de ce titre en juillet 1921, il devient en novembre 1922 directeur du quotidien dunkerquois d’union des gauches Nord-Eclair qui disparaît en juin 1924. Maurice Monier quitte alors le Nord pour Paris où il est nommé secrétaire général du quotidien L’Ere nouvelle, créé en 1919. Dix ans après sa nomination dans l’ordre de la Légion d’honneur, il est promu officier en mars 1929. Franc-maçon, Monier est membre de la Grande Loge de France de 1925 à 1928 et de 1930 à 1931. Il est également membre de la Société des gens de lettres. Il meurt le 16 février 1931 à Paris.Source(s) :Dossier de Légion d’honneur LH/1907/30, consulté en ligne; Dictionnaire bibliographique du Nord, Paris, Flammarion, n.d., p. 793-796.
-
MONTAGNE Lucien
Fils d’un commis principal des contributions indirectes, Lucien Louis Albert Montagne, né à Aire-sur-la-Lys, devint journaliste après des études de droits. Secrétaire de rédaction au Courrier du Pas-de-Calais , il fut également attaché à la rédaction du Grand Echo du Nord de la France après la Première Guerre mondiale. Auxiliaire au début de la guerre, il passa, sur sa demande, dans le service armé. Au sein du 43 e RI, il fit campagne d’abord comme simple soldat, puis comme sous-officier, il prit part aux batailles de Champagne, de Verdun, de Craone, d’Yser,… en 1917, de la Somme en 1918. Après la guerre, il fut élu secrétaire de la fédération des combattants du Pas-de-Calais, vice-président de la Fédération départementale des Associations de mutilés, anciens combattants, veuves et orphelins. Il était membre du comité de rédaction du Combattant du Pas-de-Calais. En 1922, Lucien Montagne fut nommé chevalier de la Légion d’honneur. Il fut également trésorier de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 014/18, 1R 9225; Le Grand Echo du Nord, 23 janvier 1922.
-
MONTBAZIN de
Rédacteur, peut-être à partir du 1 er janvier 1791, du Journal du département du Nord (ex Abeille patriote, feuille de tous les jours ), Montbazin fusionna, le 21 avril 1791, son journal avec les Affiches nationales du département du Nord , périodique douaisien dont les rédacteurs étaient Aubry et Marchant.
Source(s) :Arthur Dinaux.
-
MONTLINOT abbé Charles Leclerc de
Docteur en théologie et en médecine, Charles Leclerc de Montlinot est chanoine à la collégiale Saint-Pierre à Lille. Ardent admirateur de Voltaire, il est le principal rédacteur des Annonces, Affiches et Avis divers pour les Pays-Bas français lancé à partir du 7 janvier 1761 par Charles Panckoucke. Sa collaboration ne dure que quelques semaines, elle cesse en juillet 1761, bien avant que Panckoucke ne laisse le périodique à Jean-Baptiste Henry.
Source(s) :Gilbert Dalmasso, «André et Charles Panckoucke», L’Abeille, n° 15, septembre 2010.
-
MOREL Henri
Fils de Henri Charles Joseph Morel, maître teinturier à Lille, et de Virginie Catherine Flinois, Henri Jules Joseph Morel s’engage en 1870 comme zouave pontifical.
Par la suite, il est nommé directeur du quotidien légitimiste et catholique La Vraie France. A la disparition de ce quotidien en 1896, il devient directeur de l’imprimerie commerciale et des services administratifs de La Dépêche, journal conservateur dirigé par Henri Langlais. Resté à Lille pendant la Première Guerre, il s’oppose aux prétentions des Allemands qui avaient installé le conseil de guerre impérial dans les locaux du journal. Après la Délivrance, il participe à la relance du titre qu’il quitte dans les années 1920.
Chevalier des ordres pontificaux de Saint-Grégoire et de Saint-Sylvestre, il meurt à l’âge de 84 ans.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 044 R 163, 3 E 15474; La Croix du Nord, 18 décembre 1935.
-
MOREL Jean
Fils d’Henri Morel, administrateur de La Vraie France, Jean Marie Joseph Morel suit des études d’ingénieur dans sa ville natale. Son service militaire effectué au 3e régiment de génie d’octobre 1907 à septembre 1909, il entre aux services techniques du quotidien La Dépêche.
Le 26 août 1913, il se marie à Greux dans les Vosges avec Jeanne Michel. Mobilisé le 2 août 1914, il est fait prisonnier à Givet le 19 août et emmené en captivité. Il est libéré le 28 février 1918. Après l’armistice, il reprend sa place à La Dépêche dont il devient, quelques années plus tard après le départ de son père, directeur jusqu’en 1939.
Ce journal n’ayant pas repris sa parution durant la Seconde Guerre, il fonde en 1942, avec M. Corduant, l’imprimerie Morel-Corduant, installée rue des Bouchers à Lille. Veuf en 1947, il se remarie en 1948 avec Thérèse Catherine Juliette Finet. Jean Morel meurt, en novembre 1968, à l’âge de 82 ans, dans l’incendie de sa maison.
Source(s) :AD Nord 1 R 2839 et 3 E 21658; AD Vosges 4 E 223/7; Notice nécrologique dans Nord-Matin, 29 novembre 1968.
N
-
NAUDEAU, Ludovic
Journaliste à 19 ans, dès 1889, parlant anglais, allemand et russe, Naudeau se rend de sa propre initiative à Port-Arthur parce qu’il a deviné que la guerre entre Russes et Japonais allait éclater. Il est plusieurs mois durant le seul correspondant de guerre européen sur place, et Le Journal en tirera un grand profit. Fait deux fois prisonnier par les Japonais, il se fait passer la première fois pour un marchand; la seconde fois il sera emmené à Tokyo, où il restera deux ans. En 1918, il est à Moscou (on lui doit une interview de Lénine), et est fait prisonnier par les Bolchevicks . Rédacteur au Temps , il écrira pour L’Illustration , et quelques autres journaux. On lui doit une série d’ouvrages: Le Japon moderne et son évolution ; En prison sous la terreur russe ; Le Japon, son crime et son châtiment ; En écoutant parler les Allemands ; La Jolie Fille de Dublin (un roman); etc.
-
NAUDIN Arthur-Jean
Rédacteur en chef du Petit Ardennais lors du lancement de ce journal à Charleville le 31 mars 1880, Arthur Jean Naudin fonde en janvier 1887 le quotidien socialiste Le Petit Calaisien qu’il dirige jusqu’en 1912.
Source(s) :Yves Guillauma, «Figures de presse dans le Pas-de-Calais», L’Abeille, avril 2015, n° 29, p. 25.
-
NAUDIN Georges
En 1912, Georges Emile Louis Naudin succède à son père à la tête du Petit Calaisien. Propriétaire et gérant du journal ainsi que de l’imprimerie, il doit en 1940 fuir avant l’arrivée des Allemands. Il se réfugie d’abord dans le Loiret, puis à Bergerac où il reste durant toute la durée de la guerre. De retour dans le Pas-de-Calais en 1945, il tente de relancer un nouveau journal, mais, devant la multiplication des obstacles, renonce. Son imprimerie accueille dans un premier temps L’Echo de Calais et Le Réveil de Calais. En 1953, elle est vendue au quotidien Nord littoral.
Source(s) :Yves Guillauma, «Figures de presse dans le Pas-de-Calais», L’Abeille, avril 2015, n° 29, p. 25-26; Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021.
-
NAUDIN Henri
Fils de Georges Naudin, directeur du Petit Calaisien, Henry Naudin est administrateur de ce quotidien lors de son mariage le 24 octobre 1928 avec Germaine Léontine Marie Aniéré. Il assume la direction technique du journal jusqu’à la guerre. Par la suite, il devient voyageur de commerce.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 26 octobre 1928; Yves Guillauma, «Figures de presse dans le Pas-de-Calais», L’Abeille, avril 2015, n° 29, p. 26.
-
NAVADIC Auguste, dit Nava-Pacha
Après de brillantes études dans sa ville natale, Auguste Navadic opte pour le journalisme, il devient rédacteur au journal socialiste L’Avenir brestois où il se bat en duel avec Petitcolas de La Dépêche de Brest et ancien du Grand Echo du Nord . Il collabore au quotidien parisien L’Intransigeant dont il reste le correspondant jusqu’en 1939. Durant la Première Guerre, il combat sur le front français et en Orient, ce qui lui vaut la croix de Guerre et la médaille du Combattant. Navadic arrive à Lille en 1919 où il travaille au Réveil du Nord au début des années 20, puis il devient rédacteur au Télégramme du Nord . Secrétaire de rédaction à L’Echo du Nord , il est dans le même temps rédacteur principal au Progrès du Nord puis secrétaire général de la rédaction. Selon La Croix du Nord, «il aborde tous les genres de l’article politique au reportage et à la critique théâtrale.» Après la Seconde Guerre, il entre à La Voix du Nord. L’homme semble d’ailleurs sur tous les fronts: commentateur et critique à la radio, chroniqueur dans différents hebdomadaires, chargé de cours à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille.
Auguste Navadic est également un défenseur des intérêts de la profession. Avec Paul Béghin, il fonde la section régionale du Nord du Syndicat des journalistes dont il devient le secrétaire général, puis le président d’honneur.
Source(s) :AD Nord, M. 149-143; La Croix du Nord, 22 septembre 1952.
-
NAVADIC Jacques
Né à Lille le 3 janvier 1920, Jacques Navadic suit les traces de son père en entrant à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (14 e promotion, 1940). Lauréat d’un concours de reporters organisé par la RTF, il choisit pourtant de rentrer au Conservatoire d’art dramatique de Lille.
Comédien pendant l’Occupation, il revient à la Libération au journaliste en entrant à Télé-Lille qu’il quitte en 1955 pour Télé-Luxembourg inaugurée le 23 janvier 1955. Premier rédacteur en chef de la chaîne, il y crée le journal télévisé en septembre qu’il présente alors avec Robert Diligent.
Il devient par la suite directeur de l’information, puis directeur des programmes de RTL Luxembourg qui avait succédé en 1982 à Télé Luxembourg. De 1984 à 1989, année où il prend sa retraite, il est président de RTL.
Auteur de deux ouvrages relatant son expérience, Télé Luxembourg a 20 ans et RTL Télévision, c’est nous, Jacques Navadic est chevalier de l’ordre national du mérite, chevalier de la Légion d’honneur et décoré de l’ordre Orange-Nassau et de la Maison grand ducale.
-
NAWROCKI Stanislas
Né à Sieradz en Pologne le 8 mars 1901, Stanislas Nawrocki, fils d’un employé d’Etat, devient journaliste au quotidien catholique édité à Lille en langue polonaise Warius Polski dont il est bientôt rédacteur en chef. En 1930, il soutient à Lille une thèse en droit sur les assurances sociales en Pologne. A la mort de son beau-père Jan Brejski, en décembre 1934, il lui succède à la tête de Warius Polski. Il dirige ce journal jusqu’à son interdiction de parution à la Libération, en septembre 1944.
Source(s) :AD Nord, 3 E 15130; différents numéros du Grand Echo du Nord, et de, La Croix du Nord.
-
NEGRERIE Guy
Guy Négrerie était attaché à l’administration des P.T.T. à Dunkerque, quand il fut engagé à l’édition locale de La Voix du Nord. Il exerça ses premières fonctions en liaison avec Marc Burnod. Par la suite, en 1976, il fut transféré à Cambrai où lui fut confiée la rubrique des sports pour l’ensemble de l’arrondissement. Il la couvrit avec le concours de plusieurs correspondants. Au terme de son activité professionnelle, il se retira à Coligny (Ain). Son décès survint à Toulon, au cours d’un séjour de vacances dans la région varoise.
-
NOBECOURT René Gustave
Fils d’un épicier-cafetier d’Envermeu en Seine-inférieure, René-Gustave Nobécourt étudie au petit séminaire de Rouen. Mobilisé en janvier 1916, il combat au sein du 28 e RI et est blessé à trois reprises. Rendu à la vie civile avec la croix de guerre, il reprend ses études de philosophie et de scolastique à l’Institut catholique de Paris et à la Sorbonne. En 1922, il opte pour le journalisme. Entré au Journal de Rouen, il y est successivement secrétaire de rédaction et directeur de l’édition de Rouen. Critique littéraire dans le même quotidien, sa réputation dépasse bientôt les frontières de son département. Nobécourt est d’ailleurs lui-même auteur, il publie notamment en 1927 Un enfant qui demandait du pain, en 1930 une Vie d’Armand Carrel et en 1936 Armand Carrel, journaliste. En 1928, il est fait chevalier de la Légion d’honneur, en 1938, il entre à l’Académie des sciences, belles lettres et arts de Rouen. En 1941, il prend la direction du Journal de Normandie édité à Caen sous contrôle de l’occupant. En juillet 1944, il est arrêté pour ses sympathies pétainistes, mais il est blanchi après vingt-deux mois de détention et dirige alors l’ Echo de Normandie. Le 1 er mars 1949, René-Gustave Nobécourt devient le premier directeur-rédacteur en chef laïque du quotidien catholique La Croix du Nord qu’il contribue à rénover: il supprime le crucifix dans le titre, il accorde une place plus large à l’information régionale et locale, accueille de grandes signatures,… En 1956, il prend la direction de La France catholique qu’il dirige jusqu’à sa retraite en 1961. Il se consacre dès lors à l’histoire et publie notamment Les Secrets de la propagande en France occupée, Les Fantassins du Chemin des Dames , L’Année du11 novembre , Les Soldats de 40 dans la première bataille de Normandie: de la Bresle au Cotentin ,…
Source(s) :Loïc Vadelorge, Rouen sous la, IIIe, République. Politiques et pratiques culturelles, Presse universitaires de Rouen, 2005, consulté sur Open Edition Books; Catherine Poirot-Bourdin «Un directeur de France catholique, René-Gustave Nobécourt (1897-1989)», france-catholique.fr/Rene-Gustave-Nobecourt-1897-1989.html, 2012; Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, op. cit.
-
NOILHAU Pierre
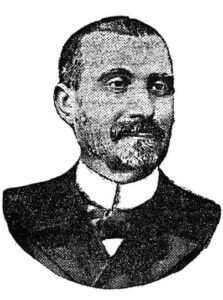
Pierre Noilhau pour l’état civil et le barreau, Pierre Salvat pour la presse. Natif des Landes, Noilhau mena en effet plusieurs carrières sous son nom propre et sous un pseudonyme : d’un côté celle d’avocat et de délégué général de la Ligue de la Patrie française, de l’autre, celle de journaliste.
Comme journaliste, Pierre Salvat exerça probablement une dizaine d’années dans le département du Nord. Durant les années 1880, il signe des articles dans Le Courrier d’Armentières, La Dépêche, Le Mémorial de Lille et Le Journal de Roubaix autant de quotidiens conservateurs qui appartiennent à la Société des journaux réunis de l’arrondissement de Lille dirigée par Reboux. Ses articles sont hostiles à la République et en particulier à la politique de laïcisation. En mars 1884, il est nommé rédacteur en chef de La Gazette d’Armentières, édition armentiéroise du quotidien royaliste et catholique lillois La Vraie France. Parallèlement, il collabore au quotidien parisien Le Gaulois.
Selon L’Avenir de Roubaix-Tourcoing, il aurait quitté Roubaix à la suite de nombreuses indélicatesses. En 1887, il serait devenu rédacteur en chef du « journal réactionnaire » de Vesoul, Le Réveil. Cependant, sa signature apparaît encore irrégulièrement dans Le Journal de Roubaix jusqu’en 1890. L’homme n’hésite pas à porter la contradiction chez ses adversaires politiques et ses écrits lui valent des démêlés avec la justice.
Par la suite, il serait devenu agent électoral boulangiste en Charente. En 1898, on le retrouve rédacteur en chef du Journal d’Alençon, organe du baron de Mackau, député de l’Orne, membre de l’Union des droites. Il en reste rédacteur politique jusqu’à sa mort. En 1899, la police du Nord croit encore le voir derrière le nouveau directeur du Journal d‘Armentières devenu propriété du député Union libérale Jules Dansette dont il aurait été le secrétaire, comme il aurait été celui du député Union des droites Eugène Robert des Rotours.
En opposition au dreyfusisme, à l’initiative de François Coppée, Jules Lemaître, Gabriel Syveton… est fondée en décembre 1898 la Ligue de la Patrie française. Pierre Noilhau en devient le délégué général et anime de nombreuses réunions en province. « De la barre à la tribune des réunions publiques, dira le bâtonnier du barreau de Paris dans l’hommage qu’il lui rendra après sa mort, il allait, toujours prêt à la bataille, apportant à ses amis le concours d’une parole tour à tour enflammée, pittoresque et souriante. »
Ami et confident de Syveton, il doit assister son défenseur dans le procès intenté au député nationaliste par le ministre de la guerre, le général André. Antidreyfusard devenu partisan de la réhabilitation du capitaine Dreyfus, le général, accusé d’avoir organisé un service de renseignements sur les opinions politiques et religieuses des officiers, avait été, le 4 novembre 1904, giflé par Syveton. A la veille de son procès, le député est retrouvé mort asphyxié dans son bureau. Le procès est annulé mais cette mort mystérieuse alimente les rumeurs les plus contradictoires, d’autant que Syveton, trésorier de la Ligue de la Patrie française, aurait eu une gestion peu rigoureuse des finances de l’association .
Selon la presse de l’époque, Noilhau, conseil de la veuve Syveton, renonça à cette fonction en raison des attaques dont il fut l’objet de la part de ses amis politiques ». Lors de son hommage, le bâtonnier ajoute : « Le soupçon l’éprouva, d’autant plus difficile à repousser qu’il était plus vague et moins raisonné. Noilhau fit tête et l’accusation recula. Mais la lutte douloureuse avait épuisé ses forces. » L’avocat s’impose une retraite volontaire et meurt en juillet 1905 d’une maladie du foie. Le Temps rapporte que ses obsèques eurent lieu « au milieu d’une assistance extrêmement restreinte ».
Source(s) :Sources : AD Landes, 4 E 110/8-14 et 1872-RP 303; AD Nord, 1T 222/1; Le Clairon, 5 mars 1883; Le Français, 1er mars 1884; Le Gaulois, plusieurs numéros de l’année 1884; l’Autorité, 17 août 1893; L’Avenir de Roubaix Tourcoing, 20 et 25 mars 1890; Le Journal, 27 juillet 1905; Le Temps, 29 juillet 1905 et 3 décembre 1905.
-
NOLF Michel
Metteur en page pendant de nombreuses années à Liberté, Michel Nolf rejoignit en suite Nord-Éclair où il travailla pendant près de vingt ans. Il prit sa retraite juste avant que Nord – Eclair ne quitte ses locaux de la Grand-rue pour rejoindre la rue du Caire, toujours à Roubaix.
Source(s) :Nord-Eclair, 22 juillet 2008.
-
NOURISSON Michel Alfred, dit Nour
Michel Alfred Nourrisson a été libraire jusqu’en 1895, en association avec un dénommé Faure, puis seul. Il a ensuite collaboré, sous le pseudonyme de Nour, «à différents journaux sans importance, mais de façon intermittente» selon la police. En 1897, il est rédacteur à L’Emancipateur de Cambrai. Marié, père d’un enfant, il «appartient, selon la même source, à une bonne famille et aurait reçu une bonne éducation». Enfin, il ne paraît pas s’occuper de politique .
Source(s) :AD Nord, T 222/3, dossier, L’Emancipateur, 14 septembre 1897.
O
-
OBEZ Adolphe Louis
Fils d’un cabaretier de Douai, Adolphe Louis Obez travaille d’abord comme libraire. Il obtient ensuite son brevet de lithographe, puis d’imprimeur en lettres. Il fonde alors les journaux Le Programme, feuille d’annonces (1846-1848) et L’Echo du commerce (1849-1851) . En 1853, après la mort de Crépeaux, fondateur de L’Indicateur du Nord (1852-1854), il en devient le rédacteur-gérant, s’engageant à en faire un soutien du gouvernement. En 1854, il devient actionnaire de l’imprimerie Céret-Carpentier qui publie Le Réformiste, transformé en septembre en Courrier de Douai . Des presses de cette imprimerie sortiront notamment La Chronique douaisienne et Gayant.
En octobre 1860, Obez cède son brevet de libraire, puis en septembre 1861 celui d’imprimeur en lettres. Il devient négociant, vendant notamment le fameux sirop de Calabre. Il meurt à Douai à l’âge de 68 ans.
Source(s) :AN, F, 18, 2018; Le Douaisien, juin 1878; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017.
-
OBEZ Jacques Nestor Henri
Fils d’Adolphe Obez, négociant, et de sa seconde épouse Betzy Taylor, Jacques Nestor Henri Obez lance le 6 novembre 1880 à Douai L’Echo commercial et industriel, hebdomadaire imprimé d’abord à Lille, puis à Douai. En 1883, il transfert ses bureaux à Roubaix où le journal devient L’Echo commercial, industriel et économique .
Source(s) :AD Nord, 1T 222/7.
-
OUDART Fernand
Né au Cateau-Cambrésis, Fernand Oudart fait ses études au grand séminaire de Cambrai. Pendant deux ans, il est professeur au collège de Bavay. En 1896, il change d’orientation en entrant comme rédacteur au Journal de Roubaix. Il le quitte pour l’édition roubaisienne du Grand Echo du Nord pour laquelle il travaille durant trente-deux ans.
Membre fondateur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, il en était le secrétaire général depuis 1939.
Source(s) :L’Echo du Nord, 5 janvier 1941; Le Journal de Roubaix, 4 janvier 1941.
-
OUDART Jean
Entré à La Voix du Nord le 1 er mars 1945 comme comptable, Jean Oudart mène de pair à la faculté de droit de Lille des études pour obtenir le diplôme d’expert-comptable. Nommé chef du service comptable en 1962, il devient administrateur adjoint quatre ans plus tard. Le 1 er juin 1978, il est nommé directeur général de La Voix du Nord lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et du conseil d’administration, pour faire barrage à Robert Décout, rédacteur-en-chef. Il entre au conseil d’administration en avril 1979. Il quitte le journal en 1982 à la suite de sérieux ennuis de santé.
Jean Oudart a connu et a été un acteur de l’évolution d’une entreprise passée de 200 à 1200 personnes, d’un journal dont le tirage a été multiplié par quatre, atteignant 400000 exemplaires en 1982. Il meurt le 17 mars 1986, à la suite d’une intervention chirurgicale.
Source(s) :Presse Actualité, n° 147, juin-juillet-août 1980; La Voix du Nord, 17 mars 1986.,
M – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais P
-
PANCKOUCKE André Joseph
Fondateur du premier périodique créé dans le Nord, André Joseph Panckoucke a laissé à jamais son nom dans l’histoire de la presse de ce département, même si son journal ne connut que seize numéros. Né le 31 janvier 1703 à Lille, André Joseph Panckoucke est l’aîné d’une famille de onze enfants. En 1728, il s’établit libraire, puis il ouvre des cours publics traitant de géographie et de physique. En 1746, il lance le périodique L’Abeille flamande , imprimé par la veuve Danel . A cette époque, il est déjà l’auteur de plusieurs ouvrages: Le Dictionnaire de la châtellenie de Lille en 1733, Les Elémens d’astronomie et de géographie à l’usage des négociants en 1739, Essai sur les philosophies et les égarements de la raison sans la foi en 1743, La Bataille de Fontenoy, poème lyrique en vers burlesques par un Lillois… en 1745 . Après sa brève expérience de presse, Panckoucke poursuit son travail d’auteur avec notamment un Manuel de philosophie ou précis universel des sciences, un Dictionnaire des proverbes français, un ouvrage en deux tomes intitulé Etudes convenables aux demoiselles, et un autre Amusements mathématiques . Il meurt à Lille à l’âge de 50 ans. Deux ouvrages inédits sont encore publiés après sa mort dont un Abrégé chronologique de l’histoire de Flandre, contenant les traits remarquables des comtes de Flandre depuis Baudouin I er jusqu’à Charles II d’Espagne.
Source(s) :Dominique-Yves Chivot, L’Abeille flamande, mémoire ESJ, n.d.
-
PANCKOUCKE Charles Joseph
Fils aîné d’André Joseph Panckoucke, éditeur du premier périodique lillois, Charles-Joseph Panckoucke, après avoir demandé l’autorisation d’enseigner les mathématiques en 1756, prend le relais de son père. Libraire, il publie à partir du 7 janvier 1761 les Annonces, affiches et avis divers dont il confie la direction au chanoine Charles Leclerc de Montlinot et qui parut jusqu’au 28 décembre 1763. Panckoucke quitte Lille pour Paris. En 1778, il obtient le privilège de la publication du Mercure de France qu’il réunit au Journal de Bruxelles dont il était déjà propriétaire. En 1787, il obtient le privilège pour La Gazette de France. Le 24 mai 1789, il crée Le Moniteur universel pour publier les débats de l’Assemblée constituante. Pendant la Révolution, il doit se réfugier en Angleterre où il fonde Le Mercure britannique. Après sa mort survenue en décembre 1798, Le Moniteur universel devient, en 1799, le journal officiel de l’Etat français. Ecrivain prolixe, Panckoucke laisse de nombreux ouvrages de philosophie, de grammaire, d’économie politique, ainsi que des traductions du Tasse, de Lucrèce,…
Source(s) :Dominique-Yves Chivot, L’Abeille flamande, mémoire ESJ, n.d.
-
PARMENTIER Emile
Fils de la résistante Jeanne Parmentier, qui avait participé à la création de la Voix du Nord clandestine, membre du Conseil de gérance du quotidien La Voix du Nord, Emile Parmentier entre au service des sports de La Voix du Nord le 1 er novembre 1945. Chargé plus particulièrement de la rubrique cyclisme, il suit plusieurs tours de France. En 1959, il est promu à la tête du service des sports. A ce titre, il devient rédacteur en chef de La Voix des Sports, hebdomadaire sportif de La Voix du Nord publié le lundi. Il occupe ce poste jusqu’à sa retraite en 1980.
Source(s) :La Voix du Nord, 10 et 11 janvier 1999.
-
PARZY Gérard
Gérard Parzy passa toute sa vie professionnelle dans le Valenciennois. Après des études secondaires, il avait d’abord opté pour l’Education nationale puisqu’il fut instituteur durant la première décennie de son activité…
Très intéressé par l’information locale et, notamment, par la valorisation de «son» secteur de Vieux-Condé, Hergnies et Condé-sur-l’Escaut, il devint vite correspondant de La Voix du Nord dans ce triangle objet de toutes ses attentions. Enseignant et journaliste: ces deux métiers ne pouvaient être menés longtemps de front et Gérard Parzy choisit finalement le second en 1971. Cette deuxième carrière, il l’a menée jusqu’en 2000. A l’agence valenciennoise de La Voix du Nord . Un œil sur son canton, un autre sur le football avec l’USVA qu’il ne cessa de suivre (il fut coopté au sein du comité du club): au milieu de la population cet homme de terrain était dans son élément!
Le football était important pour lui, mais son besoin d’investissement dans la vie de ses semblables s’exerça aussi sur d’autres terrains que celui du sport…
A Valenciennes, son journal lui confia la fonction d’adjoint au chef d’agence puis, pendant cinq ans, le détacha à l’agence du Quesnoy, à deux pas de sa terre d’attache.
A la retraite Gérard Parzy décida avec son épouse de s’établir au Sénégal, dans un petit village où il avait fait construire. C’est là qu’il est décédé le 28 juin 2008… cinq jours après avoir fêté son 65 e anniversaire…
-
PASCAL Edmond
Selon une fiche de police établie en septembre 1895, Edmond Pascal habite au n° 101 de la Grand-rue à Roubaix. C’est un homme barbu, mesurant 1,70 mètre, au teint ordinaire, au nez ordinaire, à la bouche moyenne et au menton rond. Reporter au Journal de Roubaix depuis trois mois seulement, c’est un transfuge de La Croix du Nord , où il exerçait la même fonction. De bonne conduite et moralité, c’est un homme très actif et très catholique. Il a les opinions du Journal de Roubaix , franc partisan d’une «République religieuse» (sic). La Bataille du 13 novembre 1909 met d’ailleurs en doute les sentiments républicains d’Edmond Pascal…
Source(s) :AD Nord, 1T 222/25.
-
PAUCHET Albert
Originaire de Boulogne-sur-Mer, Albert Pauchet entre en 1921 au quotidien Le Télégramme du Pas-de-Calais où il est rédacteur sportif. Passionné de cyclisme, il est lui-même pratiquant. A ce titre, il participe aux championnats de France des journalistes sportifs. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en 1940, mais réussit à se faire rapatrier le 26 mars 1941. Il reprend alors sa place au Télégramme . Si le quotidien est interdit à la Libération, Albert Pauchet qui, durant l’Occupation, ne s’est occupé que de sport, peut continuer à exercer sa profession. Il entre à la rédaction boulonnaise de La Voix du Nord. Il meurt le 2 juillet 1950 à Wimille en se rendant, à vélo, à une manifestation sportive.
Source(s) :AD Nord, 6W 16; La Croix du Nord, 1er, juillet 1932.
-
PAUL-KAHN R.
Président honoraire de la presse diplomatique, Paul-Kahn assure du 15 juillet 1950 au 10 mars 1952 les nouvelles du Parlement et des milieux gouvernementaux pour L’Echo de Calais et du Pas-de-Calais. Source : Presse Actualité , n° 102, juin-juillet-août 1975.
-
PAUWELS Maurice
Maurice Pauwels fit partie de ceux qui n’acceptèrent pas la défaite en 1940. Après avoir tenté en vain de rejoindre Londres dès 1940, il se consacre à la résistance intérieure: transport d’armes, sauvetage d’aviateurs alliés, sabotages, etc. Il participe également à la rédaction et la diffusion de La Voix du Nord clandestine. Responsable départemental du mouvement Voix du Nord, il est arrêté en avril 1944. Il est déporté à Buchenwald par le dernier train parti de la prison de Loos en septembre. Rentré en France en 1945, il devient rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef de La Voix du Nord qu’il quitte en avril 1948, à l’issue d’une grève de trois semaines, en même temps que le directeur du journal Léon Chadé. Il entre dans le monde de l’industrie devenant successivement secrétaire général des laboratoires pharmaceutiques Dausse, directeur de Boussois SA et délégué du groupe Malakoff.
Maurice Pauwels était titulaire de plusieurs distinctions françaises et alliées. Il avait reçu la rosette d’officier de la Légion d’honneur des mains du général de Gaulle.
Source(s) :La Voix du Nord, 28 septembre 1984.
-
PECQUEUR Constantin
Né dans une famille aisée, Pecqueur étudia les mathématiques et les arts de l’ingénieur. Il travailla à l’Hôpital militaire de Lille, où il découvrit les théories socialistes. Il monta à Paris en 1830, et rejoint les saint-simoniens. Il écrit alors pour Le Globe et d’autres feuilles saint-simoniennes, mais quitte le mouvement, en 1832, à cause des dérives religieuses de Prosper Enfantin. Il rejoint alors Fourier, et vit dans un phalanstère. En 1835, il écrit une biographie de Fourier. Il quitte Fourier en 1836, il publie une critique de son système et fonde alors le sien, tout en restant proche de certains de ses anciens amis : Pierre Leroux ou Victor Considérant.
Pecqueur, au contraire des précédents, est un des premiers partisans de l’appropriation collective des moyens de production, de distribution et d’échange, devenant le père du socialisme collectiviste français. Marx citera souvent Pecqueur dans les manuscrits de 1844 aussi bien que dans le Capital.
En 1839, il publie son œuvre majeure, deux volumes intitulés Économie sociale des intérêts du commerce, de l’industrie, de l’agriculture et de la civilisation en général, sous l’influence de l’application de la vapeur. Cetouvrage sera récompensé par a l’Académie des sciences morales et politiques. La même année, Pecqueur est chargé par le gouvernement d’étudier l’organisation des chemins de fer belges. Il recommandera dans son rapport que l’État investisse dans ce domaine.
En 1844, Pecqueur devient un contributeur régulier de La Réforme, le journal de Ledru-Rollin.
En 1848, il soutient le mouvement de février, il est nommé par Louis Blanc à la Commission du Luxembourg chargée d’étudier l’organisation du travail. Il propose, avec Victor Considérant, l’introduction des négociations collectives, la fondation de colonies agricoles par l’État, la construction de logements sociaux et la création de coopératives ouvrières, propositions qui ne sont pas retenues. Dans le même temps, Pecqueur est nommé directeur adjoint de la Bibliothèque nationale. Il publie aussi sous le pseudonyme de Greppo un livre destiné à répandre ses idées dans le peuple. En 1848-1849, il publie son journal, Le Salut du peuple, où il entame une polémique contre Proudhon, qu’il accuse de plagier certaines idées de Saint-Simon.
Pecqueur a aussi défendu l’idée d’organisations internationales où pourraient se régler les conflits internationaux, une fédération de toutes les nations, anticipant l’ONU. Outre Le Globe et Le Salut du peuple, il a écrit dans Le Phalanstère, La Revue du progrès, La Presse, La Réforme, La Revue indépendante, et bien d’autres.
Source(s) :Dictionnaire universel des contemporains (édition de 1870); Wikipédia.
-
PELADAN Adrien
Né au Vigan dans le Gard, Adrien Peladan fait partie de ces «blancs du midi», catholiques intransigeants et légitimistes farouches. Et dans son cas, mystiques et exaltés? D’abord enseignant dans le secondaire, il fonde en 1848 L ’Etoile du Midi qui ne survit pas au coup d’Etat du 2 décembre 1851. Installé à Lyon, il fonde, en 1856, La France littéraire, artistique, scientifique , puis en avril 1857 La Semaine religieuse de Lyon qu’il dirige jusqu’en novembre 1866, date à laquelle l’archevêché reprend le périodique en main. Après la guerre de 1870, Adrien Peladan devient rédacteur en chef du quotidien catholique et légitimiste lillois fondé par l’industriel Philibert Vrau, La Vraie France qu’il quitte «volontairement», selon le journal Le Progrès du Nord , en octobre 1872. Il regagne alors le Gard où ce partisan du comte de Chambord fonde successivement Le Châtiment , puis L’Extrême Droite. Péladan est l’auteur de nombreux ouvrages en faveur de la cause légitimiste dont, en 1878, Dernier mot des prophéties qui connut un réel succès. Son dernier livre, Saint Christophe protecteur de nos aïeux, paraît quelques mois avant sa mort survenue le 7 avril 1890 à Nîmes.
Source(s) :Jean-Marie Mayeur et Yves-Marie Hilaire, Dictionnaire du monde religieux, 1985; Jean-Claude Drouin, «Un légitimiste mystique du xixe, siècle : Adrien Peladan 1815-1890», consulté sur internet; «La première semaine religieuse de Lyon et son fondateur», museedudiocesedelyon.com/MUSEEduDIOCESEdeLYONsemainereligieuse.htm
-
PELLEAU Toussaint Hervé Joseph, dit Paul T. Pelleau
Après des études au lycée de Brest, puis à l’université Rennes, Toussaint Hervé Joseph Pelleau, fils d’un professeur de la marine, effectue à partir de 1906 son service militaire au 19 e RI puis au 2 e régiment colonial. Il est réformé le 21 août 1907 pour infirmité. Il entre dans la presse du Nord où il n’est pas inconnu ayant déjà collaboré au Beffroi. Il intègre la rédaction du quotidien Le Progrès du Nord où il est successivement chef du reportage, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef. Il y reste jusqu’à la suspension du journal en décembre 1931. Il est alors pressenti pour occuper le poste de rédacteur principal au quotidien L’Ouest-Eclair, mais on le retrouve cependant rédacteur en chef du Progrès du Nord lorsque ce titre est relancé en 1933 comme hebdomadaire, sous la direction de Louis Gauche. Il est également rédacteur politique du Bonhomme du Nord et du Pas-de-Calais édité à Douai, correspondant régional du Matin et de La Dépêche de Toulouse.
Ancien secrétaire de la fédération républicaine du Nord, Paul T. Pelleau était membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, vice-président de l’Association des Bretons du Nord. Officier des palmes académiques en 1914, il avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1926.
Source(s) :AD Nord M 127/59; Léonore, dossier de légionnaire; Le Grand Echo du Nord, 20 octobre 1926.
-
PERETTI Charles de
Cet avocat parisien fut propriétaire de L’Observateur d’Avesnes qu’il racheta à Gaston Deloffre.
-
PERRIN Maurice
Rédacteur à l’édition cambrésienne du Grand Echo du Nord de la France dans l’entre-deux-guerres, Maurice Perrin a poursuivi sa carrière après la Libération dans la même ville pour La Voix du Nord.
-
PESEZ César
Rédacteur à La Vie lilloise au début des années 1900 , César Pesez entre après la Première Guerre au quotidien lillois Le Réveil du Nord où il travaille jusqu’à la disparition du titre en 1944. Parallèlement, il est secrétaire général de la rédaction du Réveil illustré. Officier d’Académie en 1927, il reçoit, en août 1944, la médaille du travail pour plus de trente années d’activités.
César Pesez fut également le fondateur de l’Amicale des journalistes lillois dont le but était de venir en aide à ses membres dans des circonstances difficiles et qui fonctionna jusqu’en 1940. Il y assuma les fonctions de trésorier puis de président. Il était également membre de l’Association professionnelle des journalistes du Nord. En avril 1925, il avait été élu conseiller municipal socialiste de Lambersart. Il meurt en novembre 1948 à l’âge de 73 ans.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 16 et 17 novembre 1903, 12 septembre 1927, 3 octobre 1907; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, 23 juin 1939, «Journée de la presse et de la publicité à l’Exposition du Progrès social»; Le Réveil du Nord, 1er août 1944; La Croix du Nord, 26 novembre 1948.
-
PESSARD Hector Louis François
Hector Pessard est né à Lille, mais fit ses études au lycée Bonaparte à Paris. Il débuta au Figaro , puis passa à La Gironde (1857-1858). Mais, ayant tiré un mauvais numéro, il dut accomplir deux ans et demi de service militaire. Il entra ensuite au service des Douanes. Nommé à Blanc-Misseron (Nord), il collabora à L’Impartial du Nord , feuille libérale de Valenciennes, à 50 F par mois. Mis en demeure de choisir entre la presse et les Douanes, il démissionna, et regagna Paris pour se consacrer au journalisme, participant à l’aventure du Courrier de Paris , avec Clément Duvernois et Charles Floquet, tout en restant le correspondant parisien de L’Impartial du Nord , collaborant au Mémorial des Deux-Sèvres , au Phare de la Loire , puis au Temps . De 1863 à 1867, il écrivit dans ce quotidien des articles politiques, puis un «courrier parisien». Il travailla également au Courrier du dimanche , puis fut un des principaux rédacteurs de La Liberté , dirigée par Émile de Girardin. En 1867, il passa à L’Epoque , et en 1869 prit la rédaction politique du Gaulois . Il collabora également à La Revue germanique et à La Revue moderne . En 1870, il déposa les statuts d’un nouveau journal Le Jour , dont il était le fondateur, mais qui ne semble pas avoir paru. Il posséda quelques mois Le Petit Parisien en 1877 qu’il céda au groupe Dalloz, fut directeur du bureau de la Presse au ministère de l’intérieur (1878), et directeur du National , où il employa notamment Ernest Judet, natif d’Avesnes-sur-Helpe (voir ce nom). Hector Pessard fut également président du Syndicat de la critique Théâtre, Musique, Danse. Il fut mêlé au scandale de Panama: alors au National , il aurait touché 7 500 F. Mais il est passé à la postérité pour avoir été éreinté par Octave Mirbeau pour son admiration pour Dumas père – «Quant à vous, Monsieur Hector Pessard, vous me copierez cent fois La Dame de Montsoreau … et vous viendrez nous parler après de M. Alexandre Dumas père – ( Le Figaro , 25 février 1888), à cause de ses diatribes antinaturalistes et de ses goûts rétrogrades en matière de littérature (Il fut un adversaire acharné d’August Strindberg). Malgré tout, T. Ferenczi dans son Invention du journalisme en France en fait l’un des représentants «d’un journalisme qui tend à conquérir son autonomie par rapport au jeu politique (p. 190) au tournant du xix e siècle. Hector Pessard a collaboré au Dictionnaire politique de M. Block; il a publié avec Clément Duvernois L’Année parlementaire 1863-1864 , et La Guerre de 1870-1871 : histoire politique et militaire avec A. Wachter, (illustré par A. Danjou, paru en livraison) en 1873. Il a aussi fait paraître les Mémoires d’un bohême, esquisse de m œ urs contemporaines (Valenciennes, 1860); Yo et les principes de 89, fantaisie chinoise (1866); Les Gendarmes, fantaisie administrative (1869); Lettres d’un interdit (1874); dirigé La France électorale… Renseignements généraux sur la situation politique du département sa représentation à l’assemblée et au conseil général, biographies et votes des députés, effets de la loi sur les maires dans le département par une réunion d’hommes politiques (1874); Mes Petits Papiers, 1860-1870 , deux volumes (1887-1888); Mes Petits Papiers. 2 e série (1871-1873); Le Théâtre libre (1889). Outre les textes autobiographiques, la Bibliothèque nationale de France détient un opuscule intitulé Hector Pessard , texte d’un devoir de Jean Darriulat, alors élève au Centre de formation des journalistes (1969-1970), avec des annotations du correcteur, Pierre Albert.
Source(s) :Vapereau G. et al., Dictionnaire universel des contemporains contenant toutes les personnes notables de la France et des pays étrangers, Paris, Hachette, 4e, éd., 1870, et plusieurs sites sur internet.
-
PETILLON, chanoine
Vicaire à Douai, l’abbé Pétillon rejoint à La Croix du Nord son ancien confrère Henri Masquelier en 1895. Il devient directeur au quotidien catholique de Lille. Il est également secrétaire général de la Chambre syndicale de la publicité du Nord de la France.
Nommé chanoine de la cathédrale de Lille, il est secrétaire général du comité des pèlerinages du diocèse de Lille et en conduit plus de cinquante, ce qui lui vaut d’être nommé chanoine honoraire de Notre-Dame de Lourdes en 1931.
-
PETIT Joseph Louis
D’après une fiche de police établie le 5 novembre 1895, le père de Joseph Petit fabriquait des fuseaux pour l’industrie textile.
Quant à Joseph Petit, il fut d’abord employé de commerce et correspondant de presse avant de devenir directeur d’agence du Journal de Roubaix , pour lequel il travaillait depuis onze ans. C’était un homme sérieux, de bonne conduite, bien éduqué, bien vu de tous ses confrères. D’opinion réactionnaire, il paraissait malgré tout disposé à se rallier à la République.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/25.
-
PETIT Jules , dit Jules Petit père
Fils d’Etienne Jean Baptiste Petit et de Marie Anne Farvacque, Jules César Joseph Petit naît à Roubaix en 1863. Devenu ouvrier lithographe, il reprit en 1863 l’imprimerie Alcan-Levy, rue Basse à Lille où s’imprimait Le Journal de Lille , fondé en 1861 par Géry Legrand et Gustave Masure . Jules Petit devint directeur de cette publication et la transforma en journal modéré sous le nom de Courrier populaire .
Tout en gardant la direction politique du journal jusqu’à sa mort, il laisse par la suite la rédaction en chef à son fils Jules Petit-Ragot.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 350 R 102; BM Lille, fonds Humbert, boîte 20, dossier 2.
-
PETIT Jules François, dit Petit-Ragot
Fils d’un journaliste et imprimeur lillois, Jules César Joseph Petit (Cf. notice précédente), et de sa seconde épouse, Marie Silvie Maurage, Jules François Petit fit ses études au lycée de Lille. En 1879, à l’âge de 20 ans, il entre au Courrier populaire dont son père est le propriétaire. Le 18 janvier 1883, il se marie avec Laetitia Julie Marie Ragot et prend, par la suite, le nom de Jules Petit-Ragot pour se distinguer de son père. Devenu rédacteur en chef du Courrier populaire, il le quitte, selon Georges Lepreux, dès février 1889.
Républicain actif, Jules Petit a été le fondateur et le secrétaire général de la Ligue républicaine de Lille. Menant campagne contre le général Boulanger lorsque celui-ci se présenta dans le Nord, il fut secrétaire du comité départemental antiboulangiste. Il semble ensuite ne plus jouer aucun rôle politique.
Entre temps, Jules Petit est également rédacteur en chef de l’hebdomadaire Les Saisons, organe consacré aux sports, créé en septembre 1882. Tout en s’ouvrant au théâtre, ce périodique paraît jusqu’en février 1893. L’année précédente, sollicité par un client pour reproduire des lettres de crédit pour une banque anglaise, Jules Petit-Ragot avait été à l’origine de l’arrestation d’un escroc ayant déjà sévi à Anvers et à Montpellier.
L’imprimerie Jules Petit-Ragot est mise en liquidation judiciaire en 1898. Jules Petit-Ragot devient alors employé des contributions à Bruay-en-Artois. Il meurt à l’âge de 43 ans à Ronchin dans la banlieue lilloise.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 044 R 168; 1 Mi EC 350 R 065; 3 E 15839; M 157/7; L’Indépendant rémois, 27 octobre 1892., PETIT-LEDUC, (?, ?, –, ?, ?), Journaliste, Journaliste au, Journal de Roubaix, figure sur la photo de groupe prise à l’occasion des fêtes de la presse à l’exposition internationale de Roubaix en 1911.
-
PETIT-LEDUC Joseph
Rédacteur puis rédacteur principal du Journal de Roubaix où il exerça pendant 30 ans, Joseph Petit-Leduc est mort en 1928 à Toulon où il venait de se retirer.
Correspondant, puis responsable de l’agence de Tourcoing du Journal de Roubaix, dont il écrivait aussi les chroniques artistiques qu’il signait « de l’Espelette », il assura aussi la direction du Journal de la laine, également édité par Reboux.
Petit-Leduc fut également secrétaire administratif de la Chambre de commerce de Tourcoing de 1895 à 1917 et secrétaire de la Société de géographie de cette même ville. Il avait obtenu les palmes académiques en 1914. D’après une fiche de police établie le 5 novembre 1895, le père de Joseph Petit fabriquait des fuseaux pour l’industrie textile. Quant à Joseph Petit, c’était un homme sérieux, de bonne conduite, bien éduqué, bien vu de tous ses confrères. D’opinion réactionnaire, il paraissait malgré tout disposé à se rallier à la République, selon la même fiche de police.
Source(s) :AD Nord; Le Journal de Roubaix, 29 septembre 1928.
-
PETITCOLAS Emile
Fils de Jules Petitcolas, menuisier à Longeroy, commune d’Harol, dans les Vosges, et de Marguerite Pélagie Barthélemy, Louis Emile Petitcolas est d’abord instituteur. A l’issue de son engagement décennal, il opte pour le journalisme. Il est d’abord rédacteur à L’Est républicain, puis arrive au Grand Echo du Nord le 1 er janvier 1895. Il n’y fait qu’un court séjour. Le 1 er juin 1895, il devient rédacteur principal à L’Avenir de Roubaix-Tourcoing qu’il quitte trois mois plus tard pour diriger un journal du Havre. Petitcolas est alors catalogué par la police comme fervent républicain et un homme sérieux, malgré, semble-t-il, une certaine instabilité professionnelle. Ce que la suite de sa carrière semble confirmer. A partir de 1897, il est secrétaire de rédaction à La Dépêche de Brest où pendant plus d’une décennie, il déploie une intense activité à la fois comme journaliste et citoyen de la commune portuaire. On le retrouve conseiller municipal, président de l’Union sténographique brestoise, de la Jeunesse sportive brestoise, de la Fédération sportive régionale brestoise, trésorier de la société mutuelle La Sauvegarde,… Défenseur de l’école laïque, il est fait officier d’Académie en 1902. Comme journaliste, il doit affronter plusieurs duels. Pour une raison inconnue, il délaisse le journalisme en 1910 et devient directeur de l’« Office commercial et contentieux » de Brest, puis voyageur de commerce. Lors de son décès, le quotidien parisien Le Temps dont il était le correspondant l’annonce au Progrès du Nord pendant quelques mois durant la Première Guerre. Si Petitcolas fit un passage dans ce quotidien lillois, ce n’est pas à cette époque où, dans une ville occupée, les journaux avaient suspendu leur parution. Après l’armistice, Petitcolas revient au journalisme à Rennes où il dirige la rédaction de L’Eclaireur du Finistère. Il meurt le 5 janvier 1928 à l’âge de 63 ans.
Le 28 avril 1917 à Paris, Emile Petitcolas, voyageur de commerce, avait épousé Marie-Anne Seznec dont le frère Guillaume est condamné le 4 novembre 1924 aux travaux forcés à perpétuité pour le meurtre de Pierre Quéméneur, conseiller général du Finistère. En 1925 et en 1926, Marie-Anne Seznec, soutenue par son mari, adresse quatre requêtes en révision du procès de son frère au ministère de la Justice.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/26; AD Vosges, 237/1 E 9-39511; La Dépêche de Brest, de 1901 à 1921; Le Temps, 19 janvier 1928.
-
PETY Charles
Charles Pety est propriétaire et rédacteur en chef de L’Echo de Cambrai. Journal des intérêts démocratique du Nord à partir du 19 octobre 1848. Ce périodique est suspendu après le coup d’Etat du 2 décembre 1851. En avril 1852, Pety sollicite l’autorisation de publier un nouveau journal Le Progrès du Nord. Le sous-préfet de Cambrai s’oppose à cette autorisation arguant des «opinions exaltées» du demandeur. «Il a, écrit-il, exercé la plus pernicieuse influence sur les classes ouvrières de l’arrondissement de Cambrai. […] l’administration commettrait une grande faute si elle permettait au sieur Pety de les travailler à nouveau par la propagation des idées démagogiques.»
Source(s) :AD Nord, 1T 222/2, dossier, L’Echo de Cambrai.
-
PEUMERY Jules
Né à Montmorillon dans la Vienne, Jules Peumery fonde à Calais le 15 septembre 1895 le journal Le Phare de Calais qui adopte la périodicité quotidienne le 1 er octobre 1907. Il est également l’auteur de plusieurs récits de voyage: Un voyage vers le soleil: de Calais au Maroc (1930), Croisière en Corse: de Nice à l’Île de Beauté (1932), Dix jours à Rome: de Nice à la ville éternelle (1933), Croisière aux capitales du Nord. De Calais à Oslo, Copenhague, Stockholm, Helsingfors, Leningrad, Tallinn, Riga, Danzig, Hambourg (1935),…
Durant l’entre-deux-guerres, ses activités lui valent plusieurs distinctions. Il est nommé chevalier de la Légion d’honneur, officier de l’Instruction publique, commandeur de l’ordre du Nicham-Iftikhas, officier du Ouissam Alaouite et chevalier de l’ordre de Léopold.
Lors de l’invasion allemande, son journal cesse sa parution le 20 mai 1940 pour la reprendre un mois plus tard et glisse vers la collaboration. A la Libération, des poursuites sont engagées contre la SARL Le Phare de Calais-Jules Peumery, fondateur. Cependant Jules Peumery ne connaîtra pas les conclusions du procès. Réfugié à Versailles depuis février 1944, il y meurt le 21 janvier 1946.
Source(s) :Nord Littoral, 23 janvier 1946, faire-part de décès; Yves Guillauma, «Figures de la presse dans le Pas-de-Calais, L’Abeille, avril 2015, n° 29.
-
PICAVET Ernest
Fils de rentiers, Ernest Picavet naît le 30 juin 1867. Voyageur de commerce, il ne fait qu’une courte apparition à L’Echo du Nord en 1895 où il est reporter pendant deux mois. Selon la police, «de par sa famille, il professerait des opinions conservatrices et même cléricales.» Il entre ensuite à La Vraie France, puis au Courrier populaire dirigé par Willot-Petit, enfin au Réveil du Nord .
Toujours selon un rapport de la police en décembre 1896, «il laisse le souvenir d’un jeune homme paresseux, versatile, qui n’a pas trouvé sa voie.»
Source(s) :AD Nord.
-
PICAVEZLouis Camille
Membre du POF puis du Parti socialiste, Louis Picavez est militant syndicaliste, élu conseiller s’arrondissement de Lille-sud et conseiller municipal de Lille en 1912.
Gérant du périodique socialiste Le Travailleur , Louis Picavet est poursuivi à plusieurs reprises en justice. En juin 1913, il est notamment inculpé pour provocation de militaires à la désobéissance après la publication un article protestant contre le maintien de la classe 1910 sous les drapeaux. Avec Marcel Deschamps, rédacteur de l’article, il est acquitté .
Source(s) :L’Echo du Nord, 4 juin 1913.
-
PICQUET André
Né le 18 juillet 1880 à Douai, André Picquet, fils de Marie Joseph Evrard, 22 ans, célibataire, cuisinière à Douai, et de Jules Joachim Picquet, est reconnu par ses parents lors de leur mariage le 8 août 1884. Engagé volontaire au 3 e régiment de dragons le 14 mars 1899 pour quatre ans, il entame, lors de son retour à la vie civile, une longue carrière de journaliste au Journal de Douai dirigé par les frères Crépin. Mobilisé en août 1914, il est blessé au combat. Sa conduite lui vaut la médaille d’Orient et la croix de Guerre. Il est démobilisé en mars 1919. Domicilié à Juziers, il regagne Douai. Lors du lancement du Bonhomme du Nord en octobre 1919, il participe à la rédaction et est nommé quelques mois plus tard rédacteur en chef. En désaccord avec la nouvelle orientation du journal qui annonce, en février 1922, soutenir la Fédération de concentration républicaine, il le quitte. En 1923, il est directeur du Douai républicain . On retrouve ensuite sa signature en 1933 dans Le Beffroi de Douai, dans l’éphémère Douaisis , mais aussi dans Douai-sportif , Le Bonhomme sportif,… En 1934, il prend la direction du Journal de Douai , créé en 1882 par Lucien Crépin . Son expérience, «ses dons d’originalité, d’observation et de sens critique», comme on peut le lire dans ce journal lors de son retour, ne suffissent pas à relancer le vieux périodique. Le 28 juin 1935, André Picquet annonce la fin du Journal de Douai qui avait voulu, explique-t-il, «se refuser aux besognes de complaisance dont la fabrication en série ternit ordinairement les petites feuilles provinciales et les remplacer par une franchise honnête, loyale, équitable».
Parallèlement, André Picquet s’engage en politique. En 1925, il est élu conseiller municipal sur la liste du Cartel des gauches emmenée par Léon Escoffier et sur laquelle figure également le journaliste Maurice Monier. En 1929, il est à nouveau candidat sur la liste d’Union des gauches et d’unité ouvrière, mais il est battu.
André Picquet est l’auteur de deux ouvrages: Quelques souvenirs. Douai 1914 , paru en 1933 et Sigmates: bloc d’un infirmier, paru en 1946. Il était également officier d’Académie depuis le 27 août 1914, il meurt en 1947 à Juziers, dans l’actuel département des Yvelines, à l’âge de 67 ans.
Source(s) :AD Nord; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne, Op. cit.; Annuaire de la Presse 1923; Douai républicain, 12 mai 1929.
-
PIERRARD André
Journaliste, certes, André Pierrard fut aussi enseignant, résistant durant l’Occupation, homme politique, écrivain, historien…
Elève instituteur à l’école normale de Douai, André Pierrard devient naturellement instituteur d’abord à Roubaix où il adhère aux Jeunesses communistes. Après son service militaire, il est nommé à Maubeuge, en 1939, il est muté d’office à Saint-Jans-Cappel pour être resté membre du Parti communiste. En 1941, il est révoqué par le gouvernement de Vichy.
Contraint à la clandestinité, il entre dans la Résistance dans la Sambre et le Valenciennois, il est notamment cofondateur de l’organe du Front national Le Patriote valenciennois. Devenu responsable politique du PCF pour le Pas-de-Calais au printemps 1943, il est à l’origine, en décembre 1943, à la formation du Comité départemental de Libération du Pas-de-Calais. A la Libération, il est nommé rédacteur en chef du quotidien de la Fédération du Nord du Parti communiste, Liberté. Parallèlement, en 1945, il entame une carrière politique, il est élu adjoint au maire de Lille. Battu lors des élections aux assemblées constituantes des 21 octobre 1945 et 2 juin 1946, il fait, par contre, son entrée à l’Assemblée nationale en novembre 1946 et est élu conseiller municipal de Dunkerque en 1947. André Pierrard est un député particulièrement actif déposant de nombreux textes sur la marine, la presse, se montrant un défenseur actif de l’école laïque. En 1954, il entre au comité central du Parti communiste et abandonne son poste de rédacteur en chef à Liberté . En novembre 1958, lors des élections législatives qui connaissent une véritable vague gaulliste, il est battu dans la 11 e circonscription du Nord et réintègre l’enseignement. En 1968, André Pierrard prend ses distances avec la direction du Parti communiste. Il abandonne la politique pour l’écriture. Seul ou en collaboration, il est l’auteur de plusieurs ouvrages: Le Jeune Homme à rose qui raconte l’histoire des «maquis des corons», La Fugue flamande qui obtient en 1971 le prix du roman populiste, On l’appelait Tamlerlan, Mourir à 14 ans , La Belle Vie au pays noir , Denain, un crime signé Usinor , avec Michel Rousseau Eusebio Ferrari, avec Jean-Louis Chappat La Fusillade de Fourmies, premier mai 1991 , avec Serge Dillaz Alexandre et Bracke Desrousseaux , etc. En 1981, il participe à la création de l’association MEMOR, Mémoire de l’Occupation et de la Résistance en zone interdite dont il sera vice-président.
Le 8 mai 1991, à Lens, Charles Tillon, ancien commandant en chef des FTPF, lui remet la croix de chevalier de la Légion d’honneur. André Pierrard meurt à Cousolre dans l’Avesnois le 26 juin 1997.
Source(s) :MEMOR, André Pierrard, chevalier de la Légion d’honneur, Lens, le 8 mai 1991, Villeneuve d’Ascq, 1er, trimestre 1992.
-
PIOTEIXJean André
Jean André Pioteix naît le 6 octobre 1865 à Magnac-Laval en Haute-Vienne d’un père boulanger. Avant d’embrasser la carrière de journaliste, Pioteix a été commis-greffier à Brives, puis commis-voyageur en librairie à Aurillac. Au début des années 1890, il est embauché comme correcteur à La Croix du Cantal qu’il abandonne pour devenir correspondant du Progrès de Lyon à Macon. Un an plus tard, il lance, à Aurillac, Le Progrès du Cantal. Poursuivi pour chantage et diffamation, il est condamné à quatre mois de prison. Il quitte alors le Cantal, en laissant quelques dettes, pour le Nord de la France. En 1895, il est embauché comme reporter au Réveil du Nord. Selon la police, il ne fait pas de politique et «son seul désir est de gagner le plus d’argent possible».
En 1905, Jean André Pioteix quitte le journalisme pour devenir secrétaire général de la mairie de Liévin. Il meurt à Lille le 14 janvier 1925.
Source(s) :AD Nord.
-
PLANQUE André
Fils de Louis Joseph Planque, négociant, et d’Angélique Louise Durteste, André Désiré Marie Planque est né à Arras le 25 août 1845. Devenu imprimeur en décembre 1870 à la suite de l’établissement Rousseau-Leroy, il est directeur gérant du quotidien Le Pas-de-Calais créé en 1870 par un groupe de légitimistes arrageois. Il le dote, en 1873, d’une «petite» édition à cinq centimes qui n’a qu’une brève existence. En 1876, la Société en commandite Planque et Cie devient la Société anonyme du Pas-de-Calais présidée par le marquis de Tramecourt. Planque, qui a choisi de se battre avec les mêmes armes que «la petite presse républicaine, imprime et dirige à partir de janvier 1878 Le Pas-de-Calais hebdomadaire. Il intervient ainsi à plusieurs reprises lors de l’assemblée générale annuelle des comités catholiques du Nord et du Pas-de-Calais sur les problèmes de presse, plaidant pour l’introduction d’un roman-feuilleton et de la caricature dans les périodiques catholiques afin les rendre plus attrayants et attirer de nouveaux lecteurs. De ses presses sortent à partir de 1870 La Semaine religieuse du diocèse d’Arras, la Revue des sciences ecclésiastiques , de 1874 le Bulletin du Conseil général du département du Pas-de-Calais..
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 041/38; Le Courrier du Pas-de-Calais, n° 30168, 1er, et 2 janvier 1928; Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise. 1788-1940, op. cit.
-
PLUVINAGE Lucien
Ancien pupille de la nation, Lucien Pluvinage, après de solides études secondaires, avait opté pour l’Ecole nationale d’agronomie de Grignon d’où, après une spécialisation, il était sorti ingénieur en économie rurale. Parfait connaisseur du monde agricole, il était attiré par une autre vocation, la presse. Le 1er novembre 1935, il entrait à la rédaction lilloise de L’Echo du Nord. Mobilisé lors de la Seconde Guerre, il avait été fait prisonnier et s’était évadé. Le 4 septembre 1944, il participait à la sortie au grand jour de La Voix du Nord où il assumait bientôt les fonctions de chef du service économique. En 1948, il était nommé au bureau de Paris qu’il allait diriger tout en assurant pendant vingt-cinq ans la rubrique parlementaire. A ce titre, il avait été élu vice-président de l’Association de la presse parlementaire, puis syndic de la presse ministérielle.
Membre de plusieurs associations de Nordistes installés à Paris, Lucien Pluvinage avait été nommé vice-président des Rosati de France, puis sociétaire à vie. Il était titulaire de nombreuses décorations : il était notamment chevalier de la Légion d’honneur, commandeur dans l’ordre national du Mérite, chevalier du Mérite agricole, chevalier des Palmes académiques. Il avait pris sa retraite en avril 1976.
Source(s) :Source: La Voix du Nord, 16 septembre 1981.
-
POËTTE Charles
« Le Guetteur est l’œuvre de M. Poëtte : il est le fruit de son labeur incessant de près de 40 années », écrivait en Une le quotidien de Saint-Quentin au lendemain de la mort de celui qui avait été son imprimeur, son directeur et son rédacteur en chef depuis son renouveau en 1869. Dans cette première décennie des années 1900, à près de 80 ans, Charles Poëtte était ainsi l’un des doyens de la presse française.
Né à Holnon, dans l’arrondissement de Saint-Quentin, il appartenait à une famille modeste – son père était maçon – et fut d’abord ouvrier lithographe. Féru de lecture et élève des cours populaires, il fit partie des délégués que la Société académique de Saint-Quentin envoya à l’exposition universelle de 1867. De cette visite, il tira un rapport L’Instruction populaire à l’exposition universelle qui fut présenté à la Société académique. Républicain, il fut pendant quinze ans conseiller municipal de son village natal auquel il était très attaché.
Lorsqu’en 1869, les républicains libéraux de Saint-Quentin se dotèrent d’un journal, Le Guetteur de Saint-Quentin, c’est vers lui qu’ils se tournèrent pour l’administrer et diriger l’imprimerie. Membre de la commission municipale en 1870, Charles Poëtte fut emprisonné à la citadelle d’Amiens par les Prussiens. Il laissera d’ailleurs des Souvenirs de la guerre franco-allemande. Lors des élections municipales, il fut élu conseiller de Saint-Quentin, fonction qu’il assuma pendant seize ans. En 1882, il fut nommé directeur du journal et rédacteur en chef, à la suite du départ à la retraite d’Edmond Delière.
Charles Poëtte était un amoureux et un défenseur du Vermandois qu’il parcourait régulièrement.
Il est notamment l’auteur d’une volumineuse Histoire d’Holnon, des Bois d’Holnon, d’Attily et des environs, de Promenades autour de Saint-Quentin en onze volumes, d’un ouvrage sur l’Origine des noms des rues et places de la ville de Saint-Quentin, mais aussi de Beaurevoir, son ancien château-fort, Jeanne d’Arc, l’Escaut,…
Bien que républicain, Charles Poëtte n’acceptât aucune distinction des gouvernements de la République. Sa commune natale lui a consacré un mémorial.
Source(s) :Le Guetteur de Saint-Quentin et de l’Aisne, 31 août 1906.
-
POILVILAIN François
François Poilvilain est rédacteur au Mémorial de Lille pendant dix-huit mois. Le 1 er mars 1868, il devient rédacteur principal au Journal du Cateau , périodique qui soutient la politique du gouvernement.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/11.
-
POLVENT Elisée
Du séminaire au socialisme le plus dur. Né dans le Cambrésis, Elisée Polvent est, à partir de 1880, élève au petit séminaire de Cambrai qu’il quitte, en 1885, alors qu’il est élève en rhétorique. Ancien enfant de chœur, ancien membre de la congrégation des Saints-Anges et de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul, il va se montrer un adversaire acharné de L’Eglise et du clergé du diocèse.
Devenu publiciste, il travaille au bihebdomadaire Le Cambrésis où, selon la police, il se fait remarquer par ses articles contre l’Ancien-Régime. Après son service militaire au 1 er de Ligne, il est admis à la loge «Tolérance et liberté» de Cambrai. En 1887, il fonde à Valenciennes La Lorgnette , un «journal hebdomadaire et indépendant» dont le premier numéro sort le 3 juillet. Poursuivi, cet hebdomadaire satirique disparaît au bout de quelques numéros. La même année, Polvent publie un ouvrage d’histoire locale Clary et ses environs . En octobre 1891, il entre comme reporter au Réveil du Nord , après, semble-t-il, avoir sollicité un emploi au journal conservateur lillois La Dépêche . «Radical, selon la police, il devient socialiste puis révolutionnaire». Il connaît notamment son heure de gloire en juin 1892 en s’introduisant chez les jésuites de Mouvaux comme collaborateur d’un journal catholique. Le clergé ne se fait pas faute de dévoiler l’origine de l’instruction de Polvent. Il exerce ensuite les fonctions de secrétaire de rédaction. Pour des raisons de santé – «avoir moins de fatigue et enrayer la phtisie qui le mine depuis des années», selon la police – il quitte le Réveil du Nord le 1 er septembre 1895 pour le quotidien républicain Le Dunkerque fondé quelques mois plus tôt. Le 11 octobre 1892, pour défendre la «cause des ouvriers insuffisamment soutenue par le quotidien républicain», il lance Le Torpilleur. Organe socialiste de Dunkerque . Polvent connaît bien des déboires, il est notamment condamné pour diffamation. En février 1897, il est condamné en appel à un mois de prison 300 F d’amende et 2 000 F de dommages et intérêts pour diffamation envers Mme Chiroutre, femme du propriétaire du Nord maritime, à dix jours de prison et 300 F d’amende et 200 F de dommages et intérêts pour diffamation envers le gérant du même journal, en avril par le tribunal de Dunkerque à trois mois de prison, 1500 F d’amende et 6000 F de dommages et intérêts pour seize articles injurieux et diffamatoire envers un ancien notaire. Accusé de dissiper l’argent du Parti ouvrier, il est arrêté en plein congrès. Quelques jours avant d’être incarcéré, le 7 avril, il s’est fait rosser par le rédacteur en chef de L’Avenir de Dunkerque Tubert, au grand plaisir du Nord maritime qui ne manque pas de raconter l’anecdote. Le séjour en prison de Polvent met probablement fin à sa carrière de journaliste à Dunkerque. Le Réveil du Nord et Le Petit Calaisien refusent de soutenir Le Torpilleur qui devient «journal de potins et de cancans». Il vivote jusqu’en juin 1898 où Polvent, de retour à Dunkerque, ne peut qu’assister à la vente du matériel. Pendant la saison balnéaire, Polvent faisait paraître Le Petit Mousse . Revenu à Lille, il reprend sa place de rédacteur au Réveil du Nord et devient secrétaire général de la rédaction. La guerre le surprend dans la capitale des Flandres. Pendant l’Occupation, il entre au Service du ravitaillement des populations civiles, ce qui lui vaut plus tard la médaille d’or de la reconnaissance du gouvernement américain. En novembre 1918, il retrouve Le Réveil du Nord où il participe largement à la réorganisation des services rédactionnels. A partir de 1923, il prend en charge les rubriques «mutualiste» et «protection sociale». Son travail est récompensé, en 1929, par la médaille d’or de la mutualité, de la prévoyance et des assurances sociales. Parallèlement, Elisée Polvent se met au service de ses confrères au sein de l’Association professionnelle des journalistes du Nord dont il est syndic pendant plus de vingt ans. La retraite venue, le 1 er janvier 1930, il se retire dans son village natal de Bousies. En 1935, il y est élu conseiller municipal, puis premier adjoint. Il est également administrateur du Bureau de bienfaisance, de la Caisse des écoles et délégué cantonal. Autant de fonctions qui lui permettent d’accéder au grade de commandeur du mérite social. Maire depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, il meurt en janvier 1940. Il était l’oncle de Marcel Polvent, directeur des services du Réveil du Nord.
Source(s) :AD Nord 1T 222/10, M 154/172; Jean-Paul Visse, La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de L’Echo du Nord, Presses universitaires du Septentrion, 2004; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, «M. Elysée Polvent, promu commandeur du mérite social», «Mort de M. Elysée Polvent, doyen de notre rédaction», 15 janvier 1940.
-
PORRET Henri Désiré
Henri Porret est peut-être l’artiste le plus coté des graveurs de l’époque romantique. Il a commencé à travailler dans l’atelier de Blocquel à Lille, avant de monter à Paris. Il a illustré de très nombreux romans, tels Le Roi de Bohême et ses sept châteaux de Nodier , La Peau de chagrin de Balzac, Notre-Dame de Paris de Hugo, un Recueil d’illustrations typographiques gravées et polytypées par Porret, graveur en bois de l’Imprimerie royale (1840), etc. Essayer de citer tous les livres dont il a gravé les illustrations serait refaire en partie la bibliographie des ouvrages illustrés de 1830 à 1865, même s’il a signé des travaux exécutés par des ouvriers de son atelier. Il a gravé aussi bien des images pour amuser les enfants, des images publicitaires, que les grotesques de La Procession de Lille tels Phinaert , le tambour-major des Hurlus. Porret a aussi beaucoup travaillé pour la presse: il a gravé la vignette du Moulin-à – Vent et de nombreux autres journaux; citons La Mode , La Silhouette , L’Artiste , Bagatelle , L’Entracte , Vert-Vert , Le Figaro , Le Ménestrel , La Romance , L’Europe littéraire , La Revue des Deux-Mondes , L’artiste, Le Cabinet de lecture . Henri Porret a été médaillé aux expositions de Paris en 1833 et 1835, de Lille en 1834 et 1838. Un commentaire: «Porret, lui, est le premier qui ait gravé de jolis bois, obtenu un résultat artistique, et dégagé une nouvelle formule d’illustration pour le livre » (Béraldi, Henri. Les Graveurs du xix e siècle , XI, p. 24).
Source(s) :Verly, Hippolyte, Essai de biographie lilloise contemporaine1899-1869, Lille, Leleu, 1869; Le Moulin à vent, n° 11 (2 octobre 1842); quelques sites Web.
-
POUILLARD Pierre
Né en 1894 à Béthune, Pierre Pouillard, fils d’Olivier Pierre Joseph Pouillard, sculpteur, et d’Aline Roziau, est au sortir de ses études au lycée Faidherbe de Lille, où il est élève en Math spé, mobilisé comme caporal à la 7 e compagnie du 162 e RI. Il combat en Artois en 1915, participe à la défense de Verdun en 1916, à la défense de Reims en 1918. Il est blessé à plusieurs reprises. Ses états de service lui valent d’être cité à l’ordre de la IV e armée. Admis à Saint-Cyr en septembre 1916 et à l’Ecole spéciale militaire en 1919, il démissionne de l’armée en 1925. Marié le 3 novembre 1923 à Marie Albertine Logier, Pierre Pouillard entre dans le groupe de presse créé par son beau-père Jules Logier, devenant, sans titre bien défini, le bras droit du propriétaire du Petit Béthunois et du Journal de Lens , il est également libraire. En 1927, il fonde La Vie sportive du Nord, un supplément hebdomadaire du Petit Béthunois qui ne paraît que quelques mois. En décembre 1931, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Rappelé le 2 septembre 1939, il est fait prisonnier à Dunkerque en juin 1940 et est libéré le 16 août 1941 au titre d’ancien combattant. Il reprend sa place le 1 er janvier 1942 au Petit Béthunois qui reparaît depuis juillet 1940. Il le quitte en novembre 1942, après l’invasion de la zone libre par les Allemands. Parallèlement, il est président de la maison des prisonniers de Béthune.
Traduit devant la cour de justice le 5 décembre 1945, alors que le commissaire du gouvernement prononce un réquisitoire modéré, il est condamné à cinq ans de travaux forcés, à l’indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Cette condamnation suscite une certaine émotion notamment chez les anciens prisonniers. En mars 1946, la peine de travaux forcés est ramenée à deux ans de prison, puis Pierre Pouillard bénéficie d’une remise de peine de six mois en octobre 1946. Il est remis en liberté conditionnelle le 9 janvier 1947. Retiré à Marquette, dans la banlieue lilloise, il meurt le 11 mai 1951.
Source(s) :AD Nord, 7W 295; AD Pas-de-Calais, 3 E 119/123, 1R 8295; base Léonore, dossier de légionnaire.
-
POULAIN Jean-Baptiste
Premier propriétaire de L’Echo de la Lys qui commença à paraître tous les vendredis à partir du 6 octobre 1837, Jean-Baptiste Poulain avait fondé une imprimerie à Aire en 1835. Il géra le journal jusqu’à sa mort survenue en janvier 1855 dans sa soixante et unième année.
Polémiste redoutable,«d’une plume souvent agressive, il sut lancer son journal qu’il composait avec l’aide d’un rédacteur. Très critique à l’égard de tout, M. Poulain ne manquait jamais de placer une impertinente remarque lorsqu’il analysait la vie airoise. Il attaquait la religion, la municipalité et même certaines personnes qu’il n’hésitait pas à nommer.
Sans doute d’un tempérament violent, il alla jusqu’à vouloir se mesurer à coups de poing et de soufflets avec le directeur d’une revue adverse rencontré dans la rue en 1845.»
M. O.
Source(s) :Pierre Kerlévéo, «Une ville et son journal, Nouvelles chroniques locales», Revue historique et culturelle d’Aire-sur-la Lys et de sa région, n° 4, 1990, p21-22.
-
POULAIN Louis
Secrétaire de rédaction du Boulonnais, Louis Poulain meurt à l’âge de 32 ans le 25 juillet 1912 des suites d’une longue maladie.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 28 juillet 1912.
-
PRADOUX
Journaliste
Rédacteur en chef du Courrier du Pas-de-Calais en 1842 . Le 30 juillet 1842, il affronte en duel Pourchel, correspondant du Propagateur à Paris. Le duel tourne court à la suite de l’intervention de la police.
Source(s) :Le Propagateur du Pas-de-Calais, 1er, août 1842.
-
PREDHOM Roger
Entré à La Voix du Nord le 26 novembre 1944, Roger Predhom est journaliste à la rédaction lilloise de La Voix du Nord, chargé de la banlieue, puis au bureau de Seclin dès la création de celui-ci.
-
PRUVOST Rudolphe, dit Robert d’Artois
Entré à l’âge de 14 ans, en 1883, à l’imprimerie Schoutheer à Arras, Rudolphe Pruvost apprend le métier de typographe. Il passe ensuite à La Croix du Pas-de-Calais . Mobilisé dans l’artillerie lors de la déclaration de guerre, il est démobilisé le 18 février 1919. A partir du 29 janvier 1920, il signe, sous le nom de Robert d’Artois, sa première chronique dans le Beffroi d’Arras qui vient de prendre la succession du Lion d’Arras. Il y dénonce notamment les lenteurs de la reconstruction de la ville, les dangers de la circulation automobile et du progrès en général, il évoque avec nostalgie le vieil Arras. Pruvost est également le gérant de ce journal fondé par Eugène Guerrin. Après la disparition du Beffroi d’Arras, en novembre 1929, la chronique de Rudolphe Pruvost se poursuit dans Le Courrier du Pas-de-Calais. Il y collabore jusqu’en mai 1940. A la Libération, il continue sa carrière de publiciste à La Liberté du Pas-de-Calais où il donne sa dernière chronique les 2-3 décembre 1956. Le typographe publiciste, comme il se présente lui-même, aura publié plus de mille articles, libres propos et éditoriaux.
Rédacteur de la chanson des fêtes d’Arras, Rudolphe Pruvost reçoit en 1923 le premier prix du concours de la poésie patoisante et celui du concours de la prose patoisante attribués par les Rosati d’Artois.
Source(s) :Patrice Marcilloux, «Rudolphe Pruvost, alias Robert d’Artois, un sympathique, un laborieux, un modeste», in Stéphane Curveiller et Patrice Marcilloux, Regards sur l’histoire du Pas-de-Calais. Etudes en l’honneur d’Alain Nolibos, Artois Presse Université, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, 2003, p. 106-115.
-
PUEL Charles Auguste Anselme
Charles Puel fut, avec Henri Domelier, l’un des journalistes ardennais qui, en 1914, sollicités par les Allemands, refusèrent de participer à La Gazette des Ardennes, ce journal lancé à Charleville sous leur contrôle le 1 er novembre. Né à Aigues-Mortes dans le Gard en 1866 d’un père receveur-douanier, Charles Puel était journaliste au Petit Ardennais , quotidien radical-socialiste, fondé en 1880. Il n’avait pas quitté sa ville lors de l’arrivée des Allemands. Désormais en butte à leur hostilité, il chercha à gagner la France non occupée. En 1915, il s’enfuit par la Belgique et la Hollande, embarqua sur un bateau à Rotterdam qui, le lendemain de son départ, fut accosté par un sous-marin allemand. Découvert, Charles Puel fut ramené à Zeebrugge (Belgique) d’où il réussit à passer en Hollande. Gagnant l’Angleterre, il revint en France. Malgré son âge, il s’engagea dans le service sanitaire. Il ne reprit son métier de journaliste qu’après l’armistice. Sa bravoure et son engagement pour le pays ne furent reconnus qu’une dizaine d’années plus tard. En août 1928, il recevait la médaille des évadés avec citation et la croix de Guerre. L’homme était alors installé dans le Pas-de-Calais où il était rédacteur détaché à Béthune pour le quotidien Le Grand Echo depuis 1919. Il y resta jusqu’à sa retraite dans les années 1930. Regagnant les Ardennes où son épouse avait été longtemps institutrice puis directrice d’école, il s’installa à Bosseval. Journaliste au Petit Ardennais, Charles Puel avait lancé, à la fin du xix e siècle, une campagne pour aider un instituteur, devenu brasseur dans une petite ville des Ardennes, à supporter les frais d’un procès en révision. Injustement condamné en 1874 pour «crime d’incendie» par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle à 15 ans de travaux forcés, Jean-Baptiste Lefèvre avait fini par obtenir sa grâce au bout de sept ans, mais il voulait une révision de son procès. Charles Puel réussit notamment à mobiliser La Libre Pensée, la journaliste Séverine, le journal des instituteurs L’Ecole laïque… Lors de ses années passées au sein de la rédaction du Petit Ardennais, Charles Puel avait été vice-président de l’Association de la presse de l’Est. Ardent défenseur de la laïcité, il avait également éténommé officier de l’Instruction publique.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 27 août 1928 et 5 août 1941; Le Rappel, 5 mars 1899; Le, xixe, siècle, 21 octobre 1910; L’Homme libre, 23 décembre 1918; L’Indépendant rémois, 8 octobre 1906 et 9 juillet 1911 et différents numéros du Petit Ardennais.
Q
-
QUESTE André
Fils d’un père instrumentiste et professeur au conservatoire de Lille, André Charles Queste, après de brillantes études secondaires au lycée Faidherbe de Lille, préparait sa licence lorsque la Première Guerre éclata. Âgé de 17 ans, il quitta Lille pour gagner, après être passé par Dunkerque et Paris, la Tunisie et devint professeur à Sfax. De retour en France au bout d’un an, il s’engagea, mais en raison de son état de santé, il fut versé dans le service auxiliaire de l’artillerie coloniale. Parti en Indochine, il enseigna le latin et le français au lycée d’Hanoï, puis fut nommé chef du secrétariat de l’inspection académique. Après l’armistice, il reprit ses études, mais attiré par le journalisme, il quitta l’Université. Il entra d’abord au quotidien Le Progrès du Nord puis, en 1922, au Grand Echo du Nord. Sa grande culture et ses qualités professionnelles lui promettaient un bel avenir. Victime d’une pleurésie, il meurt à l’âge de 32 ans, le 3 août 1929. André Queste était l’auteur de deux ouvrages Germaine de Rouen et Des Influences astrales. Membre de l’Amicale des journalistes lillois, il avait été l’un des premiers membres de la section du Nord du Syndicat des journalistes.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 350 R 131 et 3 E 15460; Grand Echo du Nord, 4 août 1929 et 8 août 1929.
-
QUETTIER, Charles
Charles Quettier fit ses débuts de journaliste en 1867. Il n’avait donc pas vingt ans lorsqu’il rejoignit La Colonne de Boulogne , avant de passer au Libéral du Pas-de-Calais . Il travailla à La France du Nord sous la direction d’Edmond Maniez. Après la disparition de La Semaine théâtrale , journal dont il était le créateur, il revint à La France du Nord et en prit la rédaction en chef.
Conférencier, auteur, puis directeur du théâtre de Boulogne, il écrivit de nombreuses revues où il faisait défiler le tout Boulogne, aidé par son compère Ternisien, un autre journaliste boulonnais. Cela ne l’empêcha pas d’être élu brillamment au conseil municipal. Il fut président d’honneur de l’Association départementale des journalistes professionnels, fondée en 1914.
Source(s) :La Revue du Nord, 1893; Daniel Tintillier, La Presse boulonnaise : catalogue de l’exposition organisée par l’Association des journalistes du Pas-de-Calais, Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque municipale de Boulogne, 2009.,
W – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais R
-
RAMBAUD Pierre
 Le journalisme fut une vocation précoce pour Pierre Rambaud, enfant de Rethel dans les Ardennes où il est né le 18 septembre 1884. En effet, à 15 ans, encore lycéen, il envoyait déjà des articles au journal local dont, à l’en croire, l’un d’eux lui valut une belle polémique avec Urbain Gohier. Elève aux lycées de Reims, puis de Lille, Pierre Rambaud obtint d’abord une licence ès lettres en Sorbonne avant de devenir journaliste professionnel. A 21 ans, il entre au Démocrate vervinois dirigé par le député de l’Aisne Pascal Ceccaldi, puis en 1906, avec son ami Bujet, il fonde à Hirson La Gazette de la Thiérache dont il est rédacteur en chef jusqu’en 1909. A cette date, il arrive au Progrès du Nord à Lille comme rédacteur principal. En décembre 1910, il prend la direction de l’hebdomadaire L’Observateur d’Avesnes, succédant à Ségard, nommé directeur de La Gazette de Péronne. A moins de 30 ans, Pierre Rambaud abandonne le journalisme pour l’administration préfectorale. Il est en effet chef de cabinet du préfet des Landes lors de la déclaration de guerre le 2 août 1914. Mobilisé comme sergent, il est affecté dans des unités combattantes durant les quatre années du conflit qu’il termine avec le grade de lieutenant. Blessé, il est cité à l’ordre du régiment et reçoit la croix de Guerre. Démobilisé, Pierre Rambaud est ensuite nommé sous-préfet. Mis en disponibilité, il intègre les différents cabinets d’Edmond Lefebvre du Prey, ministre de 1920 à 1924. En 1921, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Pierre Rambaud meurt à Nice le 11 avril 1969.Source(s) :
Le journalisme fut une vocation précoce pour Pierre Rambaud, enfant de Rethel dans les Ardennes où il est né le 18 septembre 1884. En effet, à 15 ans, encore lycéen, il envoyait déjà des articles au journal local dont, à l’en croire, l’un d’eux lui valut une belle polémique avec Urbain Gohier. Elève aux lycées de Reims, puis de Lille, Pierre Rambaud obtint d’abord une licence ès lettres en Sorbonne avant de devenir journaliste professionnel. A 21 ans, il entre au Démocrate vervinois dirigé par le député de l’Aisne Pascal Ceccaldi, puis en 1906, avec son ami Bujet, il fonde à Hirson La Gazette de la Thiérache dont il est rédacteur en chef jusqu’en 1909. A cette date, il arrive au Progrès du Nord à Lille comme rédacteur principal. En décembre 1910, il prend la direction de l’hebdomadaire L’Observateur d’Avesnes, succédant à Ségard, nommé directeur de La Gazette de Péronne. A moins de 30 ans, Pierre Rambaud abandonne le journalisme pour l’administration préfectorale. Il est en effet chef de cabinet du préfet des Landes lors de la déclaration de guerre le 2 août 1914. Mobilisé comme sergent, il est affecté dans des unités combattantes durant les quatre années du conflit qu’il termine avec le grade de lieutenant. Blessé, il est cité à l’ordre du régiment et reçoit la croix de Guerre. Démobilisé, Pierre Rambaud est ensuite nommé sous-préfet. Mis en disponibilité, il intègre les différents cabinets d’Edmond Lefebvre du Prey, ministre de 1920 à 1924. En 1921, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Pierre Rambaud meurt à Nice le 11 avril 1969.Source(s) :AD Ardennes, 2E 362 76; AD Paris, 10 M 350; La Vie flamande illustrée, juin 1910; Site Léonore, dossier de légionnaire.
-
RAMETTE Gustave
Employé aux écritures, Gustave Ramette est en 1895 gérant de La Croix du Nord , de la Petite Chronique de La Croix du Nord et de La Croix flamande ( Het Vlamsch Huis ).
-
RAMON Edouard
Lorsqu’il prend la direction du Journal d’Armentières en août 1899, Edouard Frédéric Alexandre Ramon, né en 1843 dans la Marne, serait, selon la police, un ancien commis-voyageur en papier. Elle ne le croit guère « capable de diriger la rédaction d’un journal politique militant » et le pense arrivé « pour masquer la collaboration de M. Noilhau ».
Sous sa direction, Le Journal d’Armentières devient l’organe de la Ligue sociale et patriotique qui entend lutter contre le Bloc des gauches, vainqueur des élections de 1902, et les collectivistes.
Imprimeur, directeur-gérant, Edouard Ramon dirige et écrit dans Le Journal d’Armentières jusqu’à sa mort survenue, après une maladie de plusieurs années. le 28 janvier 1910. Son acte de décès ne retient comme profession que celle de libraire.
Source(s) :AD Nord, 3 E 14460 et 1 T 222/1; Le Grand Echo du Nord, 30 janvier 1910.
-
RASSEL
Lancé à Cambrai en février 1900 par le Parti ouvrier français à l’occasion des élections municipales, L’Avant-garde a pour rédacteur Julien Rassel . Agé de 48 ans, l’homme est déjà un militant socialiste de longue date. A ce titre, il a participé aux différents congrès du Parti ouvrier français (POF) depuis 1896. Ancien cocher dans la région lilloise, il est maintenant cabaretier à Escaudoeuvres dans le Cambrésis et défend les ouvriers du textile. Il s’est déjà présenté à divers scrutins sous l’étiquette socialiste: aux cantonales à Cambrai-Est en 1895, aux sénatoriales en 1897, aux législatives dans la 2 e circonscription de Cambrai en 1898 où il n’a été battu au second tour que de seize voix par Morcrette-Ledieu (10256 voix contre 10270).
En 1900, il est élu conseiller municipal d’opposition à Escaudoeuvres et sera reconduit en 1905. Lors des élections législatives suivantes, le POF, lors de son congrès fédéral du Cateau, lui préfère le maire de Caudry Fiévet, mais il passe outre et se présente. Il n’obtient cette fois que quelques centaines de voix. Cet échec ne l’empêche pas d’être délégué du département du Nord lors du congrès d’unité socialiste en 1905, l’un des deux candidats du Parti socialiste français, avec Gustave Delory, lors d’une élection sénatoriale partielle dans le Nord en 1906, d’être délégué de la fédération du Nord du Parti socialiste la même année et la suivante au congrès national.
Personnage pittoresque, parlant fort et haut, il avait été condamné en février 1898 à six jours de prison et 25 F d’amende pour injures et diffamation envers le directeur et les contre-maîtres d’un tissage du Cateau, et à 2 F d’amende en août 1902 Julien Rassel meurt en décembre 1907 à Escaudoeuvres.
Source(s) :AD Nord, 3 E 6708, 14 février 1900, plusieurs numéros du Grand Echo du Nord, et du Réveil du Nord.
-
RAVEL
Fondateur d’un cabinet de lectures politiques et littéraires rue du Curé-Saint-Étienne à Lille, Ravel lança L’Abeille patriote , le 1 er janvier 1790. Ce périodique (format in-4°, à deux colonnes, 4 pages par n°, abonnement 24 F par an) était imprimé par Lemmens, rue Neuve à Lille. Il revendit ce trihebdomadaire le 19 février 1790 qui fut transformé en quotidien, formule alors rare en France, sous le titre de L’Abeille patriote, ou feuille de tous les jours.
Source(s) :Arthur Dinaux, «Le premier journal quotidien du Nord», Archives historiques et littéraires du Nord de la France, volume 5.
-
REAL Pierre Auguste Maurice
Fils de Pierre Réal, professeur , et de Louise Suzanne Maraillac, Maurice Réal est né à Guîtres le 7 septembre 1873. Après sa licence en droit, il collabore à L’Indépendant rémois, dont la rédaction est alors dirigée par son père. En 1896, il entre à L’Echo du Nord comme secrétaire de rédaction, qu’il quitte rapidement pour Le Petit Parisien tout en continuant à tenir la chronique de politique étrangère dans le quotidien rémois sous le pseudonyme d’Edgard de Gensac . En décembre 1899, il est nommé directeur du quotidien La Dépêche d’Eure-et-Loir édité à Chartres . En 1903, il rejoint Paris où il est rédacteur parlementaire du quotidien bordelais La Petite Gironde, mais aussi du Petit Marseillais et du Lyon républicain. A plusieurs reprises, Maurice Réal est élu syndic de l’Association des journalistes parlementaires et de la Presse républicaine départementale à la Chambre des députés. Il est officier des palmes académiques et du Mérite agricole. En 1927, il est fait chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/12; L’Indépendant rémois, 11 décembre 1899; base Léonore, dossier de légionnaire.
-
REBOUX Alfred
La légende veut qu’Alfred Edmond Jean Reboux ait été associé très jeune au lancement du Journal de Roubaix, le 18 juin 1856 : « le premier journal fut tiré par Alfred Reboux, alors qu’il n’avait que huit ans. Lorsque tout fut prêt, au moment décisif, on amena l’enfant à l’atelier, un ouvrier le prit dans ses bras, et lui fit tirer le levier, après quoi, il retira lui-même la feuille imprimée et la remit à son père. » Le Journal de Roubaix a multiplié ses éditions et paraît quotidiennement depuis 1869. Les bureaux et le matériel ont été transportés au n°1 de la rue Nain. Alfred Reboux y écrit son premier article à l’âge de 18 ans. Lorsqu’il succède à son père, il a 24 ans et c’est lui qui va progressivement transformer la modeste imprimerie paternelle en une entreprise industrielle.
 Alfred Reboux fonde à Lille le journal La Dépêche en 1879 et Le Nouvelliste du Nord-Pas-de-Calais en 1882. Il fusionne dans ces journaux l’ancien Mémorial de Lille, et l’ancien Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais, dont il s’était rendu propriétaire. Puis ces journaux passent à une société lilloise en 1886. Il est propriétaire directeur du Journal de Roubaix, mais également du Courrier de Tourcoing et de la Gazette d’Armentières. Sa seconde femme qui lui succédera évoque ses projets et ses réalisations dans une conférence : « il avait rêvé de doter notre région d’organes destinés à défendre les idées de liberté et d’égalité qui étaient les siennes. […] C’est chez lui que s’initient des fondateurs de journaux comme l’abbé Trochu, directeur de L’Ouest Eclair. Il conçoit une vaste agence de presse réalisée après lui. » La profession lui rendra hommage en faisant de lui le président d’honneur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, lors de la création de cet organisme. Le formidable développement du Journal de Roubaix s’appuie sur des éléments bien précis: la modernisation de ses équipements, un grand réseau de distribution, une bonne agence de presse, une conception forte des devoirs du journaliste, et une forte imprégnation de la vie publique et politique.
Alfred Reboux fonde à Lille le journal La Dépêche en 1879 et Le Nouvelliste du Nord-Pas-de-Calais en 1882. Il fusionne dans ces journaux l’ancien Mémorial de Lille, et l’ancien Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais, dont il s’était rendu propriétaire. Puis ces journaux passent à une société lilloise en 1886. Il est propriétaire directeur du Journal de Roubaix, mais également du Courrier de Tourcoing et de la Gazette d’Armentières. Sa seconde femme qui lui succédera évoque ses projets et ses réalisations dans une conférence : « il avait rêvé de doter notre région d’organes destinés à défendre les idées de liberté et d’égalité qui étaient les siennes. […] C’est chez lui que s’initient des fondateurs de journaux comme l’abbé Trochu, directeur de L’Ouest Eclair. Il conçoit une vaste agence de presse réalisée après lui. » La profession lui rendra hommage en faisant de lui le président d’honneur de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, lors de la création de cet organisme. Le formidable développement du Journal de Roubaix s’appuie sur des éléments bien précis: la modernisation de ses équipements, un grand réseau de distribution, une bonne agence de presse, une conception forte des devoirs du journaliste, et une forte imprégnation de la vie publique et politique.La politique accapare bientôt Alfred Reboux : il se présente comme catholique, libéral et démocrate. Il est candidat au Conseil d’arrondissement en 1880, et il échoue de peu. A l’occasion des élections complémentaires des 16 et 23 avril 1882, il est élu avec un frère des Ecoles chrétiennes, et il entre au conseil municipal sous la mandature de Léon Allart. En 1884, il est réélu, cette fois-ci dans un conseil municipal majoritairement conservateur, sous la mandature de Julien Lagache. Les élections générales des 6 et 13 mai 1888 voient la fin de sa carrière politique, mais il poursuit le débat en se consacrant désormais à la direction de son journal.
Il y a chez Alfred Reboux une véritable conception du métier de journaliste : «Tout le secret de la réussite du Journal de Roubaix, c’est qu’il fait son métier et qu’il est honnête. Il fait son métier en donnant toutes les nouvelles, toutes les informations. Il est honnête, c’est-à-dire qu’il dit toujours la vérité aussi exactement que possible et sans parti-pris. En politique, il importe de combattre vigoureusement les principes, et de toujours respecter les hommes. » Cela n’empêchait pas Alfred Reboux d’être un éditorialiste mordant, un polémiste vigoureux. Ses collègues le lui reconnaissent volontiers : « Sans être batailleur, Monsieur Reboux acceptait volontiers la polémique. Il s’y montrait habile et courtois ; nous lui rendons volontiers cet hommage, nous qui avons rompu quelques lances avec lui. Son style avait de la précision, de l’élégance et une correction impeccable. Ses arguments empruntaient plus volontiers leur force au bon sens et à la raison qu’aux spéculations élevées et d’appareil scientifique. » Sa seconde femme faisait de lui un bel éloge : « Le voici avec ce caractère vif, emporté, indice d’une nature extrêmement sensible, qui s’assouplissait merveilleusement dans la polémique, afin d’opposer à l’adversaire non des épithètes, mais des arguments. » La maladie eut raison de cette énergie décuplée. Selon plusieurs témoignages, Alfred Reboux souffrait depuis de longues années d’artériosclérose. Son état s’aggrave subitement au début de l’année 1908 et il décède d’une crise de néphrite le 10 avril 1908.
Source(s) :Le Journal de Roubaix, 12 avril 1908; La Croix du Nord, 12 avril 1908; L’Echo du Nord, cité par le Journal de Roubaix, 13 avril 1908; Conférence donnée par Madame Reboux-Hottiaux à l’école de journalisme de l’Université catholique en mars 1930.
-
REBOUX Anne-Marie
cf. Hottiaux Anne-Marie
-
REBOUX Charles
Premier fils de Reboux-Leroy, marchand papetier, il a obtenu son brevet d’imprimeur lithographe le 18 août 1836. Rédacteur en chef de La Boussole , et il doit s’exiler en Belgique pour éviter la prison. Il se réfugie à Bruxelles et ne rentre en France qu’à la fin du règne de Louis-Philippe.
Source(s) :Journal de Roubaix, 13 juillet 1894.
-
REBOUX Edouard
Frère puîné de Reboux-Leroy, il s’associe un temps pour reprendre l’affaire paternelle avec son jeune frère cadet Jean Baptiste, puis fonde en 1848 avec les frères Bernard (Kolb et Henri) le journal La Liberté , qui deviendra La Vérité , puis le Mémorial de Lille .
Source(s) :Journal de Roubaix, 13 juillet 1894.
-
REBOUX Jean Baptiste Henri Joseph
Marie Anne Reboux-Hottiaux qui avait perdu sa fille Anne Marie pendant l’occupation allemande avait fondé tous ses espoirs sur son fils Jean. Il avait fait de brillantes études au collège Notre-Dame des Victoires à Roubaix. Il venait de terminer son service militaire quand elle l’appela à la tête de la rédaction du Journal de Roubaix où il commence à faire preuve d’un talent réel et reconnu. Ses éditoriaux, écrits en un style à la fois sobre et élégant, étaient très goûtés de ses lecteurs. Il relate les travaux de la session du Conseil de la Société des Nations en 1922 sous la forme de correspondances. Enfin il contribue au développement de la chronique sportive et du supplément illustré le Dimanche du Journal de Roubaix . Son avenir semblait tout tracé, mais au cours d’un voyage d’études à Tunis et à Carthage, en 1928, il succombe à une crise cardiaque, âgé de 26 ans.
Source(s) :Témoignage du Grand Hebdomadaire Illustré, cité dans le, Journal de Roubaix, du 8 janvier 1928.
-
REBOUX Jean Baptiste, dit Jean Reboux
. Directeur fondateur du Journal de Roubaix , Jean Baptiste Reboux est le plus jeune fils de Reboux-Leroy, lequel l’a engagé à s’adonner à l’art de la lithographie, dont le développement commençait en France. A peine âgé de seize ans, il se perfectionne donc en Belgique, en Hollande et en Allemagne, et devient un graveur et un dessinateur de talent. Il arrive à Roubaix, en 1835, où l’un de ses beaux frères, Charles Hennion, a ouvert le premier atelier de lithographie de la ville. C’est à Roubaix que Jean Reboux a son avenir. D’abord installé rue Saint-Georges, il reprend ensuite, au n° 7 rue du Vieil Abreuvoir, la succession du libraire Burlinchon. Puis en 1846, il obtient le brevet de son beau frère Charles Hennion, démissionnaire. Le voici donc imprimeur lithographe et libraire… Le coup d’Etat du 2 décembre 1851 entraîne l’exil d’un grand nombre des membres des comités républicains, parmi lesquels Victor Hugo. Toutes les stations frontières sont étroitement surveillées par la police qui dispose de nombreux signalements et exige des passeports. On sait à Paris les opinions indépendantes de la famille Reboux et il est fait appel au dévouement du fils des vieux légitimistes lillois. Il est alors convenu que les citoyens à qui on veut faire gagner la Belgique, viendront de Paris à Douai par le chemin de fer, qu’ils iront jusqu’à Roubaix à pied et que, munis d’une feuille portant un signe convenu, ils se présenteront chez M. Jean Reboux, qui les guidera au-delà de la frontière. A la fin de décembre 1851, et pendant les premiers mois de 1852, presque chaque soir, des suspects se présentent munis du signe convenu, et le royaliste quitte sa maison, ses affaires, et risque sa liberté et son avenir pour sauver de Cayenne ou de Lambessa ces républicains, ces socialistes qui sont reçus et hébergés à Mouscron, chez sa mère, Mme veuve Reboux-Leroy, la femme de celui dont les “libéraux” en 1832 avaient pillé la maison et conduit à l’exil le fils. De là, ils gagnent Bruxelles et l’Angleterre. La police impériale finit par se douter de quelque chose. Jean Reboux est surveillé de près et pendant toute la durée du régime, il est lui aussi un suspect. Jean Reboux sollicite l’autorisation de publier un journal d’expression politique. Après un refus faisant suite à sa demande du 20 juillet 1854, il est autorisé en mars 1856 à faire paraître une feuille littéraire et d’annonces, Le Journal de Roubaix . C’est donc au n° 20 de la rue Neuve que vint au monde ce journal, qui n’était à l’époque qu’une feuille modeste paraissant deux fois la semaine, le mercredi et le samedi. Ce n’est qu’en 1861 que Jean Reboux obtient l’autorisation de publier un journal d’expression politique, grâce à d’anciennes amitiés de son frère Charles, dont le ministre de l’Intérieur, Persigny. Jean Reboux reste cependant indépendant durant toute la période impériale.
Source(s) :Le Journal de Roubaix, du 13 juillet 1894.
-
REBOUX-LEROY Jean Baptiste
C’est en 1820 que Jean Baptiste Reboux-Leroy devient propriétaire du Journal du Département du Nord fondé à Douai par l’imprimeur Marlier le 28 décembre 1811. Après 1830, Le Journal du Département du Nord devient La Boussole et reste légitimiste, malgré l’arrivée au pouvoir de Louis-Philippe. Après avoir vu ses locaux pillés et incendiés lors des émeutes de 1832, le journal subit les poursuites des tribunaux de Louis-Philippe, occupés à réprimer le mouvement légitimiste.
Source(s) :Journal de Roubaix, 13 juillet 1894.
-
REGNIER DE LA MALENNE Eugène
Après avoir dirigé un journal à Quimper, Eugène Régnier de La Malenne travaille au quotidien parisien Le xix e Siècle . Il arrive à Arras en 1880 pour diriger la rédaction de L’Avenir du Pas-de-Calais qu’il quitte en 1883.
Source(s) :AD Pas-de-Calais 10J 22, lettre du commissaire d’Arras au maire de la ville, 5 mars 1881.
-
RENARD F.
F. Renard est rédacteur en chef du journal La Vraie France du 26 octobre 1872 à septembre 1874.
Source(s) :René Choquet, La Vraie France, journal royaliste, légitimiste et catholique lillois, mémoire de maîtrise, Université de Lille III, 1994.
-
RICHARD Amaury
Ancien combattant de la Première Guerre mondiale dont il sort avec le grade de capitaine, deux fois blessé, Amaury Richard est président des poilus de l’arrondissement de Douai. A ce titre, il est rédacteur en chef du Poilu qui paraît jusqu’en avril 1920. Cette année-là, en novembre, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Président du Sporting club de Douai, il est par la suite cofondateur et rédacteur en chef du Douai sportif qui paraît de 1926 à 1933. Après la Seconde Guerre, il reste un acteur important du sport douaisien. En 1935, il avait été nommé officier d’Académie, la même année, il avait été élu conseiller municipal sur la liste d’Union républicaine conduite par Godin.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 178 R 021; site Léonore, dossier de légionnaire; Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017.
-
RICHARD-FREMAUX Charles
Imprimeur à Béthune, Charles Léon Etienne Richard devient, en 1902, directeur de La Revue artésienne qui, en 1832, a pris la suite des Petites Affiches de la ville de Béthune fondées en 1824 par Desavary. En 1902, il crée Le Journal de La Bassée qui emprunte une grande partie de son contenu à cette Revue artésienne . Richard est membre du Syndicat des commerçants de Béthune. Lors des élections municipales de 1904, il est candidat sur la liste de l’Union républicaine libérale et populaire qui n’eut aucun élu. Le 7 octobre 1905, il cède la propriété de La Revue artésienne à Marmet. Pourtant dans son édition du 5 octobre 1914, La Gazette de Béthune le présente toujours comme directeur de cet hebdomadaire, devenu depuis la propriété de Jules Logier. Imprimeur de plusieurs revues, il est également à partir de 1910 gérant de L’Union commerciale . Mobilisé en 1914 au 6 e régiment d’infanterie territoriale, Charles Richard a été tué dès les premières semaines de la guerre.
Source(s) :La Revue artésienne, La Gazette de Béthune; site Mémoire des hommes.
-
RICHE Jean-Marie
Après avoir été interprète pour l’armée américaine en 1944, puis lieutenant aux services de renseignements français, Jean-Marie Riche commence sa carrière de journaliste en 1945 à La Vie des transports. En 1950, il rejoint Combat où il est chargé de la rubrique « transports ». Il travaille ensuite au quotidien sportif L’Équipe.
En 1960, il se consacre au journalisme aéronautique en collaborant aux magazines Aviation magazine et Les Ailes. En 1963, il fonde Air et cosmos, dont il est directeur de la rédaction jusqu’en 1993. Il a également publié des chroniques dans Jours de France. Avec trois collègues, il avait fondé l’Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace.
Résistant durant l’Occupation, il était officier de la Légion d’honneur, titulaire de la médaille des services volontaires dans la France libre, de la Croix du combattant volontaire 1939-1945. Il était également Officer of the Order of the British Empire.
Source(s) :https://france3-regions.franceinfo.fr/hauts-de-france/aisne/
-
ROBERT Georges
Lorsqu’il arrive dans le Nord, Georges Robert a déjà un long passé de journaliste. Bachelier ès Lettres, il a débuté dans la carrière à L’Union libérale de Tours. Puis quittant sa ville natale, il est en effet passé par La Charente à Angoulême, Le Progrès à Limoges, Le Patriote d’Angers et L’Avenir de l’Orne à Alençon. Il a aussi collaboré à L’Estafette, quotidien édité à Paris . Dans le Nord, il travaille d’abord au quotidien Le Petit Nord des frères Simon, les fils de l’ancien président du Conseil Jules Simon. Le 1 er décembre 1891, il succède à Claude Cazes comme rédacteur en chef du Progrès du Nord , lorsque ce dernier prend la rédaction en chef du Réveil du Nord . Bien qu’habitant Paris dans les dernières années de sa vie, il occupe ces fonctions au jusqu’à sa mort en mai 1913. Membre du comité du Parti radical et radical-socialiste, c’était, selon la police, un ancien ami de l’avocat communard Protot. Il était vice-président de l’Association de la presse républicaine départementale qui avait tenu ses premières assises en province, à Lille, en octobre 1911. Il faisait également partie de l’Association des journalistes français et de l’Association professionnelle des journalistes du Nord. Georges Robert était également chevalier de la Légion d’honneur depuis 1895.
Source(s) :AD Nord, 1er septembre 1895; Le Grand Echo, jeudi 12 octobre 1911 et 20 mai 1913.
-
ROBICHEZ Léon
Recruté pendant l’Occupation, «sur recommandation de résistants démocrates-chrétiens», selon l’historien André Caudron, comme employé au service contentieux du Journal de Roubaix , Léon Robichez fut chargé, par le directeur du journal, de préparer clandestinement un quotidien qui sortirait dès la Libération. L’homme venait d’être rapatrié alors qu’après avoir été mobilisé dès la déclaration de guerre, il était prisonnier. En captivité, il avait réussi à former un groupe de résistants dans son camp. Le Journal de Roubaix n’est pas un univers inconnu pour lui. Licencié en droit depuis 1934, il y avait été embauché en 1937 comme employé d’administration. Parallèlement, il militait dans divers mouvements d’action catholique. Roubaix libérée le 2 septembre 1944, Léon Robichez devient à 33 ans le premier rédacteur en chef et directeur politique de Nord Eclair installé dans les locaux du Journal de Roubaix interdit de parution. Chaque jour, il va ainsi signer un billet où il prône notamment un travaillisme à la française. Avec treize éditions, le quotidien roubaisien couvre l’ensemble du département du Nord, les arrondissements d’Arras, de Béthune, de Boulogne-sur-Mer et de Calais, mais aussi une partie des provinces belges du Hainaut et de la Flandre occidentale. Dès avril 1945, Léon Robichez est élu, sous les couleurs du MRP, maire de Marcq-en-Bar œ ul où il s’allie avec les socialistes, puis quelques semaines plus tard conseiller général du canton de Tourcoing-sud. Cependant personnalité contestée au sein du MRP, en 1952, il n’est pas réélu au bureau de la fédération du Nord. Au sein du journal, certains n’hésitent plus à dénoncer son «caractère difficile», les frictions avec l’éditorialiste Pierre Garcette sont de plus en plus fréquentes, le tirage est tombé de 120000 exemplaires en 1948 à 75000 en 1952, enfin le propriétaire du Journal de Roubaix avec qui les relations sont difficiles a fait son retour à Nord Eclair . En juin 1952, Léon Robichez quitte le journal. En 1954 il devient directeur de la Société nationale d’éditions artistiques et d’héliogravure, propriété de La Voix du Nord qui vient de lancer un magazine illustré Semaine du Nord. Par la suite, il quitte la presse et devient inspecteur d’une compagnie d’assurances.
Source(s) :André Caudron, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, tome 4, Lille-Flandre, Beauchesne et Université de Lille 3, 1990; Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts de France. Les Quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021.
-
ROBICHEZ Louis
Fils d’un marchand d’huile d’Aire-sur-la-Lys, Louis Robichez participa à la fondation du Télégramme de Boulogne . En 1895, il entra au Journal de Roubaix où rédacteur principal, il signait sous son nom ou sous les pseudonymes de Maurice Aubert et de Louis Dartois. En premières noces, Louis Robichez avait épousé Adèle Hottiaux, sœur d’Anne-Marie Hottiaux, femme du propriétaire du quotidien roubaisien qu’elle dirigea de 1908 à 1934. En «semi-retraite», Louis Robichez ne cessa sa participation au Journal de Roubaix qu’en juillet 1941. A la Libération, il n’en fut pas moins condamné à 1000 F d’amende et cinq ans de dégradation nationale pour les éditoriaux qu’il fit paraître pendant l’Occupation. Louis Robichez fonda également le périodique Nord Textile qu’il dirigea jusqu’à la veille de la Seconde Guerre. Il fut également l’un des pionniers de l’Association professionnelle des journalistes du Nord.
Source(s) :AD Pas-de-Calais 10T 24.
-
ROCH Maurice
Fils de Julien Camille Roch, agent voyer à Cambrai, et d’Eugénie Marie Leleu, Maurice Roch est un sportif accompli lorsqu’il devient journaliste sportif au Réveil du Nord au milieu des années 1930 . Il a notamment pratiqué le football à l’Athlétique Club de Cambrai et à l’Olympique lillois. Rédacteur au quotidien socialiste, il l’est également à son supplément Les Sports du Nord et collabore à Radio PTT Nord, tout en restant très engagé dans le milieu associatif. Trésorier de la Société des voyageurs et employés de commerce de Lille, président de la section de Saint-André du même groupement, il est président du Football Club de Marquette, délégué de la Ligue du Nord de football, animateur de l’ U nion vélocipédique de France, etc. Autant de fonctions qui ne l’empêchent pas de se mettre au service de ses confrères, puisqu’il est également trésorier de la section du Nord-Pas-de-Calais du SNJ, chacun appréciant, comme l’écrit le quotidien catholique La Croix du Nord , «ses qualités de cœur et d’organisation, mais aussi son inlassable dévouement aux petits clubs amateurs». Durant la Seconde Guerre, Maurice Roch est directeur adjoint du ravitaillement à Poitiers. Organisant notamment le ravitaillement des résistants et maquisards, il est arrêté et déporté à Buchenwald. Après la guerre, il est nommé chef du service des sports du quotidien socialiste Nord-Matin et collabore à Radio-Lille, il assure notamment les reportages sportifs dans l’émission dominicale «Sports et musique». Son activité débordante est récompensée par plusieurs distinctions. En 1936, il reçoit la médaille d’or de l’Education physique, en 1939 celle de la fédération française de football. En 1937, il est fait chevalier du Mérite social et en 1951 chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.
Source(s) :La Croix du Nord, 17 novembre 1936, 28 août 1937, 13 février 1951; L’Egalité de Roubaix-Tourcoing, 23 juin 1939.
-
RODET Augustin André
Augustin Rodet est rédacteur au Grand Echo du Nord , spécialiste des faits divers, pendant une dizaine d’années. Durant cette période, il assure la correspondance pour le journal L’Echo de Paris. En 1933, il passe au Pilote de la Somme , journal édité à Abbeville depuis 1863. Il devient correspondant du quotidien Paris Soir pour la Somme
Source(s) :AD Nord, M149/142.
-
ROGER Marcel
Diplômé de l’enseignement secondaire, Marcel Roger est d’abord voyageur de commerce. Il devient secrétaire de rédaction d’un «journal de sports et d’élevage», L’Union normande. Il entre à L’Echo du Nord en mars 1897 où il remplace Louis Roselle, nommé rédacteur en chef du Mémorial artésien .
Source(s) :AD Nord, 1T 222/12.
-
ROSAY Adolphe
En 1895, Adolphe Rosay est rédacteur à L’Indépendant de Douai. Ce célibataire, né à Paris le 14 juillet 1837, y est arrivé il y a quatre ans et s’occupe de la rubrique locale. Il fournit également quelques articles littéraires et scientifiques à des journaux parisiens. Il vit chichement et doit compter sur sa mère, domiciliée à Paris, pour satisfaire son goût des voyages, car, comme le note le commissaire de police, «presque tous les dimanches, il s’absente de Douai pour faire des excursions de côté et d’autre.» Toujours, selon la police, il n’est «pas fort communicatif» et «n’a jamais manifesté ses opinions politiques personnelles». Cependant, il est très instruit et se conduit bien.
Source(s) :AD Nord, rapport du commissaire de police daté du 21 octobre 1895, 1T 222/6.
-
ROSELLE Louis
Fils d’un instituteur public devenu secrétaire de mairie à Anzin, Louis Roselle fut lui-même instituteur, affecté après son CAP dans le quartier Saint-Maurice à Lille. «Ayant connu quelques ennuis», selon l’expression de la police, il quitte l’enseignement à l’issue de l’engagement décennal que doit effectuer tout normalien. Il hésite entre la police et le journalisme. En mai 1895, il entre à L’Echo du Nord d’abord comme reporter. S’il est un moment tenté par Le Réveil du Nord , il connaît une ascension rapide au sein du journal de Gustave Dubar où il est nommé chef des informations locales et régionales. Cela ne l’empêche pas de quitter le quotidien lillois pour devenir, le 1 er avril 1897, rédacteur en chef du Mémorial artésien qu’il quitte dès l’année suivante. Louis Roselle choisit une nouvelle voie, il devient inspecteur à la Compagnie des asphaltes de Paris. Selon la police, il «passe pour un bon garçon, est d’un commerce agréable et d’aspect sympathique», mais célibataire «il est très noceur». En janvier 1907, il est nommé officier d’Académie.
Source(s) :AD Nord, M 157/7; Le Grand Echo du Nord, 1er avril 1907.
-
ROSNY Paul
Paul Rosny succède à Ernest Delloye à la tête de la rédaction de L’Emancipateur de Cambrai en 1896.
-
ROUSTAN Jean-Henry
Jean-Henry Roustan est en 1895 rédacteur en chef du quotidien cambrésien Le Libéral qu’il quitte en mars 1898 pour le nouvel hebdomadaire Le Démocrate du Cambrésis , propriété de l’imprimeur Alfred Brunnel.
Source(s) :AD Nord, dossier, Le Démocrate du Cambrésis.
-
ROVEL Jean
Jean Rovel fut d’abord journaliste au Grand Echo du Nord. A la Libération, il passe à La Voix du Nord .
-
ROVEL Pierre Jules
Fils de Constant Rovel, receveur des domaines, et de Hortense Léopoldine Adélaïde Didion, Pierre Rovel obtient son doctorat en droit à la faculté de Lille en mai 1899 alors qu’il collabore à la presse lilloise depuis 1891. Le 11 mai 1904, il entre comme rédacteur au quotidien conservateur La Dépêche où il passe par différents services. Il quitte le journal dirigé par Henri Langlais le 30 novembre 1934. Correspondant régional du Temps depuis avril 1930, il le reste jusqu’en mai 1940 où l’Occupation allemande le réduit à l’inactivité. Dès sa parution en décembre 1944, Le Monde le choisit comme correspondant pour le Nord-Pas-de-Calais . Dans le même temps, il est chroniqueur judiciaire à La Voix du Nord. Chevalier du mérite social, officier d’Académie, médaille d’argent du Travail, Pierre Rovel était chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 053 R 013; site Léonore, dossier de légionnaire; La Croix du Nord, 17 février 1952.
-
RUCKEBUSCH Michel
Né en 1909 dans une famille d’agriculteurs de Flandre à Godewaersvelde, Michel Ruckebusch fait ses études au petit séminaire d’Hazebrouck en 1920, les poursuit au grand séminaire de Merville puis de Lille. Il est ordonné prêtre en 1934. De 1934 à 1943, il est à la fois professeur et élève car il enseigne au collège Saint-Jude d’Armentières et donne des cours de mécanique agricole à Hazebrouck alors qu’il suit les cours de l’école d’agriculture de Genech et de l’école des Sciences sociales aux facultés catholiques de Lille. Désigné pour les Œuvres agricoles, il a servi les associations agricoles et a œuvré pour l’enseignement professionnel agricole. Il a lancé la JAC dans le secteur d’Armentières, donné des conférences sur l’agriculture en hiver, préparé des cours postscolaires agricoles par correspondance et tenu une chronique dans L’Echo des Syndicats . Fait prisonnier, libéré en 1941, il est appelé par le chanoine Outters à l’ARN pour le seconder. A la mort du chanoine Outters en 1944, il est nommé directeur des Œuvres agricoles du diocèse de Lille, secrétaire général du conseil d’administration de la FSAN (Fédération des syndicats agricoles du Nord) et président du comité directeur du journal Le Syndicat agricole dont il fut le fondateur. Pendant 40 ans, il fut le directeur et le rédacteur de ce journal où il écrit des éditoriaux signés Ruckebusch ou du pseudonyme de Jean Delater. Fait chanoine honoraire par le cardinal Liénart en 1948, devenu directeur de la Fédération agricole, il fut aussi président de l’Union nationale de l’enseignement agricole privé.
Source(s) :Archives diocésaines d’Arras; Le Syndicat agricole, 27 janvier 1984; M. Ennuyer, R. Jonard, «L’abbé Michel Ruckebusch. Au service du monde paysan de 1934 à 1984», Lille, SPLARN, 1994, 388 p.
-
RY Henri Albert
Journaliste à La Croix du Nord , Albert Ry est emmené comme otage de représailles le 6 janvier 1918 au camp de Mileygany (Lituanie). Transféré à Roon le 15 mars 1918, y est demeuré jusqu’au 8 octobre 1918.
Source(s) :AD Nord, M 147/98.,
T – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais S
-
SAFFRE André
Fils d’Aloïse François Saffre, préposé des douanes, et de Louise Julie Cappoen, André Jules Joseph Saffre est né le 30 avril 1900 à Cassel. La famille s’installe ensuite à Roubaix où le père exerce le métier de concierge. André Saffre entre comme rédacteur à La Croix du Nord où il exerce successivement à Valenciennes et à Lille. A la rédaction lilloise, il suit particulièrement les affaires familiales et tout ce qui concerne l’agriculture. La Croix du Nord ayant suspendu sa parution en mai 1940, André Saffre ne reprend son métier de journaliste qu’au lendemain de la Libération. Très vite, il quitte le quotidien lillois, il est notamment nommé rédacteur en chef du Courrier des Flandres , hebdomadaire édité à Hazebrouck du 27 août 1955 au 22 septembre 1956. Il rejoint ensuite le quotidien dunkerquois Le Nouveau Nord qui disparaît le 31décembre 1959 . André Saffre est très engagé dans sa commune d’adoption, Lambersart, où il est élu conseiller municipal sur la liste d’Union communale et d’action républicaine et sociale. Il est également président du comité paroissial de la cité familiale de la commune. Ses activités professionnelles et associatives lui valent d’être promu officier du Mérite agricole et de recevoir la médaille d’or de la Ligue républicaine du bien public. Sur le plan professionnel, il était membre du bureau de l’Association professionnelle des journalistes du Nord.
Source(s) :AD Nord, M149/142, 3 E 5479, 1 Mi EC 135 R003; divers numéros de, La Croix du Nord.
-
SAILLARD Eugène
Après avoir obtenu son baccalauréat au lycée de Bayeux, Eugène Saillard, fils de Léon Saillard et de Marie Bourson, devient maître de français dans une école privée anglaise à Richmond. Rentré en France, il est embauché comme rédacteur à La Gazette de l’Oise à Compiègne où il travaille pendant quinze mois avant de gagner La Gazette de Saint-Lô. A l’issue de son service militaire au 89 e RI à Sens, il est rédacteur au Petit Courrier d’Angers pendant quelques mois puis à La République de la Sarthe pendant quatre ans. Il est nommé ensuite rédacteur en chef au Petit Manceau à l’âge de 26 ans. Mobilisé d’août 1914 au 31 décembre 1918 dans l’Infanterie territoriale, il termine la guerre comme caporal et reçoit la croix de Guerre. Il devient alors rédacteur en chef au journal L ’Union républicaine à Epinal, ville qu’il quitte en octobre 1920 pour Lille. D’abord rédacteur au Télégramme du Nord, il passe au Grand Echo du Nord où il est nommé rapidement secrétaire général de la rédaction. Parallèlement, il assume la rubrique littéraire dans le quotidien nordiste. En décembre 1934, il est fait chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. En janvier 1940, succédant à Emile Ferré, il devient rédacteur en chef, poste qu’il occupe jusqu’à son congédiement, en août 1944, par Charles Tardieu, nommé commissaire-administrateur par l’occupant. Collaborateur de La Revue contemporaine, Eugène Saillard est l’auteur de plusieurs romans dont le premier, La Forge, après des Contes normands en 1908, est publié à la veille de la Première Guerre. Il donne ensuite Les Beaux Yeux de nuit, Ninon châtelaine, La Cruelle Chanson, La Corsaire blonde, Montgaillard… En 1930, Les Quatre Sourires, d’abord publié en feuilleton dans Comœdia, lui vaut le prix de l’humour. A la Libération, accusé d’être l’auteur d’éditoriaux non signés durant l’Occupation, portant le chiffre du Grand Echo, il est interdit d’exercer. Le 9 septembre 1945, il se suicide sur la tombe de sa femme, morte cinq ans plus tôt.
Source(s) :AD Nord, 9W 513, pièce 75; Le Grand Echo du Nord, 30 décembre 1934; Comœdia, 20 juin 1930.
-
SAINSAUX Jean
Originaire du Nord, Jean Sainsaux est secrétaire de rédaction, En 1919, lors du lancement du Télégramme du Nord , il en dirige le service d’informations générales installé à Paris.
Source(s) :Le Télégramme du Nord, 21 septembre 1919.
-
SAIRAISON Raoul
Fils d’Adrien Raoul Ruppert Sairaison, conducteur de travaux aux Ponts-et-chaussées, et de Zélie Marie Dayez, sans profession, Raoul André Ernest Joachim Sairaison naît le 10 décembre 1899 à Valenciennes. Après des études secondaires au collège de Valenciennes et au collège Mariette à Boulogne-sur-Mer, il est étudiant en droit à Lille. En janvier 1918, il s’engage dans l’armée qu’il quitte en janvier 1921. Sa conduite pendant les derniers mois de la guerre lui vaut la médaille de la Victoire et la médaille commémorative de la Grande Guerre. De retour à la vie civile, il est d’abord employé à la Compagnie des chemins de fer du Nord, il travaille ensuite dans une imprimerie puis dans la banque. Il commence sa carrière de journaliste au périodique communiste L’Enchaîné . En 1928, il se présente d’ailleurs aux élections législatives dans la circonscription d’Avesnes sous l’étiquette communiste. En 1929, il entre au Progrès du Nord. Lorsque ce journal cesse sa parution, en 1932, il rejoint Le Grand Echo du Nord de la France comme correcteur. L’année suivante, il passe à la rédaction en qualité de secrétaire de rédaction aux informations générales. Mobilisé en janvier 1940, il est fait prisonnier à Dunkerque en juin. Envoyé en Allemagne, il est libéré en avril 1941. De retour à Lille, il reprend sa place au Grand Echo d’abord comme fait-diversier, puis, à partir de septembre, comme secrétaire de rédaction aux informations régionales. Durant l’Occupation, Raoul Sairaison fait parvenir aux services de renseignements alliés les informations militaires qui ont pu lui être procurées par des collègues lors de leurs déplacements, mais aussi en utilisant les fiches d’expédition du journal allemand Wacht am Kanal destiné aux troupes d’occupation et imprimé au Grand Echo . Il affirme,lors du procès de la société éditrice du journal, avoir appartenu au Mouvement de libération nationale. A la Libération, il reprend sa place à La Voix du Nord où il devient chef du service de informations générales. En 1948, il exerce brièvement, après la démission Léon Chadé, directeur de la rédaction, les fonctions de rédacteur en chef. En 1953, il fonde le journal Nord-Presse qui ne paraît que quelques semaines. Il quitte la région du Nord pour la Dordogne où il meurt le 3 février 1962.
Source(s) :AD Nord, 9 W 261, 1 Mi EC 606 R 015, 1R 3483.
-
SALEMBIER Henri
Henri Salembier, ancien chargé de publicité au journal Nord Eclair , est décédé à l’âge de 98 ans. «Jovial et courageux, c’était un chrétien généreux et fervent qui tout au long de sa vie a témoigné d’une volonté et d’une générosité exemplaire», dit de lui à cette occasion Nord Eclair . Orphelin de père tué à la bataille de Verdun, il est amené à travailler très tôt : dès 14 ans au Journal de Roubaix . «Ce fut le commencement d’une longue carrière (50 ans!) dans ce quotidien devenu à la fin de la guerre le journal Nord Eclair , qu’il quitta en 1974». Sportif accompli, il joua au football à l’Excelsior et au CORT et il a pratiqué jusqu’à 80 ans passés la natation.
Source(s) :Nord Eclair, 10 octobre 2008.
-
SALIGNON Albert
Fils de François Eugène Salignon, comptable, et de Cordule Schepens, Albert Jean Joseph Salignon naît le 19 mai 1880 à Dunkerque. Il est d’abord secrétaire gérant puis journaliste au Nord maritime . En 1924, il est nommé chef du bureau dunkerquois du Grand Echo du Nord , poste qu’il occupe jusqu’à l’invasion en mai 1940. A la Libération, il ouvre l’agence dunkerquoise de La Voix du Nord dont il est responsable jusqu’à sa retraite. Pendant plus d’une quinzaine d’années, Albert Salignon fut président du groupement amical des journalistes professionnels de Dunkerque, il appartenait également à l’Association professionnelle des journalistes du Nord. Auteur de revues, Albert Salignon était membre de la Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie. Il meurt le 1 er décembre 1961 à Malo-les-Bains.
-
SALIGNON Guy
Fils d’Albert Salignon, journaliste au Grand Echo, et d’Ernestine Antoinette Marie Renou, Guy Salignon fut journaliste à Télé Lille de 1958 à 1961. Il anime notamment le «Magazine du journal télévisé», diffusé le samedi. Il est ensuite correspondant pour Europe 1 sur la Côte d’Azur. Il meurt le 4 avril 1982 à Antibes, à l’âge de 57 ans. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont, en 1980, La Mafia des casinos.
-
SALIGNON Marcel
Frère cadet d’Albert Salignon, Marcel Jean Salignon exerce d’abord la profession de clerc de notaire à Dunkerque. Mobilisé en 1914 au 110 e RI, il sort du conflit avec le grade de capitaine et titulaire de la croix de Guerre 1914-1918. En février 1920, il se marie à Tourcoing avec Marie-Louise Jung, il est alors gérant. La même année, il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Quelques années plus tard, il opte pour le journalisme et devient rédacteur au bureau tourquennois du Journal de Roubaix. Capitaine de réserve, Marcel Salignon est vice-président de la section Tourcoing-centre des anciens combattants , secrétaire du cercle des officiers français de Tourcoing et secrétaire du comité local de la Légion d’honneur. Très impliqué dans la vie de sa ville d’adoption, il est également secrétaire des Amis de Tourcoing, de la Société d’horticulture de Tourcoing. A la Libération, il passe du Journal de Roubaix à Nord Eclair qui lui succède. En mars 1956, Marcel Salignon est promu officier de la Légion d’honneur. L’âge de la retraite venu, il se retire à Rosendaël, devenu un quartier de Dunkerque, où il meurt le 21 juillet 1977.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi 404 R 003, 3E 16236; différents numéros du Journal de Roubaix.
-
SALIVES Jean, dit Claude Le Maguet
Fils d’un receveur des contributions indirectes Jean Salives, dit Claude Le Maguet, fut confié, à l’âge de six ans, à un orphelinat, après le départ de sa mère du domicile conjugal. Il en sortit à seize ans, ayant appris le métier de typographe et marqué par les idées libertaires. En 1903, il travailla d’abord comme apprenti puis il s’embaucha à L’Anarchie où il côtoya Libertad, le jeune Kilbatchich (futur Victor Serge), André Lorulot, Sébastien Faure… Appelé sous les drapeaux, il déserta après trois semaines. Ce fut le début d’une longue insoumission et illégalité, d’une vie de vagabond durant laquelle il dut changer de noms et de métiers. Passé en Belgique, il revint en France à Lens (Pas-de-Calais) où il trouva une place de typographe chez Benoît Broutchoux, d’octobre 1908 à la fin de 1909, et écrivit ses premiers articles dans Le Journal du Peuple . Arrêté à Lille lors d’une manifestation en faveur d’un camarade incarcéré, il fut condamné à un mois de prison. Il mena alors une vie errante sous différents pseudonymes: Trivaux, Prevel, Béhier, Malaise. Ayant trouvé un emploi à l’hôtel de ville, il dut l’abandonner à la suite des arrestations consécutives à l’affaire Jules Bonnot. En 1912, il rencontra Marcelle, qui deviendra sa compagne. Il passa ensuite en Suisse, travailla comme typographe à Lausanne, puis à Genève. À la déclaration de guerre, il resta fidèle à «l’internationalisme prolétarien» selon sa propre expression. Claude Le Maguet fit bientôt partie des milieux pacifistes et rencontra Frans Masereel, Henri Guilbeaux, Pierre-Jean Jouve, René Arcos, Romain Rolland, Birukoff, J. Humbert-Droz. En 1916, peu après la création de la revue «zimmerwaldienne» Demain (Genève, 1916-1919), et sur les conseils de son fondateur Henri Guilbeaux, il fonda, avec F. Masereel, Cécile Noverraz et Albert Ledrappier, la revue Les Tablettes (Genève) pour dénoncer la guerre. Les Tablettes n’adhérèrent jamais aux idées zimmerwaldiennes ni au programme bolchevik. Sa revue, marquée d’abord par les idées anarchistes, se rattacha à la philosophie de la non-violence inspirée par Tolstoï. «Ce fut la plus libre, la plus noble, la mieux rédigée et la mieux présentée de ces revues protestataires», écrivit M.Martinet en septembre 1919. Claude Le Maguet collabora également aux journaux suisses La Voix du Peuple, La Feuille (Genève), aux Cahiers idéalistes et aux Humbles (Roubaix, 1913-1914, puis Paris, 1916-1940) de Maurice Wullens. En 1920, Claude Le Maguet entra comme correcteur à la SDN. Après sa retraite, il revint en France, à la déclaration de guerre, ne voulant pas faire figure de réfractaire dans une guerre contre le fascisme. Il fut emprisonné à Lyon, puis à la caserne de Quimper. De retour à Genève, il fut, selon ses propres mots, «happé par la poésie». Il collabora après la guerre à Liberté (Paris, 1958-1971) de Louis Lecoin et aux Cahiers de l’Humanisme libertaire (Paris, 1963-1976) de Gaston Leval. Outre ses poèmes et articles, il a écrit Les Anarchistes et le cas de conscience (1921) et composé une Anthologie des écrivains réfractaires de langue française , parue dans la revue Les Humbles , août-octobre 1927).
Source(s) :Dictionnaire international des militants anarchistes, sur le Web; Notice de Nicole Racine, in Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, …
-
SALLON Maurice
Courtier de commerce, Maurice Sallon pratique le journalisme dès sa besogne finie. Il collabore ainsi à La République libérale, au Courrier du Pas-de-Calais, à La Croix et à L’Artésien où il tient une chronique hebdomadaire. En 1914, après la mobilisation de Paul Deron, rédacteur en chef du Courrier du Pas-de-Calais , il le remplace brièvement jusqu’en octobre où l’hôtel du Courrier est bombardé par les Allemands, mettant fin la parution du quotidien durant toute la guerre. Sallon retourne au négoce et ne reprend la plume de temps en temps que pour le Bulletin de l’Association des anciens élèves de Saint-Joseph dont il est vice-président. En juin 1940, après l’invasion allemande, il reprend du service au Courrier du Pas-Calais d’abord comme seul rédacteur puis comme rédacteur en chef. Jusqu’en octobre 1942, sous le contrôle de l’occupant, il livre un éditorial puis devant ses exigences ne veut plus écrire et est remplacé par J. Dessaint, mais assure occasionnellement son intérim. Il meurt quelques mois avant la Libération, le 1 er mai 1944, échappant à toute poursuite éventuelle. Maurice Sallon avait été élu à l’Académie d’Arras en juillet 1941.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, 9 juillet 1941; Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les Quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021.
-
SALVAT Pierre
Pseudonyme de Pierre Noilhau.
-
SAMAIN Paul
Gradué en droit, secrétaire à l’Automobile‑Club du Nord, à l’Aéro‑Club du Nord et au Club Saint‑Hubert du Nord, Paul Samain était également correspondant de Comœdia , pour Roubaix. Auteur de nombreuses fantaisies humoristiques en vers, parues dans des journaux et des revues de Paris mais aussi de province, et de saynètes jouées dans des cercles privés, il a fait représenter en 1910, au théâtre hippodrome de Roubaix, une revue locale, en trois actes, qui obtint un très vif succès.
Source(s) :Manuscrits Véran (Médiathèque de Roubaix).
-
SAVARY Maurice
Fils d’un percepteur de la Somme, Maurice Edouard Savary, après avoir renoncé à faire carrière dans la marine, devient journaliste. Il fait d’abord partie de la rédaction du quotidien Le Progrès du Nord, puis en 1902, il dirige l’édition douaisienne du Réveil du Nord . De retour à Lille, il devient secrétaire général de la rédaction du quotidien, poste qu’il occupe jusqu’au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1905, il fonde toujours à Lille l’hebdomadaire Le Moniteur des sociétés lilloises et régionales qui ne semble avoir eu qu’une existence éphémère. Dans l’entre-deux-guerres, il est nommé rédacteur en chef de Nord Eclair, journal quotidien d’union des gauches , édité à Dunkerque de novembre 1922 à juin 1924. Au milieu des années 1920, il semble avoir quitté le Nord, on le retrouve notamment syndic de l’Association fraternelle des journalistes fondée en 1927.
Source(s) :Le Travailleur, 15 février 1903; Le Grand Echo du Nord, 29 septembre 1913; Le Nord maritime, 7 janvier 1925; L’Evénement, 13 février 1929.
-
SEDE (de) Gustave
, 30 novembre 1824 – La Mothe-Liéoux (Haute-Garonne), 6 mai 1888) Journaliste Apparenté à toute la noblesse de Comminges, Gabriel Paul Gustave de Sède, baron de Liéoux, était le fils d’un ancien officier de la Grande Armée. Après des études au collège militaire de La Flèche, il aurait été successivement professeur d’université, receveur de l’enregistrement, juge de paix. Arrivé à Arras vers 1857, il est chef de service à la préfecture du Pas-de-Calais avant d’opter pour le journalisme. En 1867, il prend la succession d’Auguste Tierny à la tête du quotidien bonapartiste Le Courrier du Pas-de-Calais, propriété d’une société en commandite dont il est membre ainsi qu’Auguste Tierny, le maire d’Arras Plichon, Bollaert et Rimbaux. Il maintient la ligne politique du journal et se montre toute sa vie un fidèle partisan de la dynastie impériale.
Son fils Paul lui succède en 1886 comme directeur. Retiré dans sa région d’origine, Gustave de Sède reste vice-président du Syndicat de la presse conservatrice jusqu’à sa mort. Membre de l’Académie d’Arras, il est l’auteur de plusieurs travaux historiques.
Un portrait de Gustave de Sède par le peintre Jean-André Rixens se trouve au musée municipal de Saint-Gaudens.
Source(s) :Michel Beirnaert, Dictionnaire des académiciens, site de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Arras; Le Courrier du Pas-de-Calais, 1er, et 2 janvier 1928.
-
SEDE (de) Paul
Fils de Gustave de Sède, directeur du Courrier du Pas-de-Calais , Paul Clément Jean Charles Gustave, de Sède fut rédacteur en chef du quotidien arrageois, avant de succéder à son père à la direction du titre en 1886. Quatre ans plus tard, Le Courrier fut racheté par la Société anonyme du Pas-de-Calais et devint le porte-parole des monarchistes. Paul de Sède quitta le journal et abandonna le journalisme.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, 1er et 2 janvier 1928.
-
SEIDEL Alfred
Rédacteur correspondant du Télégramme du Pas-de-Calais à Calais en 1922, Alfred Seidel est membre du bureau de l’Association des journalistes professionnels du Pas-de-Calais.
-
SEIGNE Albert
Albert Seigné quitte l’école à l’âge de 15 ans, muni de son certificat d’études. Fils d’un ouvrier de filature de Roubaix, originaire de Gand, il devient aide-tisserand dans la même ville jusqu’à son service militaire effectué au 110 e RI de Dunkerque. De retour à la vie civile en 1912, il devient employé de commerce. Mobilisé en août 1914, il est démobilisé cinq ans plus tard avec le grade de caporal fourrier, titulaire de la croix de Guerre et de la médaille militaire avec citations. Il est alors embauché au Cri du Nord et des régions libérées .Après la disparition de ce quotidien «d’union socialiste» en juillet 1921, il entre au Grand Echo du Nord où il est secrétaire de rédaction, puis devient chef des informations de jour. Le 5 juin 1928, il se marie à La Madeleine avec Elise Gruson. Bien qu’ayant continué à travailler pendant l’Occupation, à la Libération, il poursuit son métier de journaliste au sein de la rédaction de La Voix du Nord.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 512 R 033, M149/142.
-
SEITER Louis
Fils d’un chef de bataillon d’artillerie, Louis Antony Seiter naît dans le royaume de Naples en 1805 et n’arrive en France qu’en 1811. Après des études au lycée de Douai, Louis Seiter entre dans l’enseignement où il dirige de 1826 à 1832 un établissement privé à Arras puis est principal du collège de Saint-Pol-sur-Ternoise de 1832 à 1838.
Parallèlement, il participe depuis 1828 à la partie littéraire du Propagateur du Pas-de-Calais puis du Progrès du Pas-de-Calais, dirigés par Frédéric Degeorge. Il collabore au Puits artésien créé à Saint-Pol-sur-Ternoise par le docteur Bruno Danvin. En 1837, il fonde La Revue littéraire et scientifique du Pas-de-Calais. En 1838, il entre à La France septentrionale. Il abandonne le journalisme lorsque ce journal cesse de paraîtreen 1844. Louis Seiter devient alors secrétaire de mairie à Wazemmes.
Source(s) :Hippolyte Verly, Essai de biographie contemporaine lilloise, Leleu, Lille, 1869; Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2009.
-
SERVIN Charles Auguste
Fils d’un contremaître de tissage, Charles Auguste Servin est d’abord employé à l’imprimerie Dégremont à Cambrai. Imprimeur et libraire à Caudry à partir de 1907, il fonde en 1919 Caudry-Cambrésis. Journal hebdomadaire de l’arrondissement de Cambrai dont le rédacteur en chef est Maurice Servin et qui paraît jusqu’en 1936.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
SERVIN Maurice
Maurice Robert René Servin est le rédacteur en chef et gérant du journal Caudry-Cambrésis, fondé en 1919 par son père Charles Servin.
Source(s) :AD Nord, M 149/142.
-
SEYFRIED Henri
Dans une notice non datée trouvée aux Archives départementales du Nord, Henri Constant Seyfried est présenté comme «un simple reporter de locale» à L’Indépendant, édité à Cambrai. . Fils de Flore Virginie Marie Constance, couturière, il est né le 27 juin 1853 dans cette ville, mais n’est reconnu par son père Coriolan Seyfried que lors de leur mariage le 2 octobre 1858 à Amiens. Il meurt dans sa ville natale, en octobre 1903, après une courte maladie.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 122 R 008, 3E 6534 et 1T 222/4; Le Grand Echo du Nord, 4 octobre 1903.
-
SIAUVE-EVAUSY François
C’est déjà muni d’une large expérience dans la presse radicale ou socialiste que François Siauve, dit Siauve-Evausy, arrive dans le Nord pour prendre la direction de la rédaction en chef de L’Egalité de Roubaix-Tourcoing , puis quelques mois plus tard, en 1895, celle du Réveil du Nord . Fils de Charles Siauve, sabotier, et de Françoise Robert, François Siauve pratique le journalisme depuis 1885. Après des études au collège de Saint-Yrieix (Haute-Vienne), il entre d’abord dans l’administration des postes à Bordeaux et devient administrateur des télégraphes. Membre du Parti ouvrier à partir de 1888, il est révoqué et devient employé dans une maison de commerce jusqu’en 1893. Selon la biographie trouvée dans son dossier de Légion d’honneur, il est, depuis 1885, directeur ou rédacteur en chef des périodiques bordelais: L’Ere nouvelle, Le Républicain et La Question sociale. En janvier 1894, il devient rédacteur en chef du Réveil du Centre à Limoges, en juillet, il fonde à Bordeaux Le Peuple , et en novembre il prend la direction du Peuple de Lyon qu’il doit quitter, selon la police, «à la suite d’un scandale, une aventure avec une ouvrière». Président de l’Association des travailleurs républicains socialistes de Bordeaux, il est candidat aux élections municipales de 1892 dans cette ville, aux élections législatives en 1893 à Brive. La police le considère cependant comme un homme facilement achetable. Après un passage à L’Egalité de Roubaix-Tourcoing , il est nommé, en 1895, rédacteur en chef du Réveil du Nord . Selon la police, son arrivée «marque une nouvelle phase dans l’évolution du journal». Représentant de la fédération du Nord lors de différents congrès du Parti ouvrier, il abandonne l’organisation en 1901, en même temps que Delesalle, directeur du Réveil du Nord . Lorsqu’il quitte le quotidien socialiste, en 1907, pour «raisons de santé», dit-il, il exerce les fonctions de directeur d’une société d’assurances, filiale de «La Mondiale». En octobre 1908, il crée un bimensuel, la Revue des grands intérêts économiques de l’industrie, du commerce et de l’agriculture et La Prévoyance sociale. Officier d’Académie et chevalier du Mérite agricole, il est nommé c hevalier de la Légion d’honneur en 1909. Cofondateur en 1902 de l’Association professionnelle des journalistes du Nord, il en est le secrétaire général pendant plusieurs années et la dote d’une caisse de secours et de retraite. Il est également l’auteur de plusieurs brochures dont Le Peuple et son avenir, Les Votes de Jules Guesde (1898), Le Repos hebdomadaires (1906) , Le Droit au repos (1907). Resté à Lille lors de l’occupation allemande, Siauve-Evausy y meurt à l’âge de 58 ans des suites d’une courte maladie, «en captivité» diront ses amis.
Source(s) :Bernard Grelle, «Catalogue commenté de la presse roubaisienne 1829-1911, », Les Cahiers de Roubaix, n° 10, Lire à Roubaix, p. 115-116; site Léonore, dossier de légionnaire; AD Nord, rapport de police du 4 janvier 1896, M 149/148; Bulletin de Lille, dimanche 3 mars 1918.
-
SIMON Charles
Charles Eugène Simon est le fils cadet de l’ancien président du Conseil Jules Simon. Après une courte carrière de journaliste commencée en 1869 au Rappel et au Soir, il participe à la guerre de 1870 au sein de la garde nationale où il est nommé sous-lieutenant.
Lors de la nomination de son père au ministère de l’Instruction publique, il est nommé secrétaire particulier. Le 24 mai 1871, il quitte le ministère et devient correspondant parisien de La Gironde et du Journal de Rouen.
 Lors de la création du Sénat en 1876, il est nommé sur concours secrétaire-rédacteur de cette assemblée. Il ne quitte son poste que le temps de devenir directeur de cabinet de son père nommé ministre de l’Intérieur et président du Conseil. En 1877, il tente en vain de se faire élire député à Castres.
Lors de la création du Sénat en 1876, il est nommé sur concours secrétaire-rédacteur de cette assemblée. Il ne quitte son poste que le temps de devenir directeur de cabinet de son père nommé ministre de l’Intérieur et président du Conseil. En 1877, il tente en vain de se faire élire député à Castres.En octobre 1878, Charles Simon fonde à Lille, avec son frère Gustave, Le Petit Nord et prend une part active aux luttes politiques du département. Il tente notamment de se faire élire député du Nord en septembre 1889. En avril 1891, il fonde dans la région du Nord, deux autres quotidiens Roubaix-Tourcoing et Calais, journal républicain. Charles Simon est également l’auteur de quatre pièces de théâtre, dont deux en collaboration avec Alfred Bonsergent : Trop heureuse (1894), Irréguliers (1897), Zaza (1898), Doré Sœurs (1910).
Charles Simon était chevalier de la Légion d’honneur depuis 1884.
Source(s) :AD Nord 1T 222/24; BM Lille, fonds Humbert, boîte 22, dossier 5.
-
SIMON Gustave
Frère aîné de Charles Simon et fils de l’ancien président du Conseil Jules Simon, Gustave Marie Stéphane Simon étudie la médecine et devient aide-major pendant le siège de Paris de 1870. A ce titre, il participe aux batailles de Champigny et de Montretout (octobre-décembre). Il accompagne son père à Bordeaux lorsque celui-ci est nommé ministre de l’Instruction publique. En avril 1877, il est reçu docteur en médecine.
Correspondant depuis 1871 de L’Indépendance belge, du Sémaphore de Marseille, du Journal de Rouen, il fonde, en octobre 1878 à Lille, avec son frère Charles, le quotidien Le Petit Nord dont il assume la direction. En 1891, il lance, toujours avec son frère, Roubaix-Tourcoing et Calais, journal républicain. Par la suite, ayant quitté le Nord, il est secrétaire de rédaction au Journal officiel et collabore à divers journaux et revues de Paris dont Le Temps et La Revue hebdomadaire. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages.
Gustave Simon était vice-président de l’Association des journaux républicains des départements.
Source(s) :AD Nord 1T 222/24; BM Lille, fonds Humbert, boîte 22, dossier 5; Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains…, p. 1447.
-
SIMON Michel
Né le 12 août 1935 à Saint-James dans la Manche, Michel Simon fut étudiant à l’ESJ de Lille de 1957 à 1959. A sa sortie, il intégra la rédaction de La Voix du Nord à Saint-Quentin. Le 1 er avril 1961, il était affecté à l’agence de Calais où il travailla pendant quinze ans. En octobre 1976, il est nommé à Lille où il s’occupe de la banlieue jusqu’en 1991, date de son départ en préretraite. Passionné de peinture et d’architecture, Michel Simon a également suivi la création et le développement du quartier d’Euralille. Il a notamment publié deux ouvrages sur ce sujet.
Source(s) :La Voix du Nord, édition de Marcq-en-Baroeul-Lambersart, 9 septembre 2017.
-
SOCKEEL Raoul
Fils d’un ajusteur d’Hazebrouck, Raoul Paul Albert Sockeel est secrétaire de rédaction au journal de l’abbé Lemire Le Cri des Flandres à partir de 1911. Mobilisé lors de la déclaration de guerre, avec le grade de sergent, il meurt le 25 janvier 1916 des suites de ses blessures à l’hôpital de Vitry-le-François dans la Marne. Il est titulaire de la médaille militaire à titre posthume.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 295 R 003; site Mémoire des hommes, soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale; J.-P. Vanhove, «Le Cri des Flandres, journal républicain», Bulletin de l’Association Mémoire de l’abbé Lemire, n° 24, septembre 2017, p. 24.
-
SOOTS Georges
Fils de Charles Soots, directeur de tissage, ancien combattant de la guerre 1870-1871, et Juliette Delangue, Georges Louis Soots entre au Grand Echo du Nord de la France en 1920, après avoir exercé la profession de comptable. Selon le quotidien, il «consacre la meilleure part de son activité de journaliste aux choses de la terre, relatant les diverses manifestations agricoles, horticoles et avicoles, participant à la page agricole hebdomadaire du journal, collaborant à l’organisation du concours annuel «Du plus bel épi de blé». Sa compétence pour ces matières est reconnue par la Société des agriculteurs du Nord qui lui remet sa médaille de bronze, puis d’argent. Le ministre de l’Agriculture le fait chevalier du Mérite agricole en 1930 et l’élève au grade d’officier huit ans plus tard. Georges Soots quitte Le Grand Echo du Nord dans les premiers mois de l’Occupation.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 378 R 001, M 149/142; Le Grand Echo du Nord, 14 juin 1936 et 24 avril 1939.
-
SOUPLET Calixte
Calixte Souplet fut l’un de ces journalistes avec qui Louis Napoléon Bonaparte noua des relations alors qu’il était prisonnier au fort de Ham dans la Somme. Directeur du Guetteur de Saint-Quentin, il publia même quelques articles d’économie sociale de la plume du prince dans son journal. A. Morel dans son ouvrage Napoléon III. Sa vie, son œuvre et ses opinions publié en 1869 lui attribue même un rôle dans l’évasion du futur empereur. Reprise par l’Anglais Henry Drummond Wolff, cette thèse fut démentie en 1894 par le petit-fils du journaliste Pierre Hachet-Souplet dans son livre Louis Napoléon, prisonnier au fort de Ham. La vérité sur l’évasion de 1846.
Fils d’un officier de Napoléon Ier, blessé à Iéna, Calixte Souplet fut élève du lycée Louis Legrand à Paris avant de travailler dans l’étude d’un notaire saint-quentinois, puis de rejoindre Le Guetteur de Saint-Quentin. En 1834, il en devint directeur à l’âge de 24 ans et le restera jusqu’en 1856. Républicain, il rompt ses relations avec Louis Napoléon en 1849, il condamne le coup d’Etat du décembre 1851, puis démissionne du conseil municipal de Saint-Quentin, dont il était membre depuis 1846, pour ne pas prêter serment à l’Empire.
En 1856, Calixte Souplet change d’orientation, prenant la direction de l’usine à gaz de la ville. Poursuivi par deux fois, Le Guetteur de Saint-Quentin est lui supprimé par décision de justice le 8 mai 1858. Membre de la Société académique, Souplet meurt brutalement d’une congestion cérébrale le 28 mars 1867. Deux ans plus tard, Le Guetteur de Saint-Quentin est relancé par un comité républicain présidé par Henri Martin.
Source(s) :Le Guetteur de Saint-Quentin, 7 mai 1891, 2 juin 1912; La Vie moderne, 3 juin 1894.
-
SOUQUET Gustave
Fils du maire d’Etaples, Nicolas César Souquet qui reçut par deux fois Napoléon Bonaparte lors du camp de Boulogne, Gustave Souquet, né le 27 avril 1805, fut élève au collège Sainte-Barbe à Paris, puis apprenti chez Didot toujours à Paris et enfin à l’imprimerie Le Roy-Berger à Boulogne-sur-Mer. Là, il invente un outil de typographie, le justificateur, qui lui vaut la médaille de la Société d’agriculture, de commerce et des arts de Boulogne-sur-Mer. Enfin, le 20 septembre 1825, il obtient son brevet d’imprimeur. Ayant acquis la même année l’imprimerie Louis Leducq de Fontaine, qui édita de mai 1816 à juin 1819 Le Journal du département du Pas-de-Calais, il s’installe à Arras où il imprime des ouvrages historiques et scientifiques, mais aussi les Mémoires de l’Académie d’Arras. En janvier 1826, il lance la Revue départementale ou feuille judiciaire, commerciale et administrative de la ville d’Arras . En septembre, il fonde Le Journal de l’arrondissement de Montreuil et en mai 1827 Le Journal de l’arrondissement de Saint-Pol. En novembre 1828, un prospectus annonçant la sortie d’un nouveau journal Le Propagateur informe les lecteurs de la Revue départementale d’un accord entre les propriétaires des deux titres: «A partir du 15 novembre la Revue départementale cessera de paraître et les abonnés de cette feuille recevront jusqu’au 1 er janvier 1829 les numéros du Propagateur en remplacement de leur abonnement.» Imprimeur du Propagateur, journal libéral dirigé par Frédéric Degeorge, Gustave Souquet participe également à sa rédaction. Dès novembre, il manifeste son intention de transmettre son affaire, mais son successeur est refusé par le ministre de l’Intérieur. Le 28 juillet 1830, le journal, dont la devise est «le roi et la charte», est interdit de publication par les ordonnances de Charles X, Souquet refuse cependant de se soumettre. Ses presses sont scellées puis saisies. Le journal ne reparaît que le 4 août, portant les dates «du vendredi 30 juillet au mercredi 4 août». La rédaction rapportealors :«Les scellés placés sur nos presses, l’enlèvement postérieur de tous les caractères de notre imprimerie nous ont empêché de paraître jusqu’à ce jour. […] Sur les quatre presses saisies, deux ont été cassées dans le déménagement, la nature de cet accident les met hors d’état de servir.» Cependant ajoute-t-elle le 20 août: « Le Propagateur n’avait pas moins continué à paraître: une presse et quelques casses de caractères, qu’on était parvenu à soustraire aux perquisitions de l’autorité,fournirent pendant toute la durée de la crise à l’impression du journal condamné.» L’ex-préfet du Pas-de-Calais Blin de Bourdon, l’ex-secrétaire général Rivière et l’ex-maire d’Arras Hauteclocque qui avaient ordonné la saisie et l’enlèvement des presses, furent condamnés à payer une somme de 3000 F à titre de dommages et intérêts à Souquet. Le nouveau préfet lui accorde même le titre d’imprimeur de la préfecture, recommande Le Propagateur aux maires du département. Le journal glisse cependant vers une opposition au régime et, en juin 1831, après la nomination d’un nouveau préfet, le baron Alexandre Daniel de Talleyrand, Souquet perd les travaux d’impression de la préfecture. Une «pétition adressée à MM. les députés de France contre M. le baron de Talleyrand, préfet du Pas-de-Calais» n’y fait rien. En 1833, Souquet cède son imprimerie à Jean Degeorge, frère du directeur du Propagateur, et regagne sa ville natale où il reprend l’affaire de négoce de ses ancêtres. Loin de la presse et de l’imprimerie, il devient maire adjoint de sa commune de 1843 à 1848, assume les fonctions de vice-consul de Belgique, des Pays-Bas, des pays scandinaves, d’Espagne,… En mars 1853, il est nommé capitaine de la compagnie des sapeurs-pompiers de sa ville. Archéologue, historien de sa ville et de sa région, collectionneur, il participe à diverses recherches archéologiques, donne des communications aux nombreuses sociétés savantes dont il fait partie, publie plusieurs brochures ou ouvrages. Enfin passionné de photographie, il est membre de la Société boulonnaise de photographie, fondée en 1856 et laisse de nombreux documents aujourd’hui conservés au musée Quentovic d’Etaples.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse arrageoise 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2009; Corinne Helin, «Gustave Souquet (1805-1867), un érudit aux prémices de l’archéologie étaploise», nordoc.hypotheses.org, publié le 15 décembre 2015, mise à jour le 9 mai 2016.
-
SOURDILLE Raoul
Licencié en droit et ancien élève du collège libre des services sociales de Paris, Raoul Silvain Laurent Sourdille collabore pendant de nombreuses années à deux journaux parisiens. A la fins des années 1920, il entre au Grand Echo du Nord où il occupe le poste de rédacteur correspondant à Arras. Raoul Sourdille prend sa retraite en août 1941. Il est remplacé par Pol Hardy qui occupait le même poste au Télégramme. En février 1931, il avait été élevé au grade d’officier de l’Instruction publique.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, 5 février 1931; Le Courrier du Pas-de-Calais, 3 décembre 1941.
-
SPA Arthur
Propriétaire-gérant de l’hebdomadaire Le Journal de Bourbourg fondé en 1882 , Arthur Désiré Spa «n’est, selon le sous-préfet de Dunkerque, que le rédacteur nominal de son journal». Son rôle consisterait «uniquement à prêter son nom aux réactionnaires anonymes qui ne cessent d’attaquer et de vilipender tout ce qui se dit franchement républicain». Dans le contexte de l’époque, son intelligence ne peut donc être que «médiocre».
Source(s) :AD Nord, 1T 222/1.
-
SPROIT J.
Journaliste à L’Echo du Nord, Sproit fonde en 1839 le quotidien La France septentrionale, journal constitutionnel, «destiné, selon Georges Lepreux, à soutenir les intérêts de l’opposition modérée».Très rapidement, il quitte le journal et laisse la place à Voyer, Baju et Seiter Il est l’auteur en 1832 d’une brochure intitulée Lettre d’un réformateur sur les établissements charitables de la ville de Lille.
Source(s) :BM Lille, fonds Humbert, boîte 22, dossier 6; Georges Lepreux, Nos Journaux, Crépin, Douai, 1896; notice «La France septentrionale».
-
STACKERSKI
Né en Pologne, Stackerski arrive à Lens en 1928 pour travailler comme journaliste au quotidien polonais Narodowiec . Il prend notamment en charge les pages culturelles. Lorsque le journal suspend sa parution avant l’arrivée des Allemands à Lens en mai 1940, il devient interprète à la mairie de Lens. Dénoncé, il est arrêté par la Gestapo et transféré à la prison de Loos-lès-Lille. Il meurt en juin 1941 à Bruxelles.
-
STEENHOUWER Georges
Fils de Henri Steenhouwer, distillateur, originaire de Bruxelles, et d’Anna Julia Henocq, Georges Auguste Paul LéonSteenhouwer est né le 19 mai 1899 à Lille. Il entre dans le journalisme au quotidien lillois Le Progrès du Nord. Il rejoint ensuite l’hebdomadaire Le Bonhomme du Nord et du Pas-de-Calais édité à Douai de 1919 à 1940. Au début des années 1930, il entre à l’agence douaisienne du Grand Echo du Nord . Il ne semble pas écrire durant l’Occupation. A la Libération, il est embauché à La Voix du Nord où il est nommé chef de l’édition douaisienne. Il meurt en 1956.
Source(s) :AD Nord, 1 Mi EC 350 R 137; différents numéros du Bonhomme du Nord, et du Grand Echo du Nord.
-
STIL André
Fils d’un tailleur, André Stil accomplit ses études secondaires au lycée Henri Wallon de Valenciennes. Son baccalauréat obtenu, il devient en 1940 instituteur, puis en 1942 professeur dans le secondaire au Quesnoy. Il rejoint la Résistance et participe aux combats de la libération du Quesnoy. En septembre 1944, il adhère au Parti communiste. A la fin de la même année, il reprend ses études à la faculté des Lettres de Lille où il obtient une licence de lettres et un DESS de philosophie. Il devient rédacteur en chef du magazine Nord, supplément dominical du quotidien communiste Liberté. En 1949, André Stil quitte le Nord pour Paris où il devient rédacteur en chef adjoint du quotidien Ce Soir. Responsable pour le Nord de l’Union nationale des intellectuels, Stil est membre permanent du comité fédéral du Nord du PCF, secrétaire de la section communiste du Quesnoy. En 1950, il est élu membre suppléant au comité central du Parti et est nommé, à l’initiative de Maurice Thorez, rédacteur en chef de L’Humanité . Candidat lors d’une élection législative partielle dans la 1 re circonscription de Seine-et-Oise, en 1959, il est battu par une candidate MRP. S’il reste rédacteur en chef de L’Humanité jusqu’en 1958, il prend quelque distance, s’adonnant de plus en plus à l’écriture de ses livres. Après la nomination de René Andrieux comme rédacteur en chef, il reste chroniqueur littéraire du quotidien comme de plusieurs revues communistes pendant une quinzaine d’années. Membre du comité central du PCF jusqu’en 1970, il s’installe dans les Pyrénées-Orientales où il poursuit son activité d’écrivain, mais aussi de scénariste. En 1977, il est élu membre de l’académie Goncourt où il siège jusqu’à sa mort en 2004.
Source(s) :https://maitron.fr/spip;php?article172107, notice STIL André par Reynal Lahangue, 2015, modification 2022.
-
STOVEN Arthur
Elève du collège Saint-Bertin à Saint-Omer, licencié en droit de la faculté de Paris en 1880, Arthur Stoven est d’abord avocat stagiaire à Lille, puis s’oriente vers le journalisme. Pendant dix ans, il est au service de la presse catholique, dans le quotidien La Vraie France , puis à la direction de l’hebdomadaire satirique antirépublicain, antimaçonnique et antisémite Le Lillois. Il est président de la section antimaçonnique des Congrès des catholiques du Nord et du Pas-de-Calais. Il choisit ensuite une orientation professionnelle délibérément différente. Il se fixe à Armentières où il est, à partir de 1891, directeur de la Compagnie d’assurances «La France». Il est membre du Comité flamand de France.
Source(s) :AD Nord, M 157/8; Dictionnaire biographique du Nord, 1893; André Caudron, Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, tome 4, Lille-Flandres, Beauchène, CHRNO-Université Charles de Gaulle-Lille III, 1990.
-
SUEUR Georges
Georges Sueur débute sa carrière de journaliste au Journal de Boulogne. Durant l’Occupation, réfractaire au STO, il participe en 1943 au mouvement des « Jeunesses chrétiennes combattantes » du Pas-de-Calais. En 1945, il est incorporé au 601e groupe de transport en Sarre.
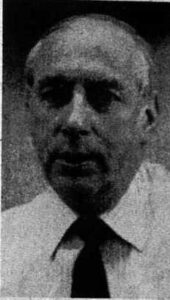 En 1946, il entre à Nord Eclair comme rédacteur aux informations générales. Il travaille dans plusieurs agences locales avant de devenir, en 1960, secrétaire général de la rédaction puis directeur du bureau de Nord Eclair à Lille. Parallèlement en 1966, il devient correspondant du Monde pour le Nord-Pas-de-Calais. Chargé de cours à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille et au Centre de formation des journalistes de Paris, de 1957 à 1968, il fonde et préside en 1970 le Centre d’information permanente des journalistes de Lille. De 1949 à 1953, il est délégué du Syndicat national des journalistes, puis membre du bureau régional de l’Association des journalistes européens.
En 1946, il entre à Nord Eclair comme rédacteur aux informations générales. Il travaille dans plusieurs agences locales avant de devenir, en 1960, secrétaire général de la rédaction puis directeur du bureau de Nord Eclair à Lille. Parallèlement en 1966, il devient correspondant du Monde pour le Nord-Pas-de-Calais. Chargé de cours à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille et au Centre de formation des journalistes de Paris, de 1957 à 1968, il fonde et préside en 1970 le Centre d’information permanente des journalistes de Lille. De 1949 à 1953, il est délégué du Syndicat national des journalistes, puis membre du bureau régional de l’Association des journalistes européens.Lorsqu’il prend sa retraite en 1983, Georges Sueur s’engage auprès de Pierre Mauroy, sénateur-maire de Lille, et de Michel Delebarre, maire de Dunkerque. Passionné de musique et en particulier d’opéra, il préside le festival de la Côte d’Opale. Il est l’auteur de l’ouvrage Lille, Roubaix, Tourcoing, une métropole en miettes paru en 1971 et du Guide de la nature Flandres et Artois publié en 1979. Cet observateur attentif de la vie dans le Nord et le Pas-de-Calais était chevalier de la Légion d’honneur.
Source(s) :La Voix du Nord, 8 août 2009; Le Monde, 16-17 août 2009.
-
SY Georges
Entré à La Voix du Nord le 26 avril 1954, Georges Sy est le petit-fils de l’un de ceux qui l’imprimaient clandestinement pendant la guerre . Rédacteur à l’édition d’Arras, il est nommé adjoint au chef de l’édition de Douai auquel il succède ensuite. Il dirige l’édition de Douai jusqu’à sa retraite en 1992. Gaulliste et chrétien, Georges Sy était très impliqué dans le tissu associatif douaisien. Membre de la Croix-Rouge dont il fut le président de la délégation douaisienne, il a œuvré particulièrement au sein de la banque alimentaire et de l’école des infirmières. Il était également membre de la fondation Raoul Follereau, des Papillons blancs, de plusieurs œuvres humanitaires en faveur de l’Afrique. Il participait également aux travaux de la Société d’agriculture, sciences et arts de Douai.
Source(s) :La Voix du Nord, 24 juillet 2008, p. 3.,
P-Q – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais T
-
TATON ?
Taton est rédacteur au Courrier douaisien en 1863. Selon le préfet du Nord, il «était parvenu à transformer ce journal [de sensibilité légitimiste] au point de vue des idées politiques qu’il émettait, par sa forme et les extraits qu’il donnait souvent des journaux favorables au gouvernement». Ce qui lui aurait valu son renvoi.
Source(s) :AN F/18/297, rapport 53 du 9 octobre 1863.
-
THERY Henri
Henri François Victor Théry, domicilié 20, rue de Béthune à Lille, annonce, en août 1873, la sortie d’un «quotidien étranger à la politique et aux questions économiques», Le Petit Lillois, qui ne voit pas le jour. Quelques jours plus tard, le 4 septembre, il récidive avec l’annonce d’un nouveau quotidien, Les Petites Affiches du Nord, avis, annonces, affiches judiciaires,…, imprimé, précise-t-il, par Lagache, 48, rue Esquermoise à Lille, et dont on ne trouve également aucune trace.
Malgré ces tentatives avortées, Henri François Victor Théry, célibataire, n’exerça pas moins la profession de journaliste si l’on en croit son acte de décès. Ayant quitté le Nord pour Paris, il y est déclaré publiciste.
Source(s) :AD Nord, 1T 222; archives de Paris, acte de décès.
-
THOMAS Charles
Charles Thomas entre à La Voix du Nord le 15 juillet 1970 après avoir été journaliste au quotidien L’Ardennais. D’abord secrétaire de rédaction, il devient rédacteur au service économique, puis termine sa carrière comme critique cinématographique.
-
TIBERGHIEN Joseph
Fils de Louis Tiberghien, alors rédacteur au Journal de Roubaix, Joseph Tiberghien suit les traces de son père, mais aussi de son frère Maurice. Il entre à la rédaction du quotidien roubaisien. A la Libération, il passe au quotidien Nord Eclair qui prend la suite.
-
TIBERGHIEN Louis
Rédacteur au Journal de Roubaix, Louis Tiberghien quitte le journalisme pour devenir en 1912 secrétaire communal d’Estaimpuis (Belgique). Il occupe ce poste pendant plus de vingt ans. Il meurt en janvier 1933 à Roubaix chez son fils Maurice.
-
TIBERGHIEN Maurice
Fils de Louis Tiberghien, secrétaire de mairie, Maurice Tiberghien fait ses études au collège d’Estaimpuis en Belgique. A l’âge de 22 ans, il entre au Journal de Roubaix dont il devient secrétaire général de la rédaction. En 1940, il évacue vers la Normandie avec l’équipe du Journal de Roubaix . Il échappe miraculeusement à la mort dans le bombardement de Vernon en juin. Lorsque Le Journal de Journaux reparaît le 1 er janvier 1940, il reprend ses fonctions à la rédaction. A la Libération, il poursuit sa carrière au quotidien Nord Eclair dont il devient secrétaire général de la rédaction après le départ d’Alfred Messian. Il prend sa retraite en 1963 et meurt dix ans plus tard à Hyères.
Source(s) :Le Journal de Roubaix, 13 juin 1940, Nord Eclair, n.d.
-
TIBI
Pseudonyme de Marius Véran.
-
TIERNY Auguste Louis
 Auguste Tierny achète le 6 juin 1821 à Michel Nicolas son imprimerie et La Feuille d’annonces fondée en mai 1803 (10 prairial an XI) par sa mère, la veuve Nicolas sous le nom de Feuille hebdomadaire du Pas-de-Calais, qu’il y imprime.
Auguste Tierny achète le 6 juin 1821 à Michel Nicolas son imprimerie et La Feuille d’annonces fondée en mai 1803 (10 prairial an XI) par sa mère, la veuve Nicolas sous le nom de Feuille hebdomadaire du Pas-de-Calais, qu’il y imprime.Le 20 décembre 1830, Auguste Tierny transforme son périodique en feuille politique sous le nom de Courrier du Pas-de-Calais. En 1836, l’imprimerie et Le Courrier sont placés sous la direction d’une société en commandite dont Tierny est le gérant en tant que propriétaire du fond.
Sans héritier direct, Auguste Tierny transmet, en mai 1857, la propriété du journal à son neveu Auguste Louis Eugène qui y collaborait depuis février 1848 et en était rédacteur en chef et directeur depuis 1851.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, 1er et 2 janvier 1928.
-
TIERNY Auguste Louis Eugène
Licencié en droit, Auguste Louis Eugène Tierny est le fils de Guislain Louis Joseph Tierny, maître maçon, et de Félicité Bernardine Sophie Mathieu. Il est le neveu du fondateur du Courrier du Pas-de-Calais auquel il collabore à partir de février 1848. Trois ans plus tard, il en est le rédacteur en chef et directeur. En 1857, son oncle lui cède la propriété du journal et de l’imprimerie. Auguste Tierny en a fait le porte-parole du régime, appelant à voter « oui » au plébiscite approuvant en 1851 le changement de constitution et appelant de ses vœux l’Empire. Son dévouement à l’Empire lui vaut d’être nommé en 1865 chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, « distinction alors rarement accordée aux représentants de la presse » reconnaît en 1928 Le Courrier du Pas-de-Calais. Au lendemain de sa mort, en décembre 1877, le journal bonapartiste L’Ordre de Paris écrit : « M. Tierny, qui avait occupé dans la presse départementale une place des plus importantes, fut l’un des précurseurs de l’inspiration nationale qui confia le pouvoir au Prince Louis-Napoléon. Sa plume, comme sa pensée, sont toujours restées fidèles à leur culte primitif. »
En 1867, Auguste Tierny avait cédé son journal à une société en commandite, dirigée par le baron Gustave de Sède et dont il fut membre jusqu’à sa mort.
Source(s) :Le Courrier du Pas-de-Calais, 1er et 2 janvier 1928; L’Ordre de Paris, 13 décembre 1877; site Léonore, dossier de légionnaire.
-
TILLOY Oscar
Elève instituteur à l’école normale de Douai, Oscar Tilloy est renvoyé pour ses idées démocratiques en 1858. Il s’établit libraire dans la même ville et publie, en 1861, une histoire de Jean-sans-Peur. En 1882, il est rédacteur gérant de l’hebdomadaire Le Vrai Gayant , parti à l’assaut de l’équipe municipale en place. Poursuivi à plusieurs reprises par la Justice, ce périodique cesse sa parution après les élections municipales de 1884 qui voit la victoire de l’équipe sortante. Si Tilloy abandonne la presse, il n’en continue pas moins de publier. En 1885, il sort notamment Curieuses confessions d’un libraire et diverses brochures où il poursuit de sa vindicte la municipalité.
Source(s) :Dictionnaire biographique du Nord, 1893.
-
TIRANTY
«Impatient de se jeter dans la mêlée socialiste», selon la police, Tiranty passe en 1896 de La République libérale , quotidien républicain catholique édité à Arras, au Réveil du Nord , quotidien édité à Lille. Issu d’une «bonne famille que l’on dit riche», cet ancien étudiant parisien serait entré dans ce titre socialiste à «l’insu de son père».
Dès l’année 1897, Tiranty semble avoir quitté Lille pour Paris.
Source(s) :Le Grand Echo du Nord, «Les Journaux et la municipalité», 13 mars 1897.,
J.-P. V.
-
TOURNIER Henri
Henri Alexis Omer Tournier dirige La Vie à la campagne , un bimensuel illustré en 1864-1865. Il fonde en 1867 Le Courrier international , un bihebdomadaire rédigé en trois langues: français, anglais et espagnol, il collabore également au Courrier populaire de Lille. Il abandonne le journalisme pour devenir à Lille directeur de la compagnie d’assurances La Clémentine.
Source(s) :Hippolyte Verly, Essai de Biographie contemporaine lilloise, Leleu, Lille,
-
TRASSY Fortuné
Fils d’Urbain Trassy, gendarme à cheval, et de Thérésine Jourdan, FortunéPaul EugèneTrassycommence sa carrière de journaliste avant la Première Guerre à Nîmes où il est rédacteur au quotidien marseillais Le Soleil du Midi. Mobilisé en 1914, il reprend son poste en 1919. En octobre, il est nommé rédacteur en chef du quotidien Nîmes-Soir qui laisse la place en avril 1921 au Gard. Quelques mois après la disparition de ce journal , Fortuné Trassy arrive à Calais où, en 1923, il est nommé rédacteur en chef du quotidien Le Phare de Calais , dirigé par Jules Peumery. Mobilisé lors de la déclaration de guerre, il est fait prisonnier. En 1942, après sa libération, il occupe le poste de chef de la censure à Montpellier. En 1943, il tente en vain, auprès de Peumery, de retrouver son poste au Phare de Calais où les Allemands ont imposé un éditorialiste et un nouveau rédacteur en chef. A la Libération, il revient à Calais. Du 15 juillet 1950 au 10 mars 1952, il est directeur politique de L’Echo de Calais et du Pas-de- Calais où il assume à côté des informations générales et de la chronique politique, la rubrique des sports . Afin d’éveiller la curiosité des Calaisiens et l’intérêt pour son journal, Trassy s’en prend régulièrement au Nord littoral et en particulier à son directeur Jean Baratte. En novembre 1950, il est ainsi poursuivi pour diffamation et à la suite d’une enquête provoquée par son concurrent, le public est informé qu’il n’est pas titulaire de la carte de journaliste professionnel. Ce dont il se justifie dans son journal. En janvier 1952, Trassy est l’auteur d’un dernier incident, il gifle publiquement le directeur du Nord littoral qui l’aurait insulté. En raison de difficultés financières, L’Echo de Calais et du Pas-de-Calais cesse sa parution le 10 mars 1952. Propriétaire du titre, Trassy avait bien tenté de poursuivre l’aventure alors que les actionnaires de la société éditrice l’avaient lâché un mois plus tôt.
N’ayant pu trouver une solution pour relancer son journal, comme il l’espérait, Fortuné Trassy quitte Calais. Il meurt le 21 décembre 1964 à Sauveterre dans le Gard.
Source(s) :Yves Guillauma, «Figures de la presse dans le Pas-de-Calais», L’Abeille, n° 29, avril 2015, p. 27-28; Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les Quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021, p. 40-46.
-
TRIMM Timothée
cf. LESPES Léo
-
TUBERT Alexandre
Ancien rédacteur de plusieurs journaux républicains, après avoir été répétiteur, au Prytanée militaire de La Flèche dans la Sarthe, Alexandre Joseph PierreTubert, originaire de Perpignan, est présenté, lors de son arrivée à Dunkerque en 1890, comme «un journaliste d’action, très intelligent, très actif, instruit, maniant avec prestance le sarcasme et l’ironie, peut-être apportant un peu trop de violence de langage dans sa polémique».
Rédacteur en chef au Phare de Dunkerque, l’homme n’hésite pas à se battre en duel, à faire le coup de poing. En 1890, il affronte au pistolet Amédée Petit, rédacteur au Nord maritime. En 1897, il n’hésite pas à rosser Elisée Polvent du Torpilleur . Il est d’ailleurs l’objet de plusieurs procès où il est condamné à de fortes amendes et à la prison. Mais, comme le note la police, «toutes les peines encourues ont été réformées et atténuées par la cour d’appel de Douai et il a bénéficié de plusieurs recours en grâce». Du Phare de Dunkerque , il passe au quotidien L’Avenir de Dunkerque qui en octobre 1896 prend la suite du Dunkerque et dont il assume la direction . En octobre 1900, il est nommé percepteur dans l’Yonne. Le Progrès de la Somme , de sensibilité radicale, dit son regret de voir partir de la région «un journaliste de talent et d’énergie qui pendant dix ans, a mené à Dunkerque le bon combat pour la République» et note que le gouvernement «en confiant à M. Tubert un poste dans les finances, récompense un des serviteurs les plus dévoués à la démocratie». Alexandre Tubert ne perd cependant pas tout contact avec la région. En 1908, il est élu conseiller municipal de Bergues, mais est battu en 1912. L’hebdomadaire conservateur Le Journal de Bergues écrit lors de sa mort en 1925: «Dans l’ardeur combative qu’il mettait à défendre les opinions de son parti et à porter de rudes coups de boutoir à l’adversaire, il dépassait souvent le but à atteindre dans ce milieu dont la mentalité est faite tout entière de calme et réflexion, de modération et d’attachement aux traditions.» En 1914, il avait perdu son fils Louis, sous-lieutenant au 110 e RI, tué à Pontavert dans l’Aisne.
Source(s) :AD Nord 1T 222/10; La Gironde, 22 décembre 1890; Le Progrès de la Somme, 7 octobre 1900; Le Nord maritime, (reprenant, Le Journal de Bergues, ), 14 mars 1925.,
V – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais V
-
VAILLANT Charles
Né à Arras le 14 août 1864, Charles Louis Augustin Vaillant collabore à L’Artésien et à L’Echo des Rosati, puis participe à la fondation du Carillon d’Arras (1884-1886) . Il est ensuite nommé rédacteur en chef à Arras du quotidien L’Avenir d’Arras et du Pas-de-Calais de 1893 à septembre 1900. En 1896, il est élu conseiller municipal d’Arras.
Il quitte la préfecture du Pas-de-Calais pour devenir un éphémère sous-préfet de Saint-Calais dans la Sarthe du 24 septembre au 10 octobre 1900. Il devient alors chef de cabinet de Charles Jonnart, nouveau gouverneur de l’Algérie, puis sous-préfet de Miliana. En avril 1901, il regagne la France pour prendre le poste de sous-préfet de Lannion dans les Côtes-du-Nord. En juin 1906, il est nommé à Epernay dans la Marne où il meurt en fonction le 23 décembre 1906.
Charles Vaillant était officier d’Académie.
Source(s) :AN, dossier F/1BI, F/4A; Chabé, «Un nouveau sous-préfet», L’Agriculture de la région du Nord, 5 octobre 1900.
-
VALLEE Georges
Membre du barreau de Douai, Georges François Edmond Vallée, comme beaucoup d’avocats, collabora à de nombreux journaux de sa région avant d’opter pour l’administration préfectorale.
Fils d’un propriétaire terrien de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, Georges François Edmond Vallée accomplit ses études secondaires au lycée de Douai, puis entre à la faculté de droit de cette même ville où il obtient sa licence. Il devient alors avocat à la cour d’appel de Douai, avant d’opter pour la fonction publique.
Durant cette période, il publie des articles politiques, historiques et même des biographies dans plusieurs journaux républicains du Nord-Pas-de-Calais: L’Ami du peuple (Douai) , L’Echo du Nord (Lille), L’Avenir (Arras) , La France du Nord (Boulogne-sur-Mer) … Il est également membre de plusieurs sociétés savantes: Commission des monuments historiques du Pas-de-Calais, Société académique de Boulogne-sur-Mer…
En 1879, il est nommé chef de cabinet du préfet du Finistère, puis, en 1880, devient conseiller de préfecture à Quimper. Le 8 avril 1893, il est nommé sous-préfet de Bar-sur-Aube. A la mort de Graux, député de Saint-Pol-sur-Ternoise, en 1900, il lui succède à la Chambre. Il est réélu en 1902 et 1906. Malade, il ne se représente pas en 1910. Retiré de la vie politique, il meurt à Paris le 8 décembre 1928.
Source(s) :Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940, site de l’Assemblée nationale.
-
VALLEZ, Constant
Inconnu du Maitron, Constant Vallez, tisserand, gère à la fois l’Imprimerie communiste de Roubaix, installée 8, rue du Pile au Palais du travail, et La Feuille anarchiste , d’après le numéro 5 de ladite Feuille . Vallez venait d’arriver à Roubaix, venant de Reims, où il avait pris la tête d’un mouvement de grève. Il était passé par Saint-Quentin, où on avait jugé Constant Vallez «exalté en paroles, révolutionnaire, mais incapable d’un attentat.» Bien entendu, selon la police, c’est aussi un saoulard insouciant… La Feuille anarchiste remplaçait La Petite Feuille anarchiste , journal gratuit, imprimé sur papier rouge, née le 5 avril 1902, qui ne dépassa pas le numéro 16 (3 mars 1903). Antimilitariste, anticléricale et athée, La Feuille combat violemment le Parti ouvrier, dont les militants sont qualifiés de «jésuites rouges». La Feuille anarchiste reproduit, dans son numéro 6, un supplément destiné Aux bleus , lors du dernier départ de la classe , distribué à 2 000 exemplaires : «Vous voici sur le départ, vous allez avoir à protéger la société où foisonnent le vol, le crime, l’injustice et l’infamie! Vous allez être les ennemis de vos frères! Vous serez les gendarmes du capital! Tâchez d’être les volontaires de l’humanité! Expliquez aux camarades de la chambrée l’odieux du militarisme.» Ce supplément vaut à Vallez, responsable de la distribution, un procès en correctionnelle. Il est poursuivi pour «un fait de propagande anarchiste, pour provocation des militaires à la désobéissance aux lois». Son avocat plaidera que le texte de l’affiche incriminée a déjà été publiée dans La Voix du peuple ou dans L’Union syndicale de Lens, sans que ces deux périodiques soient inquiétés. D’ailleurs le procureur général de Paris, interrogé par le juge d’instruction de Lille, a répondu qu’il ne poursuivrait pas. Procureur et juges de Lille font donc du zèle, en condamnant Vallez à 100 F d’amende.
Source(s) :L’Avenir de Roubaix-Tourcoing, 9 janvier 1904; L’Égalité de Roubaix-Tourcoing, 10 janvier 1904; Le Journal de Roubaix, 15 janvier 1904.
-
VALLIEZ Ferdinand
Né dans une famille modeste de l’Aisne, Jean-Baptiste Ferdinand Valliez, après avoir fait ses classes dans diverses imprimeries, devient directeur d’un trihebdomadaire de l’Oise et en fait l’un des titres les plus importants du département.
Fils d’un tailleur d’habits, il est, après sa scolarité à l’école de son village natal, engagé comme apprenti dans les ateliers Gilles Gibert à Soissons. Parallèlement, il fréquente les bibliothèques, les cours du soir, voire les clubs politiques pour compléter ses connaissances. N’ayant pas encore vingt ans, il part pour Paris où il travaille dans l’une des plus grandes imprimeries françaises Maulde et Renou.
En 1853, Emile Lefebvre, propriétaire du Progrès de l’Oise édité à Compiègne, fait appel à lui pour diriger son imprimerie. A la mort de celui-ci en 1855, Ferdinand Valliez prend la direction politique du journal. Favorable aux idées libérales, il signe son premier article le 22 août. Se consacrant à la fois à l’imprimerie et à la rédaction, il introduit à l’atelier des méthodes nouvelles et du matériel nouveau, il développe dans son journal l’information locale. D’une feuille modeste, il fait du Progrès de l’Oise un titre qui compte dans son département.
Ferdinand Valliez participe à la formation d’un parti républicain à Compiègne. En pleine guerre franco-prussienne, il est arrêté, le 29 janvier 1871, à son domicile par une soixantaine de soldats prussiens pour « avoir fait de son journal l’organe du gouvernement de Bordeaux ». Emmené à Chantilly, il est incarcéré vingt et un jours. Le Progrès de l’Oise est interdit de parution jusqu’au 3 mars.
Alors que, depuis la démission du maréchal Mac Mahon le 30 janvier, les républicains possèdent tous les leviers du pouvoir, Ferdinand Valliez, malade, renonce à la direction du journal en novembre 1879. Il meurt quelque deux ans plus tard à l’âge de 56 ans.
Source(s) :AD Aisne, 5 Mi 0262; AD Oise, 5MI 1572; Le Progrès de l’Oise, 19 et 22 octobre 1881.
-
VALLIEZ Léon
Fils de journaliste, Léon Emmanuel Valliez suit, comme son frère Henri, l’exemple de son père Ferdinand qui est, à Compiègne, directeur du Progrès de l’Oise depuis 1855.
A partir de novembre 1883, il est rédacteur en chef de La Vérité à Epernay. Le 22 août 1891, il prend la direction du quotidien audomarois Le Mémorial artésien en remplacement de Lardez qui vient de se retirer pour raisons de santé. Il met ensuite le cap sur la Normandie où il prend la direction du Mémorial cauchoise édité à Fécamp. Il quitte ce journal en janvier 1912.
Léon Valliez a abandonné le journalisme lorsqu’il meurt, à l’âge de 57 ans, à la maison municipale de santé, dite la « Maison Dubois », située 200, faubourg Saint-Denis à Paris. Il était officier de l’Instruction publique depuis 1895.
Source(s) :AD Oise, 5MI 1572; Arch. Paris, 7D 165; Le Siècle, 20 octobre 1881 et 23 janvier 1895; L’Indépendant rémois, 16 décembre 1888; L’Express du Nord et du Pas-de-Calais, 26 août 1891, Le Mémorial artésien, 14 janvier 1912.
-
VAN COSTEN Lucien
Lorsqu’il arrive, le 15 août 1930, comme rédacteur en chef au quotidien amiénois Le Progrès de la Somme dirigé par Maurice Hisler, Lucien Van Costen a déjà une belle carrière de journaliste derrière lui, notamment dans la presse parisienne.
Issu d’une famille dunkerquoise, Lucien Clément Van Costen fait probablement ses premiers pas dans le milieu de la presse au bimensuel pour la jeunesse Jean-Pierre dont le premier numéro sort à Paris en décembre 1901. Gérant-comptable, il y écrit quelques articles et s’y fait un nom pour avoir, selon Le Libertaire, encaissé en 1904 l’argent destiné au journal : abonnement et don de 4 000 F.
Séjournant au Proche-Orient pendant plusieurs années, il collabore à divers journaux parisiens : L’Eveil, L’Action, Le Siècle… où il traite des questions concernant l’Egypte, la Grèce, la Turquie, l’Arabie, voire les colonies africaines. En 1923, il est secrétaire de rédaction au Quotidien, créé par plus de 20 000 Français et Françaises pour défendre et perfectionner les institutions républicaines et qui soutient en 1924 le Cartel des gauches. A partir de 1925, il travaille à Paris-Soir dont il devient rédacteur en chef. En 1928, il est fait chevalier de la Légion d’honneur. Remplacé à la tête de la rédaction par Alexis Caille, Van Costen continue de faire régulièrement la Une du quotidien pour ses enquêtes et reportages.
La reprise du journal, qui connaît bien des difficultés, par Jean Prouvost le 16 avril 1930 motive-t-elle le départ de Lucien Van Costen ? Il y signe son dernier article le 30 mars. Quelque quatre mois plus tard, il dirige la rédaction du Progrès de la Somme.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 758/2; Le Progrès de la Somme, 26 janvier 1940; Le Libertaire, 27 août 1904; Le Quotidien, 4 septembre 1923; divers numéros de Paris-soir.
-
VAN HOUCKE Paul
Engagé volontaire, Paul Alphonse Cornil Van Houcke, fils de Jules Antoine Guislain Van Houcke, percepteur, et de Marie Sophie Cornélie Pareydt, servit pendant plusieurs années comme sous-officier au 69 e régiment de ligne à Nancy, puis au 1 er zouaves à Alger. A ce titre, il participa à l’expédition de Tunisie, puis à celle du Tonkin en 1885. Ces états de service lui valurent la médaille coloniale et la médaille commémorative de la guerre du Tonkin. Rentré en France où il se marie en 1887 à Jeumont, il est inspecteur puis commissaire de la police des chemins de fer. En 1896, Paul Van Houcke est rédacteur pour les villes de Roubaix et de Tourcoing du quotidien lillois Le Grand Echo . Si la police concède qu’il est assez instruit, elle note que «ses articles sont généralement empreints debeaucoup d’exagération et dramatisés à souhait». Selon le Dictionnaire biographique illustré du Nord , il fut, accompagnant le président de la République Félix Faure en Russie, «le seul publiciste du Nord, délégué aux fêtes de Cronstadt, de Peterhof, de Saint-Pétersbourg et de Krasnoïe-Selo, en 1897». Journaliste pendant près de 30 ans, il devint à la fin des années 1920 secrétaire de Elby, directeur des mines de Lens et sénateur. «Esprit cultivé, voyageur infatigable» qui, selon Le Grand Echo «connaissait la plupart des pays européens» Paul Van Houcke acquit une certaine notoriété comme conférencier. Il était officier d’Académie.
A la veille de la Seconde Guerre, il quitte Lille pour suivre, dans les Pyrénées orientales, sa fille Thérèse, née de son second mariage, et son gendre. Lorsqu’il meurt en mars 1944, il est le doyen de l’Association professionnelle des journalistes du Nord dont il était l’un des fondateurs.
.
Source(s) :AD Nord 1T 222/12; Dictionnaire biographique illustré du Nord, p. 1054-1055; Le Grand Echo du Nord, 28 mars 1944.
-
VANACKERE Désiré Henri Julien
Créateur d’un journal en vers qui n’eut qu’une courte existence, Vanackère fonde en 1806 La Feuille du département du Nord. Portant en Une l’aigle impérial, ce périodique est principalement composé de petites annonces. Sa publication cesse à la fin de l’année 1810 par ordre du préfet du département. A partir de 1843, Vanckère imprime Le Journal de Lille , organe du Tiers-parti, fondé par Mermet, qui disparaît après la révolution de 1848.
Source(s) :BM Lille, fonds Humbert, boîte 23, dossier 5.
-
VANDAELE Henri
«Henri Vandaele fit ses études classiques au lycée de Lille et fut reçu bachelier ès lettres en 1881. En 1883, il s’engage au 1 er régiment d’infanterie de marine ; à peine caporal, il est envoyé au Tonkin où il participa à toute la campagne contre la Chine ; puis, il fait partie de la première colonne d’exploration du Laos, au cours de laquelle il est le secrétaire du capitaine Monteil, qui devint le célèbre explorateur ayant traversé l’Afrique, du Nil à nos possessions algériennes à travers le Soudan et la Tripolitaine. Dès sa libération, il collabore à diverses publications coloniales, horticoles et sportives et publie ensuite un certain nombre d’ouvrages de vulgarisation. En 1894, il devient le directeur-administrateur du journal Le Nord horticole ; depuis 1888, il était le chroniqueur du Carabinier , organe officiel des sociétés de tir du Nord et en devient le rédacteur en chef en 1902. Sa dernière plaquette, Notre Flandre , publiée à l’occasion de la fête de tir, où il fut l’actif président de la commission «Presse et Publicité», est très remarquée.
Vandaele, qui est membre correspondant de plusieurs sociétés savantes françaises et étrangères, est vice-président de l’Association fédérale des Sociétés de tir du Nord et du Pas-de-Calais; Officier de l’instruction publique; chevalier du Mérite agricole; titulaire de la médaille du Tonkin et de plusieurs médailles d’honneur; lauréat de la Société nationale de l’encouragement au bien».
Source(s) :Notice dans le fonds Marius Véran, Médiathèque de Roubaix.
-
VANDENBULCKE Joseph
Avant s’être rédacteur au service des sports du Grand Echo du Nord, Joseph François Vandenbulcke fut d’abord un sportif. A vingt ans, il remportait les championnats du Nord du 100 m plat. Né à Croix le 16 janvier 1901 d’un père apprêteur, il entrait au Grand Echo du Nord peu de temps après avoir conquis son titre de champion. Sous la direction d’André Messelin, il était de la plupart des grandes manifestations sportives régionales. Malade, et refusant de laisser son métier, il meurt le 4 décembre 1929, à moins de 29 ans, laissant une veuve et une fillette.
Source(s) :ADN, 3E 14644, 3E 15461 et M 149/142; Le Grand Echo, 5 et 8 décembre 1929.
-
VANDENBUSSCHE Gaspard
Gaspard Vandenbussche est encore collégien à Notre-Dame des Dunes à Dunkerque, lorsque son père meurt. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il se fait journaliste. Il fait ses premiers pas dans ce métier au Clairon , éphémère quotidien qui vient de se fonder à Dunkerque. D’abord reporter, il devient secrétaire de rédaction. En 1899, il refuse un poste de chroniqueur au Nord maritime que lui propose son cousin Charles Chiroutre pour entrer chez un armateur et importateur d’huile où la rémunération sera meilleure. Pendant dix ans, il y occupe successivement les postes d’expéditionnaire, de caissier, de comptable et de chef de bureau. Parallèlement, il reprend ses études et obtient le grade de licencié ès Lettres. Devenu chroniqueur à La Justice sociale à Paris, il quitte son emploi pour intégrer la Bonne Presse. Revenu à Dunkerque, il devient rédacteur régional à La Croix du Nord , tout en collaborant à La Croix de Paris, au Nord maritime et à l’hebdomadaire dunkerquois Le Courrier populaire . En 1910-1911, il assure à Hazebrouck la direction de L’Indicateur des Flandres qu’il abandonne après le départ de son propriétaire David, pour ne pas faire campagne contre l’abbé Lemire. Mobilisé au 1 er R.A. à pied pendant la Première Guerre, il effectue la campagne de Flandre et ne rentre à Dunkerque qu’en mars 1919. Gaspard Vandenbussche crée en juillet 1919 Le Beffroi des Flandres qui paraît une dizaine d’années. En 1923, il crée La Flandre maritime , puis en 1932 Le Guetteur du pays dunkerquois dans lequel il signe sous le pseudonyme Jan des Dunes. Dans cet entre-deux-guerres, il publie plusieurs ouvrages: en 1922 A l’ombre du veux Leughenaer , en 1925 Le Vert Vallon , en 1927 Silhouettes dunkerquoises , en 1935 Yvonne, … dont certains en flamand: La Maison au fanal rouge, Le cavalier à cocarde blanche,… mais aussi de nombreux contes dans plusieurs revues. En 1940, après l’occupation de Dunkerque par les Allemands, Vandenbussche se retrouve seul rédacteur au Nord maritime pour le relancer . Sous contrôle de l’occupant, il dirige ce journal avant d’être écarté en 1942. Retiré à Lille, il est rappelé en septembre 1943 pour remplacer le jeune éditorialiste, mécontent de son salaire. De Lille, il enverra régulièrement des éditoriaux payés «a un franc la ligne imprimée», puis reprend la direction du journal. Héraut du régionalisme en Flandre, il collabore, dès sa création en 1941, à l’hebdomadaire La Vie du Nord.
A la Libération, Vandenbussche est condamné à un an de prison et à l’indignité nationale.
Source(s) :AD Nord, 9W 565; «Figures de chez nous. Un précurseur du régionalisme français, Gaspard Vandenbussche de Dunkerque», La Vie du Nord.
-
VANDEREST Jean Joseph
Né le 22 décembre 1811 à Dunkerque d’un père originaire de Belgique Jean Baptiste Vanderest, mais installé en France depuis 1802, d’Anne Marie Fockedey, fille d’un brasseur dunkerquois, Jean Joseph Marie Vanderest obtient son brevet de capacité d’instituteur le 8 juin 1832. Le 27 août de la même année, il ouvre une école dans sa ville natale. Le 30 mars 1837, il obtient son brevet de libraire. En 1840, Vanderest, «professeur d’histoire et de littérature» publie une Histoire de Jean Bart , chef d’escadre sous Louis XIV qui lui acquiert une certaine notoriété. L’ouvrage connaît plusieurs éditions. Le 1 er août 1841, il lance un hebdomadaire Le Mercure du Nord, journal commercial, agricole, littéraire, scientifique et d’annonces dont l’existence est bien éphémère. Dès le 30 août, l’administration lui reproche de publier un journal politique sans en avoir fait la déclaration ni payer le cautionnement. Le 4 septembre, Vanderest est condamné à un mois de prison et 200 F d’amende pour offense à la famille royale et à l’autorité en place. Le 15 janvier 1842, cet hebdomadaire est interdit. Le 23 janvier 1843, il obtient son brevet d’imprimeur et, le 23 décembre lance Le Commerce de Dunkerque, Bergues, Bourbourg et Gravelines. Cet hebdomadaire légitimiste devient simplement, le 31 octobre 1844, Le Commerce de Dunkerque . Le 5 mars 1847, gérant-responsable, Vanderest est condamné à 6000 F de dommages et intérêts pour allégations calomnieuses envers un ancien juge au tribunal de Dunkerque. Le 19 mai, Le Commerce de Dunkerque est suspendu à la suite d’un arrêté du tribunal de Dunkerque déclarant que Vanderest est étranger et ne peut donc exercer la fonction de gérant. Bien qu’il soit né en France, ait obtenu son brevet de capacité d’instituteur, son père n’a pas rempli les formalités pour devenir français lorsque la Belgique a été séparée de la France en 1814. La révolution de février 1848 survenue, Vanderest annonce, en avril, son ralliement à la République et peut reprendre la publication du Commerce de Dunkerque . En 1852, il est relevé de son incapacité civile par le ministère de la Justice. Le 6 janvier 1853, il transforme Le Commerce en journal bonapartiste sous le titre Le 20 novembre , puis Le 21 novembre en souvenir du plébiscite accordant la dignité impériale à Louis-Napoléon Bonaparte. Probablement avec l’appui du sous-préfet, Vanderest reprend le brevet et le matériel d’imprimerie de ses confrères Drouillard et Vandalle, propriétaires respectifs de La Dunkerquoise et du Journal de Dunkerque . Fusionnant en décembre ces deux titres politiques avec son journal, celui-ci devient L’Autorité. Journal politique, commercial et maritime de Dunkerque. Si Vanderest occupe toujours le poste de gérant, il se voit imposer par l’Administration un rédacteur en chef venu de Paris, Jules Delcro. Selon Emile Bouchet, Vanderest souhaitait appeler ce quotidien L’Union dunkerquoise, mais Delcro fit remarquer au préfet du Nord que «ce nom sonnait mal en tête d’un journal inféodé au gouvernementde l’Empereur, car c’était le titre d’un important organe catholique et légitimiste à Paris ». Convoqué à Lille, Vanderest, malgré ses protestations, dut s’incliner. Fait par des Parisiens, L’Autorité ne rencontre guère l’adhésion des Dunkerquois. Les conflits entre le propriétaire et le rédacteur en chef son permanent et Delcro doit quitter le quotidien. Celui change de propriétaire en 1856, mais poursuit sa route jusqu’en 1885 où il devient La Flandre .
Source(s) :AD Nord 1T 222/9 et 1T 222/10; La Gazette des tribunaux, 1er février 1848; Georges Lepreux, Nos Journaux, Crépin, Douai, 1896; É, mile Bouchet, «La Presse dunkerquoise de 1868 à 1898», Revue de la société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, étude consultée sur internet; Jean-Paul Visse, La Presse du Nord et du Pas-de-Calais au temps de L’Echo du Nord 1819-1944, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 2004.
-
VANDEVYVERE Huguette
Huguette Vandevyvère fut une ardente militante de l’Europe. Née à Lille en 1926, elle fut élève de l’Institut technique de secrétariat où elle obtint le CAP de secrétaire de direction. Championne de France de sténographie, c’est tout naturellement au service des sténos qu’elle entra lorsqu’elle fut embauchée à La Voix du Nord en janvier 1965 .
Après une rencontre avec des journalistes allemands à Bonn en 1969, elle fonda, avec Jean Piat, la section régionale Nord-Pas-de-Calais de l’Association des journalistes européens. Durant de nombreuses années, elle organisa des rencontres, des conférences en faveur de l’Europe et devint secrétaire générale adjoint de la section française de l’Association des journalistes européens et membre du bureau international de cette même association. Son militantiste fut récompensé par le prix du journalisme européen 1988.
Par ailleurs, Huguette Vandevyvère fut membre du conseil d’administration de la maison de l’Europe à Lille, membre des Séverine, association regroupant les femmes journalistes du Nord-Pas-de-Calais, présidente de l’Association des amis de la fondation Claude Pompidou.
Source(s) :La Voix du Nord, 1er février 1989.
-
VANDEWYNCKEL Victor
Notaire à Bergues, Victor Vandewynckel devient rédacteur à La Vigie , feuille dunkerquoise opposé au gouvernement de Louis-Philippe. En 1873, lors de la création du Phare de Dunkerque, il est nommé directeur de ce journal républicain progressiste, dont la rédaction en chef est confiée à Taverne. Victor Vandewynckel abandonne rapidement la direction de ce journal pour des raisons de santé.
Source(s) :É, mile Bouchet, «La Presse dunkerquoise de 1868 à 1898», Revue de la société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, Ibid.
-
VANHOY Henri
Henri Vanhoy, tisserand, marié et père de famille, a exercé les fonctions d’imprimeur-gérant du Combat , hebdomadaire anarchiste, de janvier 1913 au 21 février 1914. Gérant, c’est sûr; imprimeur, ça l’est beaucoup moins… Tisserand chez Wattine-Danzin depuis cinq ans, Henri Vanhoy fait, un jour de juin 1913, arrêter le travail ( Le Combat, 21 juin 1913): il veut faire renvoyer un traître (je ne connais pas sa «traîtrise», la livraison du 14 manquant dans la collection reproduite par la Bibliothèque nationale de France dans Gallica). Bien entendu le directeur intervient, la discussion s’envenime, on en vient presque aux mains, et Vanhoy est renvoyé. Pour faire bonne mesure, on renvoie également un de ses fils: celui-ci aurait participé à la rédaction d’articles parus dans Le Combat , ce que le père dément. À la sortie de midi, Vanhoy interroge les ouvriers pour savoir ce qu’ils comptent faire. Nouvelle discussion, qui tourne à la réunion contradictoire sur les bien-fondés respectifs de l’anarchie et du capitalisme. Mais la police est déjà là et le travail reprend. Le traître est malgré tout renvoyé lui aussi, à la grande satisfaction de Vanhoy. Deux mois plus tard, Vanhoy a retrouvé du travail chez Bonnel, rue d’Alger. Se déplaçant dans l’usine sans permission, il a une altercation avec le fils du directeur. Racontant cette histoire dans Le Combat , Vanhoy menace: le fils Bonnel ferait mieux de faire poser des pare-navettes aux métiers qui en sont dépourvus, plutôt que d’ennuyer les ouvriers. Car lui, Vanhoy, pourrait dénoncer le fait à l’inspecteur du travail. Dans le numéro du Comba t du 20 août, Vanhoy s’en prend à nouveau au fils Bonnel. Il affirme que la profession de jésuite irait mieux à ce jeune homme, plutôt que celle de directeur d’usine, et l’invite à retourner à l’école. D’ailleurs il lui fera la leçon à la sortie du tribunal des Prud’hommes. Vanhoy, qui a quitté son travail, malgré sa répugnance à «faire appel à la soi-disant justice» n’a en effet pas hésité à citer l’entreprise devant cette juridiction. Cette entrevue n’aura pas lieu. C’est Bonnel père qui se présente à l’audience. Henri Vanhoy est cité en justice par Lehembre, rentier tourquennois, pour «diffamation et injures publiques par voie de presse». Relaxé du chef de la diffamation, pas assez caractérisée, il est néanmoins condamné par le tribunal correctionnel de Lille à une amende de 30,80 F ou 20 jours de prison, et à 100 F de dommages et intérêts pour injure publique, – «toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme pas l’imputation d’un fait» étant une injure. Ses «complices», Julien Béranger, imprimeur, et Alexandre Delescaut, colporteur du Combat , sont relaxés. On ne sait rien de plus sur Henry Vanhoy.
Source(s) :Le Combat.
-
VANROYE Louis
Fils d’un officier d’artillerie, Henri Constant Marie Vanroye, et de Marie Louise Augustine Delval, Louis Paul Henri Vanroye, après des études au collège Saint-Jean à Douai, rentre comme reporter à La République libérale d’Arras . Il n’y reste que cinq mois et devient reporter à L’Echo du Nord en avril 1896.
Chargé des informations locales, il se fait «dans la presse lilloise, selon son rédacteur en chef, par son ardeur au travail, son intelligence et son activité une situation d’avenir». En juillet 1897, il doit abandonner momentanément le journalisme pour raison de santé. Il se retire chez son oncle et sa tante à Douai où il meurt âgé de moins de vingt ans le 3 novembre 1897.
Source(s) :AD Nord 1T 222/12; Le Grand Echo du Nord, 1er juillet 1897 et 6 novembre 1897.
-
VANWORMHOUDT Auguste
Fils de Jean-Baptiste Thomas Vanwormhoudt, imprimeur à Dunkerque, Jean-Baptiste Ferdinand Auguste Vanwormhout poursuit la publication du Journal de Dunkerque fondé par son père. En 1843, il vend son imprimerie au Valenciennois Edmond Bertau qui change l’orientation politique du journal.
Auguste Vanwormhoudt quitte alors Dunkerque. on le retrouve notamment juge de paix à Gravelines en 1863. Il meurt le 17 janvier 1871.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/8; J.-J. Carlier, «Histoire des journaux, écrits périodiques, almanachs, annuaires publiés à Dunkerque depuis l’origine jusqu’en 1868», Bulletin de l’Union faulconnier; Georges Lepreux, Nos Journaux, Crépin, Douai, 1896.
-
VANWORMHOUDT Jean Baptiste
Originaire de Bourbourg, Jean-Baptiste Thomas Vanwormhoudt exerce dès 1795 ou 1796. Il obtient son brevet d’imprimeur en 1811. En août 1823, il fonde Le Bulletin du commerce. Annonces maritimes, judiciaires, affiches et avis divers dont il est l’imprimeur et le rédacteur. Ce bihebdomadaire laisse place en novembre 1825 au Journal de Dunkerque toujours dirigé et imprimé par Vanwormhoudt. En 1835, le journal et l’imprimerie passent entre les mains de son fils Auguste .
Jean-Baptiste Thomas Vanwormhoudt meurt à Dunkerque en août 1836.
Source(s) :AD Nord 1T 222/8; VIAF; Georges Lepreux, Nos Journaux, Crépin, Douai, 1896.
-
VASSEUR Edmond
Après ses études secondaires au lycée de Saint-Omer et de droit à la faculté de Lille, Edmond Alfred Auguste Vasseur, fils d’un mégissier, devient naturellement avocat. Rédacteur au Mémorial artésien, il entretient de mauvaises relations avec son rédacteur en chef Louis Roselle dont il se plaint, en mars 1897, auprès du député Alexandre Ribot, menaçant de démissionner. En juillet 1898, il est, sur intervention du parlementaire, nommé rédacteur en chef du journal audomarois. En octobre, il se marie à Boulogne-sur-Mer avec Nelly Julie Eugénie Humez. Jusqu’à la fin de l’année 1902, Vasseur se fait ainsi le propagandiste de la politique de Ribot, mais aussi son informateur sur la vie politique de la ville.
Entre temps, en avril 1900, il soutient une thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit. Dix ans plus tard, il est nommé avoué auprès du tribunal de 1re instance de Montdidier dans la Somme. En mars 1917, il est nommé chef du secrétariat particulier de Ribot devenu président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Après la chute du gouvernement en septembre, bien que domicilié à Paris, il reprend son poste d’avoué à Montdidier jusqu’à sa mort survenue à l’âge de 56 ans.
Source(s) :AD Pas-de-Calais, 5 MIR 765/43 bis, 3 E 160/433; Maxime Watelle, «Le Mémorial artésien : miroir de la vie politique d’Alexandre Ribot (1885-1914) in P. Allorant, W. Badier, J.-M. Guislin, O. Tort (dir.), Alexandre Ribot. Une vie en politique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2025, p. 301-303; Le Grand Echo du Nord, 12 octobre 1897 et 2 mai 1900.
-
VASSEUR Henri
Fils de Louis François Vasseur et de Pauline Joséphine Duchat, Henri Alphonse Vasseur est correcteur au Progrès du Nord. Lors de sa mort en 1920, il est président de la mutuelle du syndicat des typographes, président d’honneur de la Société typographique lilloise, président de la Mutuelle du Progrès du Nord , secrétaire de la Commission des cours professionnels du syndicat.
Source(s) :AD Nord; 3 E 15429; Le Cri du Nord, 17 août 1920.
-
VEHL Henri
Henri Charles Joseph Louis Vehl naquit à Lille en 1861. Journaliste au Progrès du Nord, il rejoignit ensuite L’Echo du Nord. Lors de la grève des mineurs d’Anzin qui se déroula du 18 février au 15 avril 1884, Vehl couvrant, à la fin du mois de mars, une réunion des grévistes fut menacé de mort par les participants, les mineurs accusant L’Echo du Nord d’être l’organe de la Compagnie d’Anzin. Henri Rochefort aurait alors pris sa défense.
Henri Vehl se distingua surtout comme chroniqueur théâtral, mais aussi comme auteur, selon la presse spécialisée, « de comédies, de vaudevilles et revues fort appréciés » : Un Acquittement, Le Mur mitoyen, Le suis-je ?, Eliane… En 1891, il quitta le quotidien lillois pour prendre la direction du Grand-Théâtre de Lille pendant une saison. Après avoir dirigé brièvement d’autres théâtres : Douai, Dunkerque, il revint au journalisme, collaborant à plusieurs journaux et agences de Paris.
Malade, il revint se fixer à Lille et travailla pour diverses publications. Son état de santé s’aggravant, en mars 1905, il cessa toute activité. Le 10 août, âgé de quarante-quatre ans, il mourait à son domicile.
Source(s) :AD Nord 3 E 15358; La Petite Gironde, 1er avril 1884; Le Petit Journal, 30 avril 1891; L’Echo du Nord, 1er juin 1892, 19 février 1893, 5 mars 1894 et 10 août 1905; BM Lille, fonds Humbert, boîte 24, dossier 3
-
VENZAC Léon
Journaliste au quotidien lillois La Vérité , après avoir travaillé au Phare de La Rochelle et au Journal des villes et des campagnes, Louis Antoine Venzac y succéda en 1855 à Dayez comme rédacteur en chef. Pendant son séjour lillois, il collabore également à La Bretesque, journal des choses d’autrefois et des choses d’aujourd’hui et à La Revue du Nord. Il quitte Lille pour Paris quelques mois plus tard avec une appréciation particulièrement élogieuse du préfet du Nord: «dans sa vie privée comme dans sa conduite politique a constamment suivi la ligne la plus irréprochable et la plus honorable». Par la suite, il demande l’autorisation de publier un journal de politique et d’économie sociale, Le Commerce du Nord. Journal de Lille. Il semble que cette demande n’eut pas de suite. On le retrouve alors au Petit Courrier de Bar-sur-Seine, rédacteur en chef au Moniteur de la Côte d’Or à Dijon, puis au Courrier des Vosges d’Epinal dont il devient en 1864 copropriétaire. . Correspondant français pour de nombreux journaux espagnols, il fut également l’auteur de plusieurs romans feuilletons.
Source(s) :AD Nord, 1T 222/16; AD Paris, VE4 5685; divers numéros du Courrier des Vosges; Hippolyte Verly, Essai de biographie contemporaine lilloise, 1800-1869, Leleu.
-
VERBAERE Auguste
Fils d’un cultivateur d’Hondeghem dans les Flandres, Auguste Chrétien Verbaere, après avoir été séminariste, fut maître d’études au collège communal de Cassel, d’Hazebrouck et de Saint-Amand.
En mai 1877, après son mariage quelques semaines plus tôt avec Marie Mathilde Vandenabeele, il fonde une imprimerie et une librairie à Armentières et crée un hebdomadaire, Le Journal d’Armentières pour lequel il a dû déposer un cautionnement de 3 000 F. Selon la police, « les articles publiés sont généralement pris dans Le Progrès du Nord, dans La Lanterne et quelques journaux à tendances radicales de Paris. » En 1883, il lance Le Petit Houplinois dont l’existence est éphémère.
Verbaere passe pour « un bon républicain » qui « soutient dans son journal les idées républicaines et combat énergiquement en temps d’élections les candidats réactionnaires. » C’est qu’il a fort affaire face à la municipalité d’Armentières, l’industriel Jules Dansette et son journal La Gazette d’Armentières. Il est poursuivi à plusieurs reprises en correctionnelle et condamné à des amendes. Cependant, la police le considère comme un homme de paille. Républicain certes, mais aussi commerçant, « il est le fournisseur de la mairie. »
Les socialistes ne sont d’ailleurs pas tendres à son égard. Membre du cercle opportuniste, Verbaere ne serait qu’un « acrobate de la politique », « tantôt opportuniste, tantôt radical et tout ce que l’on veut en iste ; en un mot un fumiste ». Rédacteur de son journal, certes, « mais ce sont d’autres plumes que la sienne qui écrivent les articles signés en son nom. » Il ne dirigerait même pas sa maison et son journal, laissant ce soin à sa femme.
En janvier 1899, il tente de revendre son imprimerie et son journal à un ancien rédacteur du Petit Calaisien, mais l’affaire n’aboutit pas. Selon la police, « craignant les opinions politiques » de l’acquéreur, le député Dansette et le maire de la ville ne seraient pas étrangers à cet échec. Le 2 août, le Journal d’Armentières est imprimé par Edouard Ramon qui en devient propriétaire-gérant quelques semaines plus tard.
Auguste Verbaere quitte le Nord et retrouve l’enseignement. Lors de sa mort, en 1908, il habite à Montrouge dans le département de la Seine et il est, selon son acte des décès, professeur. Son épouse est employée de commerce.
Source(s) :AD Nord, M 157/8, 1 T 222/1; AD Hauts-de-Seine, E-NUM-MON-D 1908; Réponse au Journal d’Armentières et aux partis de l’Hôtel de ville, Lille, Imprimerie ouvrière, 1890; différents journaux des années 1880-1890.
-
VERBESSELT Jean-Claude
Jean-Claude Verbesselt est entré dans la presse comme chef du service expédition de Nord Matin en mars 1968. À la disparition de ce journal, il a continué d’exercer les mêmes fonctions à Nord Éclair . Jusqu’à sa retraite en 2007.
Source(s) :Nord Éclair, 14 octobre 2009, p. 23.
-
VERCRUYSE
Le compagnon anarchiste Vercruyse, tisserand à Roubaix, résidant 21, rue du Fourcroy vendait plusieurs titres anarchistes en 1888 dans cette ville. En 1889, il fit paraître un périodique polycopié L’Écho de la misère (trois numéros parus; on trouve les n° 1 et 3 dans le dossier «Lorion» aux AD Nord). L’année suivante, Vercruysse animait et rédigeait peut-être Le Bandit du Nord. Organe anarchiste dont les deux numéros parus sont consultables à la médiathèque de Lille sous la cote Jx 110. Le journal était imprimé par un certain Donolet, et Girier-Lorion participait à la rédaction. Dans l’éditorial du numéro deux on pouvait lire: «Rénovateurs!…allumez l’incendie du monde bourgeois. Que toutes les tyrannies, toutes les iniquités, toutes les autorités soient consumées dans cet immense brasier et que les peuples viennent en chantant danser autour de ce splendide feu de joie qui doit éclairer l’universel banquet où il y aura des couverts mis pour tous.» La même année, «l’imprimerie Vercruyze» publiait une brochure intitulée Défense de l’anarchiste Lorion devant la correctionnelle et les assises du Nord . Cette brochure, en fait une feuille imprimée recto-verso sur quatre colonnes, était vendue 5 centimes. Elle était signée par le «Groupe communard; Les Libertaires de Roubaix», et comportait un placard publicitaire pour La Révolte . Girier avait été condamné par contumace, le 12 novembre 1888, par la cour d’assises du Rhône, à un an de prison. Venu dans le Nord où il se faisait appeler Lorion, il y poursuivit ses activités et fut à nouveau condamné, par défaut. Réfugié au Havre, il revint à Roubaix pour laver son honneur dans une réunion publique. La police le guettait et Girier-Lorion, pour s’enfuir, blessa un des agents d’un coup de revolver. Le 17 décembre 1890, la cour d’assises de Douai le condamnait à dix ans de travaux forcés et à la relégation. Selon Bianco ( Dictionnaire international des militants anarchistes sur le web), Vercruyse aurait collaboré à l’hebdomadaire Rebelle : organe mensuel d’action sociale antidogmatique, antiautoritaire , lancé en 1927 à Bruxelles par Hem Day, pseudonyme de Marcel Dieu (1902-1969), anarchiste pacifiste belge, qui fut responsable de l’Internationale des Résistants à la guerre pour son pays.
Source(s) :Dictionnaire international des militants anarchistes, (sur le Web); Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier…, op. cit.; R. Bianco, Un siècle de presse anarchiste…, op. ci, t
-
VERECQUES Charles
Charles Gabriel Vérecques a travaillé au Réveil du Nord .
-
VERGEZ Henri
Négociant à Seclin, Henri Vergez fut président du Syndicat des voyageurs, représentants et patrons-voyageurs de la région du nord de la France et délégué de la Société de protection mutuelle des voyageurs de commerce de Paris.
Délégué cantonal, il fut président de la Société républicaine des conférences populaires de Seclin. A ce titre, il fut nommé officier d’Académie et chevalier du mérite agricole. Vice-président de la Société de gymnastique, d’armes et de tir «La Seclinoise», il fut rédacteur en chef du Bulletin mensuel de l’association régional des Gymnastes du Nord et du Pas-de-Calais.
Source(s) :Dictionnaire biographique illustré du Nord, 1907, p. 1063.
-
VERJUX Charles
Professeur de français, latin et grec, Charles Verjux collabore d’abord aux Affiches, annonces et avis divers avant de devenir rédacteur principal à L’Annotateur (1823-1830). En 1829, il est condamné en appel à Douai à un mois de prison et 300 F d’amende pour incitation à la haine du gouvernement. Le 1 er janvier 1832, il fonde Le Guetteur de Boulogne où ses écrits lui valent de nombreux adversaires. En 1860, il est notamment condamné à quinze jours de prison pour diffamation envers Edmond Magnier.
Source(s) :Ernest Deseille, Histoire du journalisme boulonnais, Mémoires de la Société académique de l’arrondissement de Boulogne, 1868; Daniel Tintillier, La Presse boulonnaise. Catalogue de l’exposition organisée par l’Association des journalistes du Pas-de-Calais, Bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer, 2009.
-
VERLY Hippolyte
Hippolyte Verly publia ses premiers articles dans La Revue du Nord, fondée à Lille en 1833 par Brun-Lavainne. Il collabora ensuite à L’Écho de Lille, qui plus tard prit le titre de Courrier populaire. En 1866, il ressuscita une publication éteinte depuis longtemps, L’Abeille Lilloise, journal littéraire illustré où il signait ses articles des pseudonymes Vanvyrel ou Etienne Durand. Entré à L’Echo du Nord en 1867, il exerça d’abord les fonctions de secrétaire de rédaction, puis de rédacteur politique, il en devint rédacteur en chef en 1871, puis directeur-gérant à la mort de son propriétaire Alexandre Leleux en mai 1873. La police le décrit comme un « journaliste de talent ». Lors de la création d’une société en commandite en 1882, il partagea la direction du journal et de l’imprimerie avec Gustave Dubar qu’il avait embauché en 1871. Durant près de vingt-cinq ans, il dirigea ainsi le plus important journal de la région du Nord.
 Verly abandonna le journalisme en 1891 en laissant, toujours selon la police, « le souvenir d’un polémiste courtois, d’un journaliste de la meilleure école », et se consacra à la littérature, donnant encore, de temps en temps, des récits à son ancien journal . Il publia « plusieurs romans en vogue dans les Flandres sous le pseudonyme d’Etienne Durand ». Plusieurs journaux parisiens, Le Soir, La République française, L’Evènement les reprirent en feuilleton. Outre ses Souvenirs d’une vieille barbe politiques et pittoresques, où il a recueilli tous les évènements politiques importants de 1849 à 1889, qui eurent à Lille un retentissement, parmi toutes ses œuvres, on peut citer : Souvenir d’un canonnier lillois, Biographie lilloise, Spada-la-Rapière, Tablettes d’un bourgeois de Lille, De Flandre en Navarre et Zigzags en France, Histoires du pays flamand, Les Gens de la vieille roche, La Ville en feu, Les Contes flamands, Van Brabant et Compagnie, Toiles et sarraus.
Verly abandonna le journalisme en 1891 en laissant, toujours selon la police, « le souvenir d’un polémiste courtois, d’un journaliste de la meilleure école », et se consacra à la littérature, donnant encore, de temps en temps, des récits à son ancien journal . Il publia « plusieurs romans en vogue dans les Flandres sous le pseudonyme d’Etienne Durand ». Plusieurs journaux parisiens, Le Soir, La République française, L’Evènement les reprirent en feuilleton. Outre ses Souvenirs d’une vieille barbe politiques et pittoresques, où il a recueilli tous les évènements politiques importants de 1849 à 1889, qui eurent à Lille un retentissement, parmi toutes ses œuvres, on peut citer : Souvenir d’un canonnier lillois, Biographie lilloise, Spada-la-Rapière, Tablettes d’un bourgeois de Lille, De Flandre en Navarre et Zigzags en France, Histoires du pays flamand, Les Gens de la vieille roche, La Ville en feu, Les Contes flamands, Van Brabant et Compagnie, Toiles et sarraus.Verly fut l’un des fondateurs du Syndicat de la presse départementale. Voltairien, sans être partisan de la séparation des Eglises et l’Etat, il a été élu conseiller municipal, il le resta pendant trente ans. A ce titre, il fut président de la commission des musées, membre de la Commission administrative des Archives départementales. Très attaché à sa ville natale, il se fit, selon la police, « une spécialité de toutes les questions intéressant l’embellissement et la prospérité de Lille ». Verly fut le meilleur ami et l’exécuteur testamentaire du chansonnier Desrousseaux, qui, comme lui, n’eut pas de plus haute admiration que celle de la cité natale. Il a pris l’initiative du monument à élever à la gloire de l’auteur du P’tit Quinquin. Il fut également membre de la Commission historique du Nord, vice-président de la Société des sciences et de la Société de géographie. Il était chevalier de la Légion d’honneur depuis 1878.
Selon ses contemporains, Hippolyte Verly était « l’honnête homme, dans la suprême acception du mot, et l’une des gloires du département du Nord ».
Source(s) :AD Nord M 157/8; Albert Mundschau, «Hippolyte Verly», L’Abeille, n° 14, avril 2010, p. 1 et 7; Dictionnaire biographique illustré nord, 2e édition, Flammarion.
-
VERMERSCH Eugène
Fils d’un négociant lillois, Constant Joseph Vermersch, et de Pauline Virginie Schodduyn, Eugène Marie Joseph Vermersch est né le 13 août 1845. Après des études secondaires au collège libre de Marcq-en-Barœul, il est envoyé à Paris pour faire médecine, mais préfère bientôt la poésie et le journalisme.
Il publie une brochure, le Latium moderne , il écrit dans L’Echo de Lille, Le Peuple , participe au Journal populaire de Lille et de l’arrondissement lancé par Géry Legrand en 1863. A Paris, il devient correspondant du Progrès du Nord, collabore à La Fraternité. Parallèlement, il continue de publier diverses brochures. En 1866, il entre au Hanneton dont il devient directeur littéraire. En mai 1867, il est condamné comme directeur-gérant à huit jours de prison et 500 F d’amende pour outrage à la morale et aux bonnes mœurs. L’année suivante, à Lille, il est condamné à quinze jours de prison et 100 F d’amende pour publication d’articles incitant les militaires à la désobéissance. Selon Hippolyte Verly, il écrit dans de nombreuses revues: La Lune, L’Eclipse, Le Nain jaune, Le Bulletin international, La Vie parisienne, Le Satan, Le Corsaire…. Au début de la guerre franco-allemande, il est attaché au service des ambulances. Revenu à la vie civile, il collabore à La Marseillaise de Rochefort, puis au Cri du peuple de Jules Vallès. Le 6 mars 1871, il fonde avec Maxime Vuillaume et Alphonse Humbert Le Père Duchesne dans lequel il exige des mesures radicales pour le triomphe de la dictature populaire. Interdit le 9 mars, le journal reprend sa parution le 21 mars jusqu’au 23 mai 1871. Après la semaine sanglante, Eugène Vermersch se réfugie en Belgique puis au Pays-Bas où il est expulsé. Condamné à mort par contumace en novembre 1871, il rejoint Londres où il adhère à la section fédéraliste française de l’Internationale. Il fonde plusieurs journaux à l’existence éphémère: Qui vive! , Vermersch-Journal , L’union démocratique et L’Avenir . Il vit alors misérablement de conférences sur des sujets historiques et d’articles envoyés au Grelot dans lesquels il s’en prend à ses anciens camarades de la Commune.
En 1874, il part avec sa femme épousée en mars 1872 et son fils en Allemagne, puis en Suisse où se battant à plusieurs reprises en duel, ses démêlées se poursuivent. En juillet 1875, Vermersch regagne Londres. Souffrant de crises de démence, il finit par être placé dans un asile où il meurt le 9 octobre 1878.
Vermersch laisse une vingtaine de livres dont un roman inachevé L’Infamie humaine, publié en 1890 et préfacé par Paul Verlaine.
Source(s) :AD Nord, 5Mi 044 R 159; Georges Lepreux, Nos Journaux, Crépin, Douai, 1896; Hippolyte Verly, Essai de Biographie contemporaine lilloise, Leleu, Lille; Maitron, https://maitron.fr/pip.php?article72494, notice Vermersch Eugène, Marie, Joseph.
-
VERNEZ Henri
Journaliste, Henri Vernez était aussi poète. En 1910, la Société d’Emulation de Cambrai lui décerna une mention pour ses envois. Poète, mais « poète patriote » comme le qualifient, en 1915, Les Annales politiques et littéraires. Fut-il membre de la Ligue des patriotes fondée par Paul Déroulède ? En tout cas, il n’hésita pas à apporter son obole lorsque ce mouvement nationaliste lança des souscriptions pour soutenir sa propagande.
Fils d’un brigadier des douanes, Henri Vernez embrassa probablement la carrière militaire avant de devenir journaliste. Seul son livret militaire pourrait en faire foi, mais il nous est resté introuvable. Cependant, Vernez compte plus de neuf ans de service dans l’armée active, et plus de vingt-six dans la réserve qu’il quitta avec le grade de capitaine de cavalerie.
D’abord rédacteur en chef du trihebdomadaire L’Echo de Cambrai, journal républicain catholique (1888-1914), Henri Vernez passa au quotidien La République libérale édité à Arras à partir du 31 mai 1895. Il fut rapidement remplacé par Antoine Woisard, mais resta cependant collaborateur du journal pendant quelque temps. Par la suite, on le retrouve à L’Avenir des trois cantons, édité au Cateau à partir de novembre 1896, puis à L’Echo du peuple (ex-Echo de Cambrai).
Il quitta probablement le Nord durant ou après la Première Guerre. Domicilié à Ivry-sur-Seine, il prit une nouvelle orientation professionnelle, étant devenu employé d’un établissement bancaire. En 1924, il était nommé chevalier de la Légion d’honneur au titre du ministère de la Guerre. Henri Vernez avait épousé à Cambrai en premières noces Marie Antoinette Richard, morte en 1909, et en secondes noces Marguerite Henriette Bodin, cafetière, elle-même veuve.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 023 R 005, 3 E 6540 et 3 E 6806; Léonore, dossier de légionnaire;
Journal de la ville de Saint-Quentin, 26 juin 1892 et 12 octobre 1900; La République libérale, mai 1895; Le Guetteur de Saint-Quentin, 21 janvier 1898; Le Drapeau, 5 février 1910; Revue septentrionale, 7 janvier 1911.
-
VERNIER Carlos
Carlos Vernier commence sa carrière de journaliste au Propagateur du Nord et du Pas-de-Calais où il signe ses articles des pseudonymes de Paul Adam, Armand Duval ou Armand Dill. Il passe ensuite à L’Echo de Lille et collabore à L’Abeille lilloise d’Hippolyte Verly (1866-1868).
Source(s) :Georges Lepreux, Nos Journaux, Crépin, Douai, 1896.
-
VEROVE Pierre
Engagé dans la Marine nationale à 19 ans, Pierre Verove participe à l’évacuation de la poche de Dunkerque en 1940 et réussit à gagner l’Angleterre. Ce qui lui vaudra la Croix de guerre 39-45. Démobilisé en 1943, il regagne sa région. Il devient journaliste au Nord maritime. A la Libération, il entre à Nord Eclair à Roubaix. Revenu à Dunkerque, il rejoint la rédaction du Nouveau Nord . Après le rachat du quotidien dunkerquois par La Voix du Nord , il passe à la rédaction dunkerquoise du quotidien régional où il exerce jusqu’à sa retraite en 1978.
Source(s) :Michel Tomasek (dir.), Dictionnaire biographique dunkerquois, Société dunkerquoise d’histoire et d’archéologie, 2013, 1184 p.
-
VERPRAET Georges
Georges Verpraet commence sa carrière de journaliste en 1941 à Compagnon s, périodique du mouvement des Compagnons de France dont il devient rédacteur en chef. Il est ensuite nommé rédacteur en chef du journal Hardi, bulletin mensuel du groupement Mangin de Chantiers de jeunesse . Réfractaire au STO, il entre dans la clandestinité. En 1944, il intègre le quotidien L’Aube pour lequel il couvre la Libération de la France. Il travaille ensuite au Figaro, aux Echos, collabore à La Vie catholique et à Témoignage chrétien. En 1960, il rejoint La Voix du Nord où il est nommé secrétaire général, puis passe à La Croix du Nord . Georges Verpraet milite également dans différents syndicats et associations de journalistes. Parallèlement, proche de l’abbé Pierre, qu’il aida à rédiger son appel du 1 er février 1954, il est l’un des cofondateurs de l’association Emmaüs dont il devient le premier vice-président. Il participe également à la création du Secours d’urgence aux sans-logis. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages dont Paris, capitale souterraine, Métiers et visages de l’information moderne, L’Europe judiciaire ,…
Source(s) :Le Figaro, 7 avril 2010, Marine Coadic, «Inventaire des archives papier et iconographiques de Georges Verpraet», Institut d’histoire du temps présent
-
VERSCHAVE Luc
Luc Verschave était ce qu’on appelle un personnage, doté d’une bonne culture générale et d’un caractère bien trempé. Nœud papillon soigneusement choisi selon les circonstances, des yeux malicieux, le verbe haut, volontiers provocateur, il fut de ceux qui marquent une rédaction.
Après des études à l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, il commence sa carrière professionnelle au quotidien La Croix du Nord. Intégrant La Voix du Nord le 1 er octobre 1970,, il est affecté à la rédaction d’Etaples. En 1976, il regagne le siège à Lille où il suit les problèmes métropolitains. Parallèlement, il donne chaque semaine, pendant une dizaine d’années, une chronique à destination de ceux qu’on appelle alors le troisième âge. Spécialiste des questions religieuses, il suit une grande partie des nombreux voyages du pape Jean-Paul II à travers le monde. Attentif aux autres, toujours prêt à donner la main à son prochain, Luc Verschave milite d’abord à la section Voix du Nord du Syndicat national des journalistes, puis passe à la CFDT dont il est l’un des élus au conseil de rédaction créé en 1980. Il est également l’un des cofondateurs du Club de la presse du Nord-Pas-de-Calais et membre du conseil d’administration. Déplacé à la rédaction de Douai, il quitte La Voix du Nord en 1996. Marié en secondes noces avec une franco-australienne, il gagne l’Australie avec l’idée de créer un journal pour les Français travaillant dans ce pays. Ne réussissant pas à concrétiser son idée, il rentre en France et s’installe à Cannes où il meurt en février 2008, âgé d’à peine 60 ans.
-
VERSCHAVE Paul
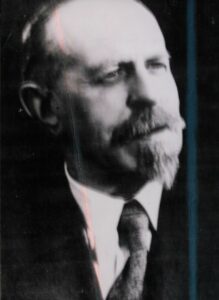
Paul Verschave ne fut ni journaliste, ni patron de presse, pourtant son nom restera à jamais graver dans l’histoire de la presse française. Malgré le scepticisme des professionnels et des universitaires, il fut en effet le fondateur et le premier directeur de l’Ecole de journalisme de Lille, un établissement centenaire qui rayonne toujours en France et dans de nombreux pays étrangers
Né en 1878 à Warhem, Paul Verschave, après ses études secondaires au collège Saint-Winoc de Bergues, entre à la faculté de droit de l’Université catholique de Lille. Docteur en droit après une thèse sur l’enseignement en Hollande, pays dont il maîtrise la langue, il devient maître de conférence dans cette université, puis professeur de droit administratif. Lorsqu’en novembre 1924, l’Association des cardinaux et archevêques de France décide la création d’une section de journalisme à la Catho de Lille, c’est à Paul Verschave qu’elle en confie la direction. Grâce à sa «ténacité toute flamande», son «désintéressement admirable» et un «labeur incessant», cette section devient une école à part entière dont la réputation dépasse la région du Nord. De trois étudiants lors de sa première rentrée, elle en accueille près d’une centaine quelque dix ans plus tard et reste un exemple unique en Europe. En 1936, Paul Verschave est ainsi amené à présider, à Rome, l’exposition internationale de la presse catholique. Deux ans plus tard, le pape Pie XI le fait commandeur de Grégoire le Grand.
Communément appelé par ses étudiants «le patron» ou «le P’tit Père», Paul Verschave dirige l’Ecole supérieure de Journalisme jusqu’à sa mort en décembre 1947 à la suite d’une intervention chirurgicale.
Faisant preuve d’une activité débordante, ce spécialiste des questions agricoles était notamment président de l’Entraide rurale, de l’Union nationale des caisses de crédit agricole, du Comité flamand de France. Gardant des attaches avec sa commune natale, il en fut conseiller municipal. Il était également l’auteur de plusieurs ouvrages.
Source(s) :La Croix du Nord, 3 juillet 1938 et 19 décembre 1947.
-
VILLAIN
Villain est secrétaire de rédaction au Grand Echo du Nord en 1929.
Source(s) :ADN, M149/142.
-
VITON DE THORAME Camille
Fils de Théodore Victor Joseph Viton de Thorame, propriétaire, et d’Elisa Frédérique Mesnil, Jean François Camille Viton de Thorame naît le 23 septembre 1843 à Dignes-les-Bains dans les Basses-Alpes (Alpes de Haute-Provence).
Il est d’abord employé de banque, puis devient journaliste. Il est notamment rédacteur en chef de L’Express du Nord et du Pas-de-Calais édité à Boulogne-sur-Mer qu’il quitte en 1890 pour prendre les mêmes fonctions au Mémorial de l’Allier. Le 21 janvier 1891, il est nommé directeur politique de L’Echo de la Frontière où il succède à l’avocat Charles Mabille. Il y reste jusqu’à la cessation de parution du périodique valenciennois, le 29 septembre 1894. Par la suite, il est nommé directeur du Semeur algérois et meurt le 9 janvier 1922 à Alger.
Source(s) :L’Echo de la Frontière, 12 février 1891; L’Express du Nord et du Pas-de-Calais, 21 février 1891; Le Semeur algérois, 10 janvier 1922.
-
VOLMERANGE Guy
Ancien élève de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, Guy Volmerange commence sa carrière de journaliste à La Voix du Nord. Il devient par la suite rédacteur en chef du trihebdomadaire L’Aisne nouvelle qu’il quitte à la fin des années 1970 .
Source(s) :Jean-Paul Visse, Ces Voix des Hauts-de-France. Les Quotidiens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie depuis la Libération, Société des Amis de Panckoucke, 2021.
-
VOLMERANGE Philippe
Ancien élève de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille, Philippe Volmerange commence sa carrière de journaliste à Nord Presse . Après la disparition de cet éphémère hebdomadaire, il entre, le 1 er juillet 1954, à la rédaction tourquennoise de Nord Eclair. Cofondateur avec les journalistes André Caudron, Maurice Monnoyer et René Verkrusse en juillet 1966 de la Société des journalistes de Nord Eclair , il en devient président.
Source(s) :Jean-Paul Visse, op. cit.
-
VRIGNAULT Charles
Né à Lorient le 6 mars 1834 d’un père négociant et adjoint au maire de la ville, Charles Alphonse Vrignault est nommé rédacteur en chef du journal catholique Le Mémorial des Pyrénées édité à Pau. En 1867, il rejoint Arras pour préparer la sortie, le 16 avril, d’un nouveau quotidien L’Ordre dont il assure la rédaction en chef. Quelques mois plus tard, le journal est assigné pour avoir publié un article rendant compte des séances du Corps législatif. S’il est acquitté par le tribunal d’Arras, ce premier passage devant la Justice ouvre une série de procès qui jalonnent l’histoire du journal: en mars 1868, Vrignault est condamné à 1 000 francs d’amende, en mai à 200 francs. En juillet, bien que défendu par Léon Gambetta, il est condamné, ainsi que Gustave Masure, rédacteur en chef du Progrès du Nord , à deux mois de prison et 500 francs d’amende. Les deux journalistes font appel, mais le jugement est confirmé par la cour de Douai. Ces procès n’empêchent pas Vrignault de s’associer à la souscription lancée pour l’érection d’un monument à Baudin, tué le 3 décembre 1851 en tentant de soulever le peuple contre le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Ces procès ont-ils effrayé le directeur du journal? Vrignault est envoyé dans la capitale pour couvrir les élections législatives partielles de novembre et le 25 décembre, les lecteurs de l’Ordre apprennent qu’à partir du 1 er janvier 1870, M. Charles Vrignault sera «complétement étranger à la rédaction du journal». Dès avril 1870, il prend la direction du Progrès libéral de Toulouse . En septembre 1870, il est nommé préfet de l’Aude, mais préfère rester auprès de Gambetta au ministère de l’Intérieur jusqu’à sa démission en février 1871. Dès mars, il participe, à Paris, au lancement du Bien public , dont son frère Henri est rédacteur en chef. Edouard Drumont évoquera les conditions d’existence de ce quotidien dans l’article nécrologique qu’il consacre à Charles Vrignault.
Souffrant d’une phtisie depuis plusieurs mois, il part se reposer à Trouville et ne regagne Paris que pour y mourir à l’âge de 37 ans le 20 septembre 1872.
Source(s) :AD Morbihan, AML 2MI8.0005; Archives de Paris, V4E 3382; Le Bien public, 22 septembre 1872, J.-P. Visse, La Presse arrageoise, 1788-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2009, p. 298-301.,
S – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais W
-
WACQUEZ-LALO Auguste Victor
Bien que né à Sedan dans les Ardennes le 18 mai 1816, Auguste Victor Wacquez appartient à une vieille famille lilloise. Revenu dans la capitale des Flandres, il y effectue ses études avant de les poursuivre à Paris. Il séjourne pendant plusieurs années en Allemagne, notamment à Stuttgart, Augsbourg et à Munich. Dans ces deux villes, il publie en allemand plusieurs études dans le Morgenblatt et dans La Gazette de Augsbourg. De retour à Lille, Auguste Victor Wacquez crée, en 1848, avec Million le Club du peuple et fonde un quotidien Le Peuple, journal républicain des intérêts du Nord qui paraît du 19 au 22 mars. Il entre alors à L’Echo du Nord comme rédacteur, puis passe au Messager du Nord, journal démocratique du Nord , lancé le 23 mai 1846 par Auguste Bianchi. En mai 1850, il fonde un journal littéraire, L’Artiste, qui cesse de paraître en 1852. Wacquez abandonne alors le journalisme. Il se consacre à l’écriture d’ouvrages pédagogiques et à des travaux de géographie qui feront sa renommée: Essai sur l’enseignement primaire basé sur l’analyse (1867) ; Géographie primaire physique et politique de la France (1869); Monsieur Curieux, dit pourquoi; Programme de géographie primaire ; Description de la France murale selon la réforme géographique (1876); Géographie descriptive du département du Nord (1884)… Homme engagé, Wacquez-Lalo est membre du Parti ouvrier. En 1892, il est élu maire de Loos-les-Lille. «M. Wacquez-Lalo, dont les opinions républicaines avaient été très avancées, écrit Le Grand Echo lors de sa mort, se montra un adepte fervent des doctrines radicales-socialistes.» A la suite des dissentions au sein de la majorité municipale, il démissionne en 1893.
Malade, ne pouvant plus travailler pour vivre, il avait notamment perdu un œil, il se suicide avec son épouse par asphyxie dans la nuit du 30 au 31 décembre 1893. Cette dernière, qui jusqu’à la fin lui a tenu de secrétaire, peut être sauvée, mais ce n’est pas le cas pour Wacquez-Lalo .
Il était le frère du peintre graveur Adolphe Antoine Wacquez.
Source(s) :AD Ardennes; Hippolyte Verly, Essai de biographie contemporaine lilloise, Leleu, Lille, 1869; Georges Lepreux, Nos Journaux, Crépin, Douai 1896; Le Grand Echo du Nord, 31 décembre 1893.
-
WAGNER Jean
Licencié en anglais, ancien journaliste à l’Agence France Presse, qu’il avait quittée en 1987, Jean Wagner a été l’une des plumes de Jazz Magazine et a tenu pendant longtemps la chronique jazz de l’hebdomadaire Télérama . Il était notamment l’auteur du Guide du jazz, initiation à l’histoire et l’esthétique du jazz (1986), dont la cinquième édition venait de paraître aux éditions Syros. Préoccupé par les relations entre le jazz et la politique, ce défenseur d’un «jazz moderne» avait publié, dans les années 70, dans Jazz Magazine des interviews qui ont fait date avec Charlie Mingus et Jackie McLean notamment. Avec Frank Ténot et Daniel Filipacchi, il avait publié en 1964 Mais oui, vous comprenez le jazz aux Éditions du Jour/Paul Legrain. Spécialiste du cinéma américain, ce collaborateur des Cahiers du cinéma avait consacré des ouvrages notamment à Anthony Mann, Nicholas Ray (éditions Rivages) et publié une Anthologie du cinéma . Il était également l’auteur d’un essai sur Jean-Pierre Melville (Seghers). Jean Wagner avait publié des poèmes et plusieurs romans : Khamsin (1971, Éditeurs français Réunis), La Ballade du nègre blanc (1987, Robert Laffont), Scénario pour une inconnue (1990, Jean Picollec), Un Jour dans la vie (1995, Le temps des cerises). Domicilié à Malakoff (Hauts-de-Seine), Jean Wagner avait été victime en 1996 d’une attaque cérébrale qui l’avait considérablement diminué.
Source(s) :L’Humanité, Nécrologie.
-
WALTZ Emile
Fils de Lehman Waltz, instituteur, et d’Odile Levy, Emile Waltz est né à Colmar le 22 août 1848. Après la guerre de 1870, il fait partie des Alsaciens qui optent pour la France. Il se lance dans le journalisme où on le retrouve notamment dans le Maine-et-Loire comme directeur du Patriote . En décembre 1879, il succède à Gustave Lhotte comme rédacteur en chef du périodique douaisien, L’Ami du peuple.
Emile Waltz ne fait qu’un très bref séjour à Douai et n’a guère le temps de marquer le journal des frères Crépin de son empreinte, puisqu’il est nommé sous-préfet de Ruffec en Charente dès le mois de janvier 1880. Sa carrière préfectorale le mène successivement à Arcis-sur-Aube, Dax, Gray en Haute-Savoie qu’il quitte pour Saint-Claude dans le Jura. De retour à Gray, il y reste jusqu’au 12 octobre 1901 où il est nommé sous-préfet honoraire.
Officier de l’Instruction publique, il meurt le 17 janvier 1904 à Neufchâteau dans les Vosges.
Source(s) :L’Ami du peuple, décembre 1879; La, Gazette de Douai, janvier 1880; AN, F/1Bl, F/4-F/1bl/530.
-
WASTELIER DU PARC Léon
Si le barreau a souvent mené à la politique, il a aussi conduit au journalisme. Ce fut ainsi le cas pour Léon Wastelier du Parc.
Fils de Henry Wastelier du Parc, sous-préfet de Saint-Pol-sur-Ternoise, Léon Wastelier du Parc naît dans cette ville le 11 juin 1867. Après des études à la faculté de droit de Douai, il devient avocat.
Au début des années 1920, Léon Wastelier du Parc préfère le journalisme au barreau. Il est correspondant douaisien du quotidien conservateur lillois La Dépêche. Lors du retour de l’hebdomadaire douaisien La Scarpe , en 1925, il en est le rédacteur. En 1934,il participe à l’aventure du mensuel Nord . Léon Wastelier du Parc meurt à 76 ans le 11 novembre 1943. Il était également l’auteur de l’ouvrage Souvenirs d’un réfugié Douai-Lille-Paris-Boulogne-sur-Mer , un recueil des notes qu’il a prises depuis l’occupation de Douai par les Allemands paru en 1916.
Source(s) :Jean-Paul Visse, La Presse douaisienne 1790-1940, Société des Amis de Panckoucke, 2017.
-
WELLHOFF Bernard
Parisien d’origine, Bernard Wellhoff, fils de négociant, effectua l’essentiel de sa carrière professionnelle à Lille. Engagé volontaire au 93e RI de La Roche-sur-Yon pour cinq ans à partir de novembre 1873, il aurait par la suite, selon ses détracteurs, exercé différents métiers : commis en soie, surveillant de verrerie, voyageur en droguerie, fabricant de glycérine, ingénieur en Amérique… Dans son dossier de Légion d’honneur, il se dit secrétaire général du quotidien La Justice, fondé à Paris par Georges Clemenceau, de 1894 à 1896.
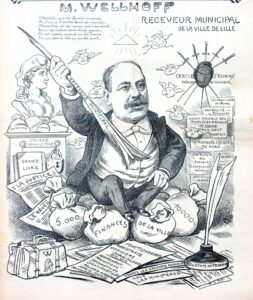 Cependant, il est déjà installé à Lille puisque, selon les mêmes renseignements fournis par lui-même, il fonde la section lilloise de l’Union française de la jeunesse le 7 juillet 1885. Il est également l’initiateur de plusieurs associations : la Société de patronage des aveugles de la région Nord, des patronages laïques du Nord… et fonde de nombreuses mutuelles : l’Union de Lille qui ne comptera pas moins de 5 000 adhérents, La Paix de Roubaix 4 000, mais aussi L’Avenir, La Coopérative vinicole de Lille. Autant d’activités qui lui valent la médaille d’honneur de la Société d’encouragement au progrès. Initié à la loge « La Fidélité » en 1885, il en devient vénérable. Son influence supposée dans les milieux militaires lui vaut le surnom, par La Croix du Nord, de « colonel civil du 43e de ligne », ou de « colonel gris » selon d’autres.
Cependant, il est déjà installé à Lille puisque, selon les mêmes renseignements fournis par lui-même, il fonde la section lilloise de l’Union française de la jeunesse le 7 juillet 1885. Il est également l’initiateur de plusieurs associations : la Société de patronage des aveugles de la région Nord, des patronages laïques du Nord… et fonde de nombreuses mutuelles : l’Union de Lille qui ne comptera pas moins de 5 000 adhérents, La Paix de Roubaix 4 000, mais aussi L’Avenir, La Coopérative vinicole de Lille. Autant d’activités qui lui valent la médaille d’honneur de la Société d’encouragement au progrès. Initié à la loge « La Fidélité » en 1885, il en devient vénérable. Son influence supposée dans les milieux militaires lui vaut le surnom, par La Croix du Nord, de « colonel civil du 43e de ligne », ou de « colonel gris » selon d’autres.Professionnellement, Bernard Wellhoff est directeur des finances et du contrôle à la mairie de Lille avant de devenir, en 1899, receveur municipal, fonction qu’il occupe pendant plus de vingt ans. A ce titre, il fonde l’Union amicale des receveurs spéciaux de France. Resté à Lille pendant la Première Guerre, il réussit, selon Le Petit Bleu de Paris, « à soustraire à la rapacité des Allemands une somme de deux millions qu’il eut la joie de sortir intacts d’une cachette lors de la délivrance de Lille ». Membre du Parti ouvrier français, Wellhoff se lie d’amitié avec Gustave Delory et Edouard Delesalle. En 1889, il participe à la fondation du Réveil du Nord dont il est administrateur. Après la guerre, il se fixe à Paris, ce qui ne l’empêche pas de participer à la création du quotidien socialiste lillois Le Cri du Nord et des régions libérées, organe d’union socialiste et d’en être administrateur jusqu’à sa disparition en 1921.
De 1919 à 1922, il est grand maître de la Grande Loge de France, puis trésorier en 1927-1928. Nommé chevalier de la Légion d’honneur en 1912, il est élevé au grade d’officier en 1919.
Source(s) :Site Léonore, dossier de légionnaire; La Volonté, 10 avril 1907; Le Petit Bleu de Paris, 20 février 1919; La Croix du Nord, 20 septembre 1926; Le Populaire, 27 novembre 1932.
-
WILFART Claude
Ancien chef du service des ventes de Nord Éclair , Claude Wilfart s’est éteint lundi 21 avril 2009, à l’âge de 71 ans. Le 31 mai 1993, il a quitté pour la dernière fois son bureau à Nord-Éclair . À cinquante-six ans, il avait décidé de mettre un terme à sa carrière au sein du quotidien, commencée le 1 er septembre 1960, en tant qu’attaché commercial. À l’époque, il n’a que vingt-trois ans. Une petite vingtaine d’années plus tard, au début des années quatre-vingt, grâce à ses qualités professionnelles, Claude Wilfart devient le chef du service des ventes du journal.
Source(s) :Nord Éclair, 24 avril 2009.
-
WILL Alex
Pseudonyme d’Eugène Guillaume.
-
WILLIOT-PETIT Gustave
Fils de Benoît Willot, tisseur, et d’Elisa Mairesse, fileuse, Gustave Willot naît le 10 janvier 1853 à Haussy dans le Cambrésis. Archiviste du 1 er Corps d’Armée, Gustave Williot donne sa démission en janvier 1879 après des démêlées. Le 25 mai 1888, il épouse à Lille la fille de l’imprimeur Jules César Joseph Petit, Marie Berthe Petit, âgée de 26 ans. Il prend alors le nom de Willot-Petit. Après la mort de son beau-père, Jules Petit, en décembre 1888, et le départ de son beau-frère, Jules Petit-Ragot, en février 1889, il assume la direction du Courrier populaire et de l’imprimerie. Williot-Petit semble d’ailleurs l’homme à tout faire du journal comme le remarque en 1895la police : « Le Courrier populaire n’a pas d’organisation intérieure, ni de personnel de rédaction». En 1897, elle note que: «la rédaction de ce journal se fait à coup de ciseaux, il n’a d’autre rédacteur que son propriétaire M. Williot-Petit qui s’occupe des questions de mutualité». Pourtant, on trouve dans d’autres périodiques la mention de rédacteurs travaillant au Courrier Populaire. Examinant la politique suivie par le journal, la police conclut qu’elle n’est pas sérieuse.
Source(s) :AD Nord, 1Mi EC 350 R 075; 1T 222 /18.
-
WILLOX Anatole
Fils de Jean-Baptiste César Willox et d’Adélaïde Eugénie Labarre, Anatole Willox est nommé rédacteur en chef du Courrier du Nord à Valenciennes en mai 1876. Il quitte le trihebdomadaire valenciennois en mai 1880. De cette expérience, il livre, en 1883, un témoignage précieux et rare, mais particulièrement désabusé sur le travail d’un rédacteur dans une sous-préfecture de province. Cet ouvrage, Le Journalisme en province, sera réédité plusieursx fois et notamment en 1897 par l’imprimerie de La Tribune du Nord de Fourmies. Par la suite, Anatole Willox est rédacteur en chef du Glaneur de Saint-Quentin qu’il quitte en octobre 1890 pour Le Progrès de la Meuse à Verdun. «On trouvait en lui, écrit à cette occasion Le Guetteur de Saint-Quentin, un confrère qui honorait la presse locale et contribuait à relever la dignité des journalistes, si compromise par des individus sans principes, sans respect d’eux-mêmes et de leurs lecteurs.»
Le journalisme menant à tout à condition d’en sortir, il entame ensuite une carrière de diplomate. On le retrouve notamment consul de France à Séville jusqu’en 1913 où il est mis en disponibilité.
Il est l’auteur de deux autres ouvrages Conscience nouvelle et Discordances parus respectivement en 1906 et 1907.
Source(s) :BM Lille, Fonds Humbert; Le Courrier du Nord; Le Guetteur de Saint-Quentin et de l’Aisne, 1er octobre 1890; Le Grand Echo du Nord, 3 août 1911; Journal de la ville de Saint-Quentin, 26 septembre 1913.
Z
-
ZANDYCK Sophie Thérèse Clara
Fille de Henri Joseph Zandyck, médecin, et de Sophie Anne Jacqueline Godeffroy, Sophie Thérèse Clara Zandyck naît à Dunkerque le 5 août 1823. Rentière, elle épouse le 1 er août 1843, dans cette même ville, Benjamin Kien, avocat et imprimeur. A sa mort en 1863, elle lui succède à la tête de l’imprimerie et à la gérance du journal dunkerquois L’Autorité. En 1882, elle les cède à C. Baudelet. L’Autorité prend alors le titre de La Flandre. Mme Kien meurt quelques années plus tard, en 1887.
Source(s) :AD Nord, 5 Mi 027 R003 et 5 Mi 027 R051.,
N – O – dictionnaire biographique des journalistes et hommes de presse du Nord Pas-de-Calais

Comment contribuer?
▼RÉDACTION D'UNE NOTICE
en Times New Roman, corps 12
En suivant :
(Pour les femmes : nom et prénom de naissance, suivis du nom marital)
Texte courant :
Le texte doit comporter plusieurs paragraphes dès qu'il dépasse cinq lignes (5 à 600 signes).
Les noms de journaux et d'ouvrages sont en italiques.
Les sigles, peu usuels, doivent être explicités lors d'une première utilisation.
Le texte est signé des initiales en majuscules de l'auteur, fer à droite. Le nom complet de l'auteur figurera dans la rubrique « contributeurs ».
Photo :
Chaque notice peut être illustrée d'une photo ou d'un dessin représentant la personne qui fait l'objet de cette notice (format JPEG, 300 Dpi). Cette illustration doit être libre de droit. Si elle n'est pas dans le domaine publique, l'auteur de la notice s'engage à fournir l'autorisation de l'utiliser de la part du fonds qui la détient et de l'auteur du cliché. La source de cette illustration doit être précisée.
Sources (en Times New Roman, corps 10) :
L'ordre des sources qui ont permis la rédaction de la notice est le suivant : fonds d'archives (lieu et cote), journaux avec date de parution de la référence, ouvrages (Nom de l'auteur, titre en italiques, lieu et date d'édition.
Sont utilisées les abréviations suivantes : AN (Archives nationales), AD (Archives départementales) + nom du département, AM (Archives municipales) + nom de la ville, Arch. diocésaines + nom de la ville.
COMPLÉMENTS DE NOTICE
La source des compléments devra être indiquée.
À moins que les compléments soient particulièrement conséquents, les initiales de la personne qui les a envoyés ne figureront pas sous la notice, mais son nom figurera dans la liste des contributeurs.
NOTICES ET COMPLÉMENTS SONT À ENVOYER À
labeille5962@orange.fr
L'auteur doit clairement indiquer ses nom, prénom, adresse mail et n° de téléphone (portable).
Les notices ou compléments seront revus par notre modérateur éditorial avant publication.
Ils sont susceptibles d'être aménagés, voire refusés s'ils ne répondent pas aux critères retenus par la Société des Amis de Panckoucke.